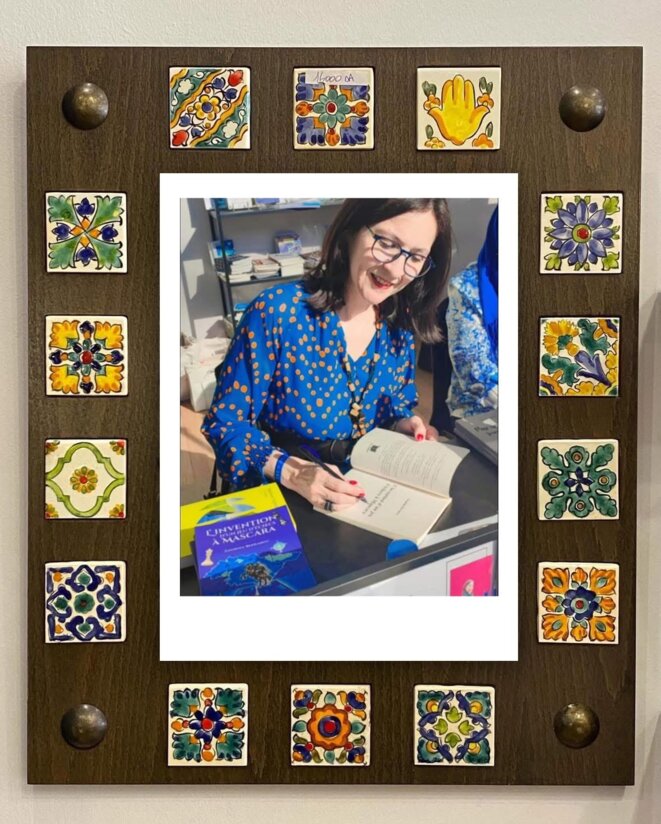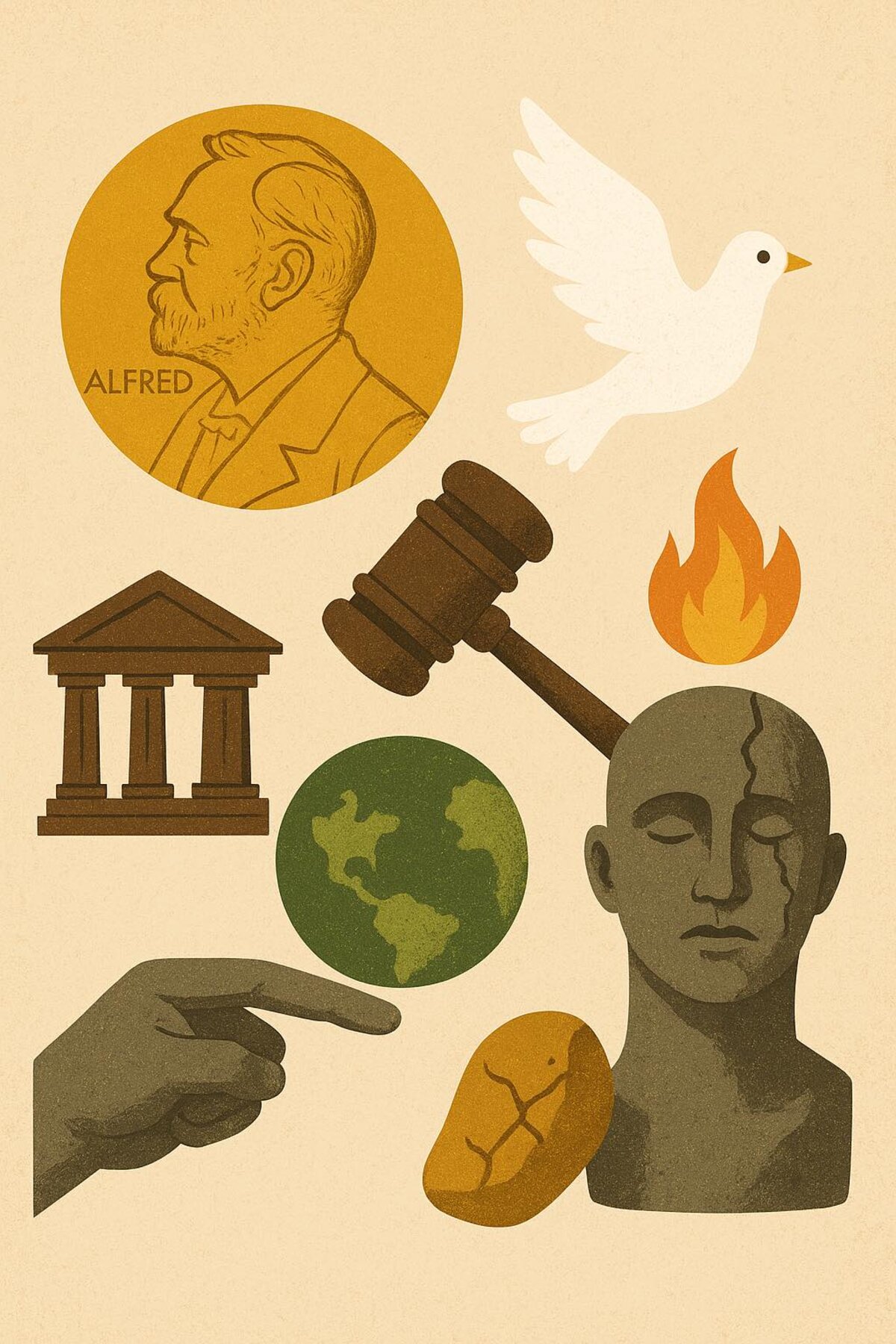
Agrandissement : Illustration 1
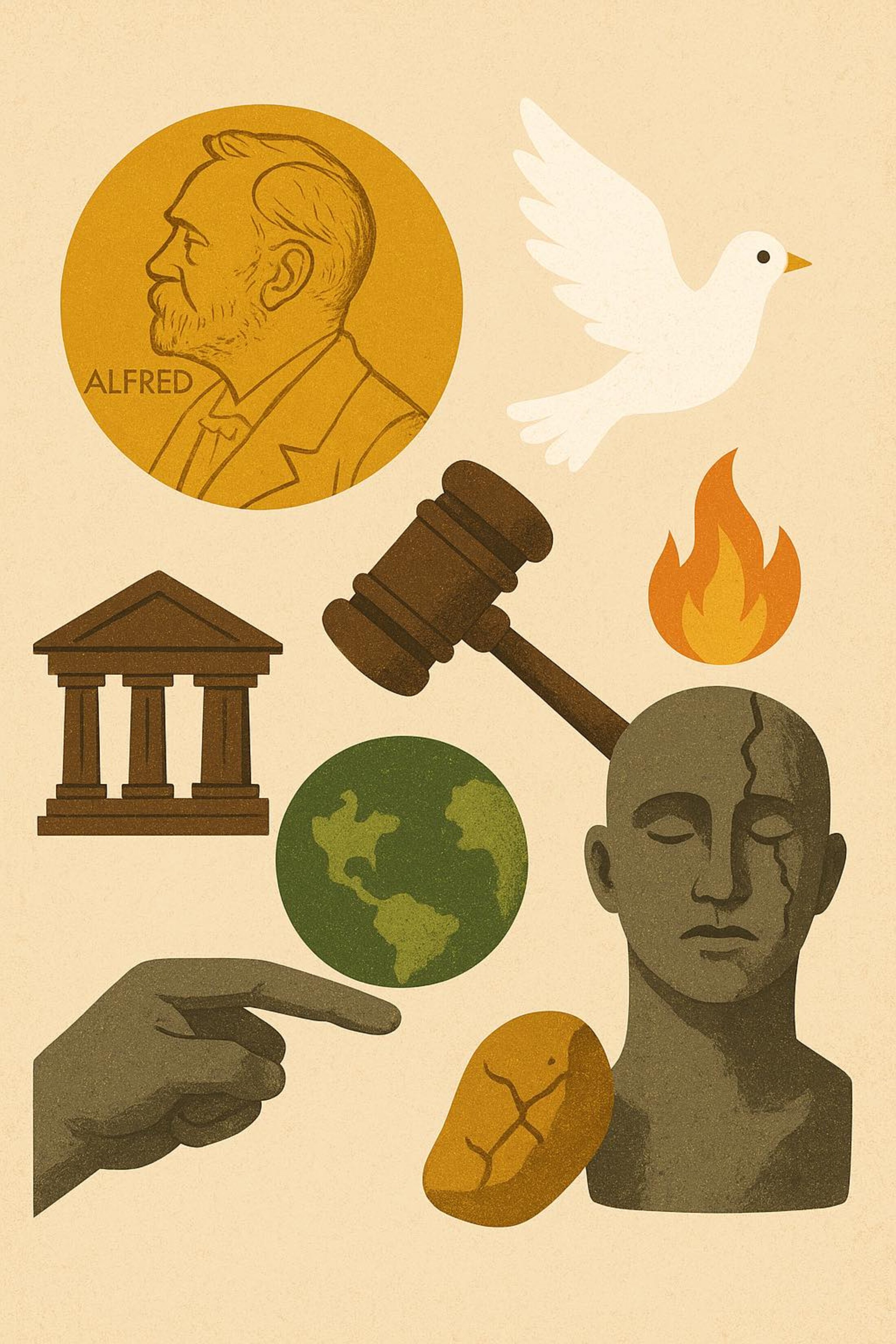
Le prix Nobel de la paix 2025 a été attribué à une opposante vénézuélienne, née un 7 octobre.
Le hasard, parfois, a le goût amer de la symbolique.
Car depuis deux ans, le 7 octobre est devenu le point de bascule d’un monde qui vacille entre mémoire et cécité.
Ce jour-là, on a crié à la barbarie.
Mais depuis, l’horreur s’est prolongée, démultipliée, industrialisée et l’on n’a plus rien dit.
Deux ans de bombes, de famine, de silences.
Deux ans où ceux qui défendent la vie, les médecins, les humanitaires, les bénévoles, n’ont reçu ni prix, ni hommage, ni merci.
Et voilà qu’aujourd’hui, on célèbre une “lutte pour la démocratie” à Caracas, comme pour détourner le regard de Gaza( casse).
On parle de paix là où il reste confortable d’en parler.
On décore la vertu là où elle ne dérange pas les marchés.
Le Nobel de la paix regarde du côté des puissants , il préfère les discours propres, les visages présentables, les causes à bonne distance des ruines.
Mais ce 7 octobre qui revient par hasard dans l’actualité, c’est comme une cicatrice qui refuse de se refermer.
Il vient rappeler que le monde a choisi son camp : celui des affaires, pas de la justice.
Celui des alliances, pas de la compassion.
Alors oui, récompenser le combat pour la démocratie, c’est une chose noble, nécessaire, courageuse.
Mais de quelle démocratie parle-t-on ?
Si c’est pour vouloir d’un Venezuela qui ressemble à Israël : une démocratie qui bombarde, colonise et bafoue le droit international , alors le mot perd tout son sens.
On ne peut pas célébrer la démocratie là où elle sert d’alibi à la domination.
Il y a une crise profonde du mot lui-même : la démocratie s’est dévoyée, elle est devenue un instrument de pouvoir, pas un idéal de justice.
Avant de l’honorer, il faudrait peut-être la retrouver.
Parce qu’elle s’est perdue , quelque part entre les lobbies, les marchés et les urnes désertées.
L’Amérique doute, l’Europe dérive, la finance gouverne et les extrêmes droites prospèrent.
La démocratie n’est plus un idéal, c’est une marque.
Et la paix, dans tout ça, n’est plus qu’un logo de plus sur l’étagère des illusions.
Alors oui, à ce stade, on a presque donné le Nobel à Trump car la récipiendaire Maria Corina Machado est souvent présentée comme une “Margaret Thatcher vénézuélienne” : “sa doctrine s'inscrit dans un libéralisme dogmatique. Elle incarne une opposition vénézuélienne issue des sphères aisées.
Elle se réclame d’un libéralisme assumé, proche du modèle américain du libre-échange et de la démocratie de marché , cette même démocratie qui confond souvent puissance économique et vertu morale.
Car récompenser une vision du monde libérale, hiérarchisée, centrée sur le pouvoir et l’économie, c’est déjà prolonger la logique de Trump.
C’est habiller le pragmatisme en vertu, le calcul en morale, l’oubli en paix.
Le Nobel de la paix n’a pas récompensé la paix.
Il a consacré le silence.
Et ce silence-là résonne plus fort que toutes les bombes.