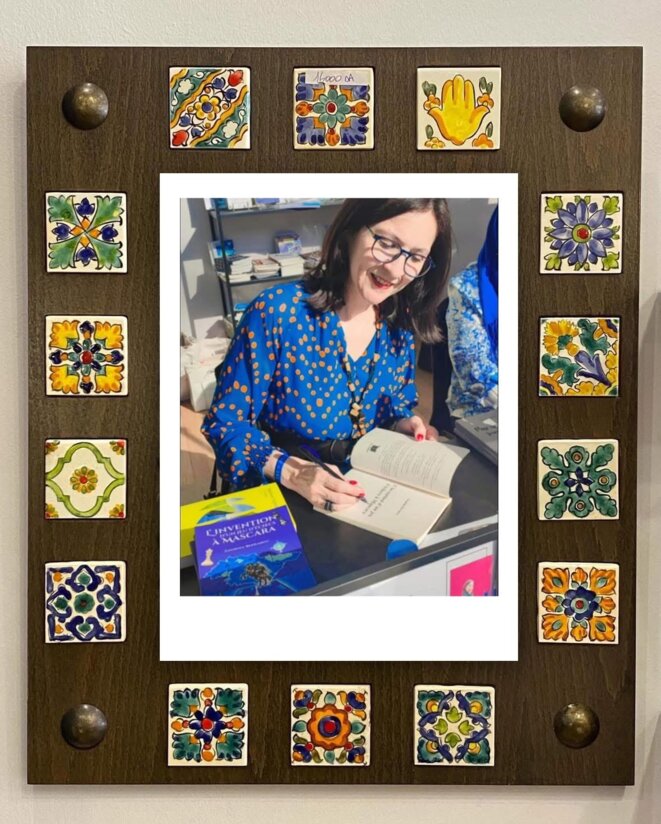Agrandissement : Illustration 1

Chronique d’une oracle littéraire :
Je ne sais pas si ce que je vais dire a une quelconque valeur, mais je veux croire — oui, croire — que le prochain prix Goncourt reviendra à Natacha Appanah pour La nuit au cœur.
Je ne l’ai pas encore lu, ce roman. J’ai seulement lu les résumés, écouté les entretiens, observé le visage de l’autrice : cette douceur lucide, cette façon de parler du silence et de la douleur. Quelque chose en moi s’est arrêté net. Une vibration. Un signe.
Et si je ne l’ai pas lu, c’est pour une raison simple — et un peu superstitieuse. Après le Goncourt de l’an dernier, j’ai été dégoûtée. L’affaire n’est toujours pas close, la justice pas rendue, et je n’ai pas envie de me réconcilier avec une littérature française qui m’a trahie. Alors cette année, je me suis tenue à l’écart.
L’an dernier, j’ai lu Houris, c’était tellement mauvais que j’étais persuadée que ce roman n’aurait pas le Goncourt, et pourtant, il l’a eu. Alors cette fois, je préfère ne rien lire du tout. Si je lis et que je trouve ça mauvais, ce livre aura peut-être le Goncourt . Si je trouve ça bon, il ne l’aura sûrement pas. Mieux vaut laisser les signes parler — et ne pas contrarier la prédiction.
Ce roman est une histoire de violences conjugales, de féminicides, de faits divers, mais derrière cela, autre chose murmure. L’une des héroïnes s’appelle Chahinez Daoud, victime d’un féminicide. Son père, Kamel Daoud — homonyme de l’écrivain. Mais le nom et prénom résonnent. Ils appellent des ombres.
Les échos d’un autre Goncourt
Dans le roman, cette résonance n’est pas anodine. Natacha Appanah écrit :
« Mes filles ont choisi leur mari, comme elles choisissent si elles veulent porter le voile ou pas », déclare Kamel Daoud.
"Kamel et Djohar Daoud sont arrivés en juillet 2021 en France, lâchant une vie entière en Algérie"
Dans ce roman, ce Kamel Daoud-là tient un rapport apaisé au voile, un rapport de liberté tranquille.
Alors que dans la réalité, l’écrivain Kamel Daoud entretient avec ce symbole un rapport nerveux, méfiant, presque obsessionnel — le signe d’une oppression qu’il combat, d’autant plus violemment qu’il vient d’un milieu où toutes les femmes de sa famille le portent.
Cette simple phrase du livre agit donc comme une dissonance — ou plutôt une réplique inversée.
Le voile devient ici un miroir : ce que la fiction apaise, la réalité le tend.
Comment ne pas penser à Kamel Daoud, l’écrivain, celui du Goncourt 2024 avec Houris ?
Et c’est là que mon intuition s’enclenche.
Je ne crois pas au hasard des noms, encore moins à celui des résonances.
Autour de l’écrivain gravitent trois femmes, trois blessures :
• Saâda Arbane, la citoyenne algérienne qui l’a assigné en justice ;
• son épouse, psychiatre de Saâda, accusée d’avoir transmis à l’écrivain le dossier médical de sa patiente ;
• son ex-femme, en Algérie, qui avait dénoncé des violences conjugales avant d’être réduite au silence.
Trois femmes, trois douleurs, trois silences.
Et dans La Nuit au cœur, il y a aussi trois femmes.
Alors forcément, ça résonne.
Et ce n’est pas tout : le Goncourt 2024 n’est pas clos.
L’écrivain qui l’a remporté a été assigné en justice, et le verdict n’est pas encore tombé.
C’est un Goncourt Cold Case, une affaire en suspens, une ombre portée sur la littérature.
Et voilà que, dans le roman de Natacha Appanah, surgit un père nommé Kamel Daoud.
Le simple fait que ce nom circule de nouveau dans un livre Gallimard, un an après Houris, agit comme un rappel inconscient, un écho involontaire.
Comme si l’algorithme invisible de la littérature recomposait ses motifs à l’aveugle, rejouant le même refrain jusqu’à la réparation.
Trois femmes, trois miroirs d’une même emprise.
Ainsi, ce que Natacha Appanah raconte dans la fiction — la souffrance des femmes, la répétition de la violence — semble répondre, malgré elle, à ce que la réalité s’efforce encore de taire.
L’énigme des couvertures
Détail troublant : la couverture du roman de Natacha Appanah aurait pu être celle d’Houris.
Chez Kamel Daoud, le titre invoquait la femme promise du paradis — houris, ces nymphes éternelles de l’imaginaire islamique. La couverture ne l'a pas représenté.
Et voilà que la jaquette d’Appanah expose ce motif , , une figure féminine auréolée d’un éclat paradisiaque.
Comme si, sans le vouloir, le nouveau roman corrigeait visuellement à celui de l'an passé.
Une imagerie en miroir, un écho de femmes promises et perdues.
La couverture d’Appanah aurait pu être celle de Houris. C’est dire à quel point la coïncidence devient vertige.
L’algorithme humain
Un programmeur a conçu un algorithme capable de prédire les lauréats du Goncourt en analysant bases de données, apparitions médiatiques et statistiques éditoriales.
Il a vu juste pour 2023 et 2024.
Et moi, face à ces chiffres froids, j’invoque un autre algorithme — humain, intuitif, poétique.
Mon Sherlock Holmes intérieur relie les signes, les visages, les silences.
Et tout me mène à Natacha Appanah : présence discrète mais constante dans les médias, autrice Gallimard (machine à Goncourt bien huilée), thème social brûlant, miroir d’un scandale encore tiède.
Les silences de la littérature française
Dans un monde parfait — une France vraiment fidèle à l’esprit de #MeToo — un écrivain accusé de violences conjugales ne serait pas célébré.
Et un écrivain récompensé puis assigné en justice ne laisserait pas la presse indifférente.
Mais ici, le silence domine : la plaignante est à peine nommée, l’affaire n’intéresse plus personne.
Les contre-pouvoirs, critiques et maisons d’édition ont préféré détourner le regard.
La littérature française, si prompte à s’ériger en conscience morale, s’est tue.
Et c’est peut-être pour cela que La Nuit au cœur me fascine autant : parce qu’il pourrait être ce livre que la France n’a pas voulu écrire, mais que la littérature, elle, a choisi de faire naître.
Une injustice à réparer
Je repense à Sandrine Collette, grande perdante de 2024 malgré onze prix dérivés. Une injustice littéraire, un déséquilibre.
Alors oui, peut-être que ce Goncourt 2025 viendra réparer celui de l’an passé.
Le Goncourt a trop longtemps été une affaire d’hommes.
Attribuer le prix à une femme, cette année, aurait la force d’un geste symbolique — presque karmique.
2023 : Veiller sur elle — promesse de protection.
2024 : Houris — la trahison, le féminin dévoyé.
2025 : La nuit au cœur — peut-être, enfin, la réparation.
Comme si, dans le silence du jury, les mots eux-mêmes corrigeaient ce que les hommes ont oublié.
Veiller sur elle, ne pas veiller sur elle, veiller enfin sur elle : une trilogie involontaire du féminin français.
Et croire encore
Et moi, malgré tout, je veux y croire.
Pas à la perfection du monde, mais au pouvoir du roman.
Parce que si ce Goncourt 2025 revient à Natacha Appanah, alors peut-être que la littérature française se souviendra de ce qu’elle doit être : une lumière, pas une couverture.
Et là, oui, je me réconcilierai avec elle —
avec cette vieille amie qu’est la littérature française, qui m’a trahie l’an dernier mais que je ne peux, ni ne veux, abandonner.
Et si ma prédiction se confirme, je me convertirai en oracle