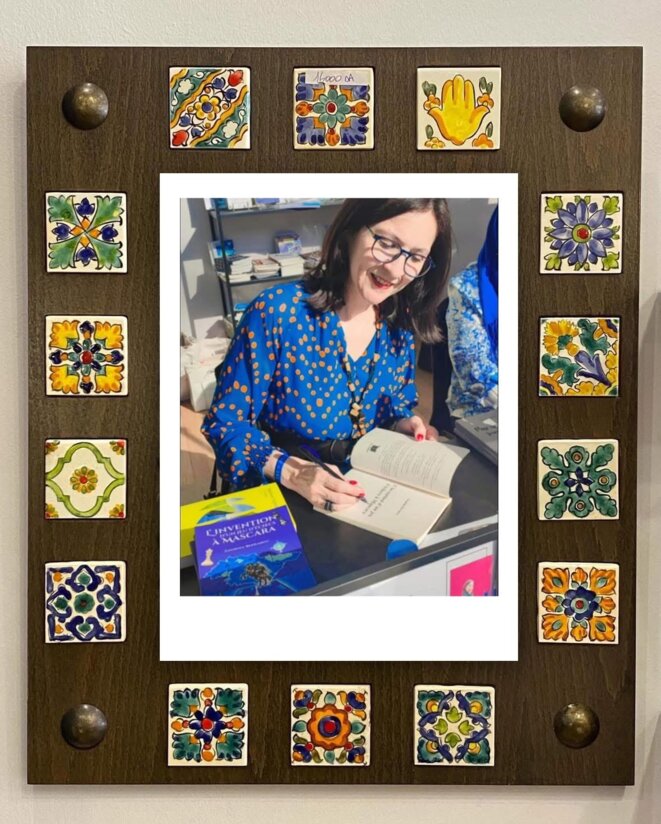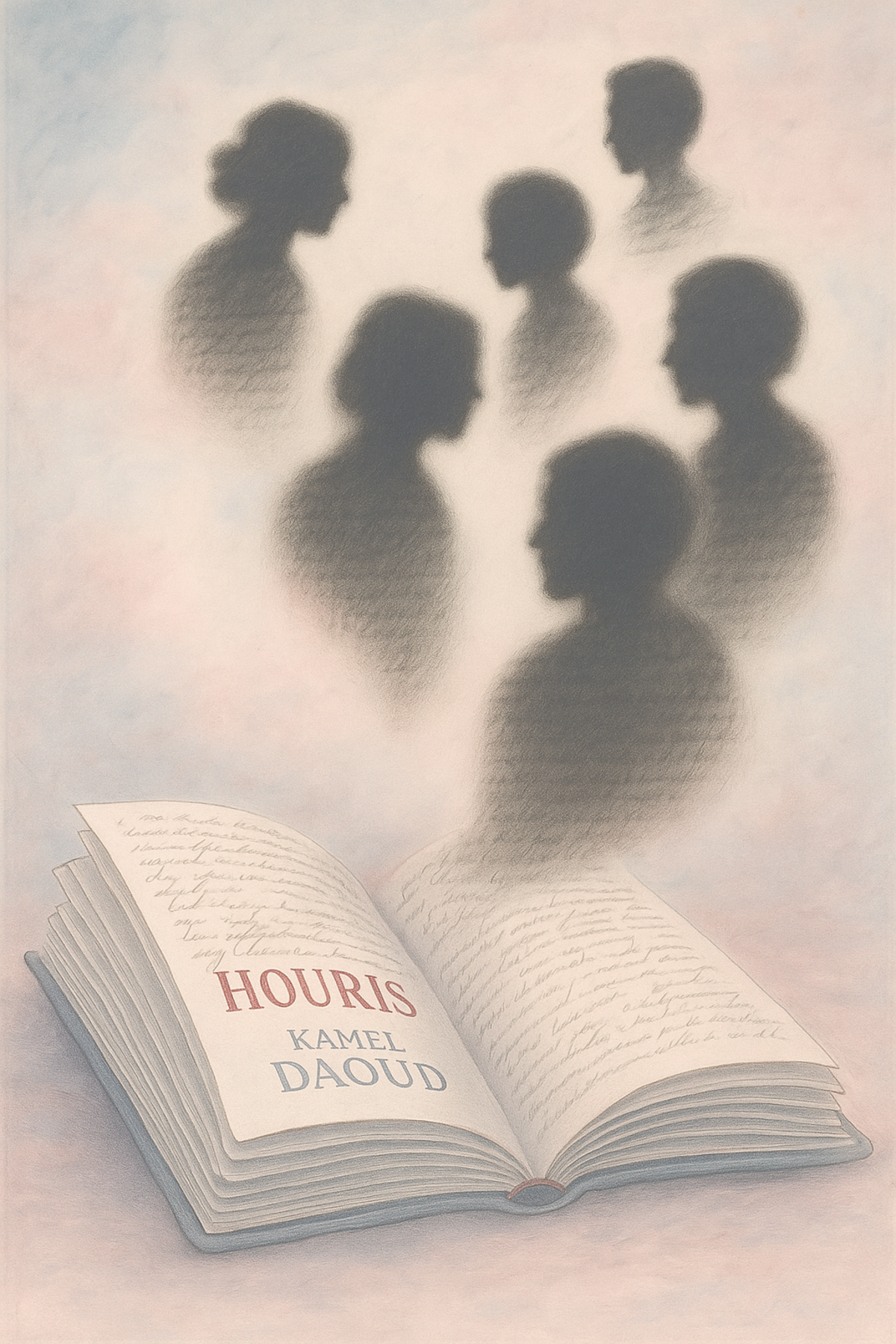
Agrandissement : Illustration 1
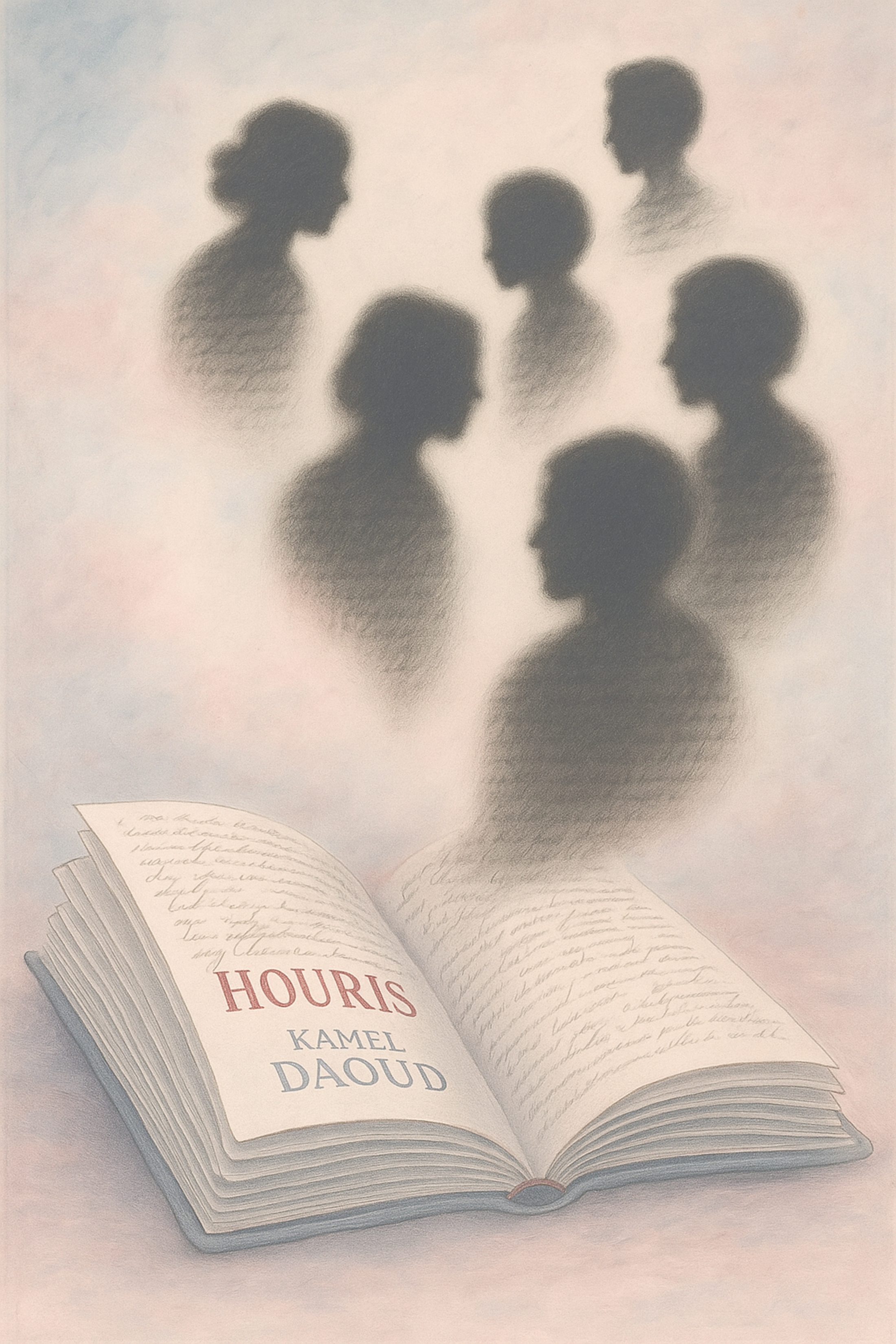
*Par une lectrice fidèle à la littérature, mais lucide sur ses détournements
Lire Houris devait être, pour moi, un exercice presque naturel. J’appartiens à la même génération que Kamel Daoud, et ses premières chroniques dans Le Quotidien d’Oran, je les aurais peut-être écrites moi-même. Ce n’est pas insinuer que nos trajectoires sont jumelles, mais rappeler que, si Daoud est devenu en France l’un des porte-voix de la cause féminine algérienne, c’est aussi grâce à un contexte où tant de femmes – à la plume peut-être aussi incisive que la sienne – étaient entravées, bâillonnées, empêchées d’exister dans l’espace public et médiatique. Il le sait, et il ne renierait sans doute pas ce fait social : la « condition difficile des femmes algériennes » qu’il rappelle à l’envi dans les médias français.
Mais nous sommes en 2024. Vingt années se sont écoulées, et si tout n’est pas idéal, les lignes ont bougé. L’émancipation des femmes algériennes n’est plus une abstraction, c’est un processus en cours, concret, souvent silencieux mais réel. Nulle société ne peut prétendre à la perfection – pas même celle que KD érige en modèle : l’Occident. Car la violence patriarcale y sévit aussi, sous d’autres formes, avec d’autres silences. Elle n’a pas toujours l’alibi religieux que KD attribue à l’islam, mais celui plus insidieux d’un ordre économique fondé sur la guerre et l’industrie de l’armement. Virginia Woolf aurait vu là l’autre visage du patriarcat. Et que dire d’une Amérique qui, une fois encore, choisit Trump ?
Je reviens donc à Houris, en tentant de le lire comme on lirait Les Filles d’Allah de Nedim Gürsel – un roman accusé de blasphème, attaqué en justice, censuré en Turquie. Et pourtant, ce livre, au-delà de toute provocation apparente, n’a rien d’une insulte à la foi. Il explore, avec finesse et souffle poétique, les origines de l’islam, ses figures féminines et les tensions entre sacré et modernité. Sa lecture montre qu’un regard critique, lorsqu’il est bien construit, peut éclairer sans offenser, déranger sans détruire. C’est là la force de la littérature quand elle se distingue de l’invective : elle suscite la pensée au lieu de la refermer.
Ma lecture de Houris s’est décidée aussi à la lumière du 7 octobre. Depuis cette date, une fracture s’est creusée dans l’espace intellectuel français. Deux camps, les GazaOui et les GazaNon. Un manichéisme peut-être, mais dicté par l’urgence morale. Face à l’omerta médiatique, à l’exclusion des voix critiques sur Gaza, il me semble indispensable d’interroger ceux qui ont tribune ouverte, tapis rouge déroulé. Les voix qui se taisent, ou qui débitent des clichés confortables sur l’islam et ses tares supposées.
Houris, encensé dès sa sortie, propulsé dans la liste Goncourt, salué par une presse unanime, se devait d’être lu. Et lu littérairement. Après tout, n’a-t-on pas séparé l’homme de l’œuvre ? Séparons donc le chroniqueur du Point de l’écrivain. Tentons.
Depuis 2021, je m’étais éloignée de KD. Ses chroniques me semblaient répétitives, obsédées par l’islam, recyclant les mêmes préjugés avec une ironie stérile. Une boucle figée dans les années 90, incapable de penser la complexité du présent. Mais là encore : juger le romancier, non le polémiste.
Et pourtant. Dès les premières pages, une suffocation. Le souffle court. Le sentiment de gravir une montagne sans oxygène. Le premier chapitre m’a presque terrassée. Pourquoi ? Je suis une lectrice aguerrie. Gargantua livresque. Alors ?
La presse présentait Houris ainsi :
« Aube est une jeune Algérienne qui doit se souvenir de la guerre d’indépendance, qu’elle n’a pas vécue, et oublier la guerre civile, qu’elle a traversée. Muette, elle rêve de retrouver sa voix. Son histoire, elle ne peut la raconter qu’à l’enfant qu’elle porte. »
Une quatrième de couverture prometteuse. Mais vite trahie. Je cherchais une héroïne, une sœur en mémoire, une survivante de la décennie noire. Je n’y ai trouvé qu’un pantin de chiffon, ventriloquée par un auteur trop présent.
Je m’attendais à suivre le lent chemin d’une reconstruction, celle d’une fille du peuple, broyée par la violence, mais rendue à l’humanité par la littérature. Comme j’ai pu, autrefois, être tour à tour Maheude et Catherine Maheu (Zola), Elena et Lila (Ferrante), la fille du pauvre de Feraoun ou la fille de Aïni chez Dib.
Mais Houris n’est pas ce roman-là. C’est une machine. Un IKEA littéraire : tout y est monté pour répondre aux codes d’un roman "Goncourtisable" dans une France droitisée.
J’ai persévéré, au nom de la littérature. J’ai tenté d’oublier KD, chroniqueur du Point, invité des plateaux. Mais la question fondamentale restait absente des entretiens : « Qui sont vos personnages ? De quoi sont-ils le nom ? Que peuvent-ils nous apprendre ? »
Virginia Woolf disait :
« Le roman repose sur la création de personnages. Rien ne compte autant que leur vérité. »
Et ici ? Que dire de L'bia, d’Aube – ou Fajr ? Trois prénoms pour une héroïne, mais aucune chair. Écorchée vive, rescapée, adoptée, instruite… mais sans cohérence. Une coiffeuse philosophe, une muette érudite, issue du monde paysan analphabète, mais lycéenne brillante. La réalité sociale ? Évacuée. Le traumatisme ? Dissous.
Et Khadîdja, mère adoptive, avocate sortie du néant, enfant abandonnée devenue figure tutélaire ? Là encore, le miracle remplace l’analyse. L’Algérie devient un théâtre de symboles et d’abstractions, où les femmes s’envolent vers la réussite comme par enchantement, quand l’auteur ne cesse de dénoncer leur oppression.
Peut-on invoquer la fiction pour justifier l’invraisemblance ? Non, si l’on choisit d’ouvrir son roman sur un article de loi pénale. Non, si l’on revendique un ancrage dans l’histoire algérienne. Ce n’est pas une fable : c’est un manifeste.
Et le style ? Un soliloque poétique, chargé, lourd, parfois ampoulé. Une érudition plaquée, un lyrisme forcé. Trop de symboles tue le sens. Trop d’allégories noient le réel. Et trop de discours tue la littérature.
Aïssa, le troisième personnage, n’est pas plus crédible. Une encyclopédie vivante, analphabète fils de libraire, capable de réciter les massacres comme un Google sinistre. Même la douleur devient performance.
Le cœur du livre – l’histoire d’un massacre, celui de Had Chekala – surgit comme une mise en scène de l’horreur. Mais tout sonne faux. Pas parce que les faits sont inventés, mais parce qu’ils sont vidés de leur complexité. L’Algérie des années 90 devient un théâtre d’affrontements religieux sans causes ni racines. Les islamistes ? Des monstres surgis de nulle part, sans histoire, sans terreau. Le peuple tue le peuple parce qu’il a appris à égorger des moutons.
Et Aube ? Corps meurtri, enceinte malgré elle, elle part seule sur les routes, sans vacillement, sans vertige, comme si l’horreur pouvait se fondre dans une marche. A-t-elle été secourue ? A-t-elle parlé ? A-t-elle reçu un geste, une main tendue, un mot qui panse ? Rien de tout cela n’apparaît. Le roman passe, survole, avance. La vraisemblance, encore une fois, est sacrifiée sur l’autel du symbole.
KD recycle ici ses chroniques : islam, oppression, misogynie, modernité contre obscurantisme. Le roman devient essai. Le romancier, pamphlétaire. L’héroïne, un porte-voix.
Or, la littérature n’est pas l’idéologie. Elle est humanité. Elle interroge, elle trouble, elle complexifie. Elle ne stigmatise pas. Elle ne caricature pas. Chaque roman devrait éclairer les précédents, ouvrir d’autres angles, offrir une vérité nuancée. KD, au contraire, semble simplifier à outrance. Il ne montre pas la complexité d’un pays, mais assène une conviction.
Joyce Carol Oates posait une série de questions essentielles pour juger une œuvre :
Pourquoi cette histoire ? Justifie-t-elle son effort ? Est-elle originale ? Convaincante ? Le style est-il juste ? Le lecteur est-il changé ? Envie-t-on de la relire ? Ici, toutes les réponses sont négatives.
Henry James affirmait :
« Le romancier doit peupler son monde de personnages réels. Ce qu’il est se diffuse dans ses pages. »
Dans Houris, ce sont les personnages qui sont absents. Seul l’auteur est présent – partout, tout le temps, au point de lasser, d’étouffer, de saturer le texte de sa propre personne. Tout lecteur attentif ne peut que déceler cette absorption de l’intrigue par une opinion.
Kamel Daoud n’écrit pas un roman. Il recycle ses prises de position. Il se répète, se cite, se renforce. Il s’épanche. Il se vomit, comme l’a dit Éric-Emmanuel Schmitt dans une formule cinglante.
À la lecture de Houris, je n’ai pas retrouvé l’écrivain de Meursault contre-enquête. J’ai vu un homme gagné par la polémique, desséché par le commentaire, vidé par la répétition de ses propres obsessions.
Et pourtant, un autre roman était possible. Il aurait suffi d’un angle neuf, d’un vrai personnage, d’un peu d’humilité. Pourquoi ne pas avoir choisi un narrateur-journaliste, en psychanalyse, racontant ces histoires entendues, recomposées, digérées ? Cela aurait permis de conserver les clichés, mais en les situant, en les interrogeant.
Mais non. KD a choisi le raccourci. L’efficacité médiatique. L’effet sur le plateau. Il a écrit pour une rentrée, pas pour une mémoire. Il a raconté Had Chekala, sans jamais raconter la guerre.
Et surtout, il a oublié la ville. Joyce disait qu’un grand roman pouvait reconstruire une ville après l’apocalypse. Ici, Oran n’est qu’une série de clichés : Bastille, Miramar, Hôtel Royal… Rien ne vit. Tout est accessoire.
En refermant Houris, j’ai repensé à Les Filles d’Allah. À leur profondeur, à leur ironie, à leur intelligence du religieux. À cette capacité de dire sans blesser. De provoquer sans accuser. De raconter sans simplifier.
Et j’ai vu que Houris manque cruellement de ce supplément d’âme : l’humour. Le grand Richard Ford l’a dit :
« Introduire de l’humour dans les sujets graves, voilà le plus grand défi de la littérature. »
Défi manqué.
Cet article a été écrit avant l’annonce du Goncourt et avant la polémique actuelle autour de la plainte déposée contre Kamel Daoud. J’y reviendrai.