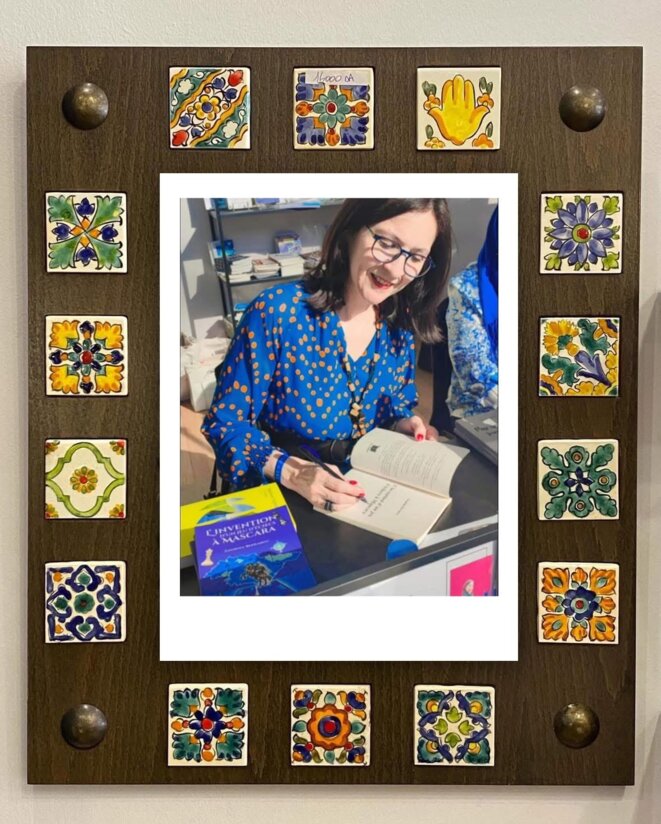Agrandissement : Illustration 1

Il arrive parfois qu’un mot se détache de la phrase, qu’il échappe à l’auteur et acquière une existence propre. Le mot « Arabe », dans la littérature française, est de ceux-là. Il traverse les œuvres, circule d’un écrivain à l’autre, impose son rythme et, ironie de l’histoire, semble conditionner la carrière de ceux qui le manipulent.
De Camus à Kamel Daoud, ce mot trace le destin d’une reconnaissance littéraire qui, pour se dire universelle, commence toujours par faire taire celui qu’elle désigne.
Camus et l’Arabe anonyme
Dans L’Étranger (1942), Albert Camus ne donne pas de nom à « l’Arabe » que Meursault abat sur la plage. L’homme existe à peine : silhouette anonyme, sans voix, réduite à une catégorie.
Ce silence n’est pas un oubli innocent ; il correspond à ce que les critiques postcoloniaux, de Frantz Fanon à Edward Said, ont montré : la colonisation commence par priver l’autre de parole.
Ce mutisme inaugural a façonné le destin du roman : débarrassé du poids historique, L’Étranger a pu devenir un texte « universel », célébré dans le monde entier. Le prix à payer pour cet universalisme fut l’effacement de l’Arabe.
Daoud 2015 : l’Arabe qui parle, mais qui dérange
En 2015, Kamel Daoud inverse le geste. Admirateur de Camus, il publie Meursault, contre-enquête, où il rend un nom et une voix à la victime : Haroun, frère de Moussa l’homme tué, raconte.
Le roman séduit la critique, mais il échoue au Goncourt. Pourquoi ? Parce qu’il a fait parler l’Arabe.
L’Arabe parlant, revendiquant une mémoire, déjouant l’oubli colonial, n’est pas le « bon Arabe » pour l’imaginaire français. La littérature peut tolérer sa silhouette muette, mais s’inquiète dès qu’il prend la parole.
Daoud 2024 : l’Arabe effacée, le Goncourt au rendez-vous
Neuf ans plus tard, Daoud revient avec Houris et décroche le Goncourt. Le roman se déploie sur la décennie noire, mais avec une thèse implicite : les Algériens devraient moins se focaliser sur la guerre de libération et sur 132 ans de colonisation française que sur les dix années de violences islamistes qu’ils préfèrent oublier.
Cette hiérarchisation mémorielle séduit les médias français. Le récit est porté par le destin tragique de Aube, une femme, écrasée par une société patriarcale — un prisme désormais familier et valorisé.
Mais le prix Goncourt est vite rattrapé lorsqu’une certaine Saada Arbane, patiente de la psychiatre — qui est par ailleurs l’épouse de Daoud — accuse l’écrivain d’avoir utilisé sa propre vie sans autorisation.
Le nom Arbane n’est pas anodin. En arabe, la racine ʿ–r–b (ع–ر–ب) renvoie à la langue, à la clarté de la parole, à l’arabité même. De cette racine dérivent ʿArab (les Arabes), ʿArabī (l’Arabe) et iʿrāb (l’expression grammaticale). Le patronyme Arbane, courant en Algérie, contient lui aussi ce noyau phonétique et sémantique. L’oreille arabe y perçoit inévitablement l’écho de ʿArabī, « l’Arabe ».
Ainsi se dessine un jeu de miroir étrange.
Ce succès au Goncourt repose en coulisses sur un effacement : celui de Saada Arbane, femme arabe bien réelle, réduite au silence pour nourrir la fiction. La boucle est bouclée : Camus a fait taire l’homme arabe dans sa fiction pour coller au réel , Daoud fait taire une femme arabe réelle pour écrire une fiction ou seule sa subjectivité fait autorité de réel .
On croit que Houris relève de la fiction, mais il n’en est rien : Daoud n’a jamais écrit qu’à partir de matériaux réels , absorbant d’abord l’étranger de Camus , puis vampirisant la vie de Saada Arbane, patiente de son épouse.
Le véritable roman n’est pas dans Houris, mais dans ce duel du réel : Saada Arbane qui surgit pour réclamer sa voix, face à l’écrivain qui la lui retire.
C’est là que L’Étranger se rejoue, non plus sur une plage inventée, mais dans la vie même, où l’Arabe anonyme prend enfin corps. Ainsi, le procès fait jadis à Camus par la critique s’inverse : c’est la justice qui juge désormais Daoud.
En portant plainte contre Daoud, Saada Arbane transforme le silence en acte et fait de la justice sa scène de parole.
Daoud devient Meursault et Saada Arbane: l’arabe qu’on ne veut pas nommer . Dans la bouche de Daoud et de la presse on dit : cette femme, une jeune femme , la plaignante …
« Aube-contre enquête », c’est Saada Arbane qui raconte son histoire. L’arabe qui existe malgré l’effacement. C’est la rébellion de l’arabe de Camus contre Kamel Daoud qui a oublié Moussa et Haroun.
Sans fiction ni porte-voix, Saada Arbane parle seule, depuis l’Algérie. Sa voix, parce qu’elle est celle d’une femme, a une force neuve : elle en incarne l’antithèse du discours de Daoud sur l’effacement de la femme en Algérie — l’Arabe qui se lève et parle enfin c’est elle face à son bourreau plumitif .
L’effacement médiatique : un système complice
Daoud, ayant quitté l’Algérie avec dans ses bagages un jugement pour violences conjugales contre son ex-femme, s’inscrit en France dans un discours féministe et défend les droits des femmes tout en effaçant une femme réelle et en héroïsant une figure fictive qui sonne faux.
Or cette contradiction, bien que connue, reste soigneusement tue par la presse, par les médias, par le monde littéraire lui-même. On ferme les yeux sur l’évidence, préférant mettre en avant le message rassurant du « bon Arabe », celui qui tient les propos attendus et adaptés au récit médiatique français.
Saada Arbane, elle, disparaît dans ce silence. Les journalistes ne s’intéressent pas à elle : elle devient invisible, comme l’Arabe de Camus, réduite à une silhouette sans voix. Elle apparaît ainsi comme son alter ego contemporain, figure qui traverse le temps et révèle la persistance d’un inconscient colonial.
L’effacement ne relève donc pas seulement de l’écrivain, mais d’un système entier — presse, édition, opinion publique — qui rejoue la même mécanique : faire disparaître une voix arabe réelle pour consacrer une fiction convenable.
Camus/Kamel : un miroir brisé
Il y a dans la trajectoire de Daoud une étrange volonté d’être l’héritier de Camus. Le glissement phonétique n’est pas anodin : le nom de l’écrivain français résonne presque comme le prénom de son double algérien. Kamu et Kamel partagent une proximité sonore qui nourrit une illusion de filiation. Comme si, par le prénom, Daoud pouvait incarner l’alter ego oriental de l’écrivain pied-noir.
Mais c’est un mirage. Car l’identité véritable ne se loge pas dans le prénom, qui peut se confondre, mais dans le nom de famille. Camus et Daoud s’éloignent l’un de l’autre : l’un inscrit dans la lignée coloniale française, l’autre enraciné dans un héritage arabe.
Entre Camus et Kamel, le miroir sonore semble se répondre. Mais c’est peut-être le hasard du camis — cet épisode d’adolescence islamiste que Daoud a reconnu — qui les rapproche le plus : Camus, l’ange déchu de là littérature de l’absurde , face à Daoud, tenté d’endosser le rôle de prophète de la littérature.
Camus prisonnier, Daoud complice
Camus est excusable, diront certains, parce qu’il est le produit d’une époque, celle de la colonisation, dont il ne pouvait totalement se détacher. Peut-être a-t-il tenté de le faire dans L’Étranger, en choisissant l’absurde ou la philosophie pour dire ce qu’il ne pouvait dire en public. Mais il reste prisonnier de son temps, fils de l’Empire, marqué par l’inconscient colonial.
Kamel Daoud, lui, appartient à une autre génération, qui a tout compris de cette histoire. Pourtant, il a reproduit le même inconscient, non pas celui d’une époque, mais celui de son propre pays et de son histoire.
Car le rapport colonisé/colonisateur, dont Camus était porteur malgré lui, se rejoue chez Daoud, mais sous une forme inversée. En effet, Daoud porte deux fardeaux : d’une part, celui du colonisé toujours assujetti au regard du colonisateur, dont il cherche la faveur ; d’autre part, celui du mâle algérien qui, dans sa propre société, occupe la place du colonisateur, tandis que la femme demeure la colonisée.
C’est en cela que son œuvre prend un relief particulier : en effaçant Saada Arbane et en portant avec lui ce lourd passé de violences conjugales, il rejoue inconsciemment le schéma qu’il prétendait dénoncer. Comme si, à son insu, il reconduisait dans sa vie intime et dans son écriture une structure de domination déjà inscrite dans l’histoire.
Car la littérature, qu’on le veuille ou non, agit comme une psychanalyse muette. Il suffit de lire pour comprendre ce qui se trahit derrière la plume.
La France universelle en contradiction
1942 : Camus publie L’Étranger. La France coloniale se proclame patrie de l’universel, mais son idéal d’égalité se paie de l’effacement de l’Arabe.
2024 : Daoud reçoit le Goncourt. La France postcoloniale se veut championne des droits des femmes, mais elle consacre un écrivain accusé de violences conjugales qui efface dans son roman la voix d’une femme réelle.
Près d’un siècle sépare ces deux dates, mais leur symétrie — 42 et 24 — dit assez la logique de miroir : l’universel français se construit encore sur un silence imposé, hier à l’Arabe, aujourd’hui à la femme arabe.
La plage, le soleil et l’effacement symbolique
Dans L’Étranger, la scène du meurtre se déroule sur une plage, sous un soleil aveuglant : Meursault abat un Arabe anonyme, effacé par la lumière. Ici, le soleil n’est pas qu’un décor : il incarne la colonisation elle-même, qui se présente comme lumière de civilisation, mais qui aveugle et efface.
Dans Houris, beaucoup de scènes se rejouent sur une plage, comme si Daoud reprenait sans le savoir le décor camusien. Là encore, la lumière agit comme instrument d’effacement. Plus troublant encore : Saada Arbane, la femme réelle, est renommée « Aube » dans la fiction. Or aube traduit en arabe fajr, la première lueur du soleil.
Cette lumière, à son tour, est métaphore de Daoud lui-même. Dans une interview, il avouait qu’à son arrivée à Paris, il avait été « ébloui par les lumières », qu’il associait aux lumières de la civilisation occidentale. Mais cette petite lumière de l’aube, fascination d’un écrivain pour l’Occident, se double d’un effacement : elle recouvre la voix d’une femme arabe bien réelle.
Ainsi, après l’homme arabe anonyme fictionnel de Camus effacé par le plein soleil colonial, c’est la femme arabe réelle non anonyme qui disparaît derrière la fiction de l’Aube néo-coloniale de Daoud .
Qui est vraiment l’étranger ?
Ainsi, la question de l’étranger se déplace : chez Camus, elle oscille entre Meursault, l’Arabe et l’écrivain lui-même ; chez Daoud, elle se resserre sur un duel où l’écrivain, en effaçant Saada Arbane, devient lui aussi étranger — étranger à sa société, à son œuvre et, en fin de compte, à lui-même.
Épilogue : le prix du miroir
Citer un écrivain, marcher sur ses traces, se revendiquer de lui peut faciliter le succès, surtout si cet écrivain est déjà un mythe. Mais l’imitation est un miroir trompeur : on hérite de ses fulgurances autant que de ses prisons, de ses éclats autant que de ses silences.
Le chemin paraît plus facile, mais il est pavé de compromissions. Et dans ce raccourci, le piège se referme.
Il y a toujours un prix à payer quand on choisit la facilité du miroir plutôt que la difficulté d’inventer sa propre voix. La littérature ne vit que de singularités. Soyez vous-mêmes, soyez singuliers : c’est cela, la seule fidélité véritable à l’écriture.
Et si le véritable étranger, au fond, était celui qui refuse d’écouter la voix de l’autre ?
En fin de compte , toucher l’universel c’est la littérature qui ose traverser ses propres préjugés.
L’universel n’est pas le choix d’un camp. Camus l’a frôlé par l’absurde, en affrontant ses propres limites. Daoud, en se conformant à une certaine ligne de conduite , a cru l’atteindre — il ne l’a qu’effacée.