Plusieurs films récents mettent en scène la quête de la mère ou les rapports mère-enfant : L'échappée belle, d'Emilie Cherpitel, Une seconde mère d'Anna Muylaert. Et aussi La mère, de Christine Carrière, avec Mathilde Seigner.
Il est possible que les cinéastes, sondant les cœurs, ont repéré que la filiation était une question centrale pour les spectateurs : au moment où les joutes publiques tournent autour de la procréation médicalement assistée, de la parentalité de deux personnes du même sexe, avec cette matérialité absolue de la filiation qu'atteste l'ADN. Mais aussi, les chamboulements sociaux provoqués par le trouble dans les relations matrimoniales : des parents, surtout des femmes, de plus en plus nombreux, élevant seuls leur enfant. Des adultes tardant à se reproduire : pour jouir plus longtemps de la vie ou par crainte de cette inconnue qu'est justement la paternité ou la maternité.
Il est possible aussi que cette question, certes bousculée par les évolutions sociétales actuelles, ne soit finalement qu'un grand classique. Parce que ce lien (indéfectible), quelque soit le contexte, est au cœur de la vie des hommes et des femmes, le cinéma n'a cessé, au fil du temps, de l'aborder.

L'échappée belle, film d'Emilie Cherpitel.
Un jeune garçon, Léon, s'approche d'une jeune femme, Eva, à une terrasse d'un café et lui demande un chocolat chaud. Elle sourit, commande et ne se préoccupe pas de lui. Elle consulte son téléphone. Sans faire trop attention à lui, elle paye les consommations, puis s'en va. Le gamin s'accroche : il la suit dans la rue, jusque chez elle.
Après avoir vu la bande-annonce au cinéma, je décide d'aller voir ce film, redoutant qu'il aborde le sujet, comme souvent, par les bons sentiments, du type : enfant malheureux et amour sans borne d'une femme riche qui compatit à sa souffrance, le recueille contre l'avis de la méchante DDASS qui est si inhumaine.
En réalité, le scénario est différent des thématiques habituelles qui cherchent à faire pleurer Margot dans les chaumières. Bien sûr, le pauvre enfant a été abandonné, et Eva vit dans l'opulence, l'inactivité, mais leur personnalité à front renversé (lui tellement adulte, elle tellement immature) que l'on peut considérer que l'on assiste à un conte qui cherche à nous confronter aux questions de la filiation, de l'amour filial, de l'amour tout court : le cri du cœur ("fuck you") poussé par nos deux héros, elle contre son amant, lui contre sa mère inconnue, en est l'illustration.
Le problème est qu'il était peut-être possible de nous présenter un enfant abandonné décalé qui ne soit pas à ce point mignon, enjoué, décidé, responsable, intelligent, déclinant le sigle du CNAOP ("conseil national d'accès aux origines personnelles") ou capable de prononcer des phrases de dialoguiste (à la question : "et si ta mère ne veut pas te voir ?", il répond : "ben, j'aurai essayé", ou, sachant que sa mère n'a pas avorté : "pourquoi elle m'a laissé exister ?"). Quant à la jeune femme (Clotilde Hesme), on ne ressent pas de sa part un réel attachement ni à cet enfant, ni à sa propre mère malade, malgré sa plainte ("elle a arrêté de nous aimer"). Elle semble en représentation, grande, très belle, elle déambule, comme un top-modèle, avec indolence, elle sourit sans cesse, et ce sourire m'apparaît davantage être celui de l'actrice que celui du personnage. L'autre Clotilde (Courau), dès qu'elle surgit en femme fortunée mais chargée d'enfants, elle est plus convaincante. Il me semble qu'il aurait fallu pour le rôle une femme un peu déjantée, ou espiègle, comme Cécile de France, pour jouer cette femme-enfant.
Le foyer éducatif, d'où Léon a fugué, accueille 150 enfants mais ce n'est pas le sujet du film. Bien sûr, le directeur cherche (par téléphone) à récupérer le gamin, il incite à ce qu'il soit conduit au commissariat, cela paraît un peu froid mais sans plus. Quand un éducateur récupère un jour Léon, il ne se passe rien : il a l'air sympa, mais ne discute pas avec Eva (il n'a pas le temps, il a beaucoup de route à faire). C'est peu crédible, peut-être critique à l'encontre des foyers, mais finalement même Eva est ailleurs : cette entrevue laconique ne semble même pas lui poser problème.
Le scénario tiendrait si on n'était pas, à ce point, à la surface des choses. Finalement, je craignais les "bons sentiments", et paradoxalement j'aurais aimé plus de sentiments exprimés. Plus de réelles confrontations dans les rapports humains. Eva dit à Léon : "t'as aussi le droit d'être un peu bizarre", comme si une phrase bien envoyée suffisait. Film à voir tout de même, car ce qui m'apparaît manquer est peut-être ce qui met en réflexion.

Une seconde mère, film d'Anna Muylaert
Val (Regina Casé) a quitté mari et enfants pour aller travailler à la ville, Sao Paulo, comme employée de maison dans une famille aisée. Elle s'est attachée au fils, Fabinho, qui lui fait confiance et s'adresse à elle comme si elle était sa mère. Voici dix ans qu'elle a déserté le Nordeste sans jamais y être revenue. Et depuis trois ans, elle n'a plus téléphoné. Mais sa fille Jessica vient à la capitale pour poursuivre des études d'architecture. Et retrouve sa mère : elle s'impose aux maîtres, s'installe carrément dans la chambre d'amis, et incite sa mère à ne pas accepter d'être traitée comme une domestique.
Le film montre ce rapport dévoué de cette femme qui cherche toujours à aller au devant des attentes de ses employeurs et qui respecte les territoires (certains lieux, certains aliments ne sont pas pour elle, mais sa fille fait voler en éclat ces conventions).

Les maîtres ne sont que des bourgeois, des bobos, pas méchants. Mais parfois c'est pire que s'ils étaient méchants. Cette bonne conscience, cet aveuglement sur le fait qu'ils font preuve d'un mépris diffus à l'égard de Val. Jessica c'est le culot, l'abolition des barrières, c'est la jeunesse, qui tente bien monsieur, mais inquiète madame. Cette dernière, qui ne sait rien faire de ses dix doigts mais seulement parader sur les plateaux de télévision (son métier), va s'employer à écarter cette insolente.
Ce film indique bien, par son titre, qu'il s'agit d'explorer le rapport mère-enfant. D'abord, le lien maternel, très affectueux entre Val et Fabinho, qui confie à la "domestique" ce qu'il ne dit jamais à sa propre mère. C'est aussi l'absence qui a duré des années entre Jessica et Val, qui espère qu'un jour sa fille la comprendra. Si sa mère est une seconde mère c'est qu'une tante a dû, jusque là, jouer le premier rôle. On ne sait pas trop si ce sont seulement les conditions sociales, l'obligation de travailler loin, qui a créé cette situation.
Mais ce que la réalisatrice nous montre c'est ce rapport dépassé entre maîtres et serviteurs : le fils des uns et la fille des autres sont, eux, sur le même plan. Evidemment, ils ne sont pas dans un rapport de subordination, mais Jessica aurait pu s'incliner devant le statut du garçon. Or, en une génération, les rapports sociaux semblent avoir changé : par dessus le marché, l'intelligence, la révolte, l'audace de la jeune fille prolétaire font qu'elle surpasse l'adolescent cocooné. Message d'espoir, conforté par le happy end. Sans doute un peu naïf, mais on a bien le droit de rêver.
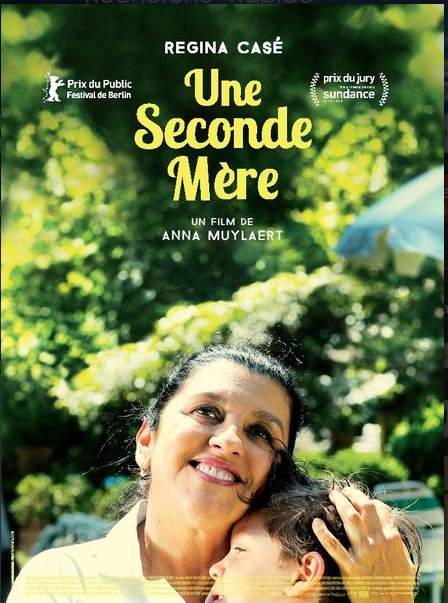
La mère, de Christine Carrière. Marie (Mathilde Seigner) confrontée à son fils de 16 ans sur lequel elle n'a plus prise. Il ne la respecte pas, ne se comporte pas comme un fils avec elle. Son arme à elle, excédée, sera de ne pas se comporter comme une mère. L'amour prend parfois des chemins tortueux pour se démontrer.
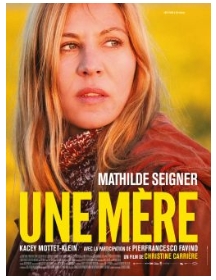
[le texte sur L'échappée belle a été publié une première fois sur le site du NPA32]
Enfants martyrisés : les "sociaux" coupables, par Yves Faucoup :
Résumé : Dans les cas de maltraitance à enfant, l’opinion publique et une partie des médias ne se contentent pas d’incriminer les coupables (le plus souvent les parents) mais dirigent aussi leurs accusations vers les services sociaux. Quitte parfois à s’arranger avec les faits pour pouvoir démontrer la responsabilité sinon la complicité des professionnels éducatifs, sociaux et médico-sociaux dans ces tragédies. L’article montre les différents protagonistes qui participent à cette curée, propose de tirer les conséquences de la loi de 2007 relative à la protection de l’enfance en vue de mieux évaluer les situations en cas de suspicion, et d’organiser des débriefings réguliers afin d’améliorer le dispositif, tout en mettant en garde contre le risque de laisser croire que le champ de la protection de l’enfance se limite aux victimes de parents tortionnaires.
Dans la revue Empan (1/2015 n°97, p.122 à 128) : https://www.cairn.info/revue-empan-2015-1-page-122.htm

Billet n°206
Billets récemment mis en ligne sur Social en question :
Psychiatrie : menace sur un lieu de proximité et d'insertion
Et la richesse ruissellera sur les pauvres
Des enfants sont pauvres, leurs parents aussi
"La lutte des classes n'est pas républicaine"
La loi du marché : c'est l'humiliation
Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr
[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]



