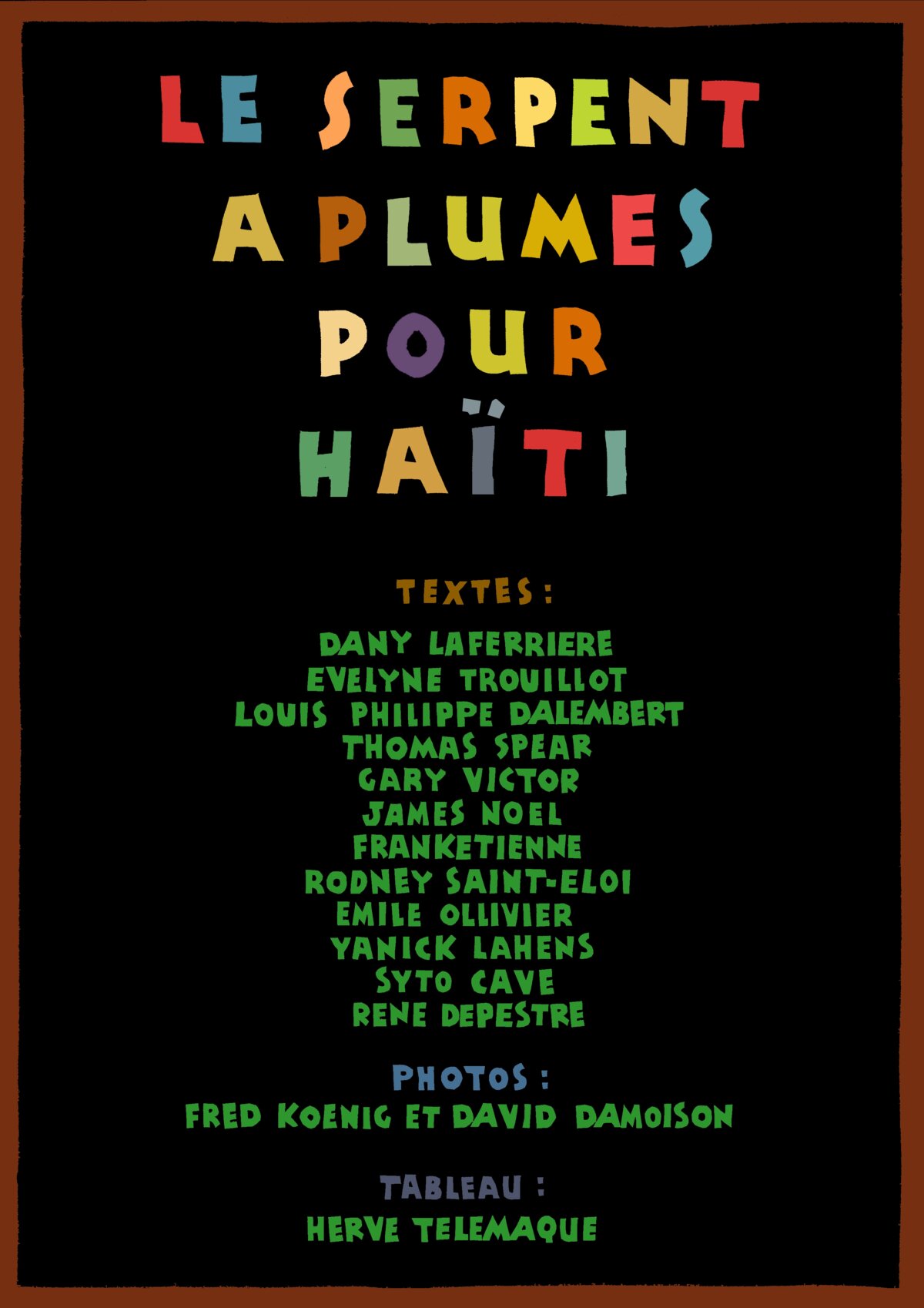
Agrandissement : Illustration 1
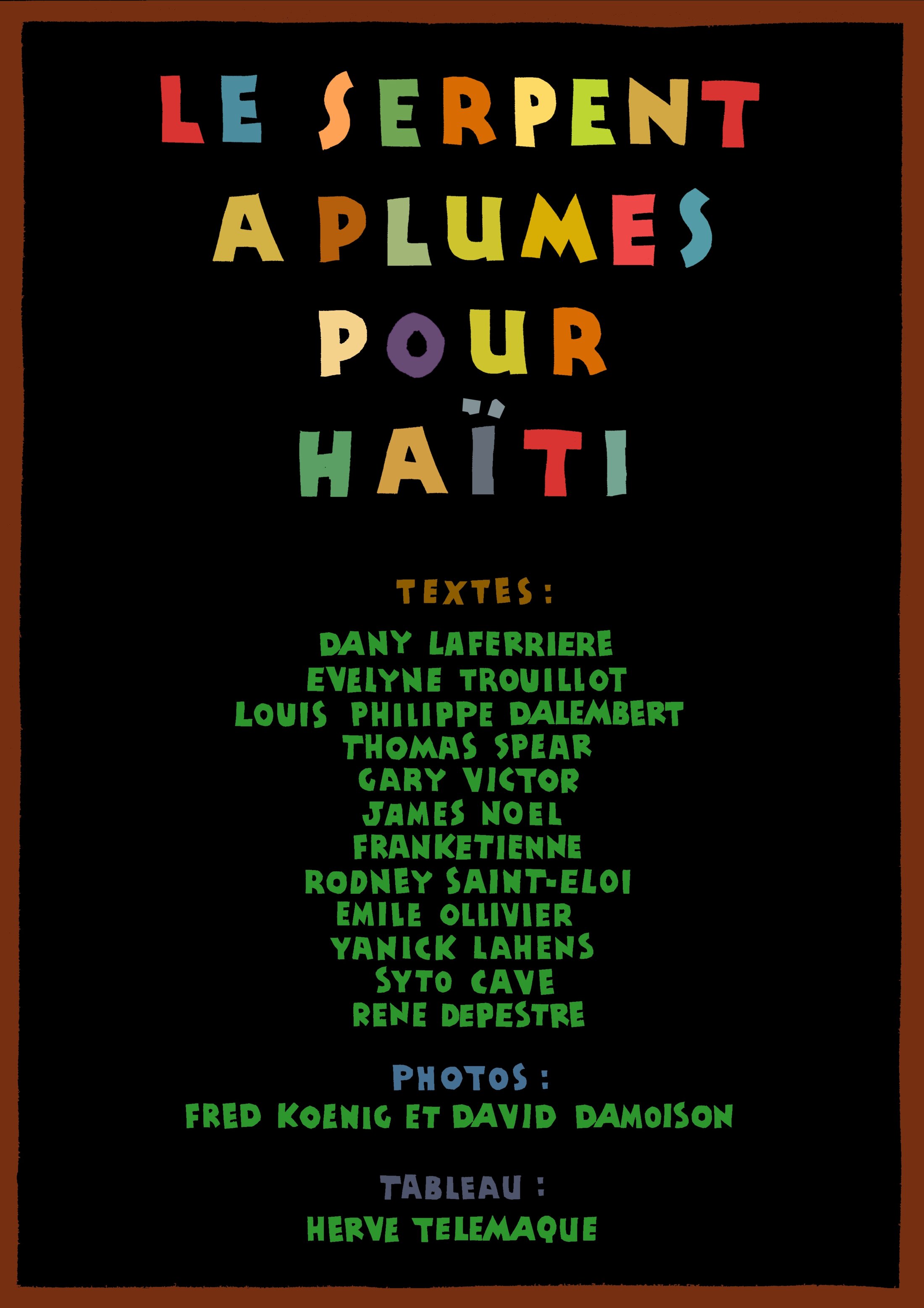
Initiatives et engagements se multiplient pour Haïti. Parmi ceux-ci soulignons la publication, le 18 février par Le Serpent à plumes, d’une revue de 176 pages dont tous les bénéfices iront à l’Hôpital de la Communauté Haïtienne.
Au sommaire : de larges extraits de romans ou nouvelles, des textes inédits, des entretiens, des photographies, des tableaux. Comme le souligne Nathalie Fiszman, directrice littéraire, en introduction à ce numéro hors-série – réponse à l’urgence –, la littérature haïtienne occupe une large place du catalogue du Serpent à plumes, avec Dany Laferrière, Yanick Lahens, Émile Ollivier, Louis- Philippe Dalembert. Plus encore, la culture est et doit être une réponse, une digue, une reconstruction, comme l’a écrit Dany Laferrière dans Le Monde :
« Quand tout tombe, il reste la culture. Et la culture, c’est la seule chose qu’Haïti a produite. Ça va rester. Ce n’est pas une catastrophe qui va empêcher Haïti d’avancer sur le chemin de la culture. »
« Ne pas se laisser submerger ». Ne pas oublier non plus. « Nous ne sommes pas à notre première fin du monde en Haïti », souligne James Noël, dans un texte inédit daté du 24 janvier 2010.
2004 déjà, séisme. 2008, les tornades.
L’aide internationale. La compassion.
Et puis, trop vite, « Haïti s’est remise de plus belle à hurler sans témoins, à pleurer dans sa solitude ».
C’est cela qu’il faut changer. Notre rapport à l’urgence, à l’aide. La culture nous y aidera.
Ce numéro est un voyage. Vers une culture, une langue, un pays. Qui prendra, pour certains lecteurs, la forme d’une découverte, pour les autres, celle d’un retour vers des terres aimées, meurtries. Pour tous celui de la nécessité, des mots qui luttent.
Comme l’écrit Rodney Saint-Éloi, narrant son 12 janvier 2010, alors qu’il vient d’atterrir en Haïti pour participer au festival Etonnants Voyageurs, « ce que j’ai vécu après n’a pas de nom » :
« Ce que j’ai vécu après n’a pas de nom. Personne ne devrait vivre cela. Je me retrouve par terre, sans savoir trop comment, entre des voix et des visages soudés par la peur. Le hurlement de la terre, les éclats de verre, les cris. Puis, un grand nuage de poussière obscurcit le ciel. La détresse commence ainsi. Des décombres des appartements dans la cour de l’hôtel… et tout le monde se fait secouriste pour pouvoir sauver quelques vies. Mais il est déjà trop tard pour certains. Une minute a suffi pour tout anéantir. Dans ma tête et dans mon corps, il y a ces milliers d’êtres piégés sous les tonnes de ciment. Et ces monuments tombés.
Je vis encore cet instant où l’hôtel craque comme une feuille de papier que l’on déchire, où tout est vraiment vanité, et que la nature contraint les êtres humains à l’humilité, pire, à l’impuissance. »
Dans un entretien publié dans ces pages, René Depestre, né en 1926 à Jacmel, écrivain et poète nomade, explicite son rapport à Haïti, son île natale et commente son histoire unique, paradoxale :« J’ai emporté avec moi Jacmel, mon enfance. (…) j’emporte avec moi partout où je vais Haïti, mon chez-soi haïtien ; mon chez-soi insulaire m’a toujours accompagné, mon natif natal fait parti de mon nomadisme, si je peux dire. »A notre tour, grâce à cette revue, de porter Haïti en nous, de comprendre son histoire complexe, sa crise permanente, à travers ses écrivains, peintres, photographes, comme dans ces mots de René Depestre, toujours :

« Haïti est en crise, au fond. Haïti est en crise peut-être depuis toujours, si l’on peut dire. (…) C’est permanent : une crise chronique. C’est l’une des caractéristiques politiques de l’histoire haïtienne. Il y a même des observateurs – peut-être un peu durs – qui ont été jusqu’à considérer qu’Haïti, sur le plan politique, depuis sa fondation en 1804 jusqu’à nos jours aurait vécu dans une sorte de parenthèse vide. Il est certain que la nation haïtienne s’est constituée sur le plan culturel, sur le plan littéraire, sur le plan esthétique, sur le plan religieux… Haïti s’est constituée en tant que communauté originale, historiquement constituée de particularités qui lui sont propres. Mais sur le plan politique, on n’a pas beaucoup avancé. Ce qu’il fallait faire c’était – depuis Christophe, depuis Pétion, sans parler de la fin du XIXe siècle – un État. Un État organisé.
On a eu parmi les plus belles constitutions du monde. Peu de pays ont eu autant de constitutions qu’Haïti, et de bonnes constitutions d’ailleurs.
J’ai rencontré un historien polonais qui avait fait une étude brillante sur les constitutions d’Haïti ; c’est un modèle de vie constitutionnelle ! Mais cette vie constitutionnelle n’avait pas de racines dans la vie quotidienne et dans les institutions du pays. On n’a jamais eu un État haïtien.
(…) Il y a une intelligentsia constituée, et c’est l’un des paradoxes de la parenthèse vide quand on parle d’Haïti, que malgré cette parenthèse vide sur le plan constitutionnel, sur le plan des institutions républicaines et démocratiques et de la société civile, il y a une culture, il y a un espace haïtien original qui fait une grande part aux rêves, à la beauté, à la création. C’est curieux, c’est peut-être exceptionnel dans l’observation des sociétés du XXe siècle qu’un pays qui a échoué à constituer une nation politique, une société civile organisée, et malgré une entrée spectaculaire sur la scène politique mondiale avec la révolution de Saint-Domingue, ça n’a pas pris sur le plan politique, mais il y a une nation culturelle. Et aujourd’hui peut-être c’est la nation culturelle qui sauvera l’autre Haïti parce que l’on est double. Il y a une Haïti terrible, ténébreuse qui a fini par trouver son incarnation diabolique, satanique dans le duvaliérisme, mais il y a une autre Haïti, il y a la face lumineuse d’Haïti qu’on trouve dans sa peinture, dans sa musique, chez ses poètes, chez ses écrivains, ses romanciers hommes et femmes ».
Pour que la vie reprenne après le « séisme assassin-démolisseur » – après « ce maudit soir du Douze janvier (…) définitivement trop triste la date du douze janvier. Douze comme si toutes les heures pleuraient en même temps la perte sèche de toutes ces vies », selon les mots de James Noël dans son magnifique texte inédit Quelques mots lâchés en catastrophe –, un volume indispensable pour comprendre (et aider) Haïti, pour qu’elle soit une, dans sa « face lumineuse ». « Dans la survie, l’élégance », comme l’écrit Rodney Saint-Éloi :
« Je vis avec ces images de détresse et de beauté absolue. Pour traverser ces vallées de larmes et de rires, ces cadavres frais et l’odeur parfumée de ces mangues douces, je dois me battre pour trouver en moi la force du guerrier et la tendresse infinie de l’amant qui regarde la mer comme dans le roman-poème d’Amos Oz :
À présent lève-toi et mets-toien quête, lève-toi d’un pied léger et va-t-en tranquillement chercher ce que tu as perdu. »CMLe Serpent à plumes pour Haïti, hors série, 176 p., 15 €Parution le 18 février 2010 – Bénéfices reversés à l’Hôpital de la Communauté Haïtienne.
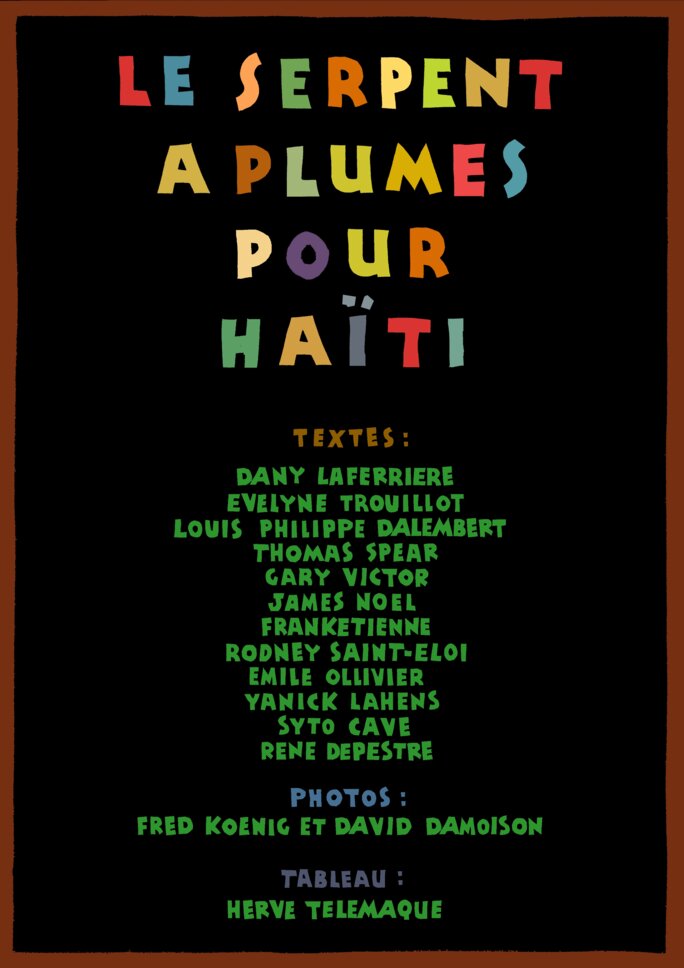
Agrandissement : Illustration 3
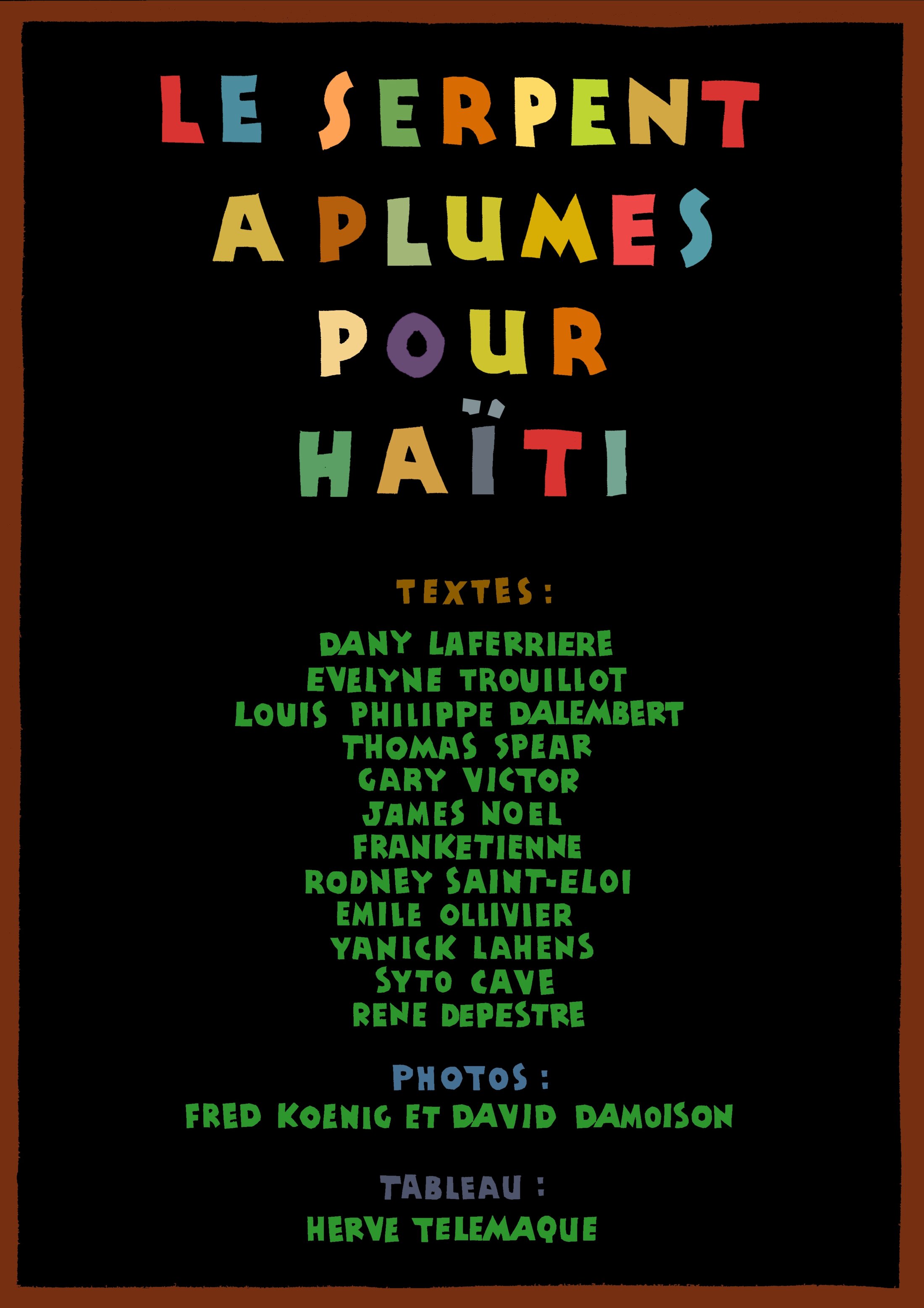
Sommaire :
•Dany Laferrière, Le Cri des oiseaux fous, roman (extraits).
•David Damoison, Nuits noires et nuits blanches, photographies.
•Louis-Philippe Dalembert, Les dieux voyagent la nuit, roman (extrait) ; Liens de sang, nouvelle.
•Yannick Lahens, Dans la maison du père, roman (extraits).
•Gary Victor, Banal Oubli, roman (extrait)
•Frankétienne, D’un pur silence inextinguible (extraits)
•Fred Koenig, photographies.
•René Depestre, entretien Depestre par lui-même.
•Thomas C. Spear, Lettre à Sergine. Inédit.
•James Noël, témoignage, inédit.
•Rodney Saint-Éloi, La tendresse et l’élégance nous sauverons du séisme.
•Hervé Télémaque, tableaux.
•Evelyne Trouillot, roman à paraître, La Mémoire aux abois (extrait).
•Syto Cavé, Fatras-Bâton, nouvelle.
•Émile Ollivier, Mère-Solitude, romans (extraits) ; Des nouvelles de son excellence, nouvelle
Extrait :
Lettre à Sergine, Thomas C. Spear
Chère Sergine,« Batiman an kraze, cheri ! batiman an kraze. »J’entends encore tes paroles, Sergine André, toi, qui cries au téléphone. Ton compagnon Gérard Le Chevallier se trouvait au 2e étage de l’hôtel Christopher au moment du séisme. Tu es sans nouvelles. Mais c’est toi qui obliges les autres à faire face à la réalité, c’est toi qui les réconfortes. Après deux jours de recherches sur le lieu, tu es désespérée, mais déterminée. Traverser les cadavres, calmer avec un câlin et un mot doux un fou-furieux. Certains perdent la boule, pas toi. « À qui puis-je m’adresser? », tu me demandes, toute recherche de vie ou de corps n’ayant abouti à rien. En deuil déjà, tu es digne, fâchée, frustrée et forte. Belle. (« Majestueuse », dit Léna.) Quarante-huit heures après le tremblement de terre, les téléphones ne marchent toujours pas, mais de temps en temps, quelque chose débloque : une autre amie vient de recevoir un texto de lui, envoyé avant que la terre ne tremble pour la première fois.L’appel est coupé. L’autre portable ne marche pas. Le texto remet tes nerfs à bout, comme la terre qui se remet à bouger…Avec chaque réplique, on craque, bourré d’adrénaline.

Quatre jours auparavant, j’étais au Cap avec mon ami, l’artiste et cinéaste Kendy Vérilus. Depuis Milot, on a fait l’ascension, à cheval, jusqu’à la Citadelle Laferrière : construite peu après l’indépendance, c’est une merveille légendaire.Chère Sergine, je ne pourrais facilement t’expliquer pourquoi je voulais connaître la Citadelle. Une lecture de René Philoctète ? Pour comprendre de visu ce défi de 1804 qui a changé le cours de l’histoire?Je sais que le tremblement de terre de 1842 a détruit la ville du Cap et a endommagé le Palais de Sans Souci et la Citadelle. Mais aujourd’hui, la Citadelle reste là, preuve du génie de la nouvelle nation. La forteresse immense immortalise le despotisme de Christophe qui a mis quelque vingt mille hommes à la construire (et dont bon nombre ont payé de leur vie). Christophe, si bien décrit par Aimé Césaire, tragiquement universel et éternel. Christophe, roi du nord d’Haïti dont le Palais et la Citadelle ne laissent rien à envier aux monarques européens. Les canons français et anglais du XVIIIe siècle (butins de guerre) visent à perpétuité cet ennemi qui oserait mettre la main sur l’indépendance haïtienne. AuPalais, ce roi promulguera le Code Henry en 1812 et établira une Académie de peinture et de musique. Christophe, qui se tirera dramatiquement une balle en argent dans la tête en 1820. Rideau.Déjà, avant le tremblement de terre, on est frappé par le contraste entre l’architecture du Cap, si belle, et la ville, si délabrée. Je me demande pourquoi on ne fait pas réparer les immeubles : ce n’est pas difficile de trouver des milliers de personnes au chômage, ne cherchant pas mieux qu’un travail qui pourrait être celui d’ouvrier en bâtiment. L’État ne fait rien, me répond-on. Par les routes en si piteux état et les égouts bouchés, on pourrait effectivement dire que l’État est peu présent dans l’infrastructure du pays, ici comme ailleurs. Et pourtant, la majorité de ces immeubles appartiennent aux individus, non pas à l’État.Combien de maisons gingerbread restent encore debout à Port-au-Prince et à Jacmel après le tremblement de terre de 2010 ? N’est-ce pas criminel de ne pas faire un minimum de réparations – un coup de peinture, un renforcement de la structure – pour entretenir cet autre patrimoine ? On me dit que les propriétaires – souvent à Miami, à Paris ou à Montréal – ne veulent pas voir leurs impôts augmenter. Ce n’est pas seulement les tremblements de terre qui effacent la mémoire architecturale. L’État n’est que l’ensemble de ces individus qui, de façon collective, doivent maintenant se mobiliser face à la tâche monumentale de la reconstruction.De retour à New York, j’ai lu l’article de Dany Laferrière qui décrit le silence de la première nuit après le tremblement de terre passée dehors (LeMonde du 16 janvier 2010). Avec Dany et Rodney Saint-Éloi, on est à table la veille du festival littéraire au moment du séisme, attendant d’autres invités, prêts pour la célébration et à la dégustation de nouveaux mets littéraires. Cette nuit, effectivement, il n’y a pas de sirènes ; une fois, entre répliques, deux hélicoptères passent, mais aucun secouriste ne vient à l’aide. Tu t’en souviens trop bien, chère Sergine. Le lendemain, ce n’est pas beaucoup mieux.Et comme à New York après le 11 septembre 2001, il fait drôlement beau à Port-au-Prince. Des corps (vivants ? décédés ?) passent sur des brancards, des milliers de piétons avancent, hébétés parfois, déterminés.Vendredi encore, comme des fourmis, des centaines de personnes – surtout des garçons et de jeunes hommes – fouillent ces piles de résidus (qui quelques jours auparavant étaient des maisons, des magasins), à la recherche d’un être cher, d’un objet personnel ou de quoi manger.J’ai peur pour eux, tout risque partout de s’écrouler.Le deuil comme le traumatisme est collectif. La terre ne cesse de bouger.Comme les milliers de boulets de canon entassés près de la Citadelle tout en haut de Bonnet-à-l’Évêque, le patrimoine haïtien dépasse l’imaginaire.Haïti, le mot qui fait peur aux planteurs du XIXe siècle.Haïti, qui donne espoir à tous les peuples enchaînés, soumis.Peuple fier, digne, debout.Anacaona. Makandal. Boukman.Toussaint Louverture.Christophe, Pétion, Dessalines.Noms de héros, d’héroïnes qui résonnent, que l’on souffle à traversle lambi immortalisé par Albert Mangonès : le nègre marron.Le pays marron.Firmin qui dépasse Gobineau. Price-Mars qui précède de très loin la « créolité », valorisant ce folklore, le fond musical, paysan et créole haïtien.Roumain, Alexis, Chauvet : les lettres classiques, universelles.Les milliers de peintres, chanteurs, danseurs. Le kompa et la musique rasin. Le son du vaksin. Les sculpteurs. Tant de poètes, dramaturges, écrivains. Le fond spirituel vodou : syncrétique et égalitaire avec ses lwa de la vie et de la mort, pour les rires et les larmes, pour guérir.La diaspora incarnée par les stars du XXIe siècle, nommées Michaëlle Jean, Emeline Michel, Wyclef Jean, Edwidge Danticat.Tragique, humaine. Le rire haïtien, unique.Le vétiver, le Barbancourt, on exporte même des mangues. Mais le café est si bon qu’il est consommé de préférence et principalement au pays. Chère Sergine, nous partageons ton deuil incommensurable.Le lendemain du séisme, le pays est k.o., c’est le chaos.Faire du chaos des premiers jours une fondation solide pour une nouvelle solidarité internationale, une coumbite à la Roumain, un konbitisme proposé par Odette Roy Fombrun. (Le lendemain du tremblement de terre, à quatre-vingt-douze ans, le « Trésor national vivant » est debout sur le toit de sa maison par terre qui ressemble à un parking cassé.)Faire le deuil, balayer les larmes qui reviennent comme ces répliques qui vont cesser. S’en souvenir, à jamais.Mettre un point ; commencer un nouveau chapitre. Thomas, il faut qu’on se voie ! me dit Georges Anglade le soir où je le quitte avant de partir au Cap. Remettre les conversations, à jamais.À Delmas, faire une nouvelle fondation pour la maison de Frankétienne, autre Trésor, le nobélisable de la Galaxie Chaos-Babel.Construire un nouveau Palais, un nouvel État démocratique.À Port-au-Prince, dans les autres villes sinistrées de 2010 (Jacmel, Léogane, Petit-Goâve…), construire des écoles, créer des emplois.Relier les grandes villes de Jérémie et du Cap à la capitale. Réparer la blessure encore ouverte de la ville du bicentenaire inondée, Gonaïves, en reboisant les mornes dénudés.Ce n’était pas un hasard que je me suis trouvé à Port-au-Prince le 12 janvier 2010. Au lendemain, le coeur brisé, je suis pourtant confiant.Avec Lody Auguste, nous disons : « Haïti est en train de renaître. »Chère Sergine, nous attendons – de ta beauté, de ta force, de ton histoire et celles de ton pays – de nouvelles créations qui nous éblouiront, nous enrichiront dans l’expérience partagée. Solidaires.Par ton exemple, chère Sergine, je vois que les plus éprouvées peuvent être les plus fortes. Comme ton pays, tu as hérité non pas de la mort, mais de la liberté.



