Comme Bonjour New York, La Petite Robe noire et autres textes est un recueil d’articles de Françoise Sagan, d’abord parus dans la presse (Vogue, Elle, Femme, Egoïste, Le Nouvel Observateur) puis regroupés en « carnets » par les éditions de l’Herne, et désormais en volume au Livre de Poche.

Sagan à la mode. Sagan et la mode. Ou plutôt Sagan et l’élégance puisque de couture il ne sera question que dans les premiers textes. Les autres étant centrés sur le cinéma, les livres avant des Lettres de Suisse qui abordent tous les sujets précédents.
Le premier article donne la note :
« On ne s’habille pas pour éblouir les autres femmes ou pour les embêter. On s’habille pour se déshabiller. Une robe n’a de sens que si un homme a envie de vous l’enlever. Je dis bien enlever pas l’arracher en hurlant d’horreur ».
Les hommes se souviennent des robes, remarque Sagan. On se souviendra de cette petite robe noire, de ces pages magnifiques sur Yves Saint Laurent : « - Qu’est-ce qui déclenche une robe ? Et Saint Laurent, sur un ton d’évidence : - Un geste. Toutes mes robes viennent d’un geste ».
Deux créateurs se rencontrent, leurs modes d’expression différent, se retrouvent : la peur avant de « trouver » le geste, la passion, et « la tristesse, le vide à la fin ». Surtout pour Yves Saint Laurent, après chaque collection de haute couture, la cruauté de « donner le jour à des choses qu’on ne reverra plus et dont l’essence même est de disparaître. La mode est ce qui se démode ».
Dans ces pages, aussi, l’obsession pour l’élégance de Peggy Roche (« le style, absolument ») et des portraits (Adjani, Deneuve, Noureev, Helmut Newton) par un écrivain fasciné par les envers, les « biais », les fêlures, qui se passionne pour l’œuvre en mouvement, dans son laboratoire, les mystères de la création. Ce qu’elle appelle, dans un article consacré à Fellini, les « détails » signifiants :
« Nous ne parlerions que de détails, mais les détails, on le sait, sont parfois, non pas révélateurs, ce qui est un terme de police, sont parfois plus passionnants que les lieux communs les plus sérieux ».
Ce portrait de Fellini est somptueux, une rêverie tout autant géo- que cinémato-graphique. Sagan part pour Rome en train, non pour une Modification, mais par refus des avions et de « leurs altitudes inhumaines ». Elle veut, en train, « suivre la douce courbure de la Terre pour retrouver cet homme né de notre planète, sorti de sa glaise et sensible à sa rotation », entrer dans un paysage italien qui deviendra fellinien :
« C’était une campagne de vignes, une campagne plate que sanglait la mer, qui filait derrière ma fenêtre. C’était une campagne ostensiblement italienne et c’était celle de Fellini, je ne sais pas pourquoi. Car s’il y a dans ma mémoire visuelle une campagne Visconti, une campagne Antonioni, une Bolognini, etc., il n’y a en revanche pas de campagne Fellini. Celle-ci, sous mes yeux, n’était pas belle au demeurant. C’était une plaine triste aux maisons délabrées et pauvres, une plaine sans charme. Mais si le talus que bordaient les rails était fané, de l’autre côté c’était la bleue, la somptueuse Méditerranée qui s’y roulait. Et dans cette opposition se glissait ce mélange d’entente et d’ironie, de complicité et de sévérité qui me semblait être le rapport même de Fellini avec son Italie ».
Sagan et le cinéma, Sagan et le rire, un texte qui justifierait à lui seul la lecture de tout le volume, le rire compagnon d’une vie, « cuirasse », « arme blanche » et « armature », « minerve » :

« Rire. Faire rire. Rire soi-même. Revenir au plus naturel de cette personne privée, que l'on fréquente si peu et qui est soi-même, et déclencher en elle quelque chose qui est à la fois l'enfance, l'adolescence et la vieillesse, quelque chose qui relie notre appartenance à ce monde et notre recul devant lui : notre goût avoué de la vie et notre refus dédaigneux de la mort, réunis ne serait-ce que trois minutes, mais trois minutes d'un bel et bon orgueil.
Car, qu’il soit féroce ou doux, suave ou sardonique, le rire, comme le soulignent l’adjectif et la locution qu’on lui accole si volontiers ; l’irrésistibilité et les éclats, le rire est avant tout cette preuve éclatante et irrésistible de notre liberté première ».
Sagan et ses livres, ceux qu’elle lit et commente (la correspondance Sand/Musset, Fitzgerald, Sartre), ceux qu’elle écrit, s’interrogeant sur la question de l’éphémère, de son image :
« L’image qu’on a donnée de moi pendant des années n’est pas forcément celle que j’aurais souhaitée, par moments, mais finalement elle était plus plaisante que d’autres. Tout compte fait, whisky, Ferrari, jeu, c’est une image plus distrayante que tricot, maison, économies… De toute manière, j’aurais eu du mal à imposer celle-là ».
CMFrançoise Sagan, La Petite Robe noire et autres textes, Le Livre de Poche, « Biblio roman », 283 p., 6 €.
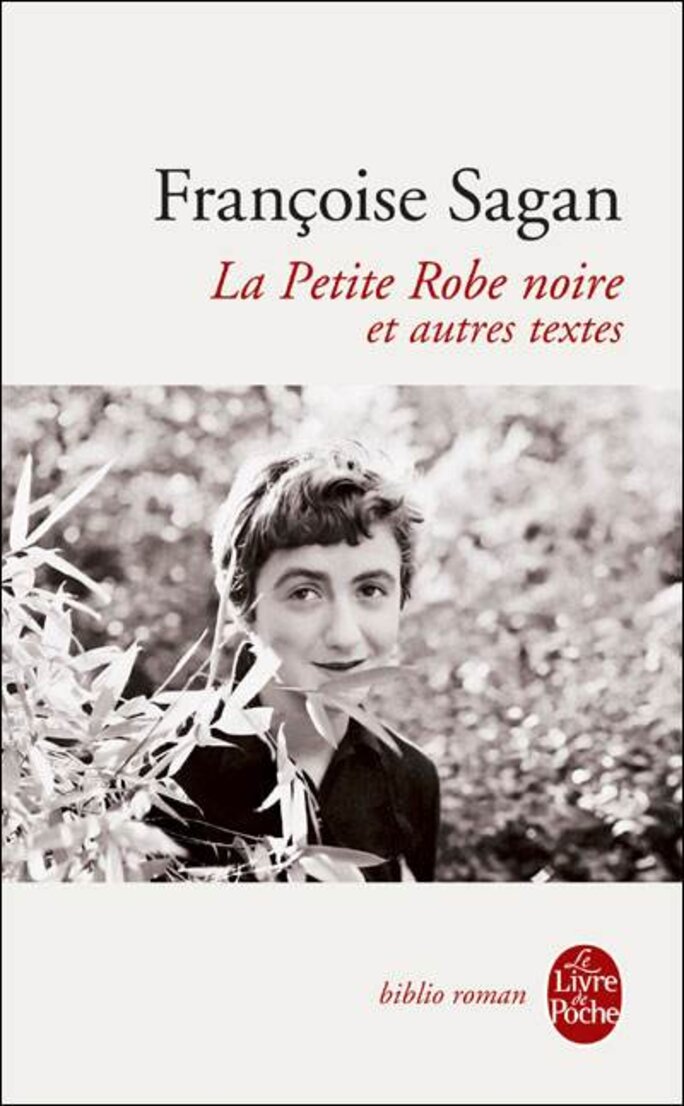
Agrandissement : Illustration 3

Voir aussi :
Françoise Sagan, Bonjour New York
Françoise Sagan, Toxique
Françoise Sagan, Des Bleus à l'âme



