Un adulte français sur dix a été victime de violences sexuelles pendant son enfance. Il est donc possible que les patients des TMR fassent partie de ces millions d'adultes, ou que certains patients des TMR en fassent partie. C'est un fait que je ne nierai pas.
Ce que je souhaite interroger, dans le présent billet, c'est l'éventuelle singularité du profil social des clients des TMR, parmi les victimes de violences sexuelles, qui ont témoigné auprès de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) (1).
La CIIVISE a reçu 30 000 témoignages, et mis en évidence les grandes « tendances » parmi eux, les informations qu’on retrouve d’une victime à l’autre, et qui doivent aider, notamment, à mieux prévenir et prendre en charge les violences sexuelles infligées aux enfants.
Dans un billet précédent, j’ai souligné les traits communs et saillants des psychothérapies abusives, dites de la « mémoire retrouvée » :
- le genre féminin et les moyens financiers des victimes,
- le caractère incestueux ou incestuel des souvenirs « retrouvés »,
- le fait que ces « souvenirs » émergent durant la thérapie, que cela ne constitue pas le motif de consultation initial des patients,
- la contrainte de rupture avec les proches, l’isolement.
Les constats qui suivent sont extraits du grand rapport public de la CIIVISE, de novembre 2023, même s’ils ne figurent pas entre guillemets, pour en faciliter la lecture. Les références précises des pages sont indiquées. (Je ne reprends bien sûr pas la totalité du rapport, qui mérite que chacun le consulte. J'en aborderai peut-être d'autres parties, dans de prochains billets.) Les phrases en italique sont ma comparaison entre les données de la CIIVISE et les informations connues sur les patients de TMR.
1] Les points communs entre les victimes entendues par la CIIVISE et les patients en TMR
- 8 victimes d’inceste ou de violences sexuelles sur 10 sont des femmes (83%) et 2 sur 10 des hommes (17%) (page 201).
- Près de 9 agresseurs sur 10 sont des hommes (87%) (page 201).
- Si les enquêtes en population générale indiquent que l’agresseur incestueux est le plus souvent extérieur à la famille nucléaire, ce n’est pas le cas des témoignages confiés à la CIIVISE au sein desquels l’agresseur est le plus souvent un homme plus âgé qui fait partie de la famille nucléaire ou recomposée, en premier lieu le père (page 206).
- L’agresseur est un homme pour plus de 9 victimes sur 10 (96%), il est le plus souvent majeur (77%) et est en contact avec des enfants à titre professionnel dans plus d’un cas sur quatre (27%). C’est-à-dire qu’il exerce une profession dans laquelle il interagit avec des enfants quotidiennement, comme professeur, animateur, pédiatre, etc. C’est le plus souvent le père (30%), le grand frère (22%) et l’oncle (15%) (page 206).
=> La patientèle en TMR est majoritairement composée de femmes.
- 81% des violences sexuelles rapportées ont lieu au sein de la famille, 22% au sein de l’entourage proche, 11% au sein d’une institution, 8% au sein de l’espace public (page 202).
- Les femmes rapportent davantage de violences sexuelles au sein de la famille et/ou de l’entourage (94% contre 77% des hommes) (page 202).
=> La patientèle en TMR voit apparaître exclusivement des souvenirs incestueux ou incestuels, comme la majorité des victimes entendues par la CIIVISE.
- Pour près de 6 victimes sur 10 (58%), les violences ont débuté avant leurs 10 ans ; en moyenne, les victimes avaient 8 ans et demi au début de violences (page 203).
- Plus l’agresseur est proche de la victime, plus les violences débutent tôt. Au sein de la famille, l’âge moyen est de 7 ans et demi au début des violences sexuelles (7,6 ans). Plus de 6 victimes sur 10 avaient moins de 10 ans (63%) (page 203).
- Le sexe a un impact très limité sur l’âge au début des violences. En moyenne, les filles avaient 7 ans et demi au début des violences (7,6 ans), les garçons près de 9 ans (8,8 ans) (page 203).
=> La patientèle en TMR voit apparaître exclusivement des souvenirs d’une époque dont elle ne se souvient pas, ce qui est cohérent avec l’âge des violences subies par les victimes entendues par la CIIVISE.
- Seule une victime sur 10 a révélé les violences au moment des faits (13%) : c’est le cas de 8% des hommes et de 14% des femmes (page 211).
- Le fait de révéler ou non les violences au moment des faits est très finement lié à la sphère de vie dans laquelle les violences ont eu lieu. Les victimes au sein de la famille sont moins d’une sur 10 à en avoir parlé tout de suite (9%). Elles sont un peu plus d’une sur 10 seulement au sein de l’entourage (page 211).
- Lorsqu’elles révèlent les violences au moment des faits, les victimes s’adressent le plus souvent à des membres de leur famille : à leur mère (66% en moyenne ; 75% au sein de la famille) ; à une sœur ou à un frère (23% en moyenne ; 19% au sein de la famille) ; à leur père (19% ; 15% au sein de la famille) (page 211).
- Plus de 6 victimes sur 10 ont révélé les violences plus de 10 ans après les faits (63%) ; c’est encore plus le cas des hommes, dont les ¾ ont attendu plus de 10 ans après les faits pour révéler les violences (75%) (page 212).
- Outre le sexe de la victime, le fait de révéler les violences tardivement est très finement lié à la sphère de vie dans laquelle les violences ont eu lieu. Les victimes au sein de la famille sont 62% à en avoir parlé plus de 10 ans après ; c’est le cas de 56% des victimes au sein de l’entourage et de 29% de celles au sein de l’espace public (page 212).
- Lorsqu’elles révèlent des violences tardivement, les victimes le font le plus souvent parce que : elles pensaient que cela allait leur faire du bien – c’est le cas de 6 victimes sur 10 (61%) ; elles voulaient protéger un enfant – c’est le cas de près d’une victime sur 5 (22%) ; à peine plus d’une victime sur 10 révèle les violences parce qu’elle voulait que l’agresseur soit puni (16%) et elles sont presque autant à parler précisément parce que l’agresseur ne pourra pas être puni (les faits étaient prescrits pour 6% d’entre elles, l’agresseur était décédé pour 9%) (page 214).
=> La patientèle en TMR fait exclusivement état de faits subis enfant, alors qu’elle est adulte. Cela est cohérent avec le caractère incestueux ou incestuel des violences subies.
- Une victime sur deux n’a bénéficié d’aucun suivi médical ou psychologique à la suite des violences (53%) (page 224).
- Parmi celles qui en ont bénéficié, une victime sur 5 a bénéficié d’un suivi auprès d’un médecin généraliste (21%), une victime sur 5 a été hospitalisée en psychiatrie ou pédopsychiatrie (22%), plus de 7 victimes sur 10 ont bénéficié d’un suivi psychologique (76%), moins d’une victime sur 5 a bénéficié de soins spécialisés du psychotraumatisme (17%) (page 224).
- Plus la victime appartient à une CSP +, plus elle a de chances de bénéficier d’un suivi spécialisé du psychotraumatisme. C’est le cas de 7% des ouvriers et de 10% des professions libérales. De même, on observe que les victimes pour lesquelles les violences ont eu lieu dans une grande ville sont 10% à avoir bénéficié de soins spécialisés du psychotraumatisme, quand ce n’est le cas que de 8% de celles pour lesquelles les violences ont eu lieu dans une petite ville (moins de 20 000 habitants). 14% des victimes pour lesquelles les violences ont eu lieu hors de France ont bénéficié de soins spécialisés du psychotraumatisme, ce qui permet de penser le retard de la France en matière d’organisation de ces soins (page 225).
=> Seule une minorité des victimes entendues par la CIIVISE a bénéficié d’un soutien psychologique. La patientèle des TMR a le même profil sociologique que cette minorité (CSP+ et vivant en milieu urbain).
2] Les différences ou la singularité des patients à la « mémoire retrouvée »
- Plus de 4 victimes sur 10 (43%) déclarent que les violences ont eu un impact négatif sur leur vie professionnelle. Comme dans le cadre scolaire, le travail constitue pour une partie des victimes un refuge et un espace de stabilité ; toutefois, nombre d’entre elles rapportent des interruptions de carrière, le poids du manque de confiance en soi sur leur vie professionnelle, et un rapport difficile à l’autorité et à la hiérarchie (page 224).
- Pour les hommes et les femmes, la survenue de violences sexuelles avant 18 ans accroît la probabilité d’être au chômage ou inactif (page 340).
=> La patientèle en TMR est bien insérée professionnellement.
- Même lorsqu’elles révèlent les violences tardivement, les victimes s’adressent le plus souvent à des membres de leur famille – et ce, quelle que soit la sphère de vie dans laquelle ont eu lieu les violences : à leur mère – c’est le cas d’une victime sur 2 (51%) ; à leur conjoint – c’est le cas d’une victime sur 2 (47%) ; à une sœur ou à un frère – c’est le cas d’un peu plus d’une victime sur 3 (36%) ; à leur père – c’est le cas d’une victime sur 5 (23%). Elles sont une sur deux à s’être adressées à un professionnel (enseignant, psychologue, médecin, etc) (page 213).
=> La patientèle en TMR commence exclusivement par faire part de la violence sexuelle qu’elle a subie enfant à son thérapeute. Autrement dit, c’est toujours le thérapeute qui entend les faits en premier, alors que, pour les victimes entendues par la CIIVISE, cela peut aussi être la mère ou le conjoint.
- Outre les conséquences mentionnées pour l’ensemble des victimes, les principales conséquences de la révélation de violences sexuelles incestueuses sont : la rupture du lien avec les parents (21%) et/ou avec les frères et sœurs (19%) ; le départ volontaire du domicile familial (12%) ; l’exclusion du domicile familial (5%) ; la séparation des parents (4%) ; la modification des droits de garde si les parents sont divorcés (2%) (page 214).
- Plusieurs facteurs semblent favoriser la rupture des liens avec la famille. Plus les violences ont commencé tôt et ont duré longtemps, plus il est probable que la révélation conduise la victime à quitter le domicile familial et à rompre les liens avec ses parents ; les victimes qui se sont adressées à un professionnel au moment des faits (santé, éducation nationale, forces de l’ordre) ont plus de chances de rompre les liens avec la famille : une victime sur 4 (25%) qui s’est confiée à un professionnel a quitté le domicile familial et a rompu les liens avec les membres de sa famille (23%) ; la présence d’un contexte de violences au sein de la famille (violences conjugales, violences verbales, physiques, psychologiques sur les enfants) accroît la probabilité que le juge des enfants se saisisse du dossier (page 214).
- La révélation des violences a conduit près d’une victime sur 10 (8%) à rompre avec son ou sa partenaire (page 222).
=> Les ruptures avec l’entourage, même familial, sont minoritaires parmi les victimes entendues par la CIIVISE, alors qu’elles sont systématiques chez la patientèle en TMR (même si elles ne concernent pas 100 % de l’entourage).
=> Seul un quart des professionnels (santé, éducation nationale, forces de l’ordre) a une prise en charge qui conduit à une rupture des victimes entendues par la CIIVISE, avec leur entourage. Mais, tous les thérapeutes de la « mémoire retrouvée » conduisent leur patientèle à rompre avec tout ou partie de son entourage.
Ainsi, ce n’est pas le traumatisme incestueux ou incestuel subi par les patients des TMR, qui les singularise des victimes de violences sexuelles entendues par la CIIVISE. C’est leur catégorie socioprofessionnelle, qui correspond au public qui bénéficie de la meilleure prise en charge psychologique, en population générale. C’est également la rupture avec tout ou partie de l’entourage, qui n’est pas majoritaire hors patientèle des TMR, même si on considère les victimes qui se sont adressées d’abord à un professionnel.
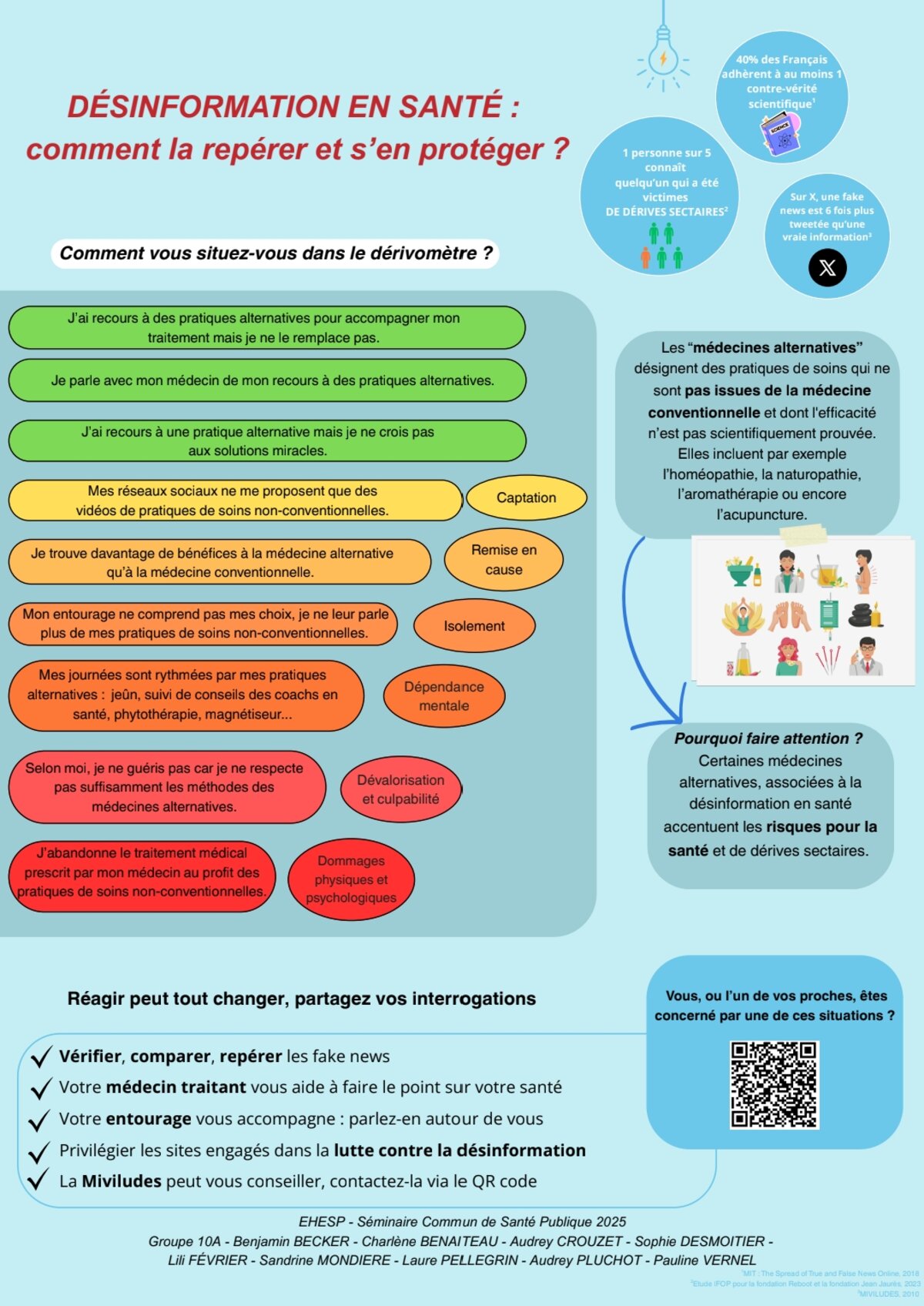
Agrandissement : Illustration 1
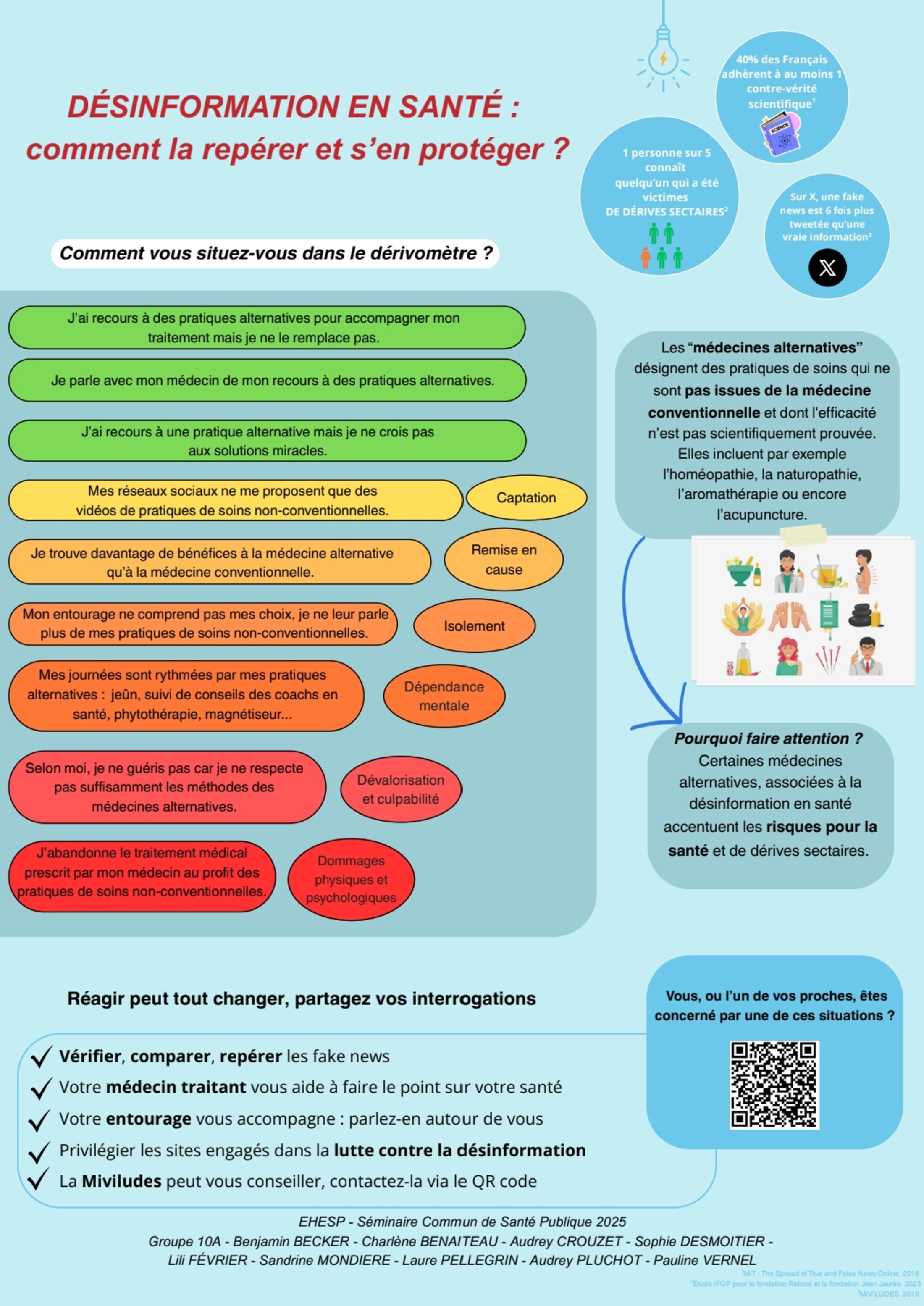
*****
Crédits et sources :
(1) Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants. Violences sexuelles faites aux enfants : « On vous croit », rapport public (20/11/2023). Url : https://www.ciivise.fr/le-rapport-public-de-2023



