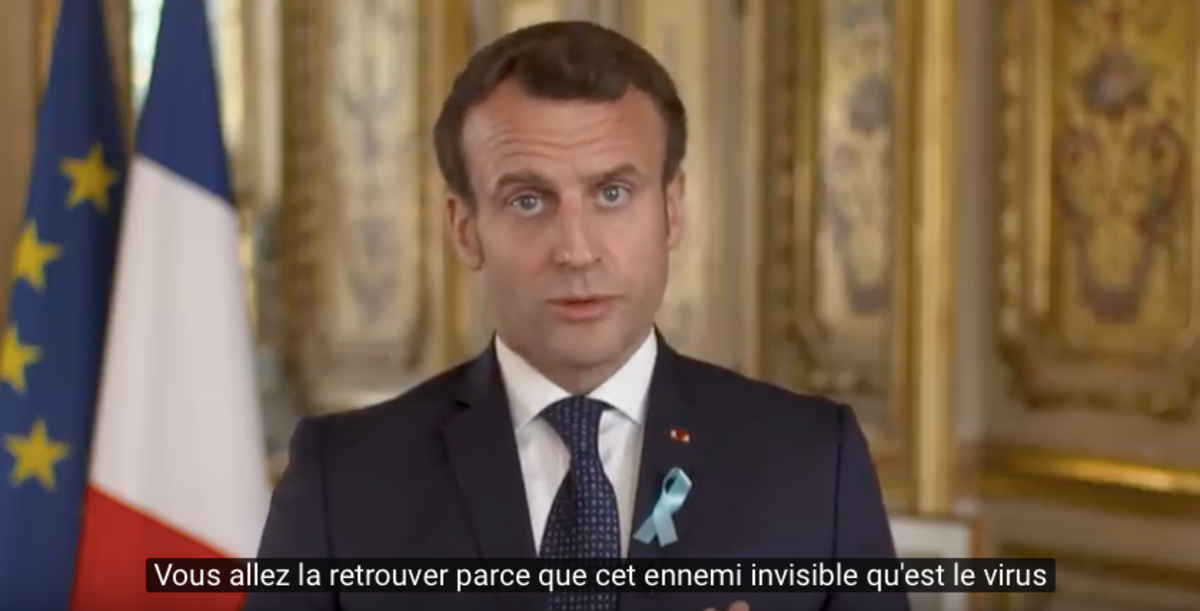
Agrandissement : Illustration 1
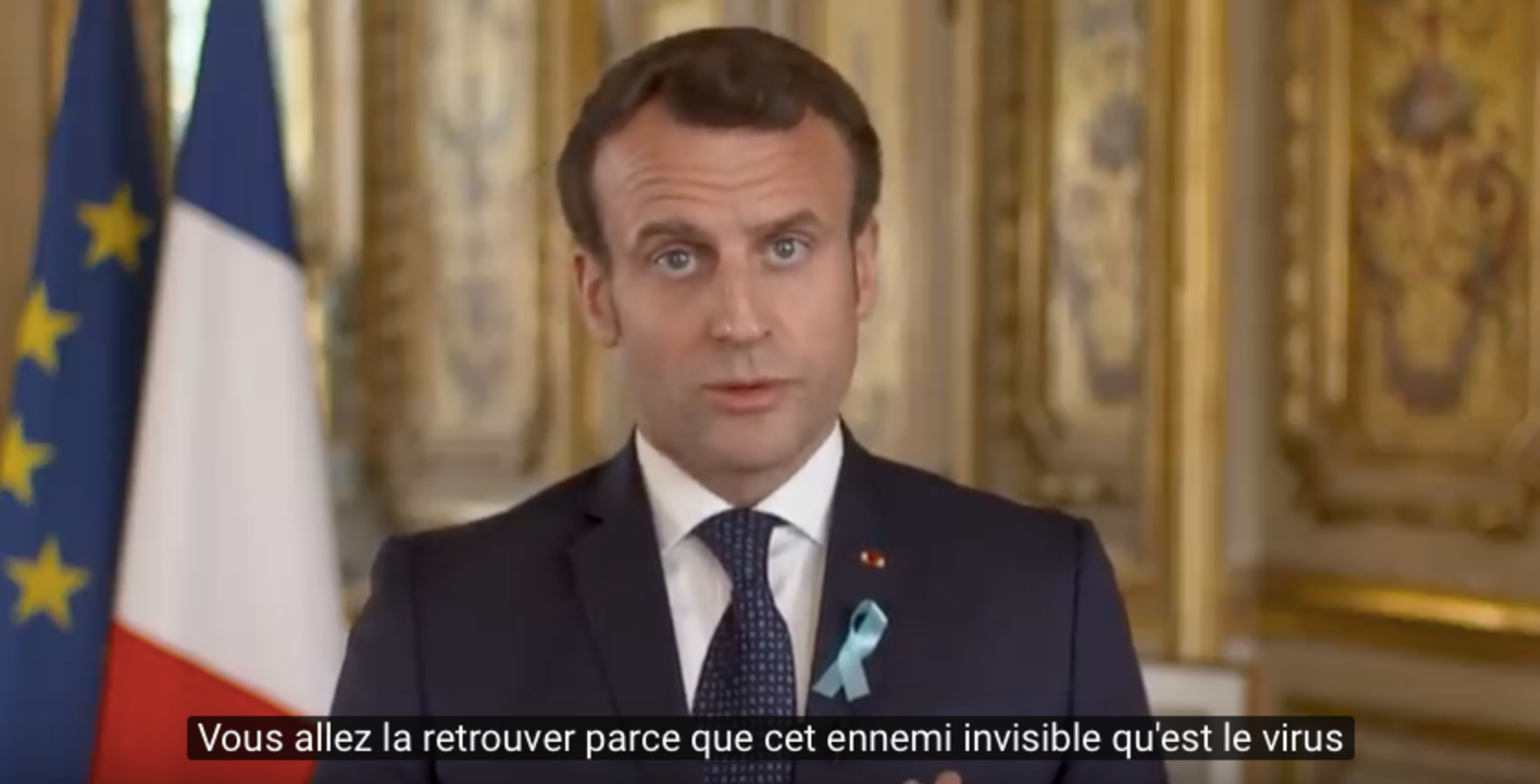
« La grande incertitude des données de la guerre est une difficulté particulière, car toute action doit, dans une certaine mesure, être planifiée dans une semi–obscurité qui, le plus souvent, à la manière d’un brouillard ou d’un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou anormales. »1
Carl von Clausewitz
« La parole prononcée est d’argent, celle qui n’est pas prononcée est d’or. »2
Léon Tolstoï
« La guerre, c’est la paix »3
Georges Orwell
Quelle « drôle de guerre », à première vue, que celle menée contre un ennemi invisible. Pourtant, dans son allocution à Genève en date du 11 février 2020, le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé : « le coronavirus est l’ennemi public numéro un et il n’est pas traité comme tel ». La phrase a été suivie des faits lorsque plusieurs chefs d’État, au premier rang desquels le Président Macron, ont successivement déclaré : « nous sommes en guerre ». Le langage belliciste a ensuite été déployé par l’exécutif et les formules ont prospéré : les Français sont « alliés de guerre », les soignants sont « en première ligne » ; « au front », l’épidémie est « meurtrière » ; elle « avance » ; elle « recule ». Ces termes recèlent une charge linguistique forte qui, en temps de paix, ne laisse personne indifférent.
Nul pouvoir n’est muet4. L’utilisation d’un lexique martial par le politique peut poursuivre plusieurs finalités. D’une part, il prend la forme d’une figure rhétorique, un message brutal envoyé à la population afin de produire un électrochoc sur les cœurs et les esprits. Dès lors, la population comprendrait rapidement l’urgence de la situation et se plierait plus facilement aux mesures à venir là où les termes « lutte », « défi » ou « crise » ne produiraient pas une prise de conscience suffisante. D’autre part, il est un outil propre à la communication de crise permettant au politique de rassoir son autorité. Si la guerre sous-entend l’idée de libération, elle implique nécessairement, en cas de victoire, que des « héros de la France libre » se soient battus pour elle. L’héroïsme des agents de l’État et de chaque allié tel que celui des soignants et des bénévoles est alors salué et applaudi. Les guerres sont, en ce sens, « bonnes » et « utiles » à l’État sur le plan symbolique puisqu’elles légitiment son existence et lui permettent de justifier le maintien de son autorité. Rappelons-nous François Hollande, à l’ouverture de son discours devant l’Assemblée Nationale, lorsqu’il déclara que « la France est en guerre » contre le terrorisme. Dans un contexte de crise de l’État-Providence5 quant à l’efficacité et la légitimité de ce dernier, il est intéressant de voir que la terminologie guerrière, employée pour traiter de la politique intérieure, devient monnaie courante depuis quelques années.
Dans l’Histoire, la guerre est généralement entendue lato sensu comme un conflit armé. Rousseau estime que « la guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats »6. La tradition moderne du droit de la guerre entend donc séparer les soldats des civils où les premiers sont censés combattre afin d’épargner les seconds. En outre, la guerre se déclare généralement contre un État ou contre une faction dans le cadre d’une guerre civile et non contre une maladie. Là encore le glissement est notable et devient source de problématiques lorsqu’on sait, depuis Camus, que mal nommer un objet philosophique, et non les choses, c’est ajouter au malheur de ce monde7 .
Lorsque le Président de la République a déclaré : « cet ennemi invisible qu’est le virus, n’est pas un ennemi invincible »8, il faut comprendre que la notion d’ennemi est centrale dans l’action menée par les autorités. S’il est invisible il n’est pas moins réel. S’il n’est pas invincible, il n’est pas moins puissant. En d’autres termes, le virus est suffisamment dangereux pour être qualifié comme tel par le chef des armées. L’emploi du mot n’est pas anodin. Il exprime la volonté du politique de désigner précisément l’entité à combattre. Si nous estimons qu’un virus s’analyse davantage comme une « menace » plutôt que comme un « ennemi », il s’avère intéressant de déplier le concept sur le terrain des idées en évoquant, notamment, la théorie de Carl Schmitt.
Ce philosophe et juriste allemand du XXe siècle, dont les accointances sulfureuses avec le IIIe Reich sont avérées sur le plan historique, a théorisé les rapports qu’entretiennent la guerre et le politique. En souscrivant au nazisme sous les exhortations de Martin Heidegger dès 1933 il restera affilié au régime jusqu’en 1942. Le syntagme ami/ennemi (Freund und Feind) qu’il a développé dans son ouvrage intitulé La notion du politique, reste pertinent pour interpréter le langage belliciste employé par les dépositaires de la force légitime.
Selon cette conception politique : qu’est-ce qu’un ami ? Qu’est-ce qu’un ennemi ? Dans la situation actuelle : Qui est l’ami ? Qui est l’ennemi ?
I. La guerre ou la France confinée loin de l’ennemi public
Tout le monde l’a compris : le Covid-19 est « l’ennemi de l’humanité »9 et de la France. Tentons de comprendre en quoi cette qualification est tout à la fois séduisante et dangereuse.
À titre préliminaire, il convient de rappeler ce que Carl Schmitt entend par « politique ». Selon l’auteur la notion de politique recoupe trois autres notions : l’homogénéité, l’intensité et l’hostilité. En premier lieu, la notion d’homogénéité présume l’existence d’un groupe de semblables. Il faut une « certaine identité » pour que « le peuple […] advienne à l’existence politique »10. En deuxième lieu, la notion d’intensité implique que l’association des membres d’une communauté atteigne le « plus haut degré d’intensité d’union (Verbindung) »11. Les motifs de cet intensif sentiment d’appartenance peuvent être culturels, religieux, économiques etc. C’est ici qu’apparaît l’amitié nationale. En troisième lieu, la notion d’hostilité correspond à l’apparition furtive d’un ennemi qui menace la cohésion de l’ensemble. C’est ce sur quoi nous porterons notre attention.
L’ennemi est étymologiquement un « faux-ami ». Il menace de tuer l’homogénéité initiale formée par le groupe tout entier. Sa mise en lumière témoigne d’une situation exceptionnelle. Si l’adversaire, le rival et le concurrent sont des synonymes, ils ne doivent toutefois pas être confondus avec la notion qui nous préoccupe. En dépit des seules traductions que permettent la langue française, l’ennemi au regard de la théorie schmittienne, doit être regardé comme un « ennemi public » (hostis) et non comme un « ennemi privé » (inimicus). Le danger qu’il suppose est celui de pouvoir « miner l’État de l’intérieur ». C’est pourquoi, il est un « autre », une « altérité radicale », un corps strictement étranger qu’il faut, « tantôt réduire, tantôt expulser de l’unité politique organique »12. Par conséquent, la détermination d’un ennemi est, selon le philosophe allemand, la condition d’existence sine qua non du politique. Pour lui : le politique n’existe que parce qu’un ennemi est désigné. Pour Emmanuel Tuchscherer le syllogisme est le suivant :
« Je ne peux vivre politiquement sans ennemi. Or l’ennemi ne peut être qu’un être réel, concret, qui me fait face et dont j’éprouve la résistance. Il m’appartient donc de le désigner comme tel et de le combattre. »13
En l’espèce, si le virus est un ennemi pour la Nation c’est parce qu’il est mortel. Il peut donc, éventuellement, mettre à mort les parties du Tout jusqu’à anéantir ce qui fondait l’unité préétablie du corps politique. En outre, il a le pouvoir de désunifier de l’intérieur la collectivité et miner l’amitié nationale. En tant que maladie invisible, elle est à la fois nulle-part et partout. Elle crispe, elle stresse, et s’amuse de jouer sur les peurs de tout un chacun. L’exemple de Mélina14, infirmière anesthésiste au CHU de Montpellier, est frappant. Elle a quitté son logement sous la pression de ses propriétaires apeurés d’être infectés par le virus. Selon la plaignante, les bailleurs septuagénaires insultaient les occupants ; coupaient le chauffage, l’eau chaude, l’antenne de la télévision etc. L’infirmière a aujourd’hui déposé plainte. En outre, gardons à l’esprit les vidéos de ces consommateurs qui s’arrachèrent des mains des paquets de pâtes par peur de manquer de nourriture lors du confinement. Dans ces conditions, il est certain qu’en plus de tuer, le virus réactive des comportements archaïques égoïstes et grégaires qui mettent à mal le sentiment d’appartenance des individus à une collectivité homogène.
Dans son ouvrage, le philosophe controversé considère que « La guerre nait de l’hostilité, celle-ci étant la négation existentielle d’un autre être. La guerre n’est que l’actualisation ultime de l’hostilité ». Pour qu’une guerre puisse être déclarée et menée contre un ennemi, la mise à mort de quelques parties du Tout ne doit être que « virtuelle »15 c’est-à-dire éventuelle, probable, possible. Il n’est pas nécessaire que la menace soit efficiente, mais simplement envisageable. Dès le moment où la menace atteint un point critique, un climax, alors le politique est en guerre. En tout état de cause, nul n’ignore que le virus menace réellement le pays et a provoqué la mort de milliers de personnes. « L’ennemi est là » selon les mots du Président de la République. Il est concret. Par conséquent, la guerre a lieu.
Toutefois, la terminologie employée par le politique selon laquelle une « guerre » est menée contre le virus considéré comme un « ennemi public » n’est pas dénuée de tout danger. Il faut s’interroger sur le nombre d’appels au 17 par certains pour dénoncer le non-confinement. Si le virus est l’ennemi, les personnes qui ne respectent pas le confinement ne pourraient-elles pas être considérées, par le corps politique, comme appartenant au camp de l’ennemi ? Et qu’en serait-il des personnes malades ? Faudrait-il les extraire du corps politique sur la base de la vision organiciste mentionnée plus haut ? Nous martelons formellement dans cet article que de telles considérations seraient abjectes.
C’est pourquoi, il a été démontré qu’un lexique martial peut modifier dangereusement les représentations au point de justifier la délation et l’ostracisme. La réversibilité et la polysémie du syntagme ami/ennemi nous pousse nécessairement à avertir le lecteur de l’usage manipulatoire qu’il peut en être fait et nous invite par conséquent à développer ce qui suit.
II. La paix ou l’ami retrouvé
Schmitt insiste : « les concepts d’ami et d’ennemi doivent être entendus dans leur acception concrète et existentielle, et non point comme des métaphores ou des symboles »16. Dès lors, le couple ami-ennemi ne réside pas seulement dans le ciel des idées, mais s’articule ici-bas comme élément de la réalité vécue et ressentie par tous.
La détermination d’un ennemi conforte la Nation dans son identité. Selon le juriste de Plettenberg, l’ennemi est celui, sans lequel, nous ne pourrions savoir qui nous sommes. « Dis-moi ton ennemi et ta manière de le combattre, je te dirai qui tu es » constitue substantiellement la vision de Carl Schmitt. Le point positif à considérer le virus comme un ennemi public est paradoxal : cela nous réconforte. En effet, dire qui est l’ennemi permet de savoir qui ne l’est pas. C’est ici que la notion d’ami prend tout son sens.
Carl Schmitt explique que « tout ce qui n’est pas ennemi porte eo ipso [le nom] d’ami »17. La notion d’ami agit de manière négative, en creux, pour désigner le non-ennemi. Si l’ennemi est strictement le virus, la notion appliquée à la situation actuelle permet de considérer tout ce qui n’est pas le virus comme un ami. C’est en ce sens, qu’un individu enfreignant les règles du confinement ou une personne contaminée par le virus ne peuvent en aucun cas être assimilée à l’hostis (ennemi public) et demeurent ipso facto des amis. De ce fait, l’ami est retrouvé. Désigner la seule maladie comme un ennemi a pour conséquence de régénérer l’amitié du peuple tout entier : le sentiment d’appartenance. L’homogénéité première est réaffirmée. A ce moment précis, la prise de conscience de demeurer une nation unifiée s’exerce. L’homogénéité initiale, parfois oubliée ou mise à mal, se réactualise et, en même temps, s’intensifie contre l’ennemi commun. Selon le maître de conférence Lucien Faggion, « l’ennemi vient sceller, de manière efficiente, la policité du peuple unifié. L’ennemi est ce quelque-chose qui engendre l’être-politique de la nation »18 du seul fait qu’il la menace. Dès lors le gouvernement en appelle à l’union nationale pour que chaque individu à l’intérieur de la communauté puisse retrouver son plus haut degré d’intensité d’union.
Il convient d’ajouter que le couple ami/ennemi éclaire les rapports qu’entretiennent les États sur la scène mondiale. Pour rappel, le coronavirus n’a pas de frontières et ne peut être personnifié. Sur la base de ce qui a été développé en amont, un État engagé dans une guerre contre le virus doit aussitôt considérer les autres États comme « amis ». Cependant, plusieurs journaux et chaînes de télévision notamment Radio France Internationale considèrent que « la guerre des masques est déclarée »19. Un État qui entraverait la bonne marche de la lutte contre le Covid-19 d’un autre État devrait-il, au regard de cette approche, rejoindre le camp « ennemi » ? En réalité, il n’est nullement question de guerre. Tout au plus cette mésentente doit s’interpréter comme de la concurrence, de l'adversité, de la compétition et de l'émulation entre les États. En somme, quelques-unes des valeurs de l’amitié ! En définitive les défis mondiaux imposés par la pandémie ne peuvent être relevés qu’en acceptant l’interdépendance des États les uns avec les autres, mais il ne s’agit pas d’être dupe : la « préférence nationale » existe. Les chefs d’État l’ont bel et bien compris. À noter que le spectre d’un gouvernement mondial apparait en filigrane de ces raisonnements. Certes, cette forme d’organisation du pouvoir est terrifiante pour certains tandis que d’autres l’appellent de leurs voeux. Si un « pour » et un « contre » semblent, dès à présent, nourrir les débats de demain, il s’avère plus prudent de prôner l’amitié des États. Elle se nomme : « coopération internationale ». Hormis les problématiques de mise en oeuvre et d’efficience qu’elle a toujours impliquées, il ne fait aucun doute que le renforcement de cette collaboration est, à l’heure actuelle, plus que jamais nécessaire.
En tant que phare, l’ennemi jette la lumière sur nos valeurs communes, nos forces, mais aussi nos faiblesses. Il n’y a qu’à observer les divergences entre les pays concernant la politique de dépistage entre, d’un côté l’Allemagne, la Corée du Sud ou l’Italie qui testent tous les cas suspects et, de l’autre les pays comme la France qui choisissent de tester « moins, mais mieux » les seules personnes gravement malades. Chaque Nation tente donc de développer des stratégies. Bien que similaires, elles peuvent être très différentes car propres aux États selon des déterminismes historiques, religieux, économiques et culturels. Nos réactions et nos comportements individuels face à l’ennemi n’en sont pas moins significatifs et sont d’ailleurs utiles à la « connaissance de soi ».
Enfin, la reconnaissance de l’ennemi serait, selon cette conception radicale, un moyen d’aboutir plus sûrement à la paix. En ce sens, le philosophe et controversé Julien Freund, qui prolonge l’œuvre de Carl Schmitt affirme : « Ce qui nous paraît déterminant, c’est que la non reconnaissance de l’ennemi est un obstacle à la paix. Avec qui la faire, s’il n’y a plus d’ennemis ? Elle ne s’établit pas d’elle–même par l’adhésion des hommes à l’une ou l’autre doctrine pacifiste, […] sans compter que les moyens dits pacifiques ne sont pas toujours ni même nécessairement les meilleurs pour préserver une paix existante. »20. Le parallèle est remarquable avec Georges Orwell qui envisageait, dans son œuvre 1984, un ministère de l’information capable d’afficher « la guerre, c’est la paix ».
Par conséquent, la démonstration a eu pour but premier de clarifier la notion d’ennemi utilisée à multiples reprises par le pouvoir et d’en saisir les dangers interprétatifs. N’oublions pas que la notion de politique et le syntagme ami/ennemi ont été conceptualisé par Carl Schmitt pour faire perdre à la loi son rôle de protection des libertés. Dès lors, la pensée schmittienne, bien que pertinente pour interpréter la situation tragique que nous vivons, ne doit rester qu’une approche parmi d’autres. Les considérations idéologiques et non scientifiques à l’initiative de cette doctrine doivent être maniées avec précaution.
Davantage, la réflexion devra demain porter sur la « rupture » provoquée par le Covid-19. Beaucoup de citoyens estiment que « plus rien ne sera pareil » à la sortie de cette crise. Cela signifie-t-il que nous en avons fini complètement avec les libertés publiques ? Le lexique belliciste employé par le pouvoir doit, selon nous, être regardé de près, car nous ne devons pas perdre de vue que nos libertés sont en jeu. Comme l’exprime le docteur en anthropologie politique Catherine Haas : « si toute crise devient guerre, nous sommes condamnés à une guerre à perpétuité »21. Et, il n’est pas exceptionnel de voir un régime juridique de crise exceptionnel, à la base dérogatoire, être entériné, par la suite, dans le droit commun. Ce fut le cas, en partie, avec la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Dans ces conditions, tâchons de préserver cette unité et de ne pas nommer « ennemi » celui ou celle qui ne l’est pas à l’heure où plus d’un million de personnes dans le monde sont touchées par le coronavirus. « Mais ce n'était là que des abstractions, des chiffres, des statistiques, des informations. On ne peut souffrir pour un million d'êtres »22 raconte Hans Schwarz : le narrateur de l’ami retrouvé écrit par Fred Uhlman. Chacun chez soi, chacun pour tous, restons soudés, restons amis. A la manière de Hans et Conrad, deux adolescents que tout oppose, affirmons la lutte et la fraternité. Il y a de la camaraderie : qu’il y ait de l’amitié !23
- Carl von Clausewitz, De la guerre, Livre 2, traduction par Denise Naville, collection « Arguments », éditions de Minuit, 1955.
- Léon Tolstoï, La Guerre et la Paix, 1865-1869.
- Georges Orwell, 1984, 1948.
- Georges Baladier : « il n’y a pas de pouvoir nu et muet », Pouvoir sur scène, PUF, 1980.
- Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-Providence, 1981.
- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, chapitre IV, De l'esclavage, 1762.
- Albert Camus : « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde », Poésie 44, Sur une philosophie de l’expression, 1944.
- Emmanuel Macron, 2 avril 2020, Message du Président de la République aux personnes qui vivent avec l’autisme.
- Selon les mots du directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.
- Carl Schmitt, « L’État de droit bourgeois », Du Politique. « Légalité et Légitimité » et autres essais, textes choisis et présentés par Alain de Benoist, 1990, p. 34
- Carl Schmitt, La notion de politique, 1932.
- Emmanuel Tuchscherer, Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre, in Les Discours de la Guerre, 2003, ENS Lyon, p. 25-42.
- Ibid.
- France info, article du 3 avril 2020 « le désarroi de Mélina, infirmière à Montpellier, expulsée de son domicile à cause de ses propriétaires ».
- Carl Schmitt, La notion de Politique, Op. Cit.
- Carl Schmitt, La notion de politique, Op. Cit.
- Carl Schmitt, La notion de politique, Corollaire II, 1938.
- Lucien Faggion, La violence : Regards croisés sur une réalité plurielle, p. 517.
- RFI, 4 avril 2020, « la guerre des marques est déclarée »
- Julien Freund, L’essence du politique, Paris, Sirey, [1965], Dalloz, 2004, p. 448.
- Catherine Haas, 30 mars 2020, Coronavirus : "Si toute crise devient guerre, nous sommes condamnés à une guerre à perpétuité !", Marianne
- Fred Uhlman, L'ami retrouvé, 1971
- Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1881.



