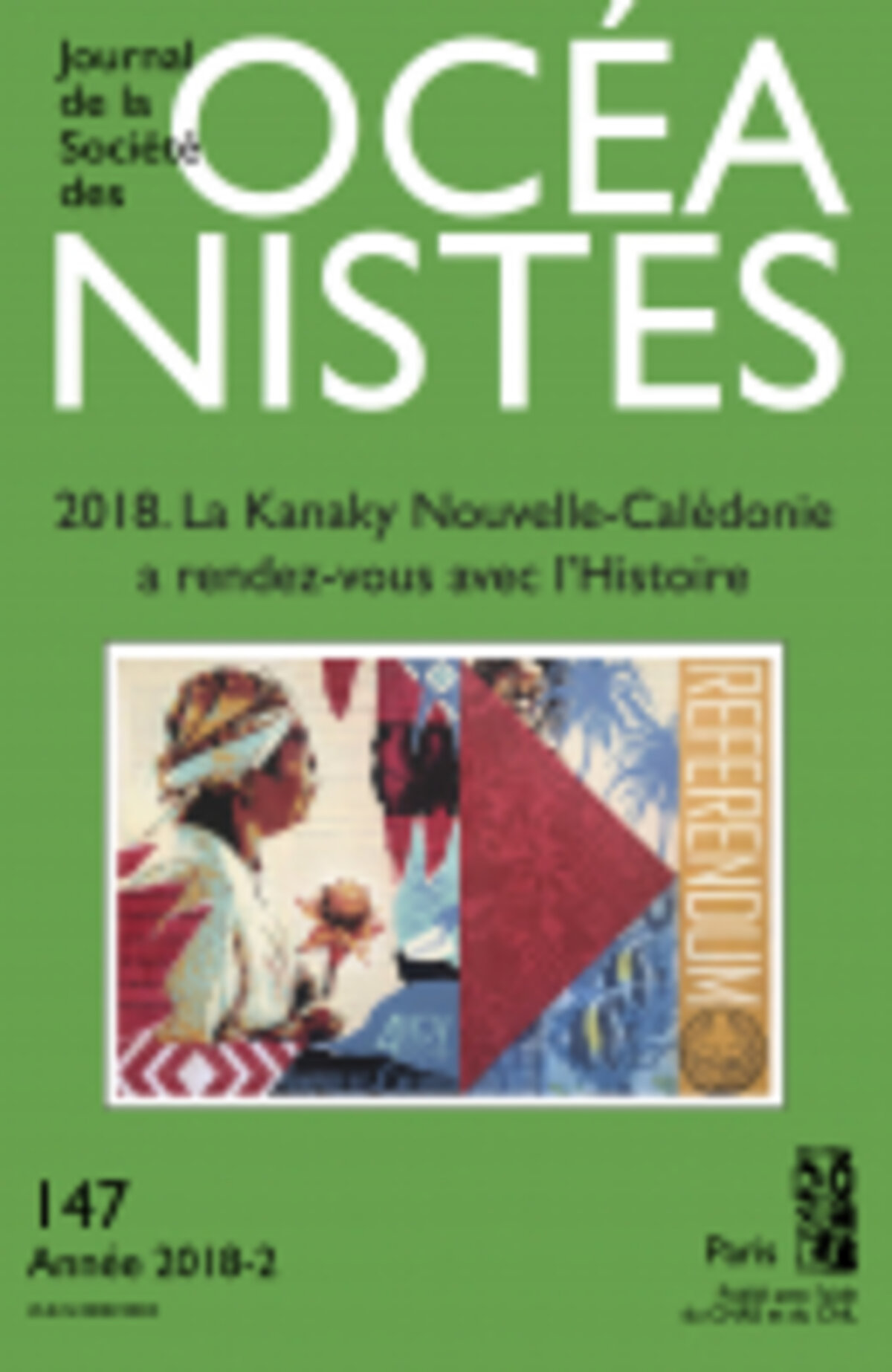Avec le 2e référendum du 4 octobre 2020, les partisans du oui gagnent encore du terrain. Si le vote historique du 4 novembre 2018 avait donné des résultats déjà époustouflants : 56,40% de non pour 43,60 % de oui, contrairement à toutes les prévisions, avec un taux de participation déjà imposant : 80,63 %, ceux de 2020 le sont encore plus : 46,6 % de oui (+ 3 points) et 53,4 % de non (- 3 points) avec un taux de participation de 85,7 % (+ 5 points).
La progression du vote indépendantiste dans des communes qui ne l’étaient pas se confirme (nous y reviendrons plus en détail dans un prochain billet), tout comme semble-t-il la forte participation des jeunes et des nouveaux inscrits. Aujourd’hui, sans les résultats précis en terme de voix par commune, il est difficile de dire si les voix en plus proviennent essentiellement des nouveaux inscrits (ceux qui ont eu 18 ans depuis le dernier référendum, environ 5 000) ou bien des abstentionnistes qui ont retrouvé le chemin des urnes. Sans doute une combinaison des deux.
Si je reprends l’exemple pris pour le référendum de 2018 : Bourail. J’écrivais alors à la suite des résultats : ville très fortement anti-indépendantiste pendant les Événements de 1984-88, où des drapeaux bleu-blanc-rouge flottaient sur la plupart des maisons, comme si nous avions à chaque coin de rue ou de colline des mairies. Et bien, Bourail a voté en 2018 oui à 30,9 % avec une participation de 88,6 %, soit une progression de 10 points pour l’indépendance par rapport aux scrutins provinciaux. C’était déjà une grande victoire. En 2020, celle-ci se conforte puisqu’on enregistre 32,7 % pour le oui avec une participation de 91%.
Autre progression très notable : celle de Nouméa. Avec une participation de 84,8 % (soit 4,5 points de plus), le oui passe à 23,3 % (soit 4 points de plus). Sans doute l’une des hausses les plus notables du territoire, fief anti-indépendantiste s’il en est, puisque la hausse de la participation profite beaucoup plus aux indépendantistes : si 1 115 électeurs de plus ont voté pour le non, 2 336, soit plus du double, l’ont fait pour le oui ! Signe que les idées indépendantistes progressent de façon indéniable et continuent de convaincre de plus en plus d’électeurs parmi les nouveaux inscrits ou parmi les abstentionnistes d’il y a deux ans. Et contrairement à ce que ne cesse de répéter d'aucun, ce vote n’est pas seulement ethnique puisque dans certaines communes, comme nous l’avons déjà écris en 2018, le oui dépasse la proportion de population kanak… Et cette année, 49,5 % des électeurs inscrits sur la liste de consultation étaient kanak… on n’a pas eu 49,5 % de oui, sans compter que tous les Kanak ne votent pas forcément oui ! Cette analyse est réductrice et peut viser à décourager les non-Kanak à voter oui. De même, le référendum n’est pas une impasse comme il a été dit en conclusion de la soirée électorale sur NC1ère par ce docteur en "géographie électorale" (sic)… Tout cela n’est pas très objectif ni scientifique !
Ce résultat global conforte donc le projet d'indépendance et l’absence de projet ou de propositions nouvelles des anti-indépendantistes, comme nous l’avons mentionné dans notre dernier billet.
À nouveau, les gens du pays, en votant ainsi, ont pris la parole pour dire massivement quelque chose comme « on veut vivre ensemble, il faut y arriver, on est prêt à construire un avenir pour notre pays ». Et, une partie des Calédoniens qui ne sont pas indépendantistes a voté Oui, par solidarité avec les Kanak, pour marquer leur ras-le-bol de ces discours passéistes et pour envoyer un message fort qu'il faut trouver une solution ensemble. Ils ont sans doute été rejoints en 2020 par une part de l’électorat wallisien et futunien.
Une fois de plus, le projet d’indépendance n’est pas évacué, même si les tenants du non voudraient supprimer le troisième référendum en arguant que cela ne changera rien. Ils l’avaient déjà claironné en 2018 : à l’époque, l’argumentaire d’un Brial et d’un Michel par exemple sur la non-nécessité d’un deuxième ou troisième référendum car ce sera du pareil au même était déjà totalement faux car, écrivions-nous, les abstentionnistes peuvent changer d’avis, d’ici deux ans, d’autres nouvelles générations auront la majorité et pourront voter. Et puis, sur les îles Loyauté, il reste une grande marge de gens à convaincre et qui n’avaient pas voté en 2018. Que ce soit pour suivre le mot d’ordre du PT (mais je n’y crois pas forcément et cela n’est pas démontrable de toutes les façons) ou bien parce qu’ils ont beaucoup plus cru dans ici qu’ailleurs aux arguments frauduleux des anti-indépendantistes visant à faire peur sur l’avenir des retraites, de l’accès à la santé ou autre… Ou encore parce que certains n’ont pas été suffisamment convaincus par le programme de pays Kanaky Nouvelle-Calédonie et que donc, pour ne pas voter non, ils n’ont pas voté oui !
Tout cela faisait que le oui pouvait grandir et c’est ce qui s’est passé. Certes la barre des 50 % n’est pas encore atteinte, mais à ce rythme de progression, tout est faisable en 2022. Donc l’espoir est encore plus grand ce soir pour que Kanaky Nouvelle-Calédonie arrive un jour en État indépendant et souverain.
En tant qu’anti-colonialiste ayant soutenu le droit à l’indépendance du peuple kanak depuis près de quarante ans, je suis ce soir très émue et heureuse de voir le vote oui grandir, ce qui rend hommage ainsi aux anciens, aux morts… pour cet idéal de liberté : sortir enfin du colonialisme.
Nous reviendrons sous peu plus longuement sur ces résultats.
À suivre donc
Merci de nous avoir lu
Isabelle Leblic, 4 octobre 2020
Pour en savoir plus, voir notamment le dossier très complet (plus de 300 pages) du Journal de la Société des Océanistes 147 : 2018. La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l'histoire, Isabelle Leblic et Umberto Cugola éds, https://doi.org/10.4000/jso.9034 préparé autour du référendum de 2018 qui est toujours d'actualité et apporte des éclairages importants.