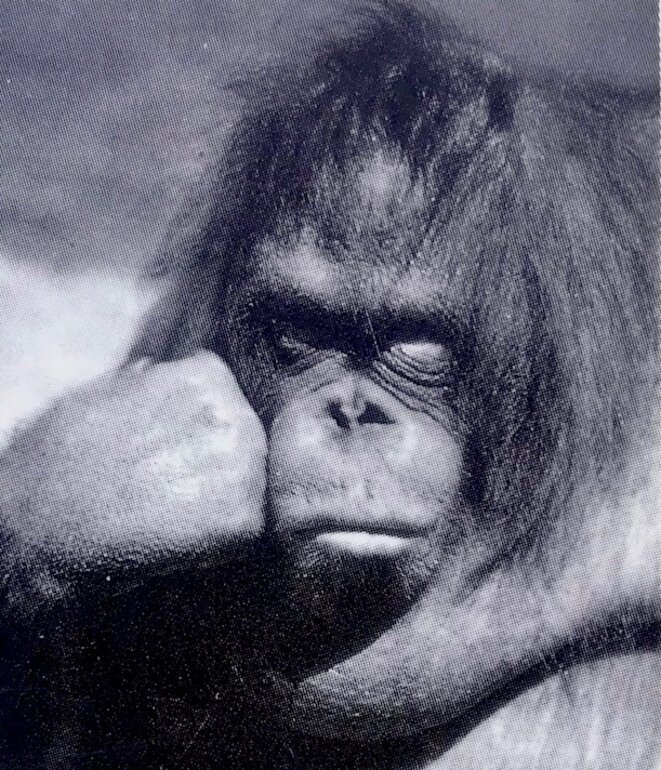À Saint-Étienne ont vécu mes grands-parents, sont nés mes oncles et tantes, ma mère, j’y suis né et j’y ai grandi. À l’occasion, me reviennent en mémoire des mots, des expressions, propres à ce langage particulier nommé « gaga » portés de manière étrange par la voix intacte de ma grand-mère stéphanoise, ma mémé.
Je rends par ce petit peu qu’est ce texte, en ce 1er de l’an un hommage modeste et peut-être suranné, mais solennel à ma grand-mère, ma mémé, qui n’est plus depuis longtemps, mais qui persiste encore dans ma mémoire où elle est toujours la bienvenue.
Ma mémé et son « à cha peu » gaga, ce « un peu à chaque fois », ce « à chaque fois un peu », au jour le jour, ce « bonjour ! » en somme dès le lever, dès le premier contact.
Trop pauvres étaient mes grands-parents pour dispenser des vœux pour une année, et le faisant quand ils avaient à le faire, qui y échappe ? savaient pertinemment que ça ne coûte pas, ni n’engage pas beaucoup, ni vraiment, moins que des « à cha peu » bienveillants pour que chaque jour soit bon.
C’est pourquoi, nous ne devrions que formuler des vœux que nous serions en mesure d’assurer, d’assumer et pour lesquels nous aurions une part majeure à leur réussite, c’est-à-dire déjà des vœux qui nous obligeraient, qui se traduiraient par l’engagement de notre présence attentive et active, proche et non intrusive mais vigilante, souple et disponible à hauteur de nos moyens même imparfaits, même insuffisants même, même maladroits, pourvu que, dans leur fragilité même encore, rencontrant des fragilités voisines, ils se proposent comme des moyens à portée de main et de voix. Les « à cha peu », pas beaucoup à la fois mais immenses quand ils sont ajoutés, répétés, si petits, si riens à en être plus que des "touts" hors de portée, des songes, des mirages. Des riens qui sont attentions qui font des vies. Le peu des riens meilleur que des promesses.
« À cha peu, mémé, à cha peu ! »
Tu ajoutais, ô combien j’aime accueillir ce souvenir, quand ta voix résonne à l’improviste, intempestive en moi : « à cha peu, mon valet, pas ? » "A chaque fois un peu mon garçon, n’est-ce-pas ?"
En suis-je digne et à la hauteur ? "Pas mémé ?"
***
Aparté
Si l’on fait le compte du temps qui passe, suivant la convention qui veut que le 1er janvier soit le jour choisi pour que l’an se fasse jour, et que ce jour se boursoufle d’être celui de l’an, et pour marquer comme un départ le début de la nouvelle révolution que la planète entame autour de son soleil.
Si l’on met de côté que pour chacun d’entre nous le véritable début des mêmes révolutions que nous avons déjà faites, et qu’il nous reste à faire, est d’abord le jour de notre naissance, ce compte repose sur deux opérations mathématiques fondamentales que l’école enseigne très tôt : une addition et une soustraction. Pour être plus précis, une addition qui est concomitamment une soustraction.
Car les années qui s’ajoutent en passant, sont aussi des années soustraites au temps que nous avons à vivre, et qu’il nous reste à vivre quand nous approchons inexorablement de sa fin.
Fêter chaque année civile qui se clôt et celle qui s’ouvre sans solution de continuité en dépit des festivités et des échanges de vœux, ou chaque anniversaire qui témoigne de notre naissance, et de notre persévérance à être, c’est aussi faire face à la réduction progressive de nos capacités à vivre ce temps qui reste, et l’approche de son terme.
Un vœu, peut-être le plus cher, le plus honnête à l’égard de soi et de ses semblables, serait de faire en sorte que cette soustraction inexorable se fasse comme une opération sans retenue pour être pleinement vécue pour ce qu’elle est : un capital dont nous ne connaissons pas l’étendue, le seul capital qui vaille et avec lequel nous naissons inégalement pourvus, capital dont nous ne veillons pas toujours aux conditions de sa préservation, de son usage, de son accroissement, de sa persévérance, ni de sa dissolution, mais que nous pouvons partager avec d’autres, sans ambition d’appropriation du leur, ni d’en tirer profit pour nous même, ou en en tirant un profit faire qu’il ne les en ampute pas, ces autres que nous nous sommes choisis ou qui nous ont choisi, ou que les hasards des rencontres ont, sinon absolument choisi ,mais nous ont proposé ; en amitié au moins, en amour au plus fort, au pire en détestation.
Ces hasards ou ces choix qui nous ont faits ou défaits, qui nous ont révélé à nous-mêmes. Précieux toujours quand ils nous ont donné la révélation de ce que nous sommes, comme quand ils ont été la connaissance de ce que nous ne sommes pas.