
Agrandissement : Illustration 1


Agrandissement : Illustration 2
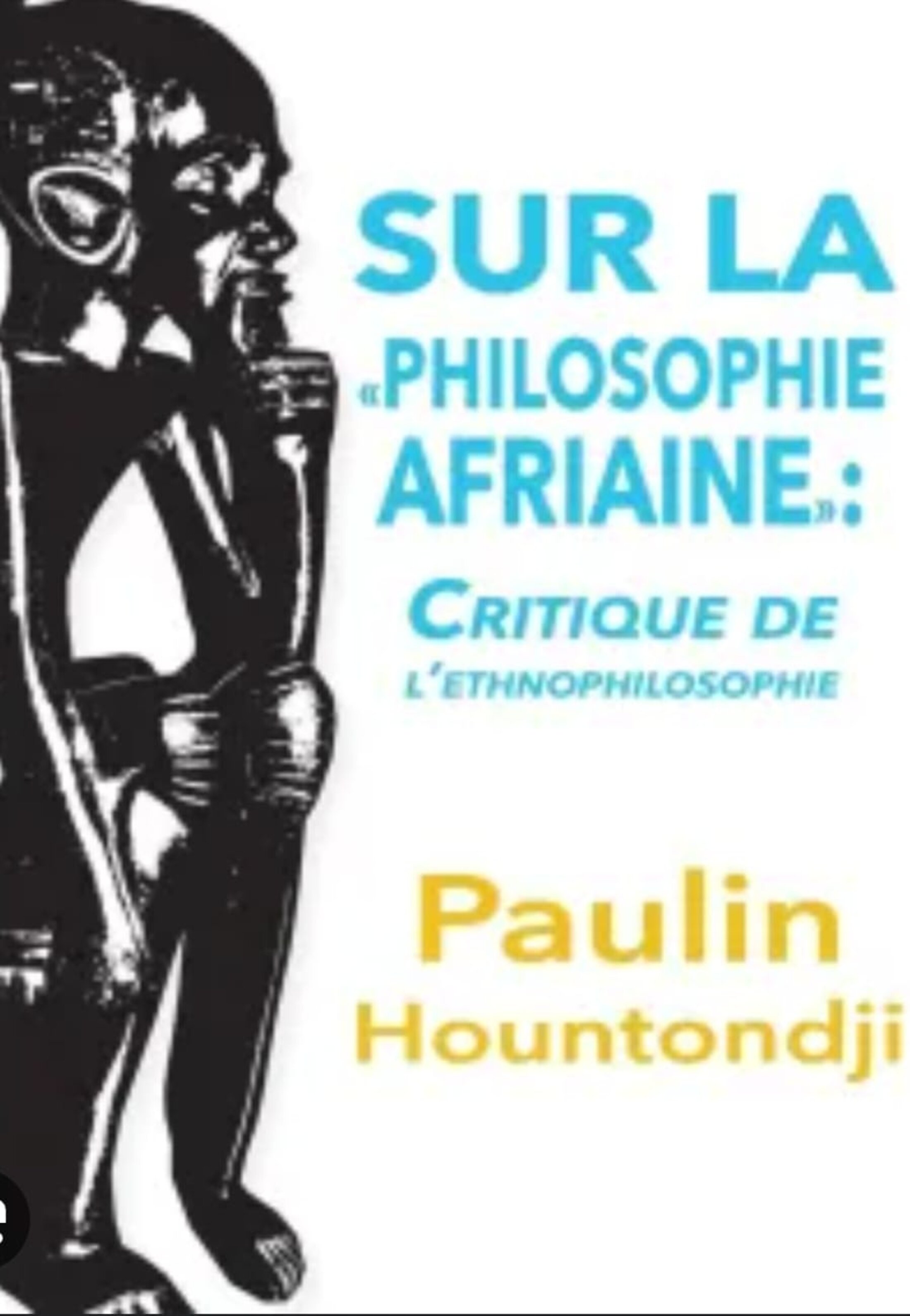

Agrandissement : Illustration 3
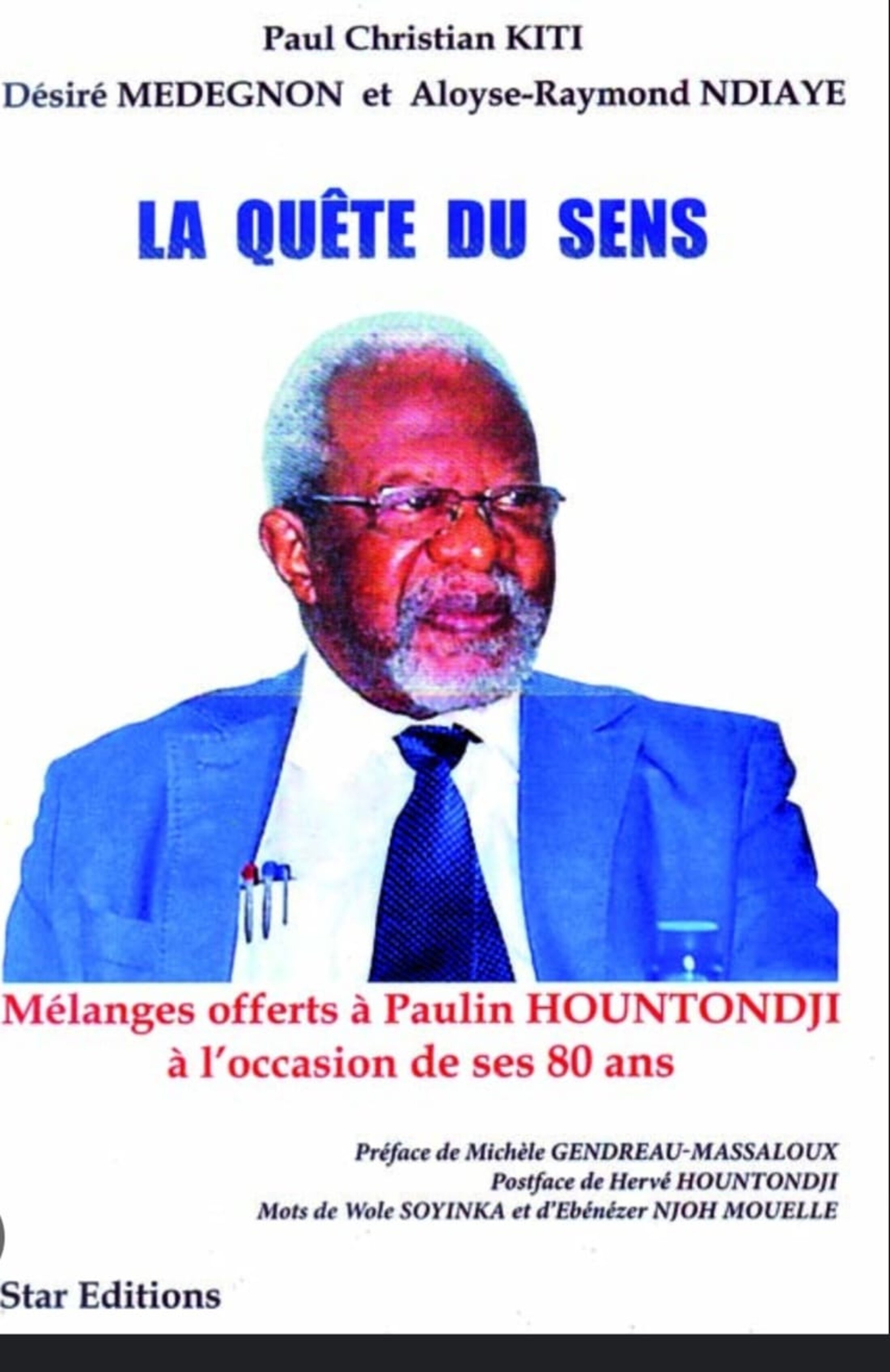

Agrandissement : Illustration 4


Agrandissement : Illustration 5

«Paulin Jidenou HOUNTONDJI (1942-2024), éminent théoricien de la philosophie africaine. In Memoriam» par Amadou Bal BA - /
Né le 11 avril 1942, à Treichville, un quartier d’Abidjan en Côte-d’Ivoire, son père, un pasteur de l’Église méthodiste, originaire du Bénin, officiait en Côte-d’Ivoire. À l’âge de quatre ans, sa famille retourne au Dahomey. Les prières de sa famille pieuse lui donnent le goût de la réflexion. Paulin Jidenu HOUNTONDJI est décédé le 2 février 2024 ; à Cotonou (Bénin) «Il a répondu à l’appel du père céleste», écrit le président de l’Association des journalistes et communicateurs de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin.
Paulin Jidenu HOUNTONDJI fait des études au Bénin, jusqu’à la terminale au lycée Victor Ballot de Porto-Novo, où avait enseigné la philosophie, le sénégalais Alassane N’DAW (1922-2013). A travers ses écrits, on sent une grande proximité avec l’intelligentsia sénégalaise (Alioune DIOP, Souleymane Bachi DIAGNE, Alassane N’DAW et Mame Moussé DIAGNE, Bado N’DOYE). «Je dois à Alioune Diop d’avoir été associe très jeune aux travaux des intellectuels africains et africanistes regroupés autour de «Présence africaine». J’avais à peine vingt-deux ans quand il m’arriva de bégayer laborieusement à Paris, au cours d’une cérémonie de lancement du «Consciencisme» de Nkrumah, une intervention qui, faisant paraitre le projet du leader ghanéen plus progressiste que la négritude, défraya aisément la chronique», écrit Paulin Jidenu HOUNTONDJI, qui sera invité, en 1964, au colloque de l’université de Pérouse, sur la «Présence de l’Afrique dans le monde de demain», mais aussi, en 1967, à Copenhague, à un forum de groupe d’intellectuels sur «l’humanisme africain, culture scandinave, un dialogue». Au Danemark, «sous l’œil protecteur de l’énigmatique Alioune Diop», Paul HOUNTONDJI y croise l’éminent égyptologue Cheikh Anta DIOP (Voir mon article, Médiapart, 2 juillet 2020), l’historien burkinabé, Joseph KI-ZERBO (1922-2006), le théologien, philosophe et écrivain kenyan, John MBITI (1931-2019), Engelbert MVENG (1930-1995), jésuite camerounais, historien, spécialiste de l’art et anthropologue camerounais, assassiné par Paul BYA, «le volubile», le Sénégalais, Pathé DIAGNE, précise-t-il (Pathé DIAGNE, voir mon article, Médiapart, 27 août 2023). C’est à Présence Africaine, à la rue des écoles, au Quartier latin, et grâce à Alioune DIOP, qu’il noue des relations amicales avec Jacques HOWLETT (1919-1982), son collaborateur, et le chantre de la négritude, Aimé CESAIRE (1913-2008, voir mon article, Médiapart, 18 avril 2022). Lors d’une conférence de la Société africaine de la culture, à l’Unesco, à Paris, il échange avec Yambo OUOLOGUEM (Voir mon article, Médiapart, 12 novembre 2021), futur et tragique Prix Renaudot, le professeur Bakary TRAORE, de l’UCAD. En raison de cette proximité avec Alioune DIOP (Voir mon article, sur le fondateur de Présence africaine, Médiapart, 13 octobre 2018), il envoie un exemplaire dédicacé de son livre au président sénégalais, Léopold Sédar SENGHOR, qui finira par le recevoir fin 1980, dans son appartement parisien, dans le 17ème arrondissement «Je crois aujourd’hui que les fonctions officielles de Senghor et ses options politiques, dans le temps, ont pesé d’un grand poids dans l’appréciation négative que portait sur son œuvre la jeunesse africaine progressiste. Depuis qu’il a montré, en démissionnant combien il relativisait ces fonctions elles-mêmes, on le lit avec d’autres yeux, et on le redécouvre » écrit Paulin Jidenu HOUNTONDJI.
Au Bénin, sa professeure française de philosophie au lycée, Hélène MARMOTIN, préférant la sèche rigueur de l’analyse aux grandes envolées lyriques, estime que la philo, comme toute autre discipline, ça s’apprend : «Je crois avoir retenu de cette année d’initiation un goût prononcé pour l’analyse conceptuelle et une fascination certaine pour les doctrines de la liberté» écrit-il dans «Combat pour le sens», un ouvrage largement autobiographique. Il fréquente, par la suite, le lycée Henri IV à Paris et son professeur André BLOCH (1919-1989) le fait découvrir Edmund HUSSERL (1859-1938). Aussi, Paulin Jidenu HOUNTINDJI a soutenu, en 1965, à la Sorbonne, un mémoire de diplôme d’études supérieures sur «La notion de Hylé dans la philosophie de Husserl» ; la «Hylè», c’est-à-dire la matière sensuelle, la couche phénoménologique des «contenus primaires», «sensibles», «sensoriels et imaginatifs», «vécus», ou «figuratifs». Dans cette sphère des états affectifs, «les sentiments sont de simples états, qui ne doivent leur rapport à des objets qu’aux représentations auxquelles ils sont associés : l’intentionnalité», écrit Paulin HOUNT0NDJ. En 1963, à l’école normale supérieure, sensible au marxiste, il se sent proche de Louis ALTHUSSER (1918-1990) et son positivisme. Jacques DERRIDA (1930-2004), un spécialiste d’Edmund HUSSERL et théoricien de «l’écriture de la différence», a complété cette éducation de la philosophie, en lui inculquant un souci de la précision. Le génie de Louis ALTHUSSER, qui citait souvent Rousseau, Aristote, Kant, Freud et Bachelard, «aura été de montrer, dans la conjoncture idéologique difficile de l’époque, qu’il était possible d’entretenir avec l’œuvre de Marx et la tradition théorique et politique qui s’en réclame un rapport non dogmatique et non catéchistique, un rapport intelligent et libre qui n’exclue pas, mais au contraire présuppose un intérêt réel pour les œuvres de l’esprit», écrit Paulin HOUNTONDJI. «En Afrique comme partout ailleurs, la théorie n’a de sens qu’ordonnée et subordonnée à la pratique, et qu’elle tient sa légitimité, en tant qu’elle est elle-même une forme de pratique, de son rôle fondateur par rapport aux autres pratiques. Parmi ces autres pratiques, je privilégiais spontanément «la pratique politique», rajoute Paulin HOUNTONDJI. Il a aussi suivi un séminaire de Paul RICŒUR (1913-2005), toujours sur Edmund HUSSERL son maître à penser, un idéal d’universalité et de rigueur scientifique, pour qui la phénoménologie est une généalogie, une quête du sens de la connaissance scientifique, à partir des origines du monde. En 1968, assistant à la faculté de Besançon, il milite au sein des organisations d’étudiants africains en France dénonçant l’impérialisme, la bourgeoisie «comprador» ou «politico-bureaucratique». En revanche, pour lui, et loin du dogmatisme stalinien, le discours de la FEANF gardait le silence sur des questions essentielles «notamment les rapports de pouvoir à l’intérieur des pays, le destin des libertés, la question du pluralisme et du monolithisme comme formes d’organisation politique, le rôle de l’armée», écrit-il.
Après l’agrégation, en 1966, quand vint le choix d’un sujet de doctorat d’Etat, sous la direction du professeur, de Georges CANGUILHEM (1904-1995) spécialiste de HUSSERL, Paulin J. HOUNTONDJI avait, dans un premier temps, songé à la philosophie du positiviste, Auguste COMTE (1798-1857), sur l’histoire des idées, le mode d’être des savoirs et les conditions du passage à la science, appliquée de manière critique à l’Afrique. Ce projet n’ayant pas vu le jour, et suite au départ à la retraite de son directeur de thèse, il a engagea, sous l’égide de Georges BALANDIER (1920-2016), un ethnologue et sociologue, une thèse sur la «Recherche critique sur le statut épistémologique de l’ethnologie», qui sera également abandonnée, mais les matériaux ont servi à ses travaux sur l’ethnophilosophie. Finalement, en 1970, il décide de soutenir une thèse de doctorat de 3ème cycle, sous la direction de Paul RICOEUR (1913-2005), philosophe de la phénoménologie et l'herméneutique et doyen de la faculté à Nanterre, sur «L’idée de science dans les «Prolégomènes» et la première «Recherche logique» de Husserl». Suzanne BACHELARD (1919-2007), philosophe, traductrice et fille de Gaston BACHELARD, ainsi qu’Emmanuel LEVINAS (1906-1995), philosophe, faisaient partie du jury. Par conséquent, l’exigence scientifique dans la philosophe est au cœur de cette thèse de doctorat «La science n’est qu’une valeur parmi d’autres valeurs de droit égal», écrit Edmund HUSSER dans «La philosophie, comme science rigoureuse». Ce n’est pas du scientisme, la science étant subordonnée, comme toute autre production intellectuelle, à l’éthique. Privilégiant la voie de la logique, de l’épistémologie, en disciple de HUSSERL, il pense qu’il revient donc à la science «d’être intrinsèquement, en elle-même et par elle-même, en tant que pratique, porteuse de normes et génératrice de valeurs», écrit Paulin Jidenu HOUNTONDJI. Par conséquent, la science ouvre la voie d’accès, dans la pluralité, à la philosophie ; d’autres chemins d’accès sont donc possibles, des «chemins possibles pour des prises de conscience dirigées vers le radicalisme», écrit HUSSERL.
Devenu éminent philosophe et universitaire, après des études à l’Ecole Normale supérieure, docteur ès lettres, à Dakar, le 25 juin 1995, Paulin HOUNTONDJI a d’abord enseigné dans diverses universités (Besançon en France, Kinshasa et Lubumbashi en RDC) pour terminer sa carrière à l’Université d’Abomey-Calavi, à partir de 1972.
Paulin HOUNTONDJI a aussi mené une brillante carrière politique au Bénin (Ministre de l’Éducation nationale dans le gouvernement de transition de 1990-1991 et ministre de la Culture et de la Communication entre 1991 et 1993, sous le président Nicéphore SOGLO). Le professeur Paulin HOUNTONDJI a été également chargé de mission du Président de la République et a dirigé le Centre Africain de Hautes Études du Bénin. «La pensée africaine est aussi vieille que les peuples africains eux-mêmes. Je crois avoir contribué à attirer l'attention sur l'existence d'une philosophie africaine prise dans un autre sens, celui justement où l'on parle de philosophie grecque, française ou allemande pour désigner la philosophie produite par les Grecs, les Français ou les Allemands tels qu'elle se laisse appréhender dans des corpus de textes réellement existants : une pensée conceptuelle et rigoureuse. Cette philosophie faite par des Africains existe», disait-il à Valérie MARIN LA MESLEE, du journal «Le Point».
Le professeur HOUNTONDJI, connu et reconnu pour sa critique percutante de l’ethnophilosophie, est un philosophe de la conscience et de la phénoménologie, son idéal est une exigence d’universalité, dans le pluralisme. «Il est nécessaire de sortir de l’enfermement pour faire de la question de l’identité et de la culture, avant tout, celle d’un programme. En particulier de réappropriation des sciences. D’un mot, et pour le dire comme Husserl : ce combat pour le sens aura déverrouillé l’horizon», écrit Souleymane Bachir DIAGNE, dans sa préface du livre de Paulin HOUNTONDJI, «Combat pour le sens. Itinéraire». En effet, Paulin HOUNTONDJI est partisan de la démocratie et des droits de l’homme, mais dans la responsabilité. Pour lui, un vrai philosophe doit rester modeste et à l’écoute des autres. Pour lui, le philosophe «sait que sa formation de philosophe ne le prépare pas mieux que d’autres à gouverner ou à gérer les affaires de la cité. Il sait qu’il doit d’abord se mettre à l’écoute des classes sociales ou des couches de la population qu’il a décidé de servir, se battre à leurs côtés, au coude à coude avec tous ceux qui ont fait ce même choix, discuter avec eux d’égal à égal en restant lui-même, sans jamais se renier, mais en restant ouvert, en permanence, à des découvertes et à des apprentissages nouveaux», dit-il. Paulin HOUNTONDJI est un remarquable avocat pour une Afrique autocentrée, maîtresse de son destin, contrôlant elle-même et produisant, à l’occasion, les connaissances théoriques et pratiques. L’Afrique n’est pas la périphérie, mais le centre. Contestant le concept fumeux de «miracle grec», il estime que la rationalité, un attribut non seulement de l’homme blanc, est plurielle «La raison n’est le monopole d’aucun groupe humain ni d’aucune culture. Elle est un attribut universel de l’humanité. Force est de reconnaître cependant qu’elle s’exprime de différentes façons d’une culture à l’autre, voire d’un individu à l’autre et d’une époque à l’autre au sein d’une même culture», écrit-il. C’est quoi donc la philosophie africaine ?
«J’appelle philosophie africaine un ensemble de textes : l’ensemble, précisément, des textes écrits par des Africains et qualifiés par leurs auteurs eux-mêmes de philosophiques. La philosophie africaine est donc pour nous une certaine littérature. Cette littérature existe», écrit-il dans et ce n’est pas une définition tautologique. «la philosophie africaine n’est pas où nous l’avons longtemps cherchée, dans quelque recoin mystérieux de notre âme supposée immuable», précise-t-il. La philosophie bantoue de Placide TEMPELS (1906-1977), un missionnaire belge, n’est pas, selon lui, un classique de la philosophie africaine, mais un ouvrage d’ethnologie à prétention philosophique. En effet, Placide TEMPELS met en avant le concept de «force vitale» qui croit ou décroit, l’univers étant constitué de forces reliées entre elles, suivant un ordre hiérarchisé. Placide TEMPELS, un humaniste, contestait les théories racistes de Lucien LEVY-BRUHL (1857-1939) sur «la mentalité primitive», répandues à l’époque. Par conséquent, Placide TEMPELS a exposé un système raisonné de la pensée bantoue, ne s’adressant aux Africains, mais aux coloniaux et les missionnaires les accompagnant, en vue de réhabiliter l’homme noir et sa culture. L’ontologie bantoue est essentiellement, suivant Placide TEMPS, une théorie des forces, une notion dynamique de l’être, contrairement aux Occidentaux, qui en ont une notion statique. Pour le Noir, donc, l’être est force, un attribut de l’être, mais en ce sens qu’il est force en son essence même «Pour le Bantou, la force n’est pas un accident, c’est même plus qu’un accident nécessaire, c’est l’essence même de l’être en soi. [...] L’être est force, la force est d’être. Notre notion d’être c’est «ce qui est», la leur «la force qui est», écrit Placide TEMPELS. Le concept d’Ubuntu, un ancien mot bantou, signifiant «Je suis grâce à ce que nous sommes tous», a revalorisé les valeurs ancestrales humanistes africaines de générosité, de solidarité «Neddo Ko Bandoum» diraient les Peuls, ou la piété familiale au cœur de la culture africaine «L’homme est le remède l’homme», dit un dicton Ouolof. Par conséquent, ces concepts englobent les notions de communauté et d’interdépendance entre les hommes, l’individu n’existant qu’à travers la communauté à laquelle il appartient.
Quel héritage du professeur Paulin J HOUNTOUNDJI ?
Aimé CESAIRE considérait que la philosophie bantoue de Placide TEMPELS comme une «diversion», en vue de détourner les colonisés des problèmes fondamentaux d’égalité et de justice. S’agissant de ces chemins qui ne mènent à nulle part, Martin HEIDGGER (1889-1976), dans ses leçons de Fribourg, en 2019, avait a donné sa définition de la philosophie «Qu’est-ce que philosopher en temps de crise ? Suffit-il de recourir aux «valeurs» pour échapper à la détresse du présent ? La philosophie, c’est l’Ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire et de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique», écrit-il dans «Vers une définition de la philosophie». D’une grande profondeur, pédagogue et limpide dans ses écrits, qu’un non-philosophe peut comprendre aisément, Paulin Jidenu HOUNTONDJI est le meilleur avocat de la philosophie africaine, longtemps engluée dans des polémiques oiseuses «Prenant pour exergue la fameuse onzième «Thèse sur Feuerbach», je m’interrogeai d’abord sur le rôle de la philosophie en Afrique. J’étais d’avis qu’elle devait être autre chose que la chouette hégélienne, l’oiseau de Minerve qui ne prend son vol qu’a la tombée de la nuit: justification idéologique du réel conduisant, dans la pratique, au conformisme le plus absurde. La philosophie devait permettre au contraire de transformer le monde», écrit-il. En kantien, le Copernicien de la philosophie, Paulin Jidenu HOUNTONDJI, avait pour ambition de restituer la richesse, la complexité, la diversité interne de l’héritage intellectuel africain : «En Afrique, comme partout ailleurs, la théorie n’a de sens qu’ordonnée et subordonnée à la pratique, et qu’elle tient sa légitimité, en tant qu’elle est elle-même une forme de pratique, de son rôle. Fondateur par rapport aux autres pratiques. Liée cependant à cette idée du rôle de la philosophie, une conviction s’exprimait avec force, et non sans une certaine candeur: l’idée que l’infériorisation des cultures nègres ne devait pas être considérée comme un fait premier, mais comme une conséquence de la colonisation en tant que phénomène économique, politique et militaire. L’éveil politique des peuples dits primitifs crée aujourd’hui les conditions d’une critique de l’ethnocentrisme», écrit-il Paulin Jidenu HOUNTONDJI.
Par conséquent, de son vivant, le professeur Paulin HOUNTOUNDJI est entré dans l’Histoire. Pour lui, la philosophie africaine, ce n’est pas de l’ethnologie, «La philosophie africaine, c’est la littérature philosophique africaine. J’appelle «philosophie africaine» un ensemble de textes», dit-il. Le professeur HOUNTONDJI inclut dans cette philosophie la littérature orale, dont celle du philosophe sénégalais du XVIème siècle, Kocc Barma, mais aussi la cosmogonie des Dogons du Mali, telle que restituée par Marcel GRIAULE (1898-1956). «Point n’est besoin d’écriture pour que se développe dans une société l’esprit philosophique au sens de Voltaire ou de Socrate, le non-conformisme social et idéologique», dit-il. En effet, il existe désormais de nombreux ouvrages de qualité, sur la philosophie africaine, et le professeur Souleymane Bachir DIAGNE, un philosophe sénégalais enseignant aux États-Unis, est incontestablement celui qui, par ses écrits, qui connaît le mieux la pensée de Paulin HOUNTOUNDJI, et qui a développé, en raison de son autorité, sa vision en la matière. Le discours philosophique négro-africain de ce siècle a d'abord réfléchi sur son existence, ensuite sur l'état de la culture africaine, l'enseignement, les langues africaines, les religions et enfin l'Etat. Toutes ces réflexions tournaient autour du paradigme de la refondation d'une histoire africaine.
Contre les mensonges et l’oubli, pour une réhabilitation de l’histoire et de la mémoire, dans sa grande compassion, l’Afrique étant riche, mais ses populations sont toujours misérables, Paulin HOUNTONDJI est resté solidaire des vaincus «L'élan qui pousse à s'élever vers une cause noble est parfois de nature irrésistible. La cause qui affirme sa singularité sur le plan du mérite n'est jamais des plus faciles. Celle des oubliés s'inscrit de manière irréversible dans les annales de l'histoire et des sciences sociales, en les marquant, comme d'un sceau, de ses critiques incontournables pour la justice et le devenir de l'être humain tout entier. Elle réunit les profondeurs de la nature de l'être humain, en même temps que ses insuffisances et ses illusions politiques, tandis qu'elle affiche un extérieur multiforme qui s'étend jusqu'à la charnière des possibles humains. Oui, il s'agit bel et bien là de «la cause des oubliés» !», écrit-il en 1990. Paulin HOUNTONDJ.
Paulin HOUNTOUNDJI, en maître de la philosophie africaine, a réhabilité et défendu la conscience du peuple noir. «La conscience africaine se voit trop souvent caractérisée par son immédiateté et son innocence», écrit Alfred ADLER, s’insurge sur une pensée pleine de préjugés racistes du grand philosophe allemand non visionnaire, Goerg W. F HEGEL (1770-1831), en eurocentriste et théoricien du racisme, au même titre de Joseph GOBINEAU (1816-1882) et son livre sur «l’inégalité des races», à savoir qu’en Afrique, il n’y aurait pas de place pour l’éclosion des idées. L’Afrique, sans histoire, serait paralysée, figée par l’inertie, et donc sans philosophie, une idée que les tenants de l’apologie du colonialisme, comme ce nabot, ont tenu constamment à en faire l’apologie. Autant HEGEL «excluait le Noir africain de l’histoire du monde parce qu’il ne reconnaît pas en Afrique noire la révélation de la Raison Divine, de l’Esprit Universel, ni aucune sublime création de la raison dans l’évolution historique de l’humanité, autant Gobineau refuse au Nègre tout rôle majeur ou simplement significatif dans l’évolution historique de l’humanité, vu l’infériorité de la race noire», écrit Théophile OBENGA. En fait, historiquement, pour HEGEL, l’homme n’est raison et liberté que lorsqu’il sait ce qu’il est, lorsqu’il parvient à la conscience de ce qu’il est en soi : «Sans cela, raison et liberté ne sont rien», écrit le philosophe allemand. La faute à HEGEL ? Pour Amady Aly DIENG (1932-2015, voir mon article), dans sa glorification du Moyen-Age, HEGEL serait victime par la suite de polémiques abusives, concernant les Africains vivant, selon lui, dans un état de «nature pure abusive et innocente. (…) C’est dans le peuple grec que nous trouvons pour la première fois cette notion de liberté et c’est là aussi que pour cette raison commence la philosophie», écrit-il. Cependant, et en réaction contre le discours de Dakar de Nicolas SARKOZY, Alfred ADELER nous invite à théoriser une histoire et une conscience propres à ce continent. À l’Afrique, dès lors, de s’inventer un destin. «Occidentaux anciens colonisateurs, comme Africains, nous sommes aujourd'hui inextricablement mêlés dans un monde désorienté et en plein remue-ménage de cultures demeurées tout à la fois diverses, mais tendant inexorablement à une uniformité qui s'impose à elles et qu'elles vivent de plus en plus mal et dans une nostalgie qui semble incurable», écrit Alfred ADLER, dans «Hegel et l’Afrique». En fait, à l’époque, HEGEL, dans sa philosophie ethnocentriste, idéaliste et idéologique, avait une connaissance manifestement insuffisante sur la culture africaine, suivant Marcien TOWA. Pour HEGEL l’Égypte ne ferait pas partie de l’Afrique, mais de l’Asie, un continent anhistorique. C’est le Sénégalais, Cheikh Anta DIOP, qui a établi, de façon incontestable, l’origine africaine de la civilisation égyptienne, et l’antériorité de cette grande civilisation (Voir mon article, sur Cheikh Anta Diop, Médiapart, 2 juillet 2020), en se fondant en particulier sur Hérodote, Diodore de Sicile et Volney.
Pour autant, «Peut-on parler d’une pensée africaine ?», s’interroge, le Sénégalais, le doyen Alassane N’DAW. Face à une dualité de culture, «Socrate et Platon ne me seront véritablement nécessaires que •lorsque . Je pourrai les relier à d'autres éléments de pensée et de morale acquis par ma propre société», dit, en décembre 1955, le professeur Kofi Abrefa BUSIA du Ghana (1913-1978). Face à ce retour aux sources, et contre l’européocentrisme, dans un souci de cultiver les différences : «Une philosophie qui n'est pas un système ne saurait rien avoir de scientifique ; elle exprime bien plutôt une opinion subjective», disait déjà HEGEL. Dans cette perspective, la tradition, la pensée négro-africaine ou la sagesse africaine sont une source d’inspiration : «La connaissance des contes et proverbes revêtait une grande importance, car elle révélait au cours des palabres où devaient se traiter les affaires de la communauté ceux qui étaient les mieux initiés à la tradition .des ancêtres, ceux qui. avaient reçu le meilleur héritage et qui apparaissaient souvent comme étant les plus dignes de commander», écrit, en 1966, le doyen Alassane N’DAW. Par conséquent, «Que peut la philosophie ?», s’interroge Paulin HOUNTONDJI. Pour lui, l’ethnophilosophie est paresseuse et peu courageuse : «Elle consiste à se réfugier paresseusement derrière la pensée du groupe, en s'abstenant de prendre soi-même position et de se prononcer sur les problèmes auxquels répondait à sa manière cette pensée des ancêtres», écrit-il. Le vrai philosophe, c’est celui qui affronte les problèmes réels, les vrais, même s’ils sont clivants. Fuir le débat est une imposture. «À vrai dire, tout Africain un tant soit peu patriote, conscient de Ia situation historique de son peuple domine, et soucieux de sa libération, se reconnaît forcément, au moins jusqu'à un certain point, dans cette exigence d'une pensée militante. N'importe quel intellectuel africain, n'importe quels écrivains, hommes de science ou penseurs africains savent d'avance qu'il encourt, s'il n'y prend garde, le reproche insupportable d'aristocratisme hautain, de complicité directe ou indirecte avec I’oppresseur», écrit Paulin HOUNTONDJI. Les mots sont des munitions, «Les mots sont les seules munitions dans la cartouchière de la vérité. Et les poètes sont les francs-tireurs qui s'en servent”, écrit, en 1989, Dan SIMMONS, dans «Hypérion». La philosophie, ainsi conçue, loin d’être spéculative, atteste que «Les mots sont des pistolets chargés», suivant une formule de Jean-Paul SARTRE (Voir mon article, Médiapart, 14 février 2023). En raison de cette puissante métaphore, cet éminent philosophe français, anticolonialiste, Jean-Paul SARTRE administre la preuve du pouvoir des mots, le titre de ses mémoires, vise à exprimer des idées capables de renverser l’ordre établi ; c’est sont une arme puissante pour se battre contre les injustices, pour un monde meilleur.
En redoutable avocat, contre un faux universalisme, un euro universalisme ethnique, digne du discours de Dakar, le professeur Paulin HOUNTONDJI est un partisan du vrai multiculturalisme, «d’un rendez-vous du donner et du recevoir», suivant SENGHOR, «Il y a une manière de défendre les cultures opprimées qui ne leur rend service qu’en apparence parce qu’elle revient, somme toute, à les enfermer dans leur particularité. Le plaidoyer habituel en faveur des cultures non occidentales tombe souvent dans ce piège. Il ne les valorise qu’au nom du droit à la différence, face aux prétentions d’une civilisation occidentale qui revendique, à travers quelques-uns de ses représentants les plus en vue, le monopole de l’universel. L’Europe est amnésique. Elle oublie trop souvent ce qu’elle doit aux autres cultures», écrit Paulin HOUNTONDJI.
Références bibliographiques
I – Contributions de Paulin Jidenu HOUNTOUNDJI
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), Autobiographie intellectuelle, Cotonou, Renaissance, 1983, 48 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin Jidenu), «Sagesse africaine et philosophie moderne», in Torben Lundbaek éditeur, Humanisme africain-culture scandinave: un dialogue, Copenhague, Danida, 1970, pages 187-197 ;
HOUNTONDJI (Paulin Jidenu), L’idée de science dans les «Prolégomènes» et la première «Recherche logique» de Husserl, Thèse pour le doctorat de troisième cycle, sous la direction de Paul Ricoeur, Paris X - Nanterre, 1970, 187 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin Jidenu), Libertés, Cotonou. Renaissance, 1973, 71 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu) «Construire l’universel, un défi transculturel», Méthodes, 2016, Vol 2, n°1-2, pages 155-168 ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu) «Histoire d’un mythe», Présence africaine, 1974, Vol 3, n°91, pages 3-13 ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu) «Que peut la philosophie ?», Présence africaine, 1981, Vol 1, n°119, pages 47-71 ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu) «Remarques sur la philosophie africaine contemporaine», Diogène, 1970, Vol I, pages 120-140 ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu) «Une pensée pré-personnelle. Notes sur l’ethnophilosphie et idéo-logique de Marc Augé», L’Homme, 2008, Vol 1-2, n°185-186, pages 343-363 ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), «From the Ethnosciences to Ethnophilosophy: The Thesis Project of Kwame Nkrumah», Research in African literatures, Bloomington, 1998, XXVIII: 4, numéro spécial sur le multiculturalisme, page 112–120 ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), «Histoire d’un mythe», Présence africaine, 1974, Vol 3, n°91, pages 3-13 ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), Combat pour le sens : itinéraire africain, préface de Souleymane Bachir Diagne, Cotonou, éditions du Flamboyant, 1997, 300 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), éditeur, Les Savoirs endogènes : Pistes pour une recherche, Dakar, Codesria, Paris, Karthala, 1994, 345 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), La notion de Hylé dans la philosophie de Husserl, mémoire de D.E.S., Paris, Sorbonne, 1965, 160 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), sous la direction de, La rationalité, une ou plurielle ?, Dakar, Codesria, Unesco, 2007, 466 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin, Jidenu), Sur la philosophie africaine : critique de l’ethnophilosophie, Paris, La Découverte, 1976, 257 pages ;
HOUNTONDJI (Paulin Jidenu), «Langues africaines et philosophie : l’hypothèse relativiste», Les études philosophiques (Paris), 1982, Vol 4, pages 393-406 ;
HOUNTONDJI (Paulin Jidenu), «Le particulier et l’universel», Bulletin de la Société Française de philosophie, 1987, Vol 81, n°4, pages 145-189.
II – Autres références
ABRAHAM (William), The Mind of Africa, Chicago, Londres, University of Chicago Press, Weidenfeld and Nicolson, 1962, 232 pages ;
ADLER (Alfred), Hegel et l’Afrique, Histoire et conscience historique africaines, Paris, 2017, 300 pages ;
ALTHUSSER (Louis), Eléments d’autocritique, Paris, Hachette, 1974, 126 pages ;
ALTHUSSER (Louis), Philosophie et philosophie spontanée des savants, Paris, Maspero, 1967, 157 pages ;
AZOMBO-MENDA (Soter) MEYONGO (Pierre), Précis de philosophie pour L’Afrique, Paris, Nathan, 1981, 171 pages ;
BACHELARD (Suzanne), La logique de Husserl, Paris, PUF, 1957, 447 pages ;
BENOT (Yves), «La philosophie en Afrique ou l’émergence de l’individu», Revue Tiers-monde, 1979, Vol 20 77, pages 187-198 ;
BIDIMA (Jean-Godefroy), La philosophie négro-africaine, Paris, PUF, 1995, 126 pages ;
BOELAERT (Edmond-Eloi), «La philosophie bantoue selon le R. P. Placide Tempels», Aequatoria (Coquilhatville) 1946, Vol 9, pages 81-90 ;
BOULAGA (Fabien), La crise du Muntu, Paris, Présence africaine, 1977, 240 pages ;
DERRIDA (Jacques), L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, 439 pages ;
DERRIDA (Jacques), Le problème de la genèse dans la philosophe de Husserl, Paris. P.U.F., 1994, 560 pages ;
DIAGNE (Mamoussé), «Paulin J. Hountondji ou la psychanalyse de la conscience ethno philosophique», Psychopathologie africaine, 1976, Vol 12, n°3, pages 443-449 ;
DIAGNE (Mamoussé), Critique de la raison orale : les pratiques discursives dans les civilisations de l’oralité, Dakar, Paris, IFAN/Karthala, 2006, 600 pages ;
DIAGNE (Mamoussé), De la philosophie et des philosophes en Afrique noire, préface de Paulin J. Hountondji, Dakar, IFAN, Paris, Karthala, 2006, 115 pages ;
DIAGNE (Pathé), L’euro philosophie face à la pensée du négro-africain. Suivi des thèses sur épistémologie du réel et problématique néo-pharaonique, Dakar, éditions Sankoré, 1981, 219 pages ;
DIAGNE (Souleymane Bachir), Le faux dialogue de l’ethnophilosophie, Paris, mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies, Université de Paris, 1978, 122 pages ;
DIAGNE (Souleymane, Bachir), L’encre des savants : réflexion sur la philosophie en Afrique, Codesria-Présence africaine, 2013, 120 pages ;
DIENG (Amady Aly), Contribution à l’étude des problèmes philosophiques en Afrique noire, Paris, Nubia, 1983, 181 pages ;
DIENG (Amady Aly), Hegel, Marx, Engels et les problèmes de l’Afrique noire, Dakar, éditions Sankoré, 1978, pages ;
DIENG (Amady, Aly), 2006, Hegel et l'Afrique noire, Hegel était-il raciste ?, Dakar, CODESRIA, 2006, 140 pages ;
DIOP (Cheikh Anta), «Existe-t-il une philosophie africaine?», in Claude Sumner éditeur, African philosophy/La philosophie africaine, Addis-Abeba, Chamber Printing House, 1980, pages 24-37 ;
HALLEN (Barry), A Short History of History of African Philosophy, Indiana University Press, 2002, 113 pages ;
HEIDEGGER (Martin), Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Gallimard, 1957, 54 pages ;
HOWLETT (Jacques) «La philosophie africaine en question», Présence africaine, 1974, Vol 91, pages 14-25 ;
HUSSERL (Edmund), La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Paris, Gallimard. 1976, 372 pages ;
HUSSERL (Edmund), La philosophie comme science rigoureuse, traduction et commentaire de Quentin Lauer, Paris, P.U.F, 1955, 1999 pages ;
KAGAME (Alexis), La Philosophie bantu-rwandaise de l’être, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniale, 1956, 448 pages ;
KITI (Paul, Christian), éditeur scientifique et autres, Mélanges offerts Paulin Hountondji à l’occasion de ses 80 ans, préface de Michèle GENDREAU-MASSALOUX, Bénin, Star éditions, 2021, 501 pages ;
KODJO-GRANDVAUX (Séverine), Philosophies africaines, Paris, Présence africaine, 2013, 301 pages ;
LUFULUABO (François-Marie), Vers une théodicée bantoue, Tournay, Casterman, 1962, 51 pages ;
LUFULUABO, (François-Marue), La Notion luba-bantoue de l’être, Tournay, Casterman, 1964, 43 pages ;
MARIN LA MESLEE (Valérie), «16 questions sur la philosophie africaine, Paulin Hountondji», Africultures, 2010, Vol 3, n°82, pages 83-91 ;
MARIN LA MESLEE (Valérie), «Paulin Hountondji : Non à l’ethnophilosphie comme philosophie africaine», Le Point, 30 avril 2014 ;
MASOLO (D A), African Philosophy in Search of Identity, London, International African Institute, Edinburgh University Press, 1994, 297 pages ;
MAURIER (Henri), Philosophie de l’Afrique noire, Saint-Augustin, Anthropos-Institut, 1985, 318 pages ;
MONO NDJANA (Hubert), Histoire de la philosophie africaine, Paris, Harmattan, 2009, 251 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), L’invention de l’Afrique. Ngose, philosophie et ordre de la connaissance, Paris, Présence africaine, 2021, 514 pages ;
N’DAW (Alassane), «Peut-on parler d’une pensée africaine ?», Présence africaine, 1966, Vol 2, n°58, pages 32-46 ;
N’DAW (Alassane), La pensée africaine, Dakar, Nouvelles éditions africaines, 1983, 284 pages ;
N’DOYE (Bado), Paulin Hountodji, leçons de philosophie africaine, préface de Souleymane Bachir Diagne, Paris, Riveneuve, 2022, 181 pages ;
OBENGA (Théophile), La philosophie africaine de l’époque pharaonique 27_0-330 de notre ère, Paris, Harmattan, 1990, 567 pages ;
OMOTOUNDE (Jean-Philippe), L’origine négro-africaine du savoir grec, Paris, éditions Menaibuc, 2000, 110 pages ;
TEMPELS (Placide), Philosophie bantoue, préface de Souleymane Bachir Diagne, Paris, Présence africaine, 2013, 123 pages ;
TOWA (Marcien), Essai sur la problématique de la philosophie africaine dans l’Afrique actuelle, Paris, Clé Internationale, 1971, 75 pages.
Paris, le 2 février 2024, par Amadou Bal BA -



