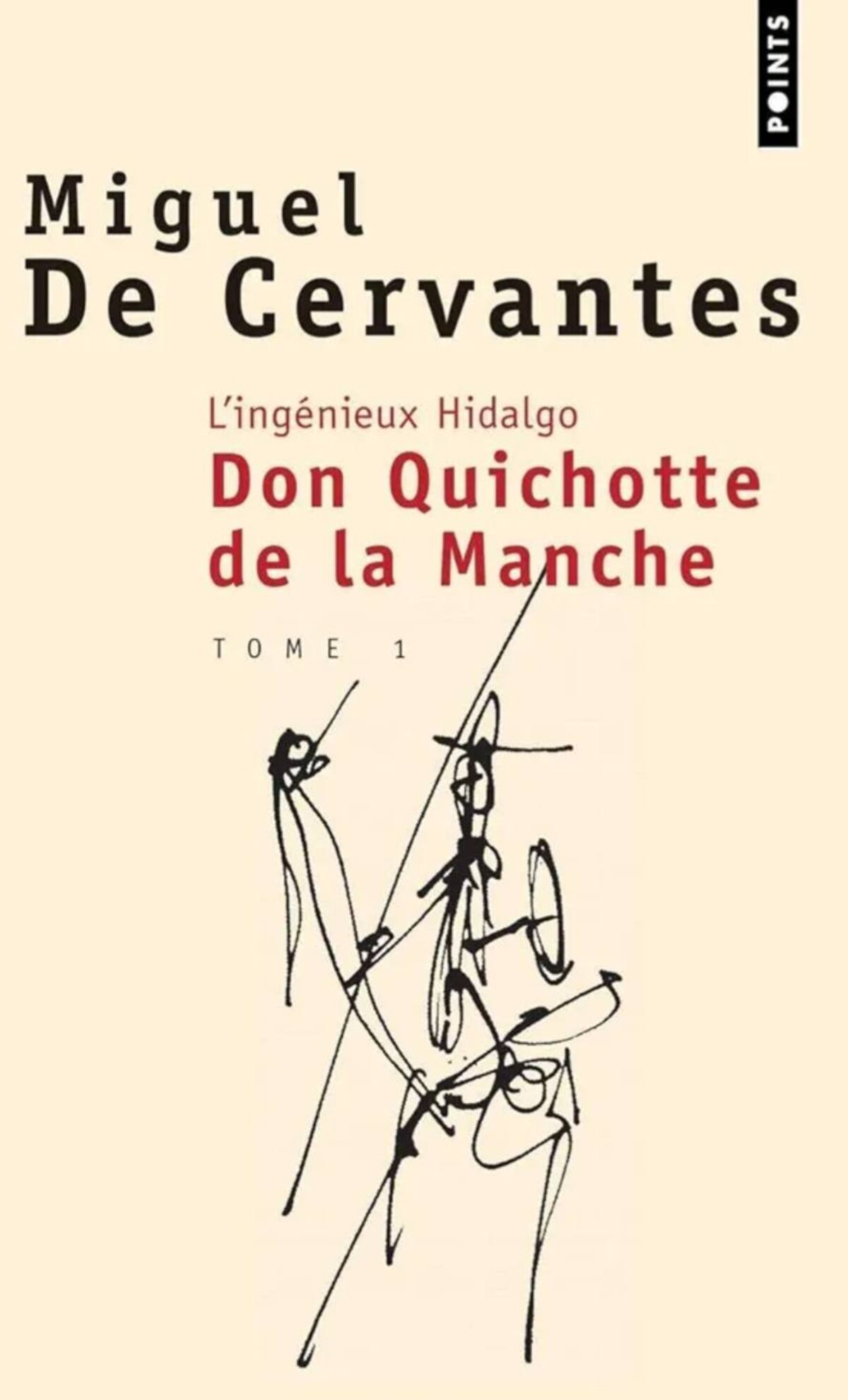
Agrandissement : Illustration 1
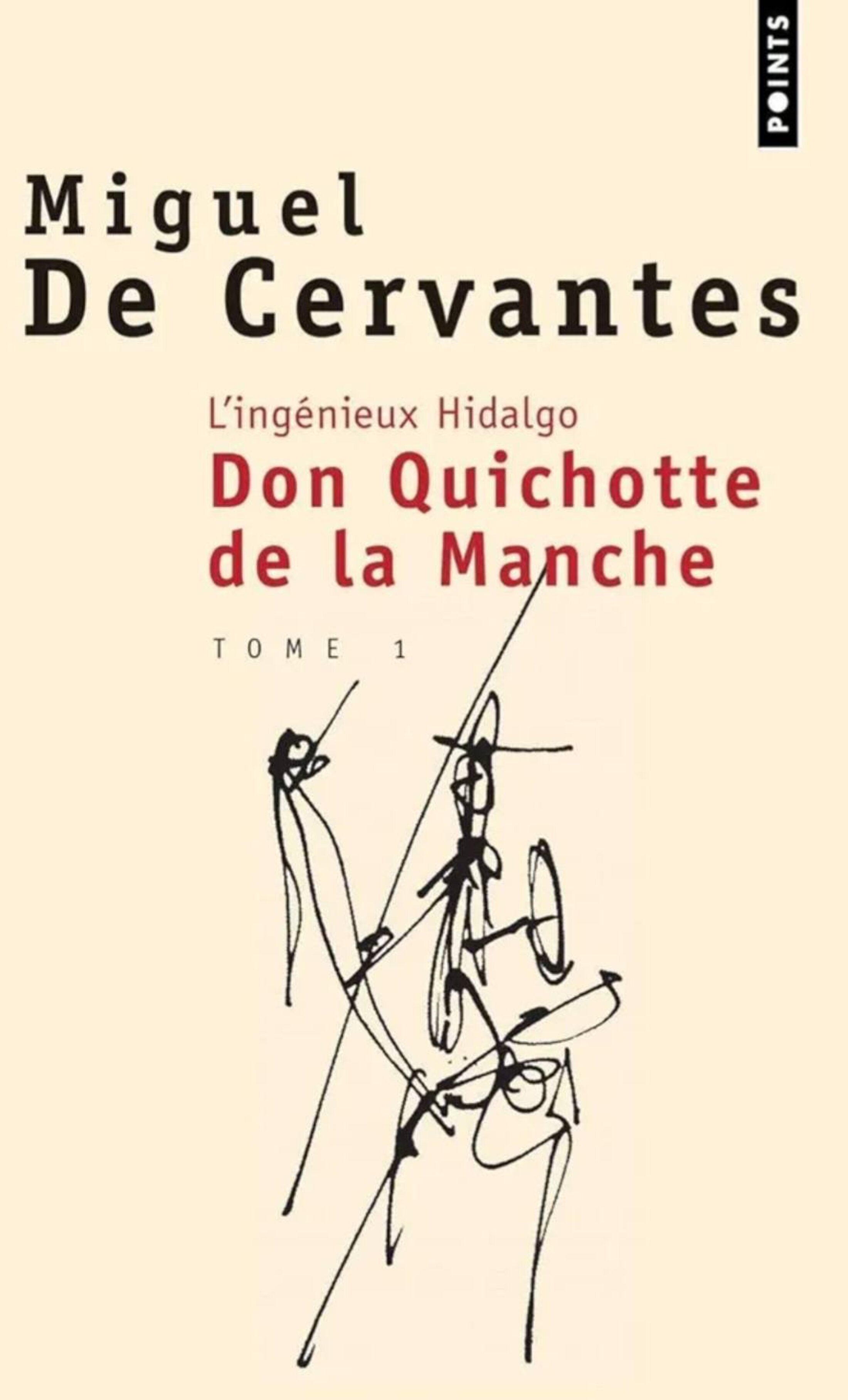

Agrandissement : Illustration 2
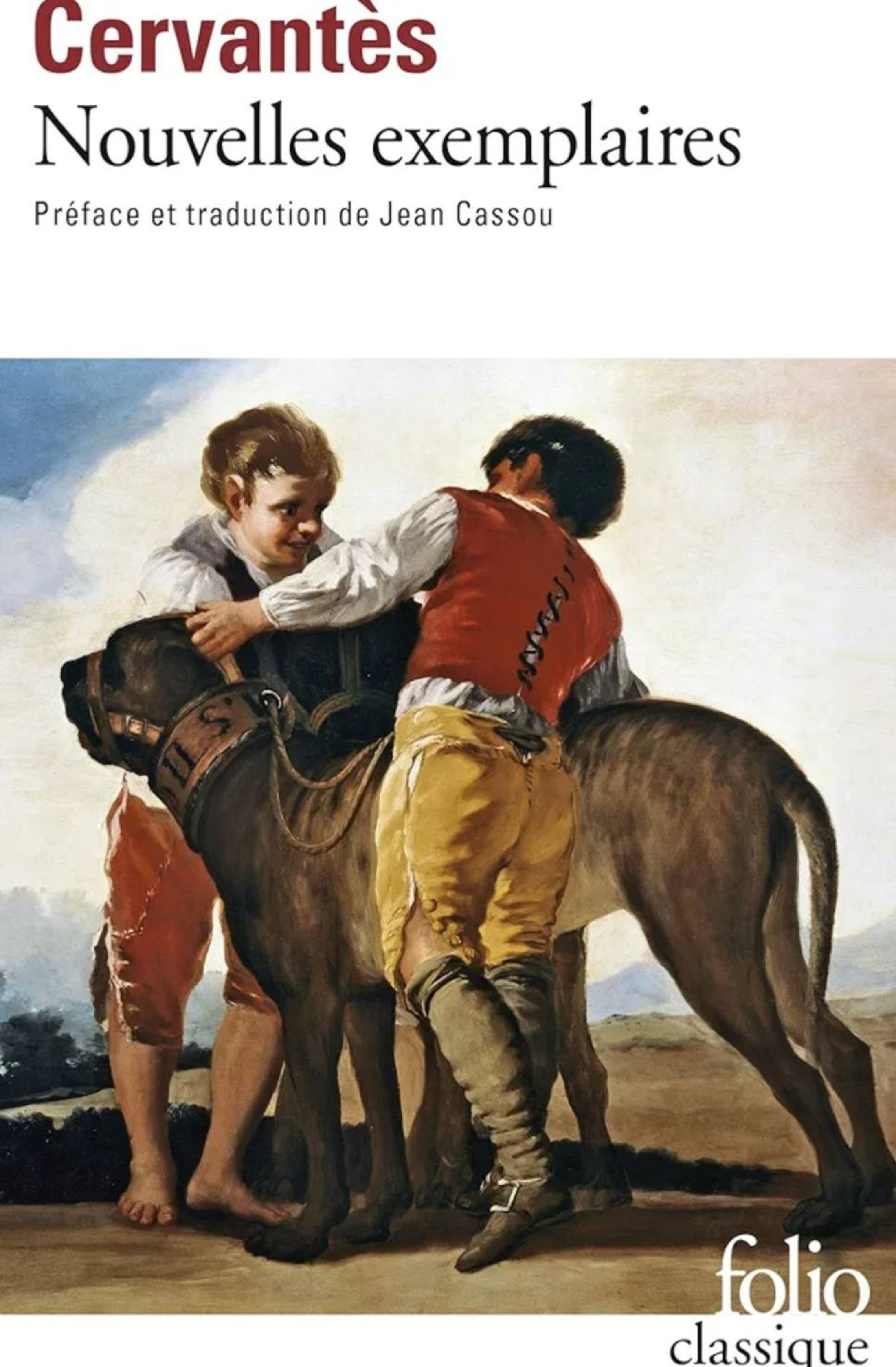

«Miguel de CERVANTES SAAVEDRA (1547-1616), romancier, poète et dramaturge espagnol et son «Don Quichotte de la Manche», entre sagesse et folie, un personnage riche, multiple, contradictoire, incertain et riche de potentialités. Le conflit des tendances inverse est au cœur de la vie, du délirant au sublime.» Amadou Bal BA
«Je rends hommage à ceux qui parlent au vent, les fous d’amour, les visionnaires, ceux qui donneraient leur vie à un rêve, aux rejetés, aux exclus, aux hommes de cœur, à ceux qui persistent à croire aux sentiments purs, à ceux qui sont ridiculisés et jugés, à ceux qui n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent et qui n’abandonnent jamais», écrit CERVANTES. Son roman, «Don Quichotte», un puissant appel à la rénovation des valeurs morales de la chevalerie, «reflète ce que notre être a de multitude, de contradictoire, et de toujours incertain ; c’est là son inépuisable richesse. Sans nous donner aucune leçon, il nous apprend tout, même la sagesse, même la folie. Il ne dogmatise sur le conflit des apparences et du réel, mais les place au cœur de notre vie. Il nous offre tant d’amorces, tant de points de départ, qu’il nous fait entrer, à tout moment, dans le monde de la pensée et du rêve.», écrit Paul HAZARD. En effet, «Don Quichotte» est l’une des œuvres les plus lues et les plus traduites au monde, une nostalgie de l’Ancien monde ayant conduit à la folie d’un hidalgo corrompu par la lecture des livres de chevalerie. Dans sa fiction romanesque et historique, une distinction entre imagination et réalité, qui a influencé les générations postérieures, CERVANTES a fait recours au dialogisme, au perspectivisme et à la polyphonie, ainsi qu’à la métafiction. Don Quichotte, un roman d’autocritique et critique littéraire, reste un chef-d’œuvre, un puissant hymne à la faculté imaginative des hommes, en même temps qu’une dénonciation des périls de la fantaisie. «L'admirable Cervantès, unissant Molière à Rabelais et les surpassant tous deux, a écrit le plus humain et le plus beau livre qui soit», dit José Maria de HEREDIA (1842-1905). «Son plus bel ouvrage, celui a qui a tant fait sa réputation, c’est le roman de Don Quichotte. La raison, la gaieté, la fine ironie répandue dans cet ouvrage, l’extrême vérité des portraits, la pureté, le naturel du style ont rendu ce livre immortel.», écrit, en 1784, Jean-Pierre Claris de FLORIAN (1755-1794).
Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, éminent romancier, poète et dramaturge de la Renaissance, ancien esclave, a dominé les littératures espagnole et européenne, comme le portugais Luis de CAMOES (1524-1580), le poète ou aède grec Homère du VIIIe siècle av. J.-C. «Mais le bel arbre de son œuvre n’a pas que ce tronc puissant. Il porte haut et loin, dans notre ciel latin, plus d’une ramure de chanteuse. Cervantes est un génie humain, et rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Aussi bien, les mœurs paisibles et le calme bonheur auxquels nous aspirons sans trêve, le pittoresque familier de la vie populaire, puis les inquiétudes lyriques, les poétiques effusions, enfin la tragédie des âmes fières, la passion mystique, ou, par contraste, nos faiblesses», écrit, en 1920, Henri COLLET. Cependant, il a vécu pauvre, malheureux et presque oublié de tous. «La raison majeure est que la gloire de la création a éclipsé la personne du créateur, «Don Quichotte» a fait oublier Cervantès, ou l’a réduit à n’être qu’un grand nom. Tel est le paradoxe du génie : ses créatures s’affirment toutes seules et avec une telle énergie qu’elles font oublier les existences naturelles de leur génération», écrit, en 1928, Marcel BATAILLON, dans «Cervantès penseur».
Immense écrivain du pittoresque et d’une grande justesse de l’image peinte, le style de CERVANTES est marqué du sceau de l’élégance et de la finesse, mais aussi une certaine distanciation dans l’ordre du fantastique. «Le motif principal du Quichotte est, si l'on peut dire, celui d'un hidalgo déséquilibré qui croit, en cela consiste sa folie, à la continuité ou à l'identité fondamentale entre le monde de son expérience quotidienne et le monde représenté dans les livres de chevalerie. La leçon de la satire semble donc être la suivante : une telle continuité entre le monde des idéalisations fantastiques et le monde réel n'existe pas. Et cette leçon semble possible grâce à l'adoption, comme plan de base du monde de l'œuvre, d'une imagination réaliste, qui contraste avec l'imagination fantastique que du protagoniste. Le «réalisme» de Cervantes serait, par conséquent, le fondement de la satire immédiate de l'absurde crédulité de don Quichotte, et, d'une façon plus générale, de la naïveté des lecteurs qui recherchent dans la littérature un rêve d'héroïcité et d'amour qu'ils ne peuvent trouver effectivement dans la vie», écrit, en 1975, Félix MARTINEZ BONATI.
Miguel de CERVANTES naquit le 9 octobre 1647, sous le règne de Charles QUINT, sacré roi d’Espagne, à Alcalá de Henares, une ville nouvelle de la Castille, une ville d’élite, un foyer de lumière. Par conséquent, enfant, témoin et victime du XVIe siècle finissant et son âge d’or espagnol, une liberté d’expression et d’inspiration, avec sa littérature opulente et féconde s’évanouissant de sa splendeur, CERVANTES n’est pas éloigné du dramaturge français Pierre CORNEILLE (1606-1684), de Félix LOPE de VEGA CARPIO (1562-1635), dramaturge et poète espagnol, et annonce déjà Pédro CALDERON de BARCA (1600-1681), poète et dramaturge espagnol, pour qui la vie est un songe. D’une famille de la vieille noblesse originaire de la Galice, il est le quatrième fils de Rodrigue de CERVANTES (1509-1585), un apothicaire-chirurgien, est un noble, mais un pauvre Hidalgo, des gens honnêtes et braves. Les SAAVERDA avaient combattu les Maures. Sa mère est Léonor CORTINAS (1520-1593). Miguel, le cadet de quatre autres enfants, est décédé le 22 avril 1616, à Madrid, la veille de la disparition de William SHAKESPEARE (1564-1616). Quand il n’avait que quatre ans, ses parents déménagent provisoirement à Valladolid, où son père fait quelques mois de prison pour dettes. En raison de son exceptionnel héritage littéraire, de nombreuses villes en Espagne ou en Italie, se disputent l’honneur de compter Miguel CERVANTES parmi leurs citoyens, notamment à Valladolid en 1554, à Madrid en 1561, à Séville en 1564-1565, Madrid à partir de 1566, Lucena, Tolède, Esquivias, Alcazar de San Juan ou Consuegra, mais aussi en Italie ; il a été aussi retenu en esclavage, à Alger.
Dans ses vies orageuses, pleines de bifurcations et de menaces, mais belles, CERVANTES estime que «La liberté est un des dons les plus précieux que le ciel ait fait aux hommes. Rien ne l’égale, ni les trésors que la terre enferme en son sein ni ceux que la mère recèle en ses abîmes». Homme d’aventure et de plume, figure majeure du siècle d’or espagnol, CERVANTES a vécu une existence à la fois héroïque, glorieuse, laborieuse, courageuse, mais aussi douloureuse, dans la pauvreté et la résilience, un vrai roman. «Cervantès est un des plus beaux génies de l'humanité et une de ses plus grandes âmes», dit Anatole France. Passionné de lecture, dès son jeune âge, il lisait toujours tout ce qui lui tombait sous la main, et même les morceaux de papier déchirés qu'il ramassait dans les rues et sur les places publiques.
Cependant, ses parents voulant qu’il devienne un ecclésiastique, Miguel de CERVANTES a d’abord suivi, à Madrid, des cours de latin et de théologie. En rebelle, son ambition littéraire étant plus forte que tout, il sort une élégie sur la mort de la reine Isabelle de Valois, plusieurs sonnets, un poème appelé «Filène». La reconnaissance littéraire étant tardive, il s’exile à Rome, et devient un valet de chambre au légat du Pape, le cardinal Giulio AQUAVIVA d’ARAGONA (1546-1574). Rebuté par ce métier ingrat, Miguel de CERVANTES s’engage dans l’armée à Rome, sous Marc-Antoine COLONNA et combattit les Turcs aux côtés des Vénitiens. Il participe à la bataille de Lépante en 1571, où il perd l'usage de la main gauche, devenue paralysée ; ce qui lui vaut le surnom de «Manchot de Lépante». Poète méprisé, à sa guérison, il s’engage, à nouveau, dans la garnison de Naples et y demeure pendant trois ans. «Il n'y a pas de meilleurs soldats que ceux qui se transplantent du terrain des études aux champs de la guerre: nul n'est devenu d'étudiant soldat, qui ne l'ait pas été à l'excès», Persile et Sigismonde. Voulant se rendre en Espagne, par une galère de Philippe II, il est capturé, avec son frère, Rodrigo, le 26 septembre 1575, par un redoutable corsaire, Arnaute MAMI ou Mohamed l’Albanais, qui le conduit à Alger. Après moult péripéties, son frère Rodriguo fut libéré contre une rançon. CERVANTES, maintenu en esclavage pendant cinq à Alger, fut racheté le 19 septembre 1580, à cinq cents écus d’or, grâce en partie à sa mère. Le malheur, la misère, la faim, il les bravera sans se plaindre. Il les connait de longue date et maintenant, le ciel de sa patrie les lui fait oublier.
Revenu en Espagne, CERVANTES a abandonna l’Armée, pour se consacrer intégralement à la littérature. Quatre poésies sont publiées en 1569 à Madrid par son maître, l'humaniste Juan LOPES de HOYOS (1511-1583), qui lui donna le goût des Belles lettres. Aussi, il entama «Galatée», avec six chapitres, un ouvrage resté inachevé. Il épouse Dona Catherine de SALAZAR Y PALACIOS (1565-1626), et s’improvise en dramaturge.
I – Don Quichotte, un roman de la chevalerie et de la modernité
Devant les difficultés financières, CERVANTES va s’établir à Séville, et entame la rédaction de ses nouvelles, une peinture des vices de cette ville. Il fit un voyage dans la Manche, et à la suite d’une querelle, avec les habitants d’un village, Argamazille, commissaire aux vivres de l'armée, mais accusé de concussion, CERVANTES est jeté en prison.
CERVANTES demande du temps pour rendre ses comptes ; le grand honnête homme soupçonné cherche, compulse, met en ordre ses registres. C’est homme marqué par une grande humilité «Que personne ne dise, «Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau», écrit-il. L’auteur, tout en étant envahi par une montagne de difficultés, est resté attaché à sa dignité. «Mon honneur m’est plus cher que ma vie. (…) Un homme déshonoré est pire qu’un homme mort. (…) Mieux vaut la honte sur le visage, que la tache dans le cœur. (…). L’honneur et le profit ne couchent pas dans le même lit», dit-il.
C’est dans ces moments de désespoir et d’injustice, en écrivain immortel, talentueux et universel, pour se venger de ceux qui l’ont persécuté, sans nommer ce village d’Argamazille, CERVANTES entame alors la rédaction de son fameux roman, «Dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un gentilhomme de ceux qui ont lancé au râtelier, bouclier antique, maigre roussin et lévrier chasseur (..) Cet hidalgo, dans les moments où il restait oisif, c’est-à-dire à peu près toute l’année, s’adonnait à lire des livres de chevalerie, avec tant de goût et de plaisir, qu’il en oublia presque entièrement l’exercice de la chasse et même l’administration de son bien. Sa curiosité et son extravagance arrivèrent à ce point qu’il vendit plusieurs arpents de bonnes terres à labourer pour acheter des livres de chevalerie à lire. (…) Finalement, ayant perdu l’esprit sans ressource, il vint à donner dans la plus étrange pensée dont jamais fou se fût avisé dans le monde. Il lui parut convenable et nécessaire, aussi bien pour l’éclat de sa gloire que pour le service de son pays, de se faire chevalier errant, de s’en aller par le monde», écrit-il au début de «Don Quichotte de la Manche». Par conséquent la littérature l’a sauvé de la misère ; il écrit avec son démon intérieur pour se libérer du poids de la vie. Les calomnies et les critiques ont accru sans pauvreté, mais sans altérer dans sa détermination d’écrivain ; il a voulu, à travers ses écrits, rétablir la Vérité «L’histoire est comme une chose sacrée, parce qu’elle doit être véritable, et où se trouve la vérité, se trouve Dieu, son unique source. La plume est l’interprète de l’âme : ce que l’une pense, l’autre l’exprime. On est toujours le fils de ses œuvres», écrit-il. En effet, dans cette satire, de la mort, du ridicule, du rire, et de l’outrage, le héros du roman, couvre du ridicule ses détracteurs. «Cervantes commença sans doute son œuvre pour se distraire et avec ce désir instinctif de se moquer, lui aussi, des fous qui sacrifient quelque chose de leur vie à leur idéal. Il était vieux, brisé, torturé ; que de déceptions et de misères! Il comprenait le ridicule du sacrifice, la sottise de l'abnégation; il avait déjà reçu le châtiment de l'honneur ! Il se mit à rire, mais d'un rire strident, se bafouant lui-même dans ce personnage qu'il appelait le fils de son esprit, ne lui épargnant ni les horions ni les déboires, répondant à toute illusion par une déception, à toute croyance par une négation, à tout espoir par une défaite. Aussi, de quoi se mêlait- il, cet écervelé, ce chevalier de la Triste-Figure, maigre et pauvre pantin juché sur un cheval osseux, de quoi se mêlait-il de défendre le bon droit méconnu, la vertu persécutée, la faiblesse opprimée !», écrit en 1865, Jules CLARETIE.
Par conséquent, CERVANTES a mis de lui-même dans ce roman. «Pour écrire cette critique, il m'a fallu non seulement rassembler des souvenirs, ce qui n'est pas encore si difficile, mais également tâcher d'aller au-delà et, ce faisant, affuter mon propre sens critique et le diriger vers moi-même dans un lourd travail d'introspection», écrit-il. «J'ai essayé, dans Don Quichotte, de donner quelque passe-temps à mon humeur mélancolique», écrit-il. «Le meilleur des livres de l'Espagne est celui qui se moque de tous les autres», dira MONTESQUIEU. En effet, CERVANTES dans son roman de la chevalerie, un hidalgo d’âge moyen, Alonso Quichano, perd la raison après avoir lu trop de romans de chevalerie. Convaincu qu’il doit rétablir la chevalerie et défendre les opprimés, il prend le nom de Don Quichotte, se costume en chevalier, et choisit une vieille jument, Rossinante, comme sa monture. Il persuade également un fermier simple et bon, Sancho Panza, de l’accompagner comme son écuyer, lui promettant le gouvernorat d’une île en récompense.
Leur première aventure les mène à une auberge que Don Quichotte prend pour un château. Il demande à l’aubergiste de l’adouber chevalier, ce que l’aubergiste fait pour amuser ses hôtes. Cet acte de «chevalerie» est suivi par de nombreux autres, chacun reflétant le fossé entre la vision idéalisée de Don Quichotte et la réalité brutale et souvent comique du monde qui l’entoure. Ils rencontreront des géants, à moins que ce ne soient des moulins à vent, et des armées en bataille, sauf si ce n’étaient que des troupeaux de moutons. Dans les derniers développements du roman, Sancho acquiert finalement une île à gouverner, mais il Don Quichotte est vaincu dans un duel par le chevalier de la Blanche Lune, un personnage déguisé en chevalier pour le convaincre de renoncer à ses aventures et de retourner à sa vie de gentilhomme. Selon les termes de leur affrontement, Don Quichotte doit abandonner ses armes et retourner chez lui. Il obéit, et, de retour dans son village, il tombe malade. Sur son lit de mort, il renonce à ses illusions chevaleresques, recouvre la raison et meurt en paix, entouré de ses amis et de sa famille. La mort le délivre de sa folie. Il découvre rapidement que le pouvoir et la responsabilité ne sont pas ce qu’il avait imaginé. «Ce ne sont pas les richesses qui font le bonheur, mais l’usage qu’on en fait», écrit CERVANTES.
Dans son roman, «Don Quichotte», une création littéraire mobile, inquiète, flexible, pleine de vagabondages et de variations, CERVANTES n’abandonne jamais ; il est dans la vérité historique qui «a pour mère l’histoire, émule du temps, dépositaire de nos actions, témoin du passé, exemple et annonce du présent, avertissement pour l’avenir». En fait, Don Quichotte, bien plus qu’une bouffonnerie, une fantaisie ou la création d’un écrivain désabusé, est une remarquable critique sociale de la chevalerie, les difficultés financières, familiales et sociales de l’auteur étant sous-jacentes et omniprésentes. «La vie véritable des hommes de génie est la vie de leur pensée ; quelque curiosité qui s'attache à leurs aventures, n'oublions pas que le rôle des écrivains supérieurs parmi les hommes est purement spirituel, le caractère qui les distingue, leur marque, leur don est de gouverner le monde idéal. Fils de l'esprit, messagers de lumière, ils doivent à la flamme qu'ils portent en eux la puissance invisible qui leur est conférée», écrit Michel CHASLES. En effet, Don Quichotte un roman fait de contrastes, une littérature pleine de rêve et de magie, de valeurs essentielles de la vie. «Simple comme un enfant, on ne sait pourtant pas combien il est sage, et tout nourri d'exquise érudition. Il serait un docteur, s'il n'était trop honnête homme pour avoir trace de pédant. Il n'enseigne rien que par l'exemple. Et s'il fait leçon, c'est avec une modestie de jeune fille, parce qu'on la sollicite de parler, et qu'on la prie de lever un peu son voile. Néanmoins, que de suave orgueil il cache ainsi : le contentement de servir jusqu'à la mort, et peut-être mieux qu'un autre, tout ce qui vaut d'être servi. Il n'est point fourni de poisons et d'engins diaboliques, pour prouver la bonté de sa doctrine. Il n'a que son lait d'humanité, là, qu'il verse en nourriture à tout venant. Le succès ne lui est rien du tout : il ne pense qu'à l'éternelle victoire.», écrit André SUARES.
D’une part, nous avons Don Quichotte, le chevalier décalé, un obscur et illuminé gentilhomme de province, le rondache, sans pitié, sans répit, et point de pardon. C’est un membre d'une époque qui rêverait d'en habiter une autre, plus ancienne, plus noble, plus féérique à ses yeux. Cette époque rêvée il ne la connaît pas, il l'a seulement fantasmée.
Don Quichotte est dans le plus grand déni ; pour lui, voir la réalité en face c'est renoncer à son rêve, à sa définition du bonheur, c'est perdre le sens de sa vie. «Heureux furent les temps bénis où vint au monde l’intrépide chevalier don Quichotte de la Manche, Sa noble décision de ressusciter et de rendre au monde l’ordre perdu et presque défunt de la chevalerie errante nous permet de goûter, en un âge qui a tant besoin de divertissements joyeux, non seulement l’agrément de sa véridique histoire, mais ses contes à épisodes, qui ne sont pas moins plaisants, vrais et remplis d’art que l’histoire elle-même», écrit Cid Hamet Benengeli, un personnage fictif créé par CERVANTES. Dans ses dialogues platoniciens, CERVANTES au siècle d’or espagnol, ce voyage initiatique de Don Quichotte et son écuyer, esquisse le siècle des Lumières ; il y a bien un décalage manifeste entre le monde tel qu’on vous le conte et tel qu’il est réellement. CERVANTES a «combattu l’esprit d’illusion dans sa patrie et en lui-même», écrit Emile CHASLES.
D’autre part, Don Quichotte prend pour écuyer un de ses voisins, Sancho Panza, un paysan entre deux âges, ignorant et crédule à l'excès, mais d'une bonne nature ; glouton et fripon, égoïste et grossier, quoiqu’attaché à son maître ; assez spirituel parfois pour reconnaître la folie de leur position, mais toujours amusant, quelquefois même malicieux dans les interprétations qu'il en fait. Face au maître, le gros et gras Sancho, plein de raisonnements irréfutables et de réponses accablantes, la vivante personnification du bon sens qui tue, de la réalité qui s'impose, de la nécessité qui attache par tous ses liens l'âme à la terre. À tous les dithyrambes du chevalier, le bon Sancho répond par un proverbe. Les folles entreprises de son maître sont de puissantes dénonciations d’injustices, à travers ce troupeau d'infidèles, c'était un troupeau de moutons, ou ces captifs innocents, ce sont des voleurs qu'on menait aux galères, des moulins à vent. Ces deux personnages sortent du village qui les a vus naître, à la recherche d'aventures; et, l'imagination surexcitée du chevalier, transformant des moulins à vent en géants, des auberges solitaires en châteaux, et des galériens en chevaliers opprimés, lui en fait trouver en abondance partout où il va.
Finalement, ce qui venge CERVANTES, c’est donc son puissant roman d’un idéal bafoué, d’un dévouement berné, d’une grandeur méconnue, de la méconnaissance du bon sens, mais aussi la folie de la Raison. «Je suis chevalier, dit-il quelque part, et tel je vivrai et mourrai s'il plaît au Très-Haut. Les uns suivent -le large chemin de l'orgueilleuse ambition; d'autres, celui de l'adulation basse et servile ; d'autres encore, celui de l'hypocrisie trompeuse ; et quelques-uns enfin, celui de la religion sincère. Quant à moi, poussé par mon ; étoile, je marche dans l'étroit sentier de la chevalerie errante, méprisant les richesses, mais non point l'honneur. J'ai vengé des injures, redressé des torts, châtié des insolences. Je n'ai point d'intention qui ne soit droite ; je ne songe qu'à faire du bien à tout le monde et à ne donner jamais lieu de se plaindre à personne, et si un homme qui pense et qui agit ainsi mérite d'être traité de fou, je le demande à Leurs Excellences», écrit CERVANTES.
Don Quichotte est donc un monument littéraire universel et intemporel, et contient ce dont parle François RABELAIS (1483-1553), la drogue inappréciable qui devrait nous guérir, si quelque chose nous guérissait. «Il y a au-dedans et au fond une triple dose d'ellébore. C'est la peinture d'une triple folie, celle de l'Espagne aventureuse et superbe, celle de Cervantes, le rêveur, l'incorrigible, et celle enfin de l'humanité qui, tour à tour positive comme Sancho et chevaleresque comme don Quichotte, s'élève et s'abaisse, s'exalte ou se calomnie, et flotte comme une insensée de la terre au ciel», écrit Michel CHASLES.
II – L’héritage littéraire de Miguel CERVANTES
À la fin de sa vie, Miguel de CERVANTES semblait être gagné par le pessimisme, avec une grande dose d’amertume. «Mon œuvre est perdue et ma vie a été une longue imprudence, écrivait Cervantes, quand il se sentait mourir et jetait sur sa carrière un regard ironique. Je vais portant sur mes épaules une pierre avec une inscription où se lit l'avortement de mes espérances», écrit-il en 1615. En poète rêveur, désintéressé, amoureux du beau, du généreux et du noble, CERVANTES, un talentueux écrivain, n’avait pas mené son ambition littéraire avec un plan de carrière orienté vers la réussite. «Le poète le plus sage est gouverné par des fantaisies imprévues et charmantes, il est plein de projets et son ignorance de la vie est éternelle. Absorbé dans ses chimères, passionné pour ce qu'il crée lui-même, il oublie d'arriver à la fortune et aux honneurs», confesse-t-il.
CERVANTES a écrit la première partie de son «Don Quichotte» dans un âge avancé, à l’âge de 60 ans, à la fin d'une vie dont presque chaque étape avait été marquée par des espérances déçues, des luttes décourageantes, des calamités douloureuses; qu'il avait été commencé dans une prison et fini quand l'auteur sentait la main de la mort pesante et glaciale presser son cœur. Cependant, qualifié de «chasseurs de nuées», Combattif, il ne reste pas inerte «Aucun pessimisme, aucun sentiment de révolte contre le destin. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est à nous d'essayer de les rendre meilleures. Si ces essais sont infructueux, il sied de ne s'en prendre qu'à soi-même. Le bon Chevalier conserve toujours son ardeur, sa foi. Les efforts, les combats recommencent que la source d'énergie, de volonté q lui, est intarissable», écrit Raymond RECOULY. Un faussaire, Alonso FERNANDEZ de AVELLANEDA, qui essaya de composer, en 1614, une suite apocryphe de la première partie de Don Quichotte, et oblige donc CERVANTES, dix ans plus tard, à rédiger la deuxième partie de son roman. «Je veux qu'il soit l'œuvre ou le livre de divertissement le meilleur qui se soit écrit dans aucune langue», écrit CERVANTES, dans la dédicace, de ce livre de la chevalerie, modifié par l'esprit de son siècle et dégagé des absurdités qui abondent dans les écrits de ses contemporains.
Finalement, la fin de vie de CERVANTES, un naufrage et une œuvre devenue une épave, bref une accumulation de difficultés, pouvant compromettre sa postérité littéraire. «Ma pensée a été à demi étouffée par la misère. Le poète pauvre se voit enlever par le souci quotidien de sa subsistance la moitié de ses pensées et de ses divines conceptions. Mon théâtre est dédaigné après avoir été applaudi, mes nouvelles courent le monde égaré de leur route et peut-être sans le nom de leur auteur», dit CERVANTES.
Aussi, Miguel de CERVANTES dédia ses nouvelles à Don Pedro FERNANDES de CASTRO, comte de LEMOS. Son «Voyage au Parnasse», ne lui rapporte aucune notoriété. Alors qu’il travaillait encore sur son roman, «Persiles et Sismondes», atteint d’hydropisie. «La mort me presse de partir, et je veux pourtant vous écrire. Voilà précisément, l’état où je suis. Ils m’ont donné hier l’extrême-onction ; je me meurs, et je suis fâché de ne pas pouvoir vous dire combien votre arrivée en Espagne me cause de plaisir. La joie que j’en ai aurait dû me sauver la vie ; mais que la volonté de Dieu soit faite», écrit-il, le 19 avril 1616, au comte de LEMOS. CERVANTES meurt le 23 avril 1616. Dramaturge, poète et romancier, CERVANTES a écrit, en plus de son fameux Don Quichotte : huit grandes pièces de théâtre et autant d'Intermèdes comiques, deux vastes romans, l'un pastoral, la Galatée, l'autre d'aventures, du genre dit byzantin, les Tribulations de Persilès et de Sigismonde, dit plus brièvement le Persilès, un bon nombre de nouvelles et une quantité non négligeable de poèmes de divers registres. Cependant, si Miguel CERVANTES est devenu une gloire littéraire mondiale, c’est en raison de son Don Quichotte. «Sur tous les points civilisés de notre globe, le nom de Cervantès, à peine prononcé, a ce privilège de dérider les fronts les plus graves, d’amener un sourire, sur les lèvres les plus moroses. (..) «L’histoire de l’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche est, en réalité, est pour l’Espagne, ce qu’est l’Arioste pour l’Italie, Shakespeare pour l’Angleterre», écrit, en 1890, Lucien BART, un de ses biographes.
Les bonnes traductions de CERVANTES attestent bien, depuis quatre siècles, un intérêt constant et renouvelé pour cet auteur, sorti depuis longtemps du Purgatoire. «J'ai à vous parler de Don Quichotte et de son auteur. Ce sujet-là est un de ceux qu'on n'épuise jamais. Le privilège des œuvres du génie est de fournir une incessante matière aux commentateurs de, tous les temps et de tous les pays. De commentateurs et de traducteurs, Don Quichotte n'a jamais manqué, et j'espère qu'il s'en trouvera encore un grand nombre. On a beau puiser, à cette source éternelle d'émotion et d'ironie, de grandeur et de bon sens, elle ne sera jamais tarie», écrivait déjà, en 1865, Jules CLARETIE. Aux yeux de la postérité, Cervantès incarne le génie littéraire d'une nation : un destin qu'il partage avec Dante, Goethe et Shakespeare, mais qui, dans son cas, s'assortit d'un curieux privilège, celui d'être le seul écrivain espagnol à avoir atteint une renommée pleinement universelle. Don Quichotte et Hamlet, publiés la même année, ont des valeurs communes. «Le sang s’hérite et la vertu s’acquiert, et la vertu vaut, par elle seule, ce que le sang ne peut valoir», écrit-il. Tous les hommes vivent, qu’ils le sachent ou non, en vertu d’un principe, d’un idéal, qu’ils considèrent comme la vérité, la beauté, le droit. «Don Quichotte est pénétré tout entier de dévouement à cet idéal pour lequel il est prêt à supporter toutes les privations, à donner même sa vie ; il n’estime cette vie que comme un moyen d’incarner l’idéal, de réaliser la vérité, la justice sur la terre. On nous dira que son cerveau dérangé a puisé cet idéal dans le monde fantastique des romans de chevalerie. D’accord, et c’est là ce qui constitue le côté comique de Don Quichotte ; mais l’idéal n’en garde pas moins toute sa pureté primitive. Vivre pour soi, s’occuper de soi, c’est une honte aux yeux de Don Quichotte. Il vit tout entier, si l’on peut s’exprimer ainsi, en dehors de lui-même, pour les autres, pour ses frères, pour la destruction du mal, pour la lutte contre les forces hostiles à l’humanité, les sorciers, les géants, c’est-à-dire les oppresseurs», écrit Ivan TOURGUENIEV.
Cette renommée, CERVANTES la doit assurément à «Don Quichotte», un roman qui renvoie à Lanzarote, le grand Lancelot des romans de chevalerie, une création littéraire sublime, tragique, farcesques et parodique. Mais, si le destin de l'ingénieux hidalgo a projeté celui-ci bien au-delà du récit de ses aventures, le mythe qu'il incarne désormais est d'abord lié à l'avènement d'une forme cardinale de la fiction en prose, que l'on appelle aujourd'hui le roman moderne. CERVANTES ne connut pas de succès immédiat parce que «la fiction romantique sérieuse, particulièrement fruit de la civilisation moderne, n'était pas encore assez développée pour permettre à un esprit tel que Cervantès d'obtenir le triomphe à un si haut degré, surtout alors que l'inclination naturelle de son génie le portait vers le genre enjoué et badin», écrit George TICKNOR. La grande percée littéraire de CERVANTES, perceptible à la fin du XVIIe siècle, éclatera au XIXe siècle et marquera son triomphe. Il n'y a pas eu, en Espagne, de monument élevé à CERVANTES, jusqu'en 1835, année où l'on éleva sur la place de l'Estamento, devenue les Cortès, une statue en bronze d'une grandeur un peu plus que naturelle, fondue à Rome par Solà, sculpteur de Barcelone. En dépit de certains détracteurs minoritaires, «il prend parmi les hommes de génie le rang qui lui est dû. Chaque point de son histoire est examiné, et l'examen de son œuvre, comme l'étude de sa vie, révèle la grandeur véritable de sa pensée ou de ses actes», écrit, en 1866, Emile CHASLES.
En 1605, le succès de «Don Quichotte», et donc l’immortalité de son auteur, est dû au fait de ce roman marque la fin du réalisme, en tant qu’esthétique et innove considérablement, par sa grande modernité, des combats contre les moulins à vent ou contre les moutons-armées un grandiose triomphe de l’imagination, avec une glorification de l’amour, sous toutes ses formes. «Heureux furent les temps bénis où vint au monde l’intrépide chevalier Don Quichotte de la Manche. Sa noble décision de ressusciter et de rendre au monde l’ordre perdu et presque défunt de la chevalerie errante nous permet de goûter, en un âge qui a tant besoin de divertissements joyeux, non seulement l’agrément de sa véridique histoire, mais ses contes à épisodes, qui ne sont pas moins plaisants, vrais et remplis d’art que l’histoire elle-même», écrit Cid Hamet BENENGELI.
Don Quichotte est un roman révolutionnaire, une structure narrative innovante et complexe, un mélange de réalité et de fiction, un équilibre entre la satire et le fond, CERVANTES veille à enrichir l’histoire ; au fond, il critique les idéaux chevaleresques et les normes sociales du début du XVIIe siècle, un mélange d’humour et d’arguments sérieux, protéger les plus démunis. «Si par hasard tu fais incliner la balance de la justice, que ce ne soit jamais sous le poids d’un cadeau, mais sous celui de la miséricorde», écrit-il. En parodiant les romans de la chevalerie populaires de son temps, non seulement il divertissait, mais aussi et surtout, il invitait à s’insurger contre certaines valeurs rétrogrades. «Attache plus de prix à un humble vertueux, qu’à un noble orgueilleux», dit-il.
Par ailleurs, au sein de l’intrigue principale, CERVANTES crée une riche mosaïque de personnages et d’histoires, en faisant recours à la métafiction. Par conséquent, CERVANTES inviter à briser le quatrième mur, la frontière entre l’écrivain, la frontière entre la vie réelle et la fiction. «La plus est la langue de l’âme», écrit-il. La métafiction dialogue souvent directement avec les lecteurs, remettant ouvertement en question la propre histoire du narrateur. En effet, il a exhorté les lecteurs à se faire leur propre opinion sur le texte écrit.
La deuxième partie du roman débute avec la découverte par Don Quichotte et Sancho que la première partie de leurs aventures a été publiée. Cela ajoute une dimension métalittéraire à l’œuvre, car ils rencontrent des personnes qui les connaissent à travers le livre. Don Quichotte doit souvent défendre son honneur et son identité contre ceux qui le défient ou qui doutent de sa chevalerie.
Dans sa modernité, CERVANTES met en scène des personnages accomplis, complets et dépeints avec une grande profondeur psychologique et évoluant tout au long du roman, avec une vision du monde contrastée et une dépendance mutuelle. C’est un puissant roman de la quête du sens de la vie, et de la noblesse des idéaux de justice et d’égalité.
Références bibliographiques
I – Contributions de CERVANTES
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), Coignet et Goupillé. Nouvelle, traduction d’Adolphe Coster, Paris, Imprimerie Levé, 1909, 51 pages ;
CERVANTÈS SAAVEDRA (Miguel, de), L’amant libéral. Tragi-comédie, traducteur de Toussaint Quinet, Paris, 1638, 177 pages ;
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), L’ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche, traduction d’Aline Schulman, Paris, Seuil, 1997, 528 pages ;
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), La bohémienne de Madrid, traducteur de Louis Viardot, Castelnau-le-Lez, éditions Climats, 1991, 120 pages ;
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), La bohémienne de Madrid, traduction de Louis Viardot, Paris, 1853, 107 pages ;
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), La force du sang, traducteur de Nicole Disnar, Paris, Alfil, 1993, 51 pages ;
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), La Galatée. Les nouvelles exemplaires. Le théâtre, introduction et notes de Maurice Bardon, Paris, La Renaissance, 1935, 189 pages ;
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), La Jitanilla, traducteur de Jacques Soldanelle, Paris, E. Dentu, 1892, 144 pages ;
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel, de), Le captif, extrait «Don Quichotte», préface de Jacques Heers, traduction de J. Merson et Marie Boudarène, Versailles, éditions de Paris, 2005, 130 pages.
II – Critiques et biographies
ARRABAL (Fernando), Un esclave nommé Cervantès, traduction de Moreau Arrabal, Paris, Plon, 1996, 270 pages ;
BABELON (Jean), A la gloire de Cervantès, Paris, Nouvelle revue critique, 1939, 283 pages ;
BABELON (Jean), Cervantès : notice sur sa vie et son œuvre, préfaces de Julien Cain et Jean Cassou, Paris, Bibliothèque nationale, 1947, 52 pages ;
BARDON (Maurice), Don Quichotte en France, au XVIIe et au XVIIIe siècles (1605-1815), Paris, Honoré Campion, 1931, 2 vol, 932 pages ;
BATAILLON (Marcel), «Cervantès peint par lui-même», Annales du centre universitaire méditerranéen, 1949, T II, pages 113-114 ;
BATAILLON (Marcel), «Cervantès penseur, d’après le livre d’Americo Castro», Revue de littérature comparée, 1928, Vol VIII, pages 318-338 ;
BAUTISTA NARANJO (Esther), «Le Don Quichotte de Cervantès ou la méta littérature critique», Revue de littérature comparée, 2019, V I, n°369, pages 11-22 ;
BERTRAND (Jean-Joseph-A), Cervantès et le romantisme allemand, Paris, éditeur non précisé, 1914, 667 pages ;
BIART (Lucien), Cervantès, Paris, Société française d’imprimerie, 1897, 234 pages ;
BIDOU (Henry), «Ce que nos aïeux ont pensé de Don Quichotte», Journal de l’université des annales, 15 mars 1924 ;
BIDOU (Henry), «De la folie au sublime», Journal de l’université des annales, 1er avril 1924 ;
BUCHANAN (Milton, A), «Cervantès as a Dramatist», Modern Language Notes, juin 1908, Vol XXIII, n°6, pages -186 ;
CANAVAGGIO (Jean), Cervantès, traduction de J. R Jones, New York, W. W. Norton, 1990, 348 pages ;
CAPEDBOSCQ (Anne-Marie), éditrice scientifique, Cervantès, Poitiers, La Licorne, 1997, 258 pages ;
CARRASCO (Raphaël), L’univers de Miguel Cervantès, Paris, Ellipses, 2010, 203 pages ;
CARRERAS (D. Lius), Essai sur la vie et les œuvres de Cervantès, Paris, Alphonse Lemerre,1896, 332 pages ;
CASSOU (Jean), Cervantès, Paris, éditions Sociales internationales, 1936, 244 pages ;
CASTRO (Americo), Cervantès, Paris, éditions Rieder, 1931, 80 pages ;
CHASLES (Emile), Michel de Cervantès, sa vie, son temps, son œuvre, politique et littéraire, Paris, Didier et Cie, Libraires-éditeurs, 1866, 460 pages ;
CIROT (Georges), «Sur les «Maris jaloux» de Cervantès», Bulletin hispanique, janvier 1929, pages 1-74 ;
CITATI (Piétro), Don Quichotte, traduction de Brigitte Pérol, Paris, Gallimard, l’Arpenteur, 2018, 192 pages ;
CLARETIE (Jules), «Cervantès, Don Quichotte», Bulletin des entretiens et lectures, 12 février 1865, pages 42-45 ;
COLLET (Henri), Œuvres choisies de Cervantès, Paris, Armand Colin, 1920, 268 pages ;
COMBET (Louis), Cervantès ou les incertitudes du désir. Une approche psychostructurale de l’œuvre de Cervantès, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1980, 593 pages ;
DAIREAUX (Max), Cervantès, Paris, Desclée de Brouwer, 1947, 294 pages ;
DIEULAFOY (Marcel), Le théâtre édifiant : Cervantès, Tirso de Molina, Calderon, Paris, Bloud,1907, 352 pages, spéc sur Cervantès, pages 59-60 ;
FAURE (Elie), Cervantès, traduction de Margarita Nelken, dessins de Pablo Picasso, Madrid, Imp. Ciudad Lineal, 1926, 137 pages ;
FEUILLERET (H.), «Cervantès à Alger. Histoire de sa captivité (1775-1780)», Akhbar, journal de l’Algérie, 24 novembre 1850, pages 3-4 ;
FITZMAURICE-KELLY (James), The Life of Miguel de Cervantès Saaverda : A Bibliographical, Literary and Historical Study, London, Chapman and Hall, 1892, 396 pages ;
FLORIAN (Jean-Pierre Claris de), Galatée, roman pastoral, imité de Cervantès, Paris, Imprimerie Didot, 1784, 171 pages ;
FUENTES (Carlos), Cervantès ou la critique de la lecture, préface de Jean Canavaggio, traduction de Claude Fell, Paris, L’Herne, 2006, 190 pages ;
GUARDIA (J.M), «Le portrait de Cervantès», Revue moderne, 1866, tome 38, pages 300-314 ;
HAINSWORTH (G.), «Cervantès en France», Bulletin hispanique, avril 1932, pages 128-135 ;
HAZARD (Paul), Don Quichotte de Cervantès : étude et analyse, Paris, éditions de la pensée moderne, 1970, 350 pages ;
LIBERT (Lucien, docteur), La folie de Cervantès, G. Steinhel, 1909, 174 pages ;
LOUVEAU (E.), De la manie dans Cervantès, Montpellier, Imprimerie centrale du Midi, 1876, 54 pages ;
MANGUEL (Alberto), Don Quichotte et ses fantasmes, Paris, Herodios, 2025 112 pages ;
MARTINEZ BONATTI (Félix), «Cervantès et les régions de l’imagination», Etudes littéraires, 1975, Vol 8, n°2-3, pages 303-343 ;
MERIMEE (Prosper), «La vie et les œuvres de Cervantes», Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1877, Vol 24, n°4, pages 721-768 ;
MERIMEE (Prosper), Portraits historiques et littéraires, Paris, Michel Lévy, 1874, 357 pages, spéc partie I, pages 4-30 ;
MONER (Michel), Cervantès : conteur, écrits et paroles, Paris, Diffusion aux amateurs de livres, 1989, 333 pages ;
MONTEGUT (Emile), «Caractère historique et moral de Don Quichotte», Revue des Deux-Mondes, 1862, Vol I, pages 170-195 ;
NADLER (Steven), «Descartes et Cervantès : le malin génie et la folie de Don Quichotte», Laval théologique et philosophique, 1997, Vol 53, n°3, pages 605-616 ;
PARELLO (Vincent), La Catalogne de Cervantès : texte et contexte, Montpellier, Université de Paul Valéry III, 2006, 217 pages ;
PERRAULT (Pierre), Critique du livre de Don Quichotte la Manche, Maurice Bardon éditeur Scientifique, Paris, Les Presses modernes, 1930, 276 pages ;
RECOULY (Raymond), Le chasseur de nuées ou la vie de Cervantès, Paris, les éditions de France, 1938, 267 pages ;
SUARES (André), Cervantès, Paris, Emile-Paul frères, 1916, 121 pages ;
SUARES (André), Trois grands vivants : Cervantès, Baudelaire, Tolstoï, Paris, Bernard Grasset, 1937, 307 pages ;
TICKNOR (George), Histoire de la littérature espagnole, traduction et notes de J.M Magnabal, Paris, Hachette, 1870, 586 pages, spéc chapitre 12, pages 183-200 ;
TOURGUENIEV (Ivan), Hamlet et Don Quichotte, traduction de Louis Léger, La bibliothèque russe, 1860, 30 pages ;
TRAPIELLO (Andrès), Les vies de Miguel Cervantès, traduction d’Alice Déon, Paris, Buchet Chastel, 2005, 314 pages ;
VILAR (Jean), et autres, «Cervantès», Revue Europe, numéro spécial, janvier-février 1956, n°121-122, 220 pages et novembre-décembre 2010, n°979-980, 117 pages.
Paris, le 2 mai 2025, par Amadou Bal BA



