
Agrandissement : Illustration 1
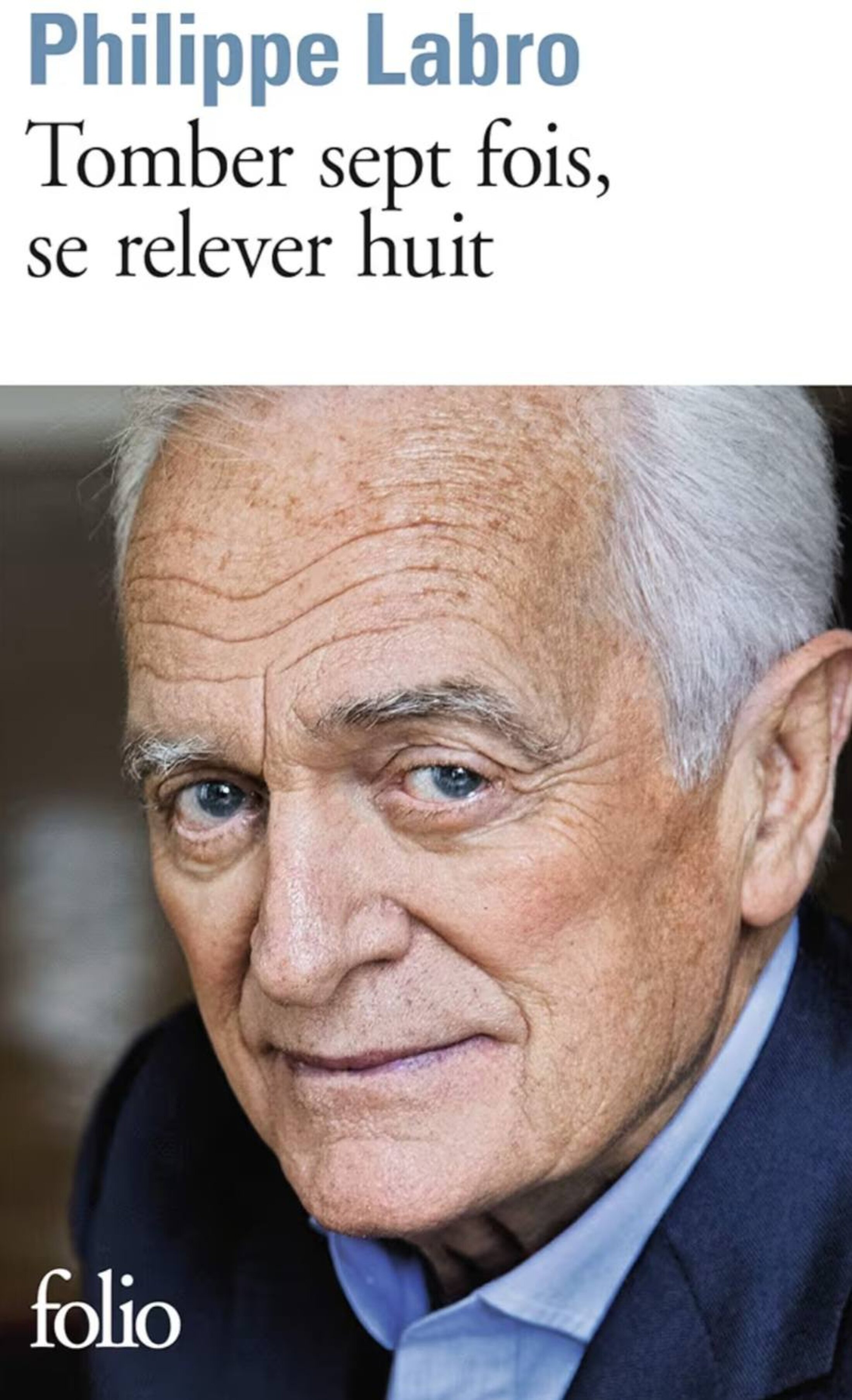

Agrandissement : Illustration 2


Agrandissement : Illustration 3

«Philippe LABRO (1936-2025) écrivain et homme de médias. Le plus américain des écrivains français. Écrivain de la force de la vie et de l’Amour. In Memoriam» par Amadou Bal BA
Atteint d’un cancer, Philippe LABRO nous a quittés le 4 juin 2025, à Paris, à l’âge de 88 ans. Courageux et lucide devant cette grande échéance, il est resté philosophe et digne. «Il ne faut pas trop penser à la finitude ; il faut vivre ; il faut embrasser la vie», disait Philippe LABRO.
Cet écrivain prolifique aux talents multiples, journaliste, scénariste et auteur de chansons, dynamite ce préjugé, encore très tenace, le journalisme ne serait que de l'anecdotique, la superficialité, la paresse intellectuelle ou le sensationnalisme. «Ton regard, aussi bien celui du romancier que celui du journaliste, sur tout sujet qui t'intéresse, chaque semaine. Tu as 7 500 signes pour le faire. Tel est le contrat. La plupart du temps, on dépasse le compte : 9 000, voire 10 000 signes. Alors, on rabote, on essaie de conserver ce que l'on croit être l'essence même d'un «papier ». En vérité, pour bien exercer ce métier (de journaliste), il ne faut jamais être «emmerdant. Jamais.», écrit-il dans «7500 signes». À l'instar de grands écrivains, comme Honoré de BALZAC, la contribution littéraire de Philippe LABRO témoigne d'une grande érudition, d’une profondeur intemporelle, par les thèmes riches et diversifiés abordés, mais aussi par la rigueur, le sens de la formule, la densité et la nervosité du style, ainsi que la technique narrative. En effet, les thèmes qui structurent ses écrits, avec une grande part autobiographique, sont l’individu, le la religion, l’histoire, la famille, la ville, la nation, l’éducation et le travail. En particulier, il a exploré l’intégration, la jeunesse, le passage à l’âge adulte et l’identité. Conteur de la vie et de l’ère du temps, en disciple d’Ernest HEMINGWAY (Voir mon article, Paris est une fête, Médiapart, 8 septembre 2018), artisan du travail bien fait, il s’est inspiré des «choses vues et des choses vécues».
Philippe LABRO est né le 27 août 1936, à Montauban (Tarn-et-Garonne), en plein Front populaire et à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Son père, Jean-François LABRO (1890-1983), arrivé à Montauban, dans les années 20, ouvre un cabinet de conseil juridique et fiscal, et fait fortune. Sa mère, Henriette CARISEY (1911-2010), est la fille naturelle d’un noble polonais et d’une institutrice française. «Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère», écrit-il dans «Ma mère, cette inconnue». En 1948, sa famille se réinstalle à Paris. Le jeune Philippe, inscrit, au lycée Janson-de-Sailly, très doué pour la littérature, remporte à 15 ans, un concours de journalisme parrainé par Le Figaro ; il devient rédacteur en chef du Journal des jeunes. Entre premier amour, violences, émotion et nostalgie, Philippe LABRO est le peintre des années parisiennes de 1950 «Le «petit garçon» a grandi. Lycéen à Paris, il a quinze ans. C'est l'âge de la solitude, des rêves, de l'attente. Un inconnu, Alexandre, entre alors dans sa vie. Le charme slave, la grâce, l'élégance font de lui un être à part», écrit-il dans «Quinze ans».
I – Philippe LABRO, écrivain américain
En 1954, alors qu'il a raté son baccalauréat et doit redoubler, Philippe LABRO obtient, à 18 ans, une bourse Zellidja pour les universités de Washington et Lee de Lexington en Virginie. Philippe LABRO en a tiré un roman «l’étudiant étranger», Prix interallié, le début d’un cycle d’apprentissage, un titre de gloire. «La première fois que l'on tombe amoureux, la première fois que l'on vous ment, la première fois qu'on fait l'amour, la première fois qu'on perd une illusion, la première fois qu'on rencontre la beauté et son contraire. Les adultes et l'existence finissent par vous imposer le vieux précepte indispensable pour survivre : on efface, et l'on continue. Mais rien n'efface la première fois, pas plus que sur le blanc immaculé d'un drap ne peut tout à fait disparaître la tache de sang d'une vierge qui ne l'est plus», écrit-il. En effet, invité par une prestigieuse université de Virginie, un jeune Français découvre émerveillé la vie dorée des College Boys, leurs équipes sportives, leur campus dans une vallée paradisiaque. C'est le temps d'une Amérique sage, celle d'avant l'explosion des mœurs et le fracas des années soixante. Très vite, le jeune homme comprend qu'il reste un «étudiant étranger». Il va franchir des lignes, transgresser des tabous, sans même s'en rendre compte : d'abord en faisant l'amour avec une jeune institutrice noire, April. Ensuite en tombant amoureux d'une héritière de Boston, Elisabeth, personnage fantasque et corrosif. «Je me suis dit qu'il y avait des moments de bonheur et de beauté, et que j'avais vécu un moment comme ça et que j'en vivrais d'autres, et qu'entre ces moments de beauté et de bonheur il y avait le reste du temps et le reste de la vie, et que la seule chose que je pouvais faire, lorsque ce moment se présentait, c'était de le goûter le plus complètement et le plus profondément, mais je ne pouvais pas prétendre que ce moment dure éternellement. Il n'y a que des moments, et certains sont, simplement plus heureux que d'autres. Et il faut les saisir, comme on saisit une chance, cet oiseau rare qui passe au-dessus de l'homme et qu'on ne peut attraper qu'en se projetant en l'air, la paume et les doigts grands ouverts», écrit-il.
«L’étudiant étranger», est donc un roman très largement autobiographique de ses expériences entre 1954 et 1956 en Virginie, des mœurs de l’entre-soi, une mentalité particulière, avec un conformisme à l’excès. Vivant son rêve américain, il découvre donc un autre monde, entre amour et répulsion. C’est une magistrale ode célébrant le voyage, la jeunesse, la beauté, le bonheur, les émois de la découverte de la vie et de l'indépendance. «Je me défie de toute biographie, plus encore de toute autobiographie, pour trois raisons au moins. Ma préférence va de loin à une fiction assumée sortie du bel imaginaire d'un romancier qu'au récit d'un réel édulcoré à travers le prisme d'une mémoire sélective. Toute biographie est toujours plus proche de la fiction non-aboutie que de l'insupportable crudité de la réalité nu», écrit-il.
Parti travailler dans les montagnes du Colorado, il relate dans «un été dans l’Ouest», un territoire magique, surréaliste et immense, ses forêts immenses peuplées d’élans, d’ours noirs, une nature à écouter, une imprégnation de senteurs, de bruits, de silences, de son immensité. Ce livre poétique exhale les silos à grains et les champs à perte de vue, les tornades, les pins géants et les Grands Lacs. Il vivra avec elle un grand amour, fulgurant, dont le souvenir ne cessera de le hanter. C’est un roman de suspense, de l'aventure, des amitiés, des rodéos, le fantasme des pieds nus et orteils «J'avais vu alors qu'il croyait que je dormais, son regard extatique et lubrique posé sur mes orteils, et je n'avais pas oublié l'extrême rougeur qui l'avait envahi lorsque je l'avais démasqué .Il ne pouvait s'empêcher de jeter encore des regards brefs vers l'extrémité de mes jambes nues.et je sentis qu'il hésitait et qu'il aurait fallu bien peu de choses pour qu'il se jette dessus et me les baise ou me les lèche, quelle horreur !», écrit-il. C’est également un récit amoureux, Philippe LABRO y fait la connaissance de celle qu’il appelle Amy, la fille Clarke, aux cheveux fous, qui exhalent des senteurs de fleurs séchées - la liberté même.
Philippe LABRO est le plus américain des écrivains français «Je n’ai pas eu besoin de demander la permission à qui que ce soit, parce que c’était un instinct, qui reposait sur un désir, une curiosité d’Amérique, que j’avais depuis toujours. Elle venait de mes lectures d’enfance, du cinéma, de la libération de la France. Et de ma curiosité du monde, de mon envie de bouger, de partir. Alors bien sûr, j’ai prévenu mes parents et ils ne m’ont pas dit non. Ils ont toujours encouragé ma vocation. C’est une des clés de la vie : si on a une passion, la force et la construction familiales, ça compte. J’en ai eu 18 sur les routes américaines. Et j’ai vécu une aventure qui a totalement changé ma vie, qui a déterminé ma carrière et peut-être même mon caractère», dit-il. L’assassinat du président John Fitzgerald KENNEDY avait traumatisé l’Amérique, mais aussi le monde entier «C'est la phrase que toute l'Amérique a prononcée le 22 novembre 1963, jour de la mort de JF Kennedy. Sur place, j'ai vécu l'événement dans les couloirs du quartier général de la police. J'ai vu Oswald, j'ai rencontré Jack Ruby, la veille du jour où il assassina Oswald. J'ai connu les flics, la presse, la confusion, le Texas, les mystères», écrit-il dans «On a tiré sur le président». Il a fait la guerre d’Algérie, mais le relate autrement «Sur un paquebot qui va vers l'Amérique, un jeune homme rencontre une femme qui lui fait perdre toute innocence. Dans un bistrot, un inconnu vient me dire : «Je vous ai eu dans ma ligne de mire, en Algérie», écrit-il dans «Le flutiste invisible».
II – Philippe LABRO, écrivain de la vie et d’une époque
Philippe LABRO a relaté ses mille vies, ses rencontres riches et sa passion pour la littérature, la musique, la politique et la nature, dans «J’irai nager dans plus de rivières». Il s’agit naturellement de cours d’eau métaphoriques, celles de la vie, entre souvenirs et sagesse. Les rencontres, notamment avec Johnny HALLYDAY, Serge GAINSBOURG, Romain GARY ou Pablo PICASSON, «sont les cadeaux de la vie», écrit-il.
Écrivain de la vie et des passions amoureuses, son roman, «La traversée» raconte ce que signifie perdre le désir, l'énergie, la passion, l'estime de soi. «C'est arrivé subrepticement, sournoisement, sans prévenir, une vraie saloperie, une lente et insidieuse pénétration. Je suis l'esclave d'une chose indéfinissable qui est en train de me détruire et je lui obéis sans aucune résistance», écrit-il. Philippe LABRO évoque aussi l’amour physique, l’estime de soi «Je n'écris que cela, des banalités. En fait, je suis nulle. Toutes mes amies me disent que je suis géniale et belle et sympa et positive, et mes parents disent la même chose et tout le monde me croit formidablement sûre de moi, plaignez, plaignez la pauvre petite poule sans amour, la gentille fille de bon aloi qui ignore ce que l'amour physique veut dire, le bébé à l'enveloppe de femme qui a les chevilles trop épaisses, les hanches trop larges, un nez trop épaté, une oreille qui dit bonjour à l'autre, des fossettes trop hautes et un menton trop pointu, et qui marche en faisant des mouvements comme les bateaux qui tanguent dans le port lorsqu'il y a de la houle» écrit-il dans «Manuella». Il est aussi question de la maladie, de la vie, de la mort, du regard des autres, mais aussi de la traversée ou de la balance entre l’angoisse et l’espérance. «La maladie qui m'a conduit à la réanimation m'a emmené plus loin que la réa, bien au-delà du cap Horn, dans ce qu'il convient d'appeler une expérience de mort approchée. Au cours de cette traversée, j'ai vu et entendu toutes sortes de choses. Des monstres, des anges, des paysages et des visages, du vide et du trop-plein, de la compassion, de l'horreur et de l'amour», écrit-il dans «La traversée».
Dans «Feux mal éteints», Philippe LABRO relate son expérience pendant la Guerre d’indépendance de l’Algérie. C’est l’époque de jeunes Français qui eurent vingt ans au moment de la guerre d'Algérie, entre 1950 et 1960. Découvrant la violence et la mort, mais aussi la beauté d'Alger sous le soleil, la magie des plages nues, obsédés par l'adolescence perdue, hantés par le mythe du cinéma américain, confrontés avec la torture, ils deviennent bientôt des «adultes», c'est-à-dire qu'ils perdent leur innocence, s'ils gardent leurs nostalgies. Dans une atmosphère oppressante, des années de bonheur des colons succédant à la panique, aux suicides, aux attentats et à la torture, il dénonce l’absurdité et la violence de la guerre. «Les voitures de police sont des 403 bleu sombre et elles diffusent, sans arrêt, la petite phrase macabre qui signale que, quelque part en ville, un autre homme a cessé de respirer pour toujours», écrit-il. L’appelé sous les drapeaux, en permanence sur le qui-vive, est stressé «Tu tires sur tout ce qui bouge, pour un oui ou pour un non, tu crois voir des trucs dans la nuit, des ombres qui s’approchent, tu entends des bruits et tous sont suspects, tu ne peux pas prévenir le chef de poste parce que si tu le réveilles pour rien, il t’en veut et il gueule, alors tu te fais des rides tout seul dans le noir et tu en arrives à souhaiter qu’il se passe quelque chose», écrit-il.
En dépit de son talent littéraire, Philippe LABRO était admiratif des idées d’Eric ZEMMOUR «C’est évident qu’il a un talent de débatteur que peu d’autres ont. Un redoutable débatteur ; il possède la culture, il a le sens de l’Histoire, il connaît tous ses dossiers très, très bien. Il fait taire les journalistes de façon autoritaire et désagréable. En tout cas, il tient la barre, avec un thème obsessionnel : l’immigration. Je pense que la France vit une période de déclin», disait-il, en 2021.
Père de quatre enfants, Philippe LABRO était marié, en 1978, 47 ans, à François COULON, pour qui «la valeur la plus importante de nos vies, c’est l’amour». C’est une rencontre qui l’a transfiguré. «J’ai 38 ans et c’est une femme qui m’apporte sa beauté, sa grâce, sa sensualité, son intelligence, sa psychologie, son attention aux autres. Les gens qui m’ont connu avant Françoise ont parfois le souvenir de quelqu’un d’assez arrogant, insolent, voire un peu prétentieux. Elle me transforme littéralement, c’est le miracle d’une osmose entre deux êtres», disait-il en 2020, à «Paris-Match».
Références bibliographiques
A – La contribution de Philippe LABRO
LABRO (Philippe), 7500 signes, Paris, Gallimard, 2010, 496 pages ;
LABRO (Philippe), Des feux mal éteints, Paris, Gallimard, 1980, 384 pages ;
LABRO (Philippe), Deux Gimlets sur la 5e avenue, Paris, Gallimard, 2024, 128 pages ;
LABRO (Philippe), Frantz et Clara, Paris, Gallimard, 2007, 192 pages ;
LABRO (Philippe), J’irai nager dans plus de rivières, Paris, Gallimard, 2022, 352 pages ;
LABRO (Philippe), Je connais des gens de toutes sortes, Paris, Gallimard, 2003, 361 pages ;
LABRO (Philippe), L’étudiant étranger, Paris, Gallimard, 1988, 320 pages ;
LABRO (Philippe), La traversée, Paris, Gallimard, 1998, 304 pages ;
LABRO (Philippe), Le flutiste invisible, Paris, Gallimard, 2014, 192 pages ;
LABRO (Philippe), Le petit garçon, Paris, Gallimard, 1990, 312 pages ;
LABRO (Philippe), Les bateaux dans la nuit, Paris, Gallimard, 1985, 416 pages ;
LABRO (Philippe), Les gens, Paris, Gallimard, 2010, 416 pages ;
LABRO (Philippe), Ma mère cette inconnue, Paris, Gallimard, 2018, 192 pages ;
LABRO (Philippe), Manuella, Paris, Gallimard, 2001, 256 pages ;
LABRO (Philippe), On a tiré sur le Président, Paris, Gallimard, 2015, 304 pages ;
LABRO (Philippe), Quinze ans, Paris, Gallimard, 1995, 336 pages ;
LABRO (Philippe), Rendez-vous au Colorado, Paris, Gallimard, 2000, 272 pages ;
LABRO (Philippe), Tomber sept fois, se relever huit, Paris, Gallimard, 2005, 256 pages ;
LABRO (Philippe), Un Américain peu tranquille, Paris, Gallimard, 2005, 240 pages ;
LABRO (Philippe), Un début à Paris, Paris, Gallimard, 1996, 416 pages ;
LABRO (Philippe), Un été dans l’Ouest, Paris, Gallimard, 1990, 288 pages ;
LABRO (Philippe), Les barricades de mai Paris, Solar, Presses de la Cité, 1968, 148 pages ;
LABRO (Philippe), «Le bourlingueur métaphysique», Les temps modernes, 2006, n°640, pages 31-33.
B- Autres références
FORESTIER (François), «Philippe Labro, cet homme aux mille vies, nous avait parlé de journalisme, de littérature et d’Amérique», Le Nouvel Observateur, 4 juin 2025 ;
SALINGER (Pierre), Philippe Labro, conversations, Paris, Stock, 1975, 363 pages.
Paris, le 5 mai 2025, par Amadou Bal BA



