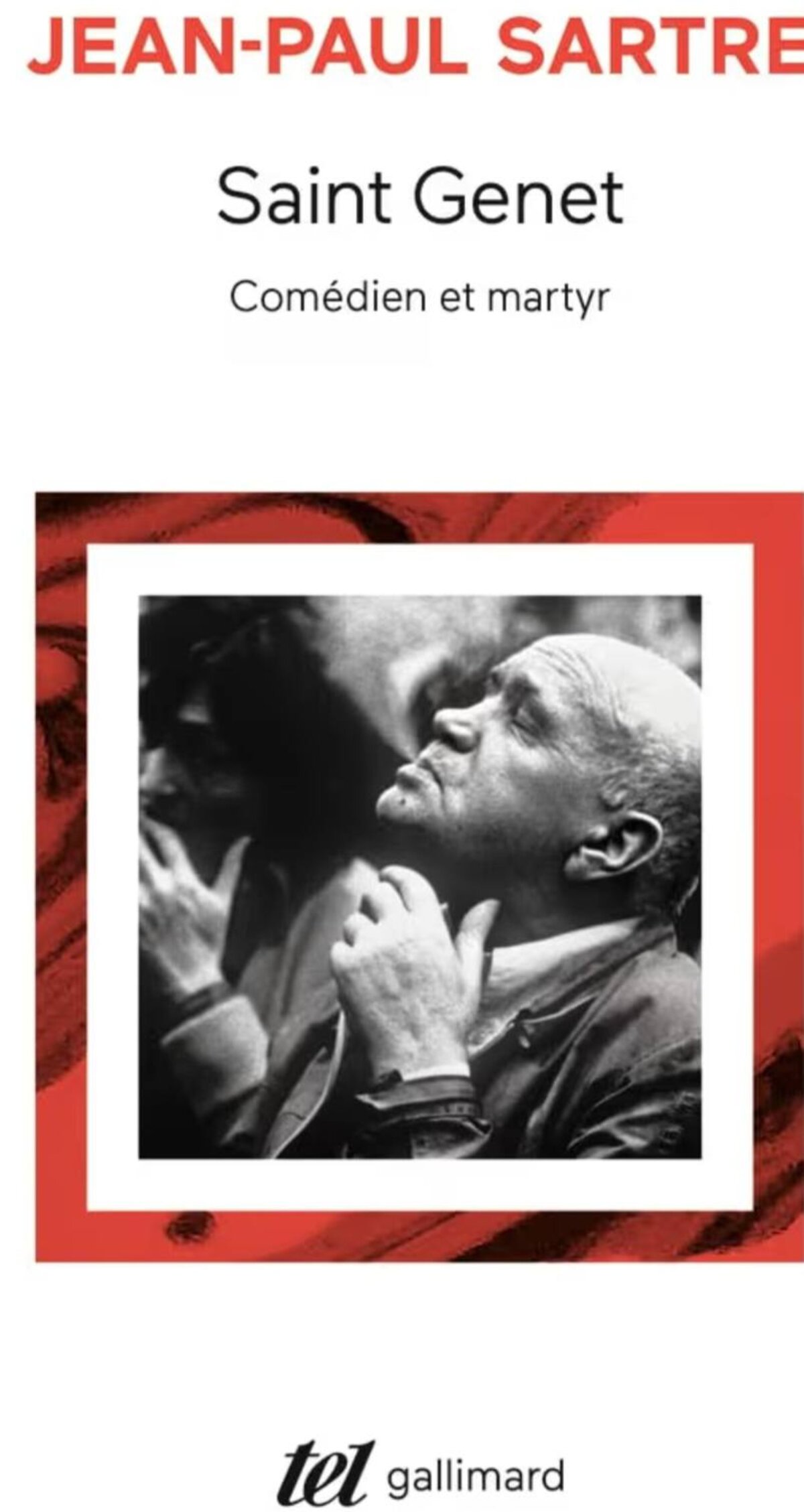
Agrandissement : Illustration 1
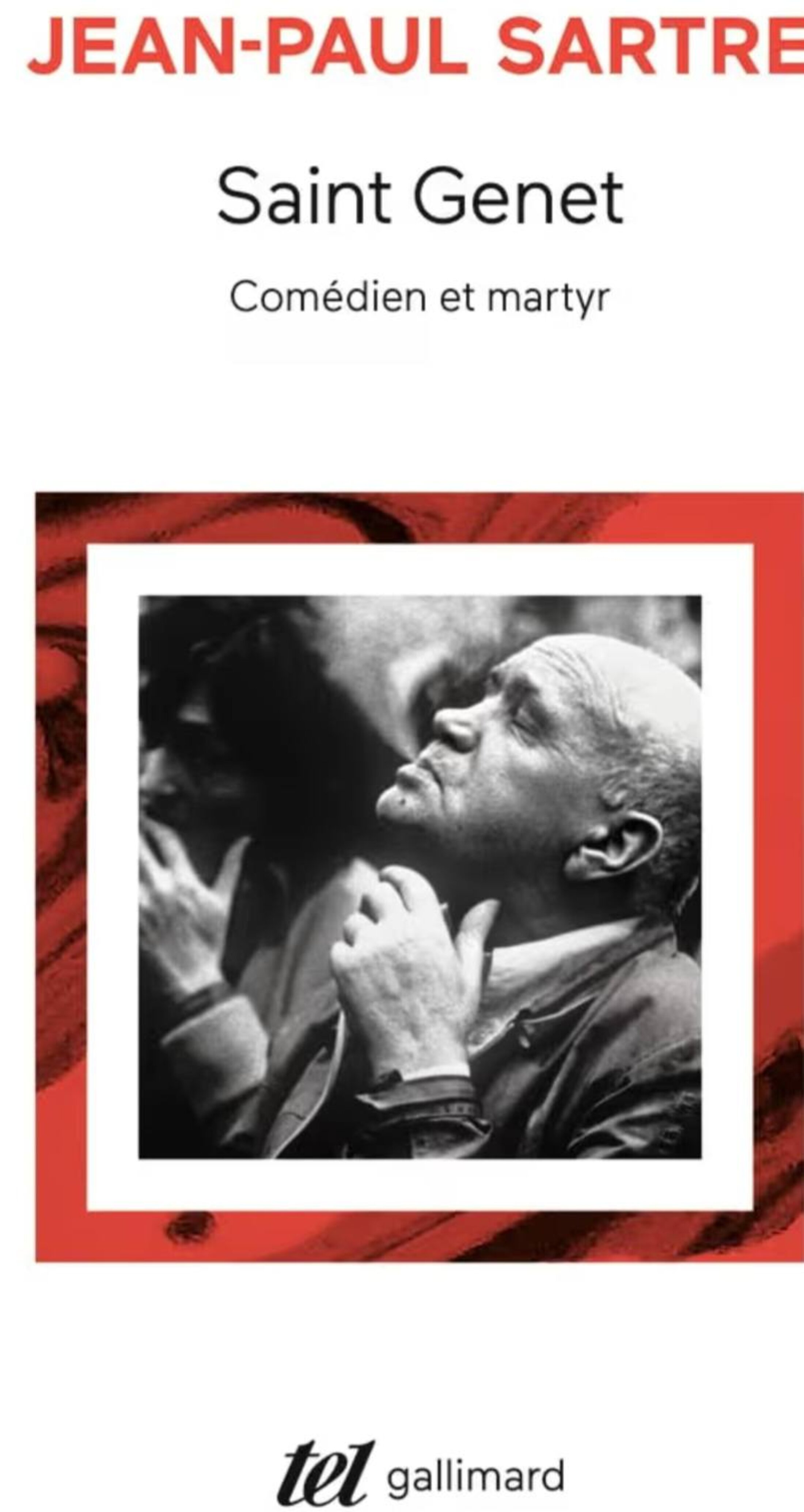

Agrandissement : Illustration 2
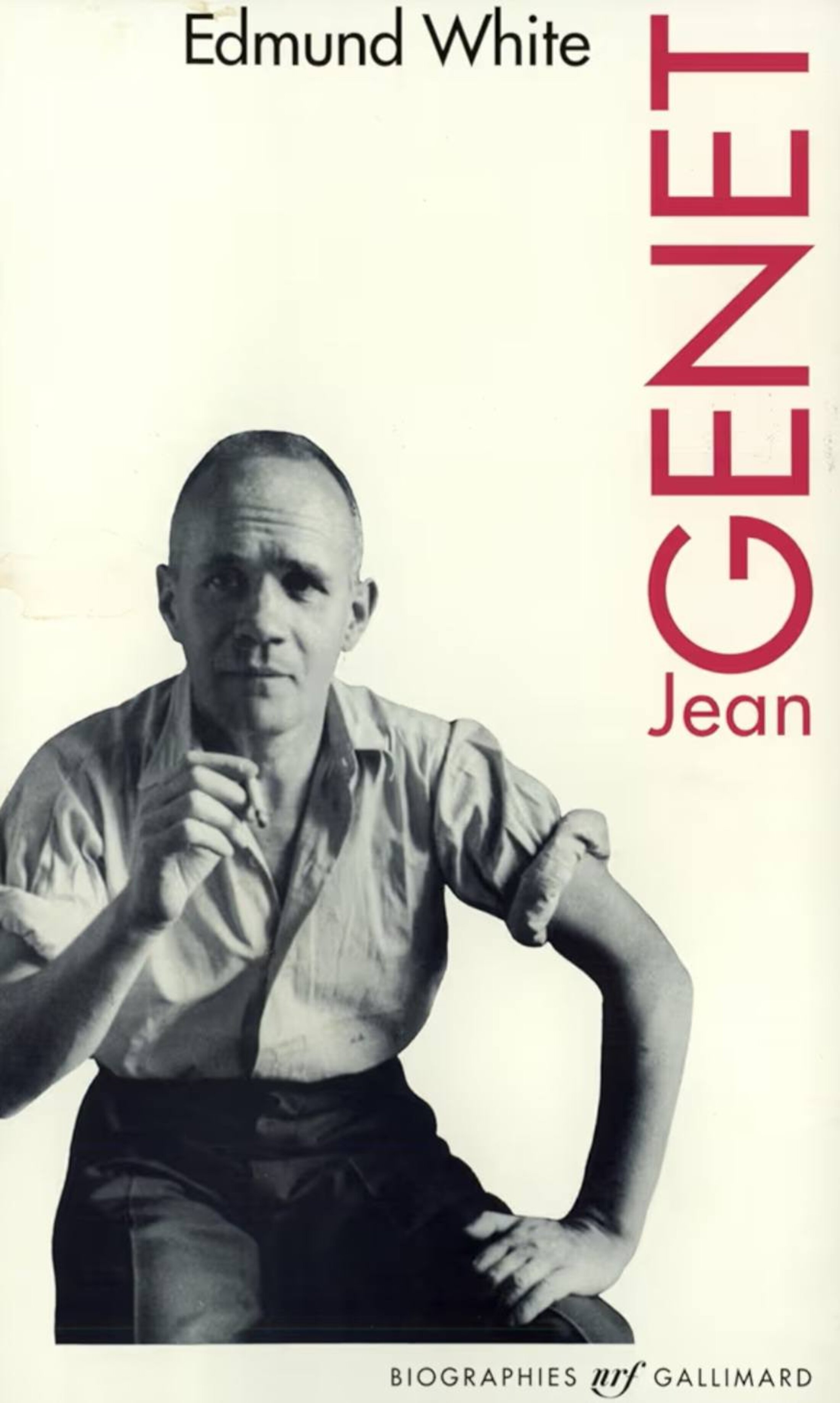
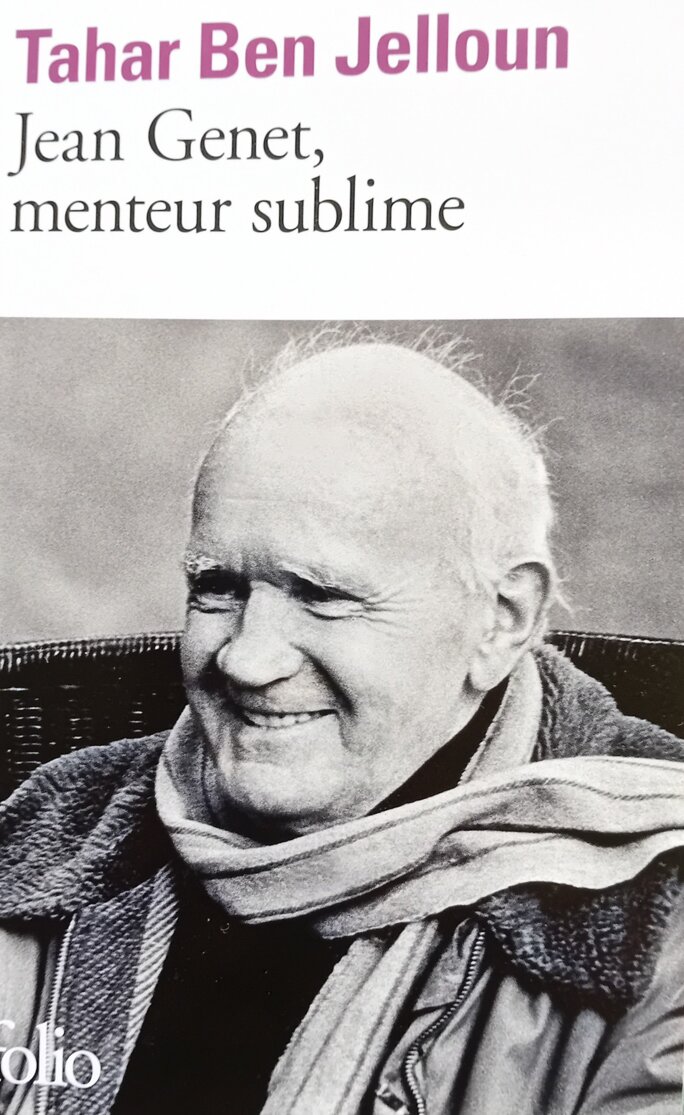
Agrandissement : Illustration 3
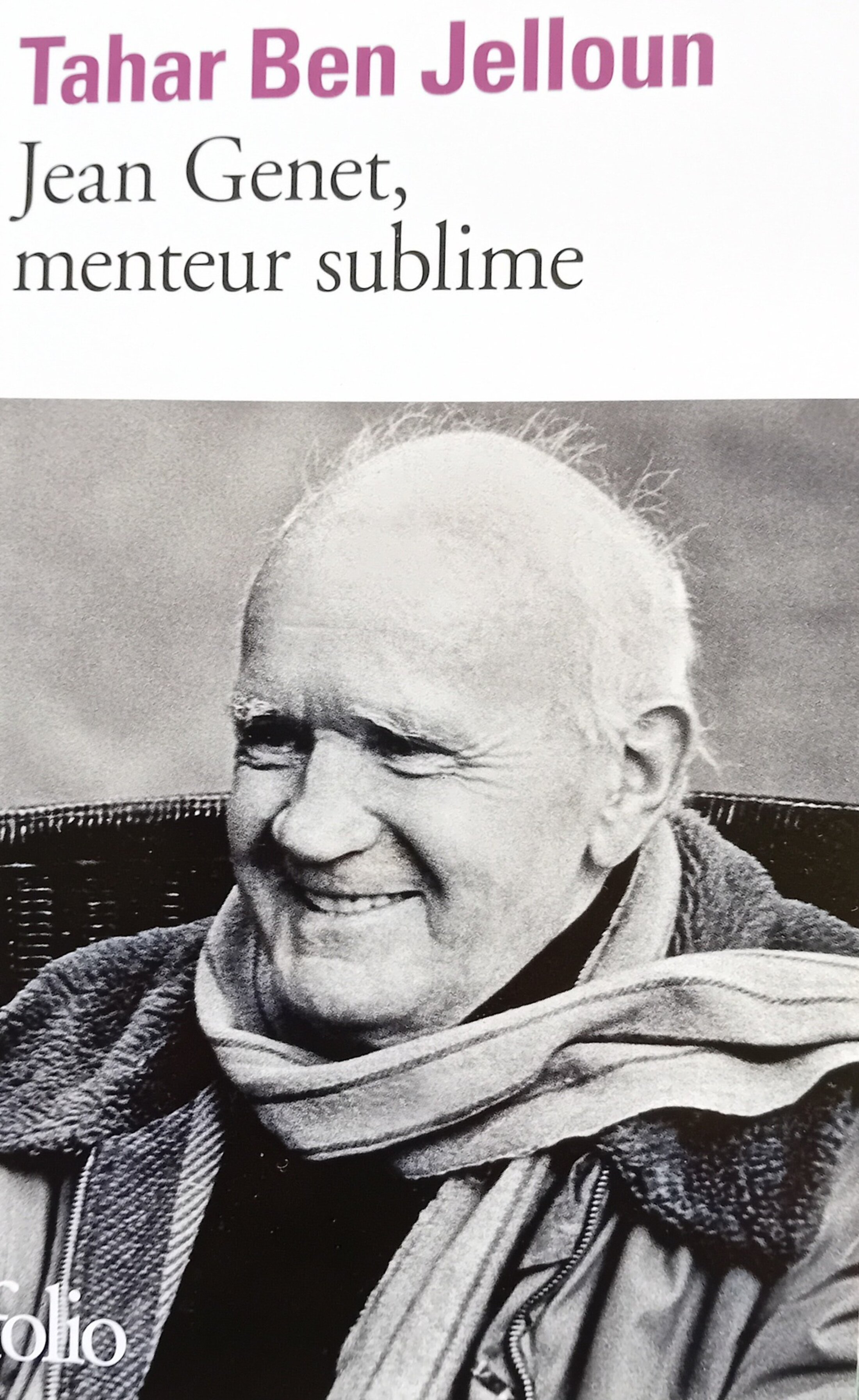
«Jean GENET (1910-1986), poète, dramaturge, romancier de la marginalité, du Mal assimilé au Bien, de la transgression, de la révolte, de la liberté et de l’altérité», par Amadou Bal BA
Jusqu’à une période relativement récente, la magistrale contribution littéraire de Jean GENET vaste, riche, poétique, marquée par la transgression et l’engagement, a été éclaboussée et brouillée par une image personnelle controversée, entre l'amour et l'abjection, la beauté et la pourriture, exploitée par le conservatisme à des fins politiciennes. Jean-Paul SARTRE (Voir mon article, sur cet exceptionnel anticolonialiste, Médiapart, 14 février 2023) face à ces attaques avait remarqué lui-même une étrange difficulté à la base de l'œuvre de Jean GENET, qui écrit, «n'a ni le pouvoir ni l'intention de communiquer avec ses lecteurs. La littérature est communication. Elle part d'un auteur souverain, par-delà les servitudes d'un lecteur isolé, elle s'adresse à l'humanité souveraine», dit son éminent biographe. La morale dominante, dans les structures inégalitaires de l'ordre social, range certains individus dans des catégories infériorisées (Racisé, la femme, gay, Noir, etc.) ; vivant la honte, ce que suscite dans la conscience et dans l'inconscient le fait d'être insulté, stigmatisé, l’artiste à la marge voué à ce que Didier ERIBON à «l'abjection». Dans sa vie errante, Jean GENET, maintenant auréolé d’une immense gloire littéraire, avait été pendant longtemps, et en raison de ses engagements, un opprimé exclu par la société et révolté contre elle. «Bandit, voleur, voyou, chenapan ! c’est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse de l’enfant», écrira Jacques PREVERT. Aussi, Jean GENET évoquera, dans «Querelle de Brest», les amours masculines jugées de son temps interdites. Si tout homme en vaut un autre, la puissance érotique se délite, tout individu devenant le sujet possible de l'art. «L'artiste n'a pas - ou le poète - pour fonction de trouver la solution pratique des problèmes du mal. Qu'ils acceptent d'être maudits. Ils y perdront leur âme, s'ils en ont une, ça ne fait rien. Mais l'œuvre sera une explosion active, un acte à partir duquel le public réagit, comme il veut, comme il peut. Si dans l'œuvre d'art le bien doit apparaître, c'est par la grâce des pouvoirs du chant, dont la vigueur, à elle seule, saura magnifier le mal exposé», écrit-il dans «le balcon».
L’image de Jean GENET, dans sa solitude morale, son ironie et ses provocations, faisant l’apologie du Mal, quand il était de ce monde, a été considérablement brouillée par son incapacité fondamentale à communiquer, et il en est conscient. Pendant longtemps, uniquement soucieux de sa dignité royale, de sa souveraineté d’écrivain, Jean GENET, entendant faire œuvre littéraire, en tournant le dos, résolument, à la servilité ; il voulait parler le langage cru de la Vérité, de la part de l'homme libre s'adressant à l'humanité, sans filtre, ni artifices. Jean GENET, ombrageux ayant cherché à se divertir à nos dépends, à scandaliser davantage, est «un Saint Genet», une perversion démoniaque et sophistiquée d'une notion sacrée comme le qualifie SARTRE. Aussi, pour avoir négligé de s’assurer une communication efficace, Jean GENET a tenté de rectifier le tir, en résumant ainsi son ambition littéraire : «empêcher que vous arrive la nostalgie d’une morale trop douce», écrit-il dans «Les Paravents», une pièce de théâtre sur la guerre, la violence et l’oppression sociale. «Jean Genet s’est proposé la recherche du Mal, comme d’autres celle du Bien. Nous recherchons le Mal, dans la mesure où nous le prenons pour le Bien. Fatalement, une telle recherche est déçue ou tourne en farce. C’est une forme de révolte chez lui, que la société a exclu», écrit Georges BATAILLE (Voir mon article, Médiapart, 15 janvier 2025). Par conséquent, le vœu le plus cher de Jean GENET a toujours été «l’effacement humain complet au profit de son œuvre, de sa légende, pour opérer cette projection quasi stellaire de soi-même où il devient son propre Signe, à ne plus se soucier d’alimenter cette Image, débarrassée l’accidentel et du contingent», écrit, en 1966, Jean-Marie MAGNAN. Il voulait conduire sa vie personnelle à l’oubli, mais ne laisse que prospérer sa création littéraire «La plupart de nos activités ont le vague et l’hébétude de l’état de clochard. C’est assez rare que nous fassions un effort conscient pour nous dépasser de cette hébétude. Moi, je le dépasse par l’écriture», dit-il au magazine, d’avril 1964, Play Boy. Il est donc dans la glorification du Mal, une valeur considérée comme positive, dans les comptes qu’il veut régler avec une société injuste «L'expérience du Mal, est un cogito princier qui découvre à la conscience sa singularité en face de l'Être. Je veux être un monstre, un ouragan, tout ce qui est humain m'est étranger, je transgresse toutes les lois qu'ont établies les hommes, je foule aux pieds toutes les valeurs, rien de ce qui est ne peut me définir ou me limiter; cependant j'existe, je serai le souffle glacé qui anéantira toute vie», écrit Jean-Paul SARTRE.
C’est donc finalement, en 1952, Jean-Paul SARTRE qui avait exhumé du Purgatoire Jean GENET, qu’il avait rencontré en 1944 ; il lui a assuré la postérité et la consécration de celui qu'il considérait comme un immense écrivain du refus de la servitude, de la liberté et de l’existentialisme. Si certains interdits de la société sont sacrés, évitant toute animalité de l’Homme, ce qui est considéré par la morale dominante, comme un Mal qui asservit devrait être combattu, au nom de la liberté, de la souveraineté et de la dignité. «Révéler dans la liberté le Mal est à l'opposé d'une manière de penser conventionnelle, conformiste, et si générale, que la contestation n'en est pas concevable. La liberté est toujours une ouverture à la révolte, et le Bien est lié au caractère fermé de la règle», écrit SARTRE. En effet, Jean GENET avait été arrêté pour vol de livres, et il avait purgé une peine de quatre mois de prison. A sa libération, il mène une vie de dandy et fréquente Saint-Germain-des-Prés. Jean COCTEAU fait son éloge auprès des existentialistes qui, d'abord sceptiques, ne tardent pas à être conquis. Cet immense écrivain anticolonialiste, Jean-Paul SARTRE a été solidaire avec de nombreux écrivains invisibilisés par le conservatisme, comme Léopold Sédar SENGHOR, Frantz FANON ou Nathalie SARRAUTE. Dans son ouvrage «Saint Genet, comédien et martyr», SARTRE conduit une analyse approfondie de la vie et de l’œuvre de Jean GENET, un écrivain et dramaturge controversé du XXe siècle. En explorant les thèmes de la liberté, de l’identité et de la rédemption, Jean GENET y est dépeint comme un personnage à la fois fascinant et troublant, une quête perpétuelle de sens et d’authenticité. Dans cette biographie, Jean-Paul SARTRE se livre à une méditation très profonde sur la nature humaine et sur le pouvoir de l’art. En effet, le Pape de l’existentialisme nous invite à nous interroger sur notre propre existence et sur notre capacité à nous affranchir des normes et des conventions.
Né le 19 décembre 1910 à Paris 6e et mort le 14 avril 1986, à Paris, Jean GENET a été abandonné, en juillet 1911, par sa mère, Camille Gabrielle GENET (1888-1919), originaire de Lyon. «Une vie qui fut tranchée en y entrant», dit-il. Son père déclaré au départ était déclaré inconnu, mais les archives de l’assistance publique indiquent qu’il s’agit de Frédéric BLANC. Il a été vécu dans une famille du Morvan qui l’éleva jusqu’à l’âge de 13 ans. Jean GENET n’a jamais eu de domicile fixe. Il a vécu souvent à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Algérie et en Palestine, et s’est déclaré solidaire avec les gauches radicales, ainsi les mouvements de libération nationale. Dès son plus jeune âge, Jean GENET a été confronté à la violence et à la criminalité, à la honte. «J'avais seize ans, dans mon cœur, je ne conservais aucune place où pût se loger le sentiment de mon innocence. Je me reconnais, le lâche, le traître, le voleur, le pédé qu'on voyait en moi. Et j'avais la stupeur de me savoir composé d'immondices. Je devins abject», écrit Jean GENET. Il a été arrêté onze fois, entre 1937 et 1944, pour des vols et des actes de délinquance, ce qui l’a conduit à passer une grande partie de sa jeunesse en prison. «Un accident l’a buté sur un souvenir d’enfance et ce souvenir est devenu sacré ; dans ses premières années, un drame liturgique s’est joué, dont il a été l’officiant : il a connu le paradis, il l’a perdu, il était enfant, on l’a chassé de son enfance», écrit Jean-Paul SARTRE.
De cette enfance marquée par l’absence et la marginalité et l’errance, Jean GENET, un sac plein d’excréments, un écrivain transgressif, revendiquant dans son abjection, sa revendication de liberté et dignité, a fait, dans sa contribution littéraire, l’éloge et la promotion des humiliés de la société. Dans cette conception, le Mal recèle une grande part de dérision et sacré libérateurs. «Un enfant trouvé, dès son plus jeune âge, fait preuve de mauvais instincts, vole les pauvres paysans qui l'ont adopté. Réprimandé, il persévère, s'évade du bagne d'enfants où il a bien fallu le mettre, vole et pille de plus belle et, par surcroît, se prostitue. Il vit dans la misère, de mendicité) de larcins, couchant avec tout le monde et trahissant chacun, mais rien ne peut décourager son zèle: c'est le moment qu'il choisit pour se vouer délibérément au mal ; il décide qu'il fera le pire en toute circonstance et, comme il s'est avisé que le plus grand forfait n'était point de mal faire, mais de manifester le mal, il écrit en prison des ouvrages qui font l'apologie du mal et tombent sous le coup de la loi. Précisément à cause de cela, il va sortir de l’abjection, de la misère, de la prison», écrit Jean-Paul SARTRE. Commettant des larcins stupides, il écrivait pour sortir de prison. Dans sa première période créatrice de sa vie, entre 1942 et 1947, provoqué par des camarades de cellule qui s'essayaient à imaginer de médiocres pièces sentimentales, que Jean GENET, ce monarque, sans sujets et considérant la prison de Fresnes comme son palais, rédigea les strophes du Condamné à mort et la dédicace en prose à Maurice PILORGE (1914-1939), un truand guillotiné, à Rennes ; et il a aussi écrit «Marche funèbre», «La galère» et «La parade». Ces poèmes s'apparentent d'ailleurs à des chefs-d’œuvre de prisonniers, dont la seule possibilité est de fabriquer des ex-voto ou de construire un bateau toutes voiles dehors dans une bouteille. Par conséquent, c’est dans ces lieux de détention qu’il a commencé une écriture échappatoire à sa réalité sombre et oppressante. «Il n’est pas à la beauté d’autre origine que la blessure, singulière, différente pour chacun, cachée et visible, que tout homme garde en soi», écrit-il. Son roman est peuplé par l’oppression des prisonniers à la vie éphémère «En quittant la Santé pour Fontevrault, je savais déjà qu'Harcamone y attendait son exécution. À mon arrivée, je fus donc saisi par le mystère d'un de mes anciens camarades de Mettray, qui avait su, notre aventure à nous tous, la pousser jusqu'à sa pointe la plus ténue : la mort sur l'échafaud qui est notre gloire», écrit-il dans «Miracle la Rose».
Ses amours masculines sont marquées par la tragédie. En effet, Jean GENET a connu dans sa vie personnelle d’autres souffrances. Ainsi de Bernard FRETCHMAN, son traducteur et agent américain, qui se dévoua pendant des années à diffuser son œuvre aux Etats-Unis, puis, tout à coup récusé et honni, tomba dans la dépression et finit par se pendre à un arbre de son jardin. «Je ne me crois pas exceptionnel, vous savez, Frechtman, mais je suis un écrivain qui se donne beaucoup de mal. Je ne veux pas le succès. Je voudrais dire d'une façon simple des choses difficiles» disait-il, en août 1961, à son traducteur. Son amant, Abdallah, originaire du Maroc, funambule qu’il aida à se perfectionner dans son métier, mais qui, victime d’une chute et contraint de se retirer du cirque, cessa peu à peu de l’intéresser. Abdallah BENTAGA, 18 ans, acrobate au cirque de Pinder, et Jean GENET en avant 44 ans, sublimé et abandonné, puis disparu, sera retrouvé, dans une chambre de bonne, le corps en putréfaction. «Une paillette d'or est un disque minuscule en métal doré, percé d'un trou. Mince et légère. Elle peut flotter sur l'eau. Il en reste quelquefois une ou deux accrochées dans les boucles d'un acrobate», écrit-il dans le «Funambule», un roman dédié à Abdallah. Rongé par le remords, Jean GENET, en pleine gloire littéraire, paie une concession funéraire pour 22 ans et demi, à Thiais, non renouvelée. En 1986, son corps sera jeté dans une fosse commune, puis rapatrié au Maroc. «Et, qui sait ? Si tu tombes du fil ? Des brancardiers t’emportent. L’orchestre jouera. On fera entrer les tigres ou l’écuyère», écrit-il dans le «Funambule», un à la gloire de son amant. Abdallah était un sans-papiers, grâce aux intercessions des avocats Roland DUMAS et Jacques VERGES, le Premier ministre, Georges POMPIDOU, un homme de Lettres, régularisa sa situation. Abdallah vendait des livres de Gallimard, sur les quais de la Seine, à Paris.
Pendant longtemps, ses contempteurs, pour mieux enfoncer sa tête sous l’eau, mettaient en avant le côté sombre et obscur de Jean GENET, en occultant, très soigneusement, ses qualités littéraires et son humanisme. «Ce reproche de n’être pas universel, comme ne le savent que trop les auteurs féministes, noirs et gays, est avant tout politique : seules les préoccupations des hommes blancs et prospères sont considérées par leurs contemporains comme ayant un intérêt éternel et universel, tandis que les expériences des minoritaires se voient invariablement taxer de marginales ou d’excentriques», écrit Edmund WHITE, un de ses biographes. En effet, Jean GENET est dans la dénonciation des injustices et des oppressions auxquelles sont confrontés les exclus. Ni saint, ni martyr, transgressif, écrivain de la marginalité, poétique, lyrique, de la sexualité, ses écrits traient des thèmes tels que la prostitution, l’homosexualité, la lutte contre les discriminations, le racisme et la criminalité, Jean GENET est constamment la révolte contre l’ordre établi. Aussi, pour Jean GENET, dans sa quête de liberté, le théâtre est un moyen de donner une visibilité aux marginaux et de les rendre présents sur scène. Le théâtre est un puissant, un espace de liberté où les marginaux, invisibilisés dans la société, ont le droit à la parole et se réapproprient leur identité. Soupçonné d’avoir pactisé avec la Collaboration, homosexuel il avait un amant nazi, voleur, menteur, provocateur, sans domicile fixe, Jean GENET, un écrivain complexe, est d’une liberté totale refusant la facilité, une création littéraire féconde ne peut s’accomplir qu’en marge de la société et contre elle. «Ecrire, c’est lever toutes les censures», écrit-il, dans «Le condamné à mort».
I – Jean GENET, sur la violence, la prédation et l’oppression sociale
Le théâtre de Jean GENET est fortement engagé pour dynamiter un ordre social conservateur, afin de promouvoir la liberté, construire une société nouvelle. «Le théâtre de Jean Genet, qui ne comprend que cinq pièces, frappe d'emblée par son caractère agonistique. Ionesco, Arrabal et surtout Beckett nous présentent des personnages égarés ou hagards, incapables de lutter contre un destin dont ils ne conçoivent clairement que l'absurdité, Genet semble savoir où il va. Animes d'une cruauté lucide et efficace, ses personnages ont entrepris d'un cœur allègre la démolition de leur société, de notre société, au nom de l'idée de Revolution», écrit Albert CHESNEAU. L’auteur, à la recherche de l’autre, de lui-même, est dans l’identité et l’altérité «Chercher l’autre, rêver le même dans la différence et la ressemblance, le théâtre de Jean Genet met en scène la circulation des identités et des altérités sexuelles, déplacées et fantasmées», écrit Agnès VANNOUVONG. Nul doute que la solidarité de Jean GENET, avec les Panthères noires américaines, les Algériens en lutte pour leur indépendance, puis les Palestiniens, peuples privés de leurs droits et de leurs terres, les thèmes qui structurent sa création littérature sont le refus de la prédation, de la soumission, en faveur d’une liberté radicale. Selon l’excellente remarque d’Edmund WHITE, «ce pur produit de l’État démocratique moderne vécut et écrivit comme pour retrouver le temps de la féodalité».
Sa pièce de théâtre sulfureuse, en 1947, «les Bonnes», des personnages invisibilisés et méprisés par la société, glorifie deux sœurs fascinées par le crime. Dès le lever du rideau, les deux domestiques endossent le rôle de Madame : elles empruntent ses vêtements, se fardent comme elle, exprimant le dégoût et la fascination qu'elles éprouvent pour leur maîtresse. Mais, coup de théâtre ! Monsieur sort de prison, où il avait été incarcéré sur dénonciation de Claire. Pour ne pas être découvertes, les sœurs projettent d'empoisonner Madame. À travers ce réquisitoire contre la servitude, Jean GENET met en lumière sa passion pour les criminels et charge le théâtre de les sacraliser, comme dans une célébration du Mal. «J’en ai assez d’être l’araignée, le fourreau de parapluie, la religieuse sordide sans Dieu, sans famille !», écrit Jean GENET. La pièce est tiré d’un fait divers criminel, en 1933, les sœurs Papin ayant assassiné sauvagement leurs patronnes. Par conséquent le langage venimeux, le comportement brutal et sauvage, avait choqué en son temps, un public un peu prude et la France venant de sortir de la Seconde guerre monde mondiale aspirait à oublier cette tragédie. On ne peut pas assimiler les deux bonnes aux sœurs Papin : les deux femmes du livre ne tuent pas leur maîtresse, mais «s’autodétruisent» dit Jean GENET. Dans ce «théâtre de la cruauté», une expression d’Antonin ARTAUD, chaque soir, les deux bonnes font un rituel en mettant en scène l’étranglement de leur patronne. Claire joue le rôle de Madame, Solange joue le rôle de sa propre sœur Claire. Un jour, Claire, la sœur cadette, rédige une fausse lettre de dénonciation pour faire emprisonner l’amant de Madame, nommé Monsieur. La manœuvre échoue ; les deux sœurs savent que leur complot sera démasqué. Elles tentent alors d’assassiner leur maîtresse en la dupant avec une tisane empoisonnée, mais Madame refuse la boisson. Claire, jouant Madame, finit par boire la tisane dans lequel a été versé du poison. La morale de cette pièce, invitant le spectateur à méditer sur ses propres pulsions et côtés sombres, sur les mauvais penchants des êtres humains, devant ces horreurs, de ne plus vouloir à les commettre. La cruauté, une sorte de «catharsis», du théâtre antique, nous guérit du Mal. C’est l’une des pièces les plus représentée de notre temps.
Les «Paravents», pièce de théâtre emblématique de Jean GENET, est une œuvre captivante qui explore les thèmes de la guerre, de la violence et de l’oppression sociale. Publiée en 1961, cette pièce se déroule dans un univers complexe où les personnages évoluent entre réalité et fiction, entre vie et mort. Les «Paravents» est une profondément ancrée dans un contexte historique tumultueux, marqué par les bouleversements politiques et sociaux, par des guerres coloniales. La pièce se déroule pendant la guerre d’Algérie, un conflit qui a profondément divisé la France et qui a été marqué par des violences et des atrocités de part et d’autre. Jean GENET, qui a lui-même été emprisonné pour vol et vagabondage, utilise Les «Paravents» pour explorer les thèmes de la répression, de la violence et de l’oppression. Pour l’auteur, le théâtre est un traquenard, tendu de telle sorte qu'il soit impossible de distinguer le sérieux du ludique, le vrai du faux, et l'imaginaire du vécu. Dans cette pièce, Jean GENET dépasse l'Histoire en illustrant, au moyen d'une centaine de personnages, un «dialogue de sourds» entre des individus - tels Saïd, l'antihéros de la pièce, jeune homme pauvre, qui épouse Leïla, une femme disgracieuse, sous la férule d'une mère féroce, ou encore Wanda, la prostituée et les différentes communautés antagoniques (colons, combattants algériens et militaires français). «La quête de l'image est au cœur de l'esthétique de Genet. C'est elle qui dicte le passage à la scène après l'expérience romanesque, conférant à l'œuvre la plus parfaite unité. C'est elle qui est à l'origine de sa conception essentialiste du personnage, qu'il soit romanesque ou dramatique, comme de l'irréalisme baroque qui féconde en permanence son écriture», écrit Marie-Claude HUBERT.
En particulier, ici, Jean GENET utilise la guerre comme toile de fond pour explorer les thèmes de l’identité, de la sexualité et de la marginalité. Les personnages qui peuplent cette pièce sont des soldats, des prisonniers, des prostituées et des mendiants, tous en quête d’une certaine forme de liberté et de reconnaissance. ««Je crois que la tragédie peut être décrite comme ceci : un rire énorme que brise un sanglot qui renvoie au rire originel, c'est-à-dire à la pensée de la mort», écrit Jean GENET.
L’atmosphère des «Paravents» est également marquée par une tension constante et une violence latente, les personnages confrontés à des dilemmes moraux et à des conflits internes, au sein de la famille, avec de lourds secrets, des tensions et des désirs inavoués. Trois femmes, employées comme domestiques, sont liées par une relation complexe de pouvoir et de soumission. Solange, la plus jeune des trois, nourrit une haine profonde envers Madame, qu’elle considère comme responsable de son malheur. Léon, un jeune homme en quête de son identité. Fils illégitime de Madame, il est rejeté par sa mère et cherche désespérément à se libérer de son emprise. Léon est un personnage tourmenté, à la fois attiré et repoussé par les figures d’autorité qui l’entourent. Son parcours de découverte de soi est l’un des fils conducteurs de l’œuvre, offrant une réflexion profonde sur la quête de liberté et d’authenticité.
Le paysage est celui du Maghreb, avec son soleil, ses déserts et sa lumière bleue, mais aussi la tragédie. Existentialiste, connu pour sa plume acérée et son engagement politique, Jean GENET fait recours à une pièce de théâtre ludique, dans laquelle il est difficile de distinguer le vrai du faux, comme un moyen de dénoncer les injustices et les inégalités de la société. Dans son expression écrite lumineuse et captivante, mêlant poésie et réalisme cru, Jean GENET convoque la guerre, celle de l’Algérie, ses horreurs, comme un moyen de questionner les normes sociales et de mettre en lumière les marginaux de la société. Dans sa révolte contre l’ordre établi, Jean GENET déroule dans cette pièce avec comme décor, la guerre d’Algérie, sa conception de la politique et de l’histoire «sa vision catastrophique du monde à la fois happé par la mort et menacé par son contraire : Tordre et le carcan des institutions et valeurs sociales qui ne valent pas mieux».
II – Jean GENET, l’éloge de la différence et de la liberté
Jean GENET a défendu la cause des homosexuels, dont il fait partie, pour une égalité des droits et le respect du droit à la différence. «Weidmann vous apparut dans une édition de cinq heures, la tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuses et encore aviateur blessé, tombé dans les seigles, un jour de septembre pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame-des-Fleurs. Son beau visage multiplié par les linotypes s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus, dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne soit frôlée d'assassins enchanteurs, élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil qu'ils vont traverser, par quelque escalier d'office qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Sous son image, éclataient d'aurore ses crimes : meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3 et jusqu'à six, disaient sa gloire secrète et préparaient sa gloire future» écrit-il dans «Notre-Dame des Fleurs», publié en 1943. C’est l’histoire d’un jeune homme prostitué et criminel, un roman salué par la critique pour sa beauté littéraire et sa capacité à explorer les profondeurs de l’âme humaine. Jean GENET a été un fervent défenseur des droits des homosexuels et a milité activement pour leur reconnaissance et leur acceptation dans la société. «Son Chef d'œuvre est à notre sens Notre-Dame-des-Fleurs, livre d'une envoutante beauté, ou l'écriture sublime toutes les dépravations, toutes les cruautés, toutes les trahisons», écrit Bernard GUERIN, dans son anthologie de la sodomie.
«Je nomme violence une audace au repos amoureuse des périls. On la distingue dans un regard, une démarche, un sourire, et c'est en vous qu'elle produit des remous. Elle vous démonte. Cette violence est un calme qui vous agite. Leur délicatesse était violence», écrit-il dans son journal du voleur. En effet, en pleine ségrégation raciale aux Etats-Unis, solidaires avec les Afro-Américains, il avait dénoncé les brutalités policières. En effet, Jean GENET s’est fortement engagé dans la lutte contre le racisme. «Genet disait souvent combien la France avait été raciste et injuste avec ses indigènes. C’est son expérience dans l’armée coloniale que se trouve l’origine de son engagement et sa lutte acharnée contre le racisme, tous les racismes», écrit Tahar BEN JELLOUN. Jean GENET a considéré que la mort de George JACKSON (1941-971), un afro-américain militant des Panthères noires, en Amérique, le 21 août 1971, à la prison de San Quentin, n’est pas un accident, mais un assassinat politique «Il est de plus en plus rare en Europe qu'un homme accepte d'être tué pour les idées qu'il défend. Les Noirs en Amérique le font chaque jour. Pour eux, «la liberté ou la mort» n'est pas un slogan de mirliton. En entrant dans le «Black Panther Party», les Noirs savent qu'ils seront tués ou qu'ils mourront en prison. Je vais parler d'un homme célèbre maintenant, George Jackson, mais si le tremblement provoqué en nous par sa mort n'a pas cessé, nous devons savoir que tous les jours de jeunes noirs anonymes sont abattus par la police ou par des blancs dans la rue, d'autres sont torturés dans les prisons américaines. Morts, ils survivront parmi nous, ce qui est peu, mais ils vivront parmi les peuples écrasés par le monde blanc, grâce à la voix retentissante de George Jackson», écrit, dans la préface, «l’assassinat de George Jackson», un dossier paru chez Gallimard.
C’est sa pièce de théâtre, «les Nègres» qui concrétise cet engagement anticolonial. «Un soir, un comédien me demanda d'écrire une pièce qui serait jouée par des Noirs. Mais, qu'est-ce que c'est donc un Noir ? Et d'abord, c'est de quelle couleur ?», écrit-il. «Je suis peut-être un Noir, qui a les couleurs blanches ou roses, mais un Noir», dit Jean GENET. «Les Nègres», c’est une pièce engagée difficile à comprendre, mais particulièrement audacieuse, en 1959, évoquant la ségrégation raciale, l’oppression des Noirs aux Etats-Unis. «Je vous ordonne d’être noir jusque dans vos veines et d’y charrier du sang noir. Que l’Afrique y circule. Que les Nègres s’y nègrent. Qu’ils s’obstinent jusqu’à la folie dans ce que l’on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans l’oeil jaune, dans leurs goûts cannibales. Qu’ils ne se contentent pas de manger les Blancs, mais qu’ils se cuisent entre eux», écrit-il. C’est une pièce pleine de lyrisme, engagée, une moquerie politique sur cette époque, de revendication des Noirs, pour la liberté, l’égalité et la dignité. «A vous écouter, il n'y aurait pas de crime puisque pas de cadavre, et pas de coupable puisque pas de crime. Mais qu'on ne s'y trompe pas : un mort, deux morts, un bataillon, une levée en masse de morts, on s'en remettra, s'il faut ça pour nous venger ; mais pas de mort du tout, cela pourrait nous tuer», écrit-il. Cette pièce de théâtre a suscité l’ire des forces du Chaos «Sale nègre, dit un poète. Eh bien ! oui, je suis un sale nègre et j'aime mieux ma négritude que la blancheur de votre peau», réplique Jean GENET.
Dans sa pièce de théâtre, «les Nègres», la Reine qui représente le pouvoir exécutif, le Missionnaire le religieux, le Gouverneur le militaire, le Juge le judiciaire et le Valet le culturel se partagent le monde colonial et regardent les Noirs. Au-dessous d’eux gît sur un catafalque blanc le cadavre imaginaire de la victime. Pendant le déroulement du simulacre sur scène, en coulisses, c’est un véritable meurtre qui est perpétré : celui d’un traître noir par ses pairs. En effet, les Blancs sont en fait des comédiens noirs : Chaque acteur de la Cour est un Noir masqué dont le masque est un visage de Blanc posé de telle façon qu’on voie une large bande noire autour, et même les cheveux crépus. À la fin, ils sont symboliquement mis à mort et finissent par descendre aux Enfers, mais c’est de leur plein gré qu’ils quittent le plateau, exhibant ainsi le théâtre en train de se faire. En fait, les «Nègres », c’est un théâtre d’exorcisme, de l’absurde de l’image que se font du Blanc sur les racisés, les Noirs jouant le rôle de Blancs afin de reconstituer un crime. «Cette pièce est écrite non pour les Noirs, mais contre les Blancs. Quand nous voyons les Nègres, voyons-nous autre chose que de précis et sombres fantômes nés de notre désir ? Mais que pensent-ils donc de nous ces fantômes ? Quel jeu jouent-ils ?» dit Jean GENET.
L’intérêt de la pièce, «les Nègres», est ailleurs que dans l’opposition entre Noirs et Noirs «La pièce, qui tourne autour d’une parodie de procès sur la scène tandis qu’un vrai procès se déroule dans les coulisses, est imprégnée d’une sexualité intense ainsi que d’un peu de travesti bon enfant (des Noirs jouent aux Blancs, des hommes incarnent des femmes) ; cette sexualité et ce travestissement marquent la place «occupée», pour ainsi dire, par l’absence totale d’homosexualité. Non seulement les hommes affrontent les femmes et les Noirs les Blancs, mais les morts sont aussi opposés sans cesse aux vivants», écrit Edmund WHITE. En effet, Hédi KHELIL a mis en exergue que, dans le théâtre de GENET, dans sa quête perpétuelle d’altérité, les racisés noirs et arabes ne sont pas des «abstractions inhumaines», comme dans l’Arabe dans l’étranger d’Albert CAMUS étant anonymisé, ils ont «des noms, une appartenance ethnique et culturelle, un langage qui leur est propre et un discours sur eux-mêmes et sur les Européens». Il précise toutefois, que ces «frontières de démarcation», entre Blancs et Noirs, Arabes et Européens, ne soient «signalées et soulignées que pour mieux être confondues et abolies», ce qui empêcherait tout véritable travail de sape des «clichés racistes», de même que tout processus d'affirmation de leur liberté ou de leur émancipation contre toutes les formes d’oppression. Il glorifie même la couleur noire «Ce qui est doux, bon, aimable et tendre sera noir. Le lait sera noir, le sucre, le riz, le ciel, les colombes, l’espérance, seront noirs — l’opéra aussi, où nous irons, noires dans des Rolls noires, saluer des rois noirs, entendre une musique de cuivre sous des lustres de cristal noir», dit Félicité, dans les Nègres. Par conséquent, dans «Les Nègres», les racisés ne sont plus représentés en arrière-plan, mais sont valorisés et mis sous la lumière. Les Blancs, mis à l’ombre, sont relégués au second plan. «Cette représentation, en termes raciaux, de ses perceptions sociales du pouvoir engendrera un nouvel élan de force créatrice», écrit Edmund WHITE. La critique est dans l’ensemble élogieuse «Les nègres tuent un chien, animal que leur secte entre tous révère et commettent ainsi le plus sacrilège des actes. Par ce crime, les voilà maintenant exilés dans leur couleur, les voilà nègres jusqu’à s’être damnés à force de l’être, les voilà prêts à réaliser, c’est-à-dire à réaliser jusqu’à sa vérité la plus absolue, le monde des Blancs», écrit Jean CAU, en 1958, dans l’Express. En effet, octobre 1959, «La Compagnie des Griots», exclusivement composée de comédiens noirs, fondée par Robert LIENSOL (1922-2011) et Sara MALDOROR (1929-2020, voir mon article, Médiapart, 4 avril 2025) monte la pièce de Jean GENET, «Les Nègres», avec une mise en scène de Roger BLIN (1907-984).
Jean GENET avait, depuis 1979, un cancer à la gorge qui le rongeait. «Jean Genet courait contre le temps, contre la mort», écrit Tahar BEN JELLOUN. Jean GENET meurt le 14 avril 1986, à Paris XIIIe. Il est enterré au cimetière chrétien de Larache, à 80 km au sud de Tanger, au Maroc, une ville où il avait vécu pendant longtemps. Voyageur désormais immobile, à travers sa sépulture, dans sa vie, Jean GENET est né, une valise sur la tête «Il n’a pas de bagages. Les objets n’encombrent pas sa vie. Ils n’existent pas. Il a juste une petite valise et habite toujours dans les hôtels, des hôtels situés souvent près des gares. Une façon d’être toujours prêt à partir», écrit Tahar BEN JELLOUN.
Quel héritage ?
«Ma vie visible ne fut que feintes bien masquées» disait-il. Contesté et contestable, la contribution littéraire semble bien avoir résisté au temps. Les fêlures de l’identité à sa naissance se sont transformées en un puissant combat contre l’ordre établi, pour l’altérité et le bien-vivre ensemble. Dans son écriture poétique et lyrique, il est le continuateur de Pierre RONSARD. Il innove par ses identités multiples et sa grande altérité, dans un monde multiculturel, mais dans le déni parfois des principes de tolérance, de liberté, d’égalité et de fraternité.
Références bibliographiques
A – Contributions de Jean GENET
GENET (Jean), Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et foutu aux chiottes, Paris, Les éditions du Chemin de fer, Micheline, 2013, 40 pages ;
GENET (Jean), Haute surveillance, Paris, Gallimard, 1988, 128 pages ;
GENET (Jean), Héliogabale, drame en cinq actes, Paris, Gallimard, 2024, 112 pages ;
GENET (Jean), Journal du voleur, Paris, Gallimard, 1982, 320 pages ;
GENET (Jean), L’atelier d’Alberto Giacometti, Paris, Gallimard, 2007, 96 pages ;
GENET (Jean), L’ennemi intérieur, textes et entretiens choisis 1970-1983, Paris, Gallimard, 304 pages ;
GENET (Jean), Le balcon, Paris, Gallimard, 2002, 160 pages ;
GENET (Jean), Le Condamné à mort et autres poèmes, le Funambule, Paris, Gallimard, 1999, 144 pages ;
GENET (Jean), Le funambule, Paris, Gallimard, 2010, 56 pages ;
GENET (Jean), Les bonnes, Paris, Gallimard, 1978, 128 pages ;
GENET (Jean), Les Nègres, Paris, Gallimard, 1980, 128 pages ;
GENET (Jean), Les paravents, Paris, Gallimard, 2000, 400 pages ;
GENET (Jean), Mademoiselle : Les rêves interdits ou l’autre versant du rêve, Paris, Gallimard, 2024, 168 pages ;
GENET (Jean), Miracle de la rose, Paris, Gallimard, 1977, 384 pages ;
GENET (Jean), Notre-Dame-des-Fleurs, Paris, Gallimard, 1976, 384 pages ;
GENET (Jean), Un captif amoureux, Paris, Gallimard, 1995, 620 pages.
B – Autres références
BATAILLE (Georges), La littérature et le Mal, Paris, Gallimard, 1957, 201 pages, spéc sur GENET, pages 125-154 ;
BEN JELLOUN (Tahar) BLIN (Roger) BRUNNEL (Pierre) DORT (Bernard) FICHTE (Hubert) MANCEAUX (Michèle) MORALY (Jean-Bernard), Les Nègres au port de la lune. Genet et les différences, CND Bordeaux, éditions de la Différence, 1988, 274 pages ;
BEN JELLOUN (Tahar), Jean Genet, menteur sublime, Paris, Gallimard, 2010, 247 pages ;
BONNEFOY (Claude), Jean Genet, Paris, éditions universitaires, 1965, 142 pages ;
CHESNEAU (Albert, C.), «Idée de révolution et principe de réversibilité dans le Balcon et les Nègres de Jean Genet», Modern Langage Association, octobre 1993, Vol 88, n°5, pages 1137-1145 ;
CORVIN (Michel), Les paravents de Jean Genet, Paris, Gallimard, 2000, 354 pages ;
DAVID (Rémi), Mourir avant que d’apparaître, Paris, Gallimard, 2022, 176 pages ;
DAVID (Rémi), SEBHAN (Guilles) VALDES (Zoé), «Qui était Abdallah Bentaga, l’amant sublimé et abonné par Jean Genet ?», France Culture, 18 septembre 2022, durée 58 minutes ;
DICHY (Albert) FOUCHE (Pascal), Jean Genet matricule 192.102. Chronique des années 1910-1944, Paris, Gallimard, 2010, 464 pages ;
DICHY (Albert) FOUCHE (Pascal), Jean Genet. Essai de chronologie, 1910-1944, Saint-Germain-la- Blanche-Herbe, éditions IMEC, 2004, 296 pages ;
DRIVER (Tom, Faw), Jean Genet, New York, Columbia University Press, 1966, 56 pages ;
EDDE (Dominique), Le crime de Jean Genet, Paris, Seuil, collection Réflexions, 2007, 144 pages ;
ERIBON (Didier), Une morale minoritaire : Variation sur un thème de Jean Genet, Paris, Champs Essais, 2023, 272 pages ;
GUERIN (Bernard), Anthologie de la sodomie, La Musardine, 279 pages, spéc Jean GENET, pages 131-134 ;
HUBERT (Marie-Claude), L'esthétique de Jean Genet, Paris, Armand Colin, 2020, 208 pages ;
JABLONKA (Ivan), Les Vérités inavouables de Jean Genet, Paris, Seuil, 2004, 438 pages ;
KHELIL (Hédi), Figures de l’altérité dans le théâtre de Jean Genet. Lecture des Nègres et des Paravents, Paris, Harmattan, 2001, 158 pages ;
KNAPP (Bettina, Liebowitch), Jean Genet, New York, Twayne Publishers, 1968, 172 pages ;
MAGNAN (Jean-Marie), Essai sur Jean Genet, Paris, Pierre Seghers, Poète d’aujourd’hui, n°148, 1966, 191 pages ;
MALGORN (Arnaud), Jean Genet, portrait d’un marginal exemplaire, Paris, Gallimard, 2002, 127 pages ;
MORALY (Jean-Bernard), Jean Genet, la vie écrite, Paris, éditions La différence, 1988, 355 pages ;
SANDARG (Robert), «Jean Genet and the Black Panthers Party», Journal of Black Studies, mars 1986, Vol 16, n°3, pages 269-282 ;
SARTRE (Jean-Paul), Saint Genet, comédien et martyr, Paris, Gallimard, 1952, 578 pages ;
SEBHAN (Gilles), Domodossola. Le suicide de Jean Genet, Paris, Denoël, 2010, 128 pages ;
TCHAMITCHIAN (Raphaëlle), «Jean Genet, le Nègre blanc, Les Nègres en France», Africultures, 2013, Vol 2, n°3, pages 92-93, pages 252-257 ;
VANNOUVONG (Agnès), «Le rêve de l’identité et de l’altérité dans le théâtre de Jean Genet, lecture des Bonnes et de Haute surveillance», Dalhousie French Studies, printemps, été 2006, Vol 74/75, pages 267-284 ;
WHITE (Edmund), Jean Genet, traduction de Philippe Delamare, Paris, Gallimard, 1993, 704 pages.
Paris, le 7 juin 2025, par Amadou Bal BA



