
Agrandissement : Illustration 1
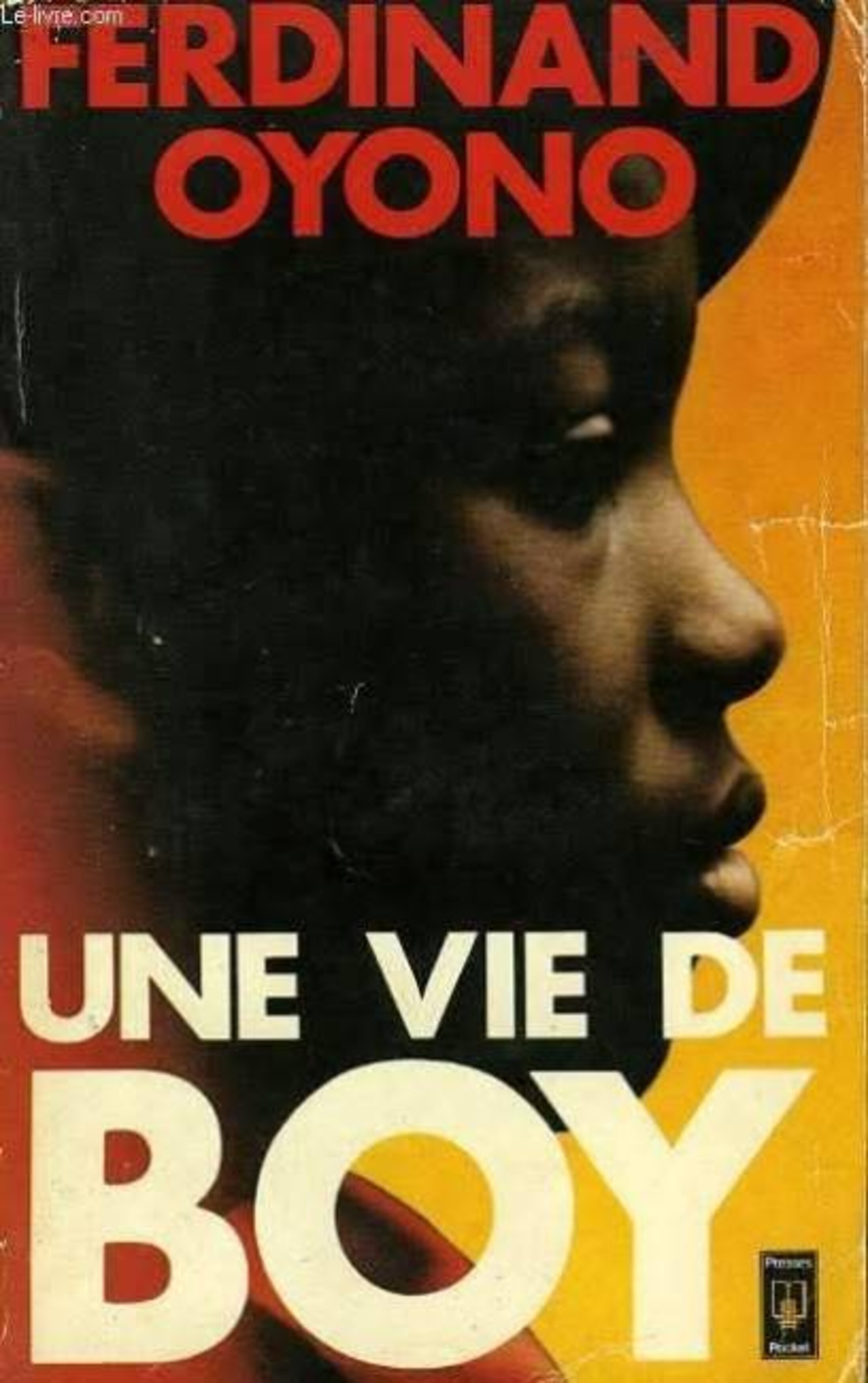
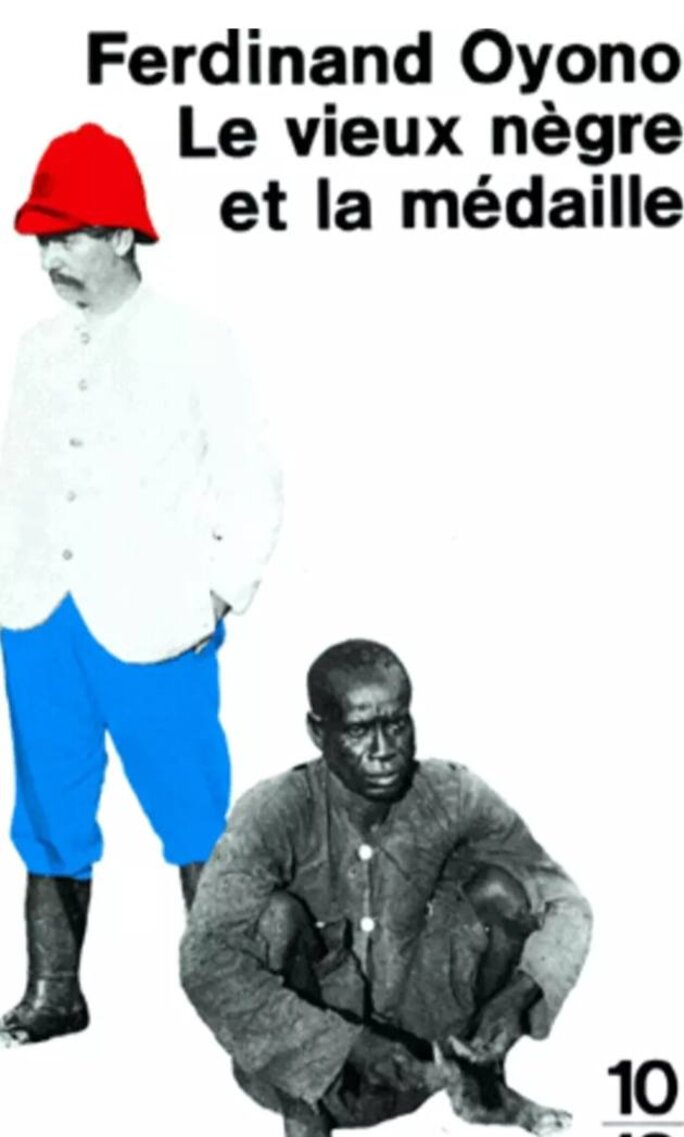
Agrandissement : Illustration 2
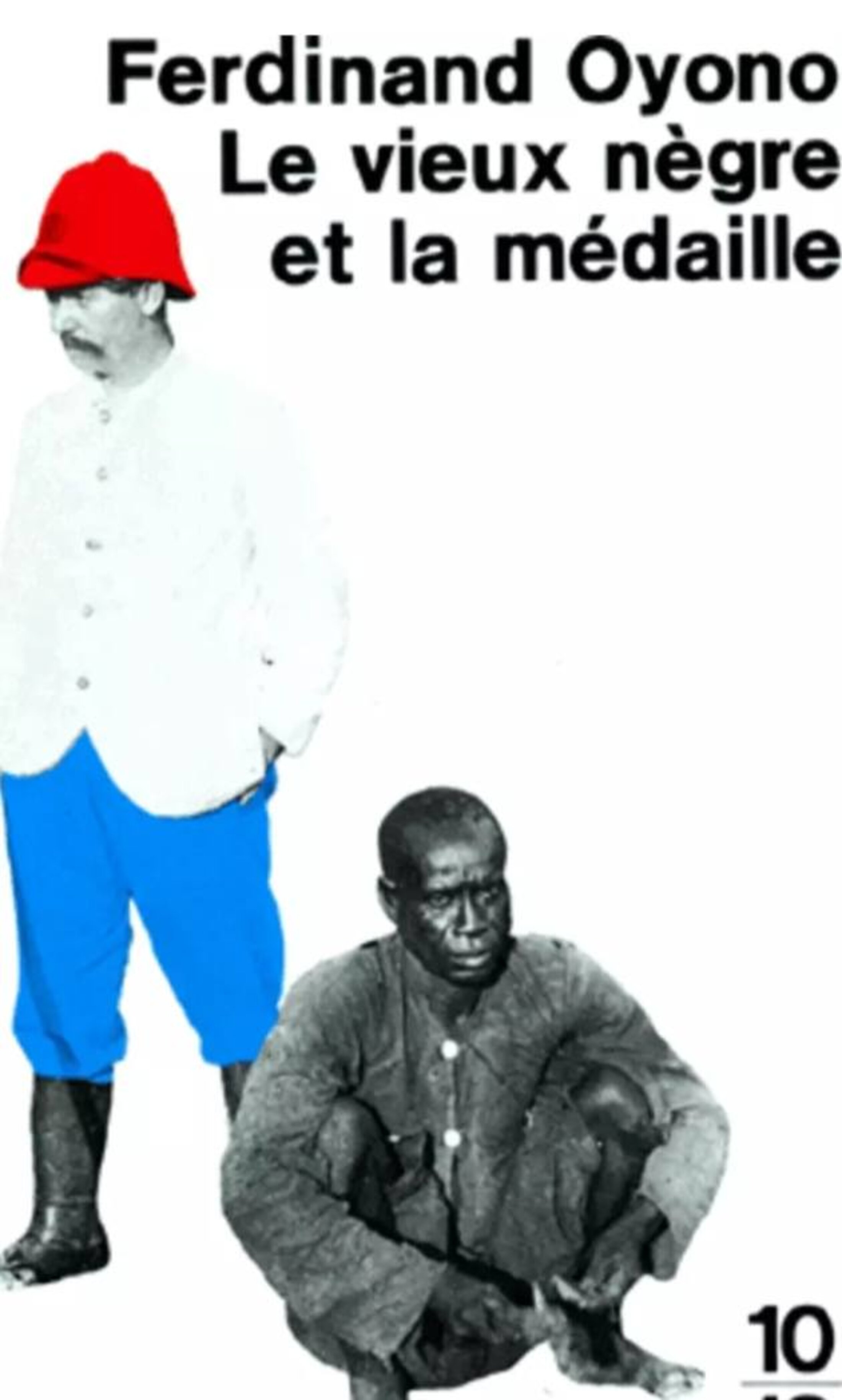

Agrandissement : Illustration 3
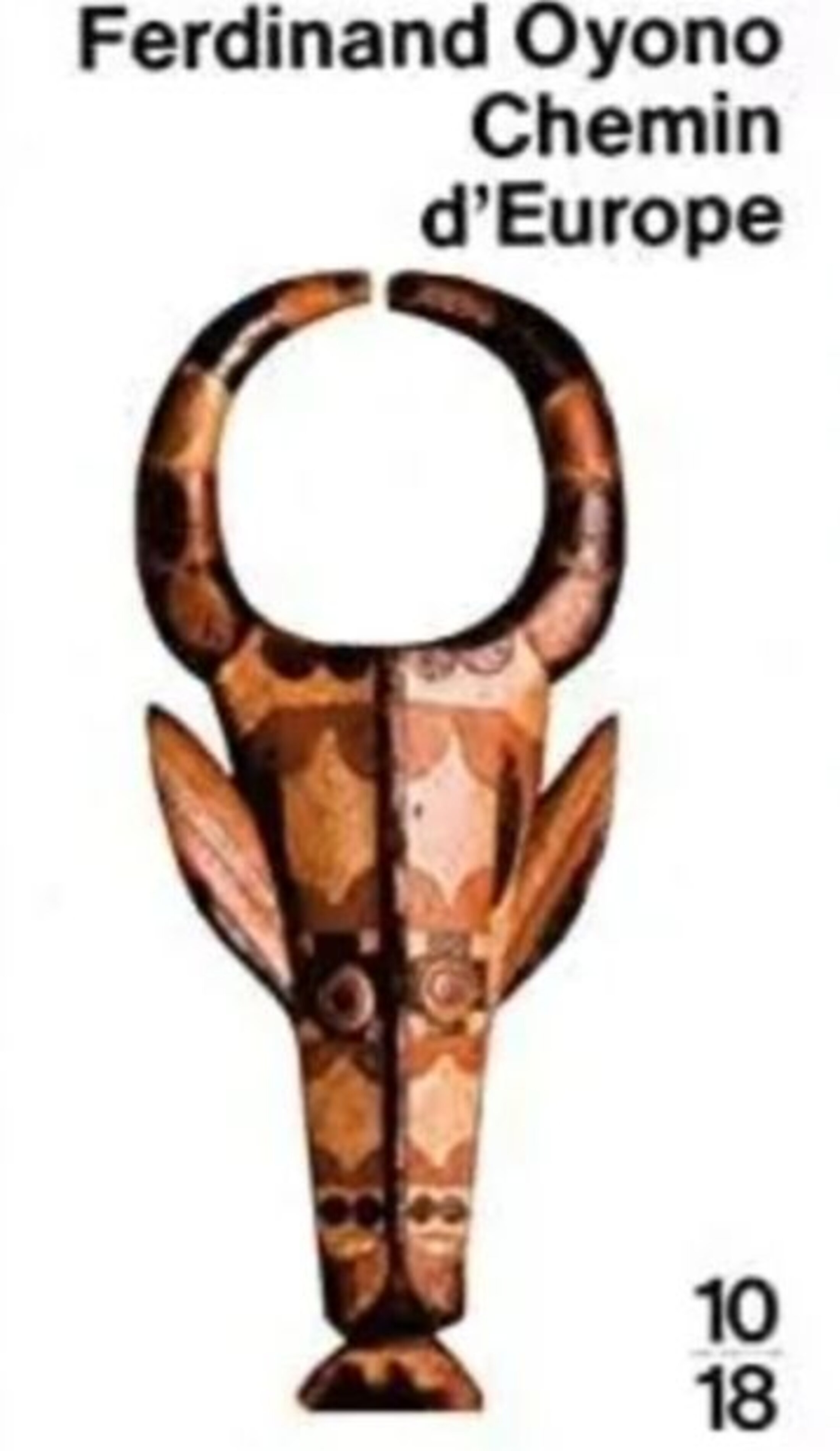
«Ferdinand OYONO (1929-2010), diplomate, homme de culture, écrivain camerounais du picaresque, de la dérision, il a démystifié et dénoncé le colonialisme, à la veille des indépendances» par Amadou Bal BA
Diplomate, haut fonctionnaire, grand auteur classique africain, un des pionniers de la littérature africaine, Ferdinand OYONO, à travers sa contribution littéraire, a valorisé la singularité de la culture africaine, fustigé et fait le procès du colonialisme, à travers le picaresque et la dérision. Le style, c’est l’Homme, la société et la culture. Sa grande finesse et sa subtilité, dans son expression écrite, à la veille des indépendances, dans une quête de liberté, de justice et de dignité, atteste d’une grande originalité et d’une vigueur intellectuelle, «d'avoir construit un univers de représentations où la verve comique donne la main à l'écriture tragique pour alimenter une satire captivante. Oyono donne la preuve que le français peut et doit exprimer l'âme africaine. C'est une langue dont la norme peut être respectée avec des utilisateurs décomplexés et émancipés qui ne se renient pas», écrit, en 2007, Gervais MENDO ZE, dans un ouvrage collectif, en hommage à l’auteur. Ferdinand OYONO, c’est «un style puissant qui décuple la force des adjectifs, comme le soleil équatorial multiplie les dimensions des arbres : tout ici est gigantesque», écrit Charles BERNARD, dans la Tribune de Genève.
Homme politique et romancier africain, Ferdinand Léopold OYONO, né le 14 septembre 1929, à Ngoulemakong, près d’Ebolowa, dans la Province du Sud Cameroun. Ainé d’une fratrie de huit enfants, son père étant polygame, Ferdinand OYONO est le fils d'OYONO Etoa (1900-1968), un Fong, un interprète de l’administration coloniale, au cabinet du gouverneur à Yaoundé. Après plusieurs affectations, son père est victime de la disgrâce, en raison des romans de son fils, jugés anticoloniaux. Il se retire dans ses terres et s’occupe de sa famille. Sa mère MYOVODO BELINGA Agnès, la fille d'un chef supérieur, Belinga Ekodo, est décrite par l’auteur comme «autoritaire, active et couturière».
Il obtient son certificat d’études primaires en 1944. Reçu à l’école supérieure de Yaoundé, puis au lycée de Nkongsamba ; il est confié à sa mère «Ce qui caractérise cette enfance, c'est la vie en dehors du foyer paternel ; c'est aussi la présence active, affectueuse et néanmoins sévère de la mère», écrit Mathieu-François MINOYOKO-NKONO. Après le lycée de Yaoundé, il fréquente, à partir de la seconde, à l’âge de 21 ans, en 1950, le lycée de Provins, en France. Il obtient son baccalauréat en 1953, et s’inscrit en études supérieures de droit à la Sorbonne avant d’entrer à l’École nationale d’administration (ENA) de Paris en section diplomatique. Parallèlement à ses études en France, tout en travaillant comme acteur pour le théâtre et la télévision, il écrit ses deux œuvres les plus connues, en 1956, «Une vie de boy» et «Le Vieux Nègre et la médaille», reflets du sentiment anticolonialiste croissant de cette époque.
De retour à son pays, en 1959, Ferdinand OYONO est nommé Directeur du bureau des études à Yaoundé. Entre 1960 et 1975, il entame sa carrière de diplomate : attaché d’ambassade à Paris, délégué du Cameroun à l’ONU, ambassadeur du Cameroun pour la Guinée, le Ghana, le Maroc, le Libéria, le BENELUX, la France, l’Italie, la Tunisie, le Maroc, et l’Algérie, avec résidence à Paris, et délégué aux Nations Unies. Il se voit confier la direction du ministère des Relations Extérieures en septembre 1992. Entre 1992 et 1997, il occupe différents postes ministériels (Culture, relations extérieures, urbanisme et habitat).
Marié à une Française, avec deux enfants, Ferdinand OYONO décède le 10 juin 2010 à Yaoundé au Cameroun.
Ce qui m’occupe dans cet article, c’est Ferdinand OYONO, l’écrivain de transition, du picaresque, de la dérision, ayant fustigé, dénoncé le colonialisme, en voie de disparition dans sa forme classique. «Tout écrivain, au moment où il décide d’écrire, le fait dans un environnement. Tout écrivain est avant tout un lecteur, qui ce soit à l’école ou par ses choix personnels ; il a été influencé par nombre de textes. Indépendamment de cela, il écrit en relation avec ses compatriotes. Quand Ferdinand Oyono écrit, il est au courant de ce que font d’autres intellectuels africains, de ce qui se passe chez Présence Africaine. Je crois qu’à l’époque où Ferdinand Oyono écrivait, c’était très clair. Dans la littérature coloniale, le point de vue peut-être sympathique, subversif, paternaliste ou franchement pro-colonial. L’écrivain africain s’inscrit forcément dans une continuité, mais dans un système politique en train de changer. Même si c’est encore un système colonial, on sait dans les années 50 que la décolonisation est proche. Cela change le regard. Ferdinand Oyono est un très bel exemple de cette transition», écrit, en 2001, Jacques CHEVRIER.
Le point central dans ses romans écrits entre 1956 et 1960, Ferdinand OYONO est le suivant «Le Cameroun a été un pays sur lequel on avait tiré un certain rideau de fantasmagorie. L'écrivain camerounais doit donc, avant tout essayer de lever ce rideau» dit-il aux Lettres françaises. En particulier, l’auteur a brossé l’influence religieuse-chrétienne et du pouvoir de l’Église sur les acteurs fondamentaux. En effet, l’auteur assigne six rôles exercés par l’Église catholique à savoir le rôle de la position temporelle, le rôle moralisateur, le rôle séparateur, le rôle d’éducation, le rôle de la tâche civilisatrice et le rôle de l’insubordination ou de la soustraction des valeurs concernant le colonisé. «La littérature nègre1 dès son origine se présente comme l’instrumentalisation de l’idéologie politique et intellectuelle de l’engagement contre le colonialisme», écrit Jacques CHEVRIER.
I – Une vie de Boy : un roman entre fascination, paternalisme et révolte contre les injustices
Le premier roman de Ferdinand OYONO, «Une vie de boy», se présente sous la forme d'un journal, relatant des relations de fascination et de domination entre le colonisé et le colon. Toundi, adolescent rebelle, menacé constamment par le regard du père autoritaire ; «on dit de moi que j’ai été la cause de la mort de mon père parce que je m’étais réfugié chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation» fait dire l’auteur, à son héros, Toundi. Il travaille comme boy, à la mission catholique de Dangan auprès du père Gilbert, curé de la paroisse, et de son adjoint le père Vandermayer. Toundi Ondoua, baptisé plus tard Joseph Ondoua Toundi, a beau s’affranchir de l’emprise machiste traditionnelle, il restera comme marqué par le sceau de la morale ancestrale et traqué par la malédiction paternelle non prononcée. Célibataire peu mûr, sans charges familiales, être émasculé sans rapports sexuels et locataire parasitaire vivant aux crochets de sa sœur, Toundi utilise inconsciemment des valeurs traditionnelles, surtout celles relatives à la circoncision, pour juger les Français colonialistes en vue de rabaisser leur taille morale et politique.
Dès le départ, Ferdinand OYONO, face la montée des idées indépendantistes, s’est ainsi trouvé engagé dans une contestation plus ou moins radicale du système colonial. Son roman, «la vie de Boy», nous invite à nous «débarrasser de nos vêtements d’emprunt, ceux de l’assimilation, affirmer notre être» , pour reprendre une formule de Léopold Sédar SENGHOR. Dans ce bref récit, Ferdinand OYONO relate la vie de Toundi, pauvre boy persécuté et acculé à la mort par la sottise et la méchanceté de ses employeurs blancs, et cette histoire tragique lui permet de révéler la cruauté et l’iniquité de l’administration coloniale. C’est donc un roman de révolte contre les injustices sociales qui se lisent aussi à partir des humiliations infligées par la bourgeoisie blanche au personnel indigène à leur service.
Ecrit pendant la période coloniale, en 1956, «Une vie de boy», est un roman largement autobiographique, relatant le destin d’un jeune africain, Toundi Ondoua Joseph, qui a quitté la maison familiale pour une mission catholique, et ce n’est pas une fuite d’un «monde brutal et sauvage», pour une prétendue d’une société rassurante, «civilisation supérieure», incarnée par l’Église. Le père Gilbert est un humaniste ; il lui a appris à lire. Mais le père Gilbert représente une société coloniale paternaliste «Le noir est un enfant, et avec les enfants rien ne peut être réalisé sans faire usage d’autorité. Pour les Noirs, en conséquence, j’ai trouvé la formule suivante: Je suis votre frère, c’est vrai, mais votre frère aîné», écrit-il.
Déraciné, pris entre deux univers, Toundi, soumis à la violence, à la maltraitance d'un père autoritaire, un monde brutal et sauvage, incarné par un père violent, s’enfuit vers un monde rassurant et civilisé symbolisé par l'Église ; il bascule rapidement dans un autre monde, lorsqu'il demande asile auprès du Père Gilbert, de la mission catholique venue sauvée les âmes perdues des indigènes.
Les thèmes majeurs de ce roman sont la vie coloniale, l’influence et l’attrait mutuel ou la répulsion entre le colon et le colonisé, les relations de pouvoir, la ségrégation raciale, la violence, l’infidélité et la religion. Au fil du roman, Ferdinand OYONO s’attache méthodiquement à déconstruire cette hiérarchisation des civilisations du colonisateur. Entre humour et dérision, Joseph Toundi est en admiration du père Gilbert, un homme animé de compassion, bienveillant, qu’il admire et révère. En effet, le père Gilbert a appris à lire et à écrire ; il tient un journal intime où il note tout. En dépit de ses grandes qualités, le rôle de l’église qui accompagne le colonisateur est de justifier à travers une religion importée, la domination étrangère.
Cependant, la disparition du père Gilbert, plonge cette église dans une atmosphère de soumission et de grande brutalité. Aussi, Ferdinand OYONO décrit magistralement ce monde à la fois doux et inégalitaire, dans lequel le colonisé, considéré comme un ignorant. En effet, à la mort du père Gilbert, le jeune Joseph Toundi est placé chez le commandant d'un district de la colonie française. Le jeune garçon aura le loisir d'observer les frasques et les turpitudes intimes de sa patronne blanche .Il relèvera aussi l'arrogance des Blancs envers les Noirs. La discrimination raciale est bien présente.
Le commandant apprend l’adultère de sa femme, et accuse Toundi d’avoir servi d'intermédiaire et d’avoir été le principal témoin. Sans défense et sans parole, Toundi est arrêté, brimé, séquestre, battu à mort sans autre forme de procès. Emprisonné par la faute de sa copine Sophie, le jeune Joseph Toundi s'interroge sur les paroles qu'il a appris dans la bible et à l'église. Car, dans la prison, les noirs sont maltraités. Alors Toundi, en tant que fervent chrétien, se demandait comment ceux qui ont apporté une religion où Dieu demande à l'homme d'avoir l'amour du prochain pouvaient ainsi maltraiter les hommes furent-ils des noirs. En dehors du miroir des remontrances des colons, ce livre nous exploite bien d'autres l'infidélité, la prostitution.
En définitive, ce roman traite d’un thème majeur, la démystification de l’homme blanc. Le fait pour l’homme noir d’être plus clairvoyant sur l’attitude de ses «maîtres» et de réaliser que l’homme blanc qu’il côtoie n’est pas ce qu’il affirme être, aussi bien par ses exigences internationalistes que ses ambitions à l’humanisme. Le personnage principal du roman, qui entre dans le milieu des Blancs et partage leur quotidien, découvre progressivement des choses qui vont révolutionner sa vie.
II – Le vieux nègre et la médaille : un roman sur l’ingratitude et le mépris
Second roman de Ferdinand OYONO, publié, également en 1956, son héros en est un vieil homme, Laurent Meka, vivant entre deux mondes, celui des colons et des indigènes, à la veille des indépendances. Meka, un bon chrétien, est un riche planteur et propriétaire terrien de Doum. Mais ces richesses matérielles ne le cèdent en rien a la grande piété du vieil homme, baptise et devenu fervent croyant de l'Église catholique. Il a donné ses terres et sacrifié ses deux fils, ont morts pour la France, «La Mère-patrie», dans des guerres mondiales en Europe. «Tu as beaucoup lait pour faciliter l'œuvre de la France dans ce Pays. La médaille que nous te donnerons veut dire que tu es plus que notre ami», dit le commandant.
Par conséquent, c’est un roman sur l’ingratitude et le grand mépris, en dépit de la générosité et du don de soi du héros, l’administration coloniale n’envisage que de lui remettre une médaille. Dans la perspective de cette décoration, le héros tragique et loufoque du roman, rêve de sortir du Code de l’indigénat, pour désormais devenir l'égal des Blancs : en biens matériels, en prestige social, et privilèges. «Meka était vraiment quelqu'un. Son nom avait traversé des mers et des mers et était parvenu jusqu'à l'oreille du grand Chef des Blancs qui avait décidé de venir lui-même lui témoigner son amitié», écrit OYONO.
Le jour de la cérémonie, c’est la désillusion, Meka a attendu vainement et longuement, l'arrivée du grand chef des Blancs qui devait le décorer, sous un soleil brûlant. Ridiculisé, arrêté, molesté, raillé par les gardes et serviteurs du commandant, dépouillé de tous ses rêves d’égalité et sa médaille, devenue un cauchemar, Meka retourne chez lui, les mains vides, et humilié, dans un état moral inquiétant. Il retrouve les siens, dans une atmosphère de rage et de deuil «Le Blanc est toujours le Blanc. Le chimpanzé n'est pas le frère du gorille.» dit-il. Finalement, toute idée d'amitié entre tout ce qui est blanc et le monde noir commence par la foi chrétienne. Devant l’indignation de son beau-frère, le héros du roman a pris, «à présent, je m'en moque. Je ne suis qu'un vieil homme», dit-il.
Finalement, «Le Vieux Nègre et la médaille», une peinture coloniale, est une satire à travers les yeux d'un vieux villageois loyal et très croyant, dont l'opinion sur l'homme blanc change du tout au tout le jour où il doit recevoir une médaille pour «services» rendus à la France (le sacrifice de ses fils et de sa terre). Dans ces deux romans, Ferdinand Oyono accuse clairement les missionnaires paternalistes et les administrateurs. Son ton ironique sait transmettre toute la tragédie et la souffrance de la vie des petites gens, souvent des paysans analphabètes, qui acceptent naïvement les doctrines du colonialisme français. En se moquant des maîtres colonialistes qui s'aveuglent délibérément et de leurs marottes, autant que des villageois simples, Ferdinand Oyono brosse souvent des portraits hilarants, tout en tirant parti de l'expérience d'acteur comique de ses jeunes années.
A travers sa fluide l'écriture, son omniprésente l'humour et éclairante, Ferdinand OYONO traite ici de l’injustice, la banalité de la violence, du mépris et de l’injustice coloniale se répand sur dans ce roman, «Le vieux Nègre et la médaille». En effet, le roman est un document irrécusable de la société coloniale, une description précise et exacte des réalités antinomiques : d’une part, les colonisés avec leurs valeurs traditionnelles, avec des conceptions de courage et d’héroïsme, et d’autre part, les colons, constitués d’administrateurs et de religieux, animés d’un projet de domination et d’exploitation. Selon un procédé balzacien «Ferdinand Oyono concentre du lecteur sur deux personnages antithétiques, dont la valeur réside moins dans une personnalité d’exception que dans leur force d’exemplarité : d’un côté Meka, le paysan camerounais, de l’autre le Haut-commissaire français. En nous donnant un tableau fidèle de la réalité coloniale, en nous montrant la perspective qu’y occupent les individus, selon qu’ils soient Blancs ou Noirs, Ferdinand Oyono fait donc œuvre de romancier réaliste», écrit Jacques CHEVRIER.
Finalement, ce roman un puissant réquisitoire et une condamnation sans appel du système colonial. Meka, d’une grande naïveté, a finalement révélé l’écart entre le prétendu discours de «civilisation» ou d’humanisme du colonialisme, et sa réalité brutale et humiliante de domination. L’accueil des critiques littéraires est enthousiaste. «Rangeons ce livre au nombre de ces ouvrages précieux dans lesquels l'homme bafoué et meurtri apprend comment on passe du ressentiment et de la colère à la lutte pour la justice» écrivent «Les Belles lettres». «Ferdinand Oyono s'attaque au bon vieux contraste noir et blanc avec une vigueur sympathique et un sourire intelligemment désinvolte» dit le «Canard enchaîné». «Cette verve comique soutenue par un réalisme intense. Une lumière crue et impitoyable met à nu les contradiction entre les paroles doucereuses des Blancs et leur comportement réel» écrit «Présence africaine».
III – Chemin d’Europe : un roman entre ambition et humiliation
Dans un autre registre, son troisième roman, Chemin d'Europe (1960), aborde le problème d'un jeune homme mieux instruit que ses pairs, mais dépourvu des capacités nécessaires pour lui assurer le succès.
«Chemin d'Europe» paru, en 1960, c'est de nouveau l'histoire d'un jeune, avec cette différence que Toundi était un jeune villageois analphabète qui avait appris a écrire et a parler français grâce aux soins de son maitre, le père Gilbert ; tandis qu'Aki Barnabas, le héros de Chemin d'Europe, est un intellectuel, confirme, du moins pour l'époque. Titulaire du C.E.P.E, Aki est renvoyé du séminaire de T..., alors qu'il est en classe de Première. Ambitieux comme tout séminariste, comme le Julien Sorel de Stendhal), il refuse de travailler dans l'Administration ou il n'occuperait qu'un poste subalterne.
Cependant, les petits boulots (rabatteur, percepteur, écrivain public) ne satisfont pas ses ambitions. Instruit en latin et grec, sur recommandation de sa grand-mère, il demande une bourse d’études en France, mais le gouverneur estime qu’il est trop âgé, pour qu’il soit admis en France. «J'eus l'impression d'en avoir trop dit. La vérité n'a jamais plaidé en faveur d'un pauvre type et je ressentis, douloureusement, au recul de ce haut fonctionnaire qui, sous le feu de mon argumentation, venait de se rejeter sur le dossier de son fauteuil, que j'avais perdu définitivement la partie» dit le héros, Aki. C’est une secte religieuse qui l’aide aller en France.
Ce roman témoigne d’un «style puissant qui décuple la force des adjectifs, comme le soleil équatorial multiplie les dimensions des arbres : tout ici est gigantesque», écrit Charles BERNARD de la Tribune de Lausanne.
Indications bibliographiques
I – Contributions de Ferdinand OYONO
OYONO (Ferdinand), Chemin d’Europe, Paris, René Julliard, 1960, 196 pages ;
OYONO (Ferdinand), Le vieux nègre et la médaille, Paris, EDICEF, 2014, 256 pages ;
OYONO (Ferdinand), Une vie de boy, Paris, Press Pockett, 2006, 185 pages.
II – Critiques et biographies
ABOUI (Marie-Antoine), Le discours Beti chez trois romanciers camerounais : Owono Joseph, «Tante Bella», Oyono Ferdinand, «Le Vieux Nègre et la médaille», Eza Boto, «Ville cruelle», thèse sous la direction de Robert Jouanny, Paris 12, 1987, 600 pages ;
AMEGBLEAME (Simon), «Le regard du boy et la conscience du commandant : une lecture d’une vie de boy de Ferdinand Oyono», in Susanne Gehrmann et János Riesz, Le Blanc du Noir : Représentations de l’Europe et des Européens dans les littératures africaines, Münster : LIT, 2004, pages 149-170 ;
ASAAH (Augustine, H.), «Rapports pères-enfants, dans «une vie de boy» de Ferdinand Oyono», Le pouvoir, 2004, n°2, pages 12-24 ;
BERGSON (Henri), Le rire : Essai sur la signification du comique, Paris, PUF, 1940 et 2004, 172 pages ;
BODO (Bidy, Cyprien), Le picaresque dans le roman sud saharien d’expression française, thèse sous la direction Michel Beniamino, Université de Limoges, 2005, 342 pages, spéc pages 203 ;
BRITON (Kwabena), «Regard, mémoire, témoignage : ou l’œil du sorcier dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono», Présence francophone, 1977, n°14, pages 37-41 ;
BRITWUM (K), «Regard, mémoire, témoignage : ou l’œil du sorcier dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono», Présence francophone, 1977, n°14, pages 37-41 ;
CHEVRIER (Jacques), Littérature nègre, Paris, Armand Colin, 2008, 310 pages, spéc pages 104-105 ;
CHEVRIER (Jacques), «L’itinéraire de contestation en Afrique noire», Le Monde diplomatique, mai 1975, page 24 ;
CHEVRIER (Jacques), «Une décolonisation, sans grande rupture», Africultures, 30 novembre 2001, pages 1-3 ;
CHOUALA (Yves, Alexandre), La politique extérieure du Cameroun. Doctrine, acteurs, processus et dynamiques régionales, Paris, Karthala, 2014, 267 pages ;
ETEO OYONO (George, Patrice), Ferdinand Léopold Oyono. Vie et œuvre d’un diplomate de carrière, Sarrebruck, éditions Universitaires européennes, 2011, 128 pages ;
EVERSON (Vanessa), «Noir sur Blanc : la dissimulation sexuelle chez Ferdinand Oyono», Gerflint, Synergies australe, 2005, n°1, pages 19-24 ;
GARNIER (Xavier), «Les formes «dures» du récit : enjeux d’un combat», Notre librairie, 2002, n°148, pages 54-58 ;
GERHMANN (Suzanne) RIESZ (Janos), Le Blanc du Noir, représentation de l’Europe et des Européens dans les littératures africaines, Munster, LIT Verlag, 2004, 256 pages ;
GODOLPIN (Maria, Anna), De la naïveté à la désillusion : les romans de Mongo Béti et Ferdinand Oyono, thèse, Edmonton, Alberta, Université d’Alberta, 1974, 177 pages ;
HAJ-NACEUR (Malika), La dérision comme stratégie d’écriture. L’exemple des littératures africaines et antillaises, Paris, Karthala, 2016, 504 pages ;
LINNEMANN (Russell), «The Anticolonialism of Ferdinand Oyono», Yale French Studies, 1976, n°53, pages 64-77 ;
LUMBILA-TOKO (Joseph Delphin), «La démystification de l’homme blanc : Le contact entre l'homme noir et l'homme blanc dans «une vie de boy de Ferdinand Oyono». Linnéuniversitetet, Institutionen för språk och litteratur, HT, 2012, 22 pages ;
MARCENAC (Jean) «Jacques-Stephen Alexis, Mongo Beti, René Depestre, Ferdinand Oyono, Les littératures noires et la France», Lettres Françaises, du 1 au 7 novembre 1956, n°643, page 1-7 ;
MENDO ZE (Gervais) sous la direction de, Ecce Homo Ferdinand Léopold Oyono. Hommage à un classique africain, Paris, Karthala, 2007, 644 pages ;
MENDO ZE (Gervais), La prose romanesque de Ferdinand Oyono : Essai d'analyse ethno-stylistique, Yaoundé, Cameroun, Presses universitaires d'Afrique, 2006, 525 pages ;
MENDO ZE (Gervais), La prose romanesque de Ferdinand Oyono, Paris, Presses universitaires d’Afrique, 2006, 525 pages ;
MENDO ZE (Gervais), sous la direction de, Ecce Homo. Ferdinand Léopold Oyono. Hommage à un classique africain, Paris, Karthala, 2007, 651 pages ;
MERCIER (Roger) BATTESTINI (Monique), Ferdinand Léopold Oyono : écrivain camerounais, Paris, Nathan, 1964, 63 pages ;
MINYONO-NKODO (Mathieu-François), Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono, Paris, Saint-Paul, Classiques africains, 1978, 72 pages ;
MINYONO-NKODO (Mathieu-François), Le vieux nègre et la médaille, Saint-Paul, Les classiques africains, 1990, 72 pages ;
MVOMO (Ela, Wullson), «Ferdinand Léopold Oyono, le haut responsable», in Gervais Mendo Ze, Ecce Homo, Ferdinand Léopold Oyono : Hommage à un classique africain, Paris, Karthala, 2007, pages 19-41 ;
N’DIAYE (Christiane), «Ce n’est pas un vieux nègre : le corps ambivalent chez Oyono», Etudes françaises, été 1995, Vol 31, n°1, pages 23–38 ;
NDIAYE (Mohamed), «Stratégie argumentative de dénonciation dans «Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono», Graphies francophones, juin 2024, n°6, pages 140-151 ;
NDIBNU-MESSINA (Julia), «Stratégie argumentative de dénonciation dans «Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono», Synergies Afrique des Grands lacs, 2017, n°6, pages 57-73 ;
NGA NDONGO (Valentin), «Esquisse d’une sociologie d’un roman camerounais postcolonial», Groupe d’études linguistiques et littéraires (G.L.L.), Saint-Louis (Université de Gaston Berger), janvier 2004, n°8, pages 77-102 ;
NKOUNGA (François, Joseph), «Le rôle de l’Église catholique dans la colonisation française en Afrique subsaharienne : Éducation et hypocrisie dans Une vie de boy de Ferdinand Oyono», Linnéuniversitetet, Institutionen för Språk (SPR), 2021, 26 pages ;
NOLA (Bienvenu), Le vieux nègre et la médaille. Essai d’analyse argumentative, Paris, Harmattan, 2008, 258 pages ;
NZAPFAKUMUNSI (Mbumburwanze Shamba), Le spectre du père : poétique et politique de la dépendance, Kingston, Ontario, Queen’s University, 2011, 299 pages ;
OGUNSANWO (Olatubosun), «The Narrative Voice in Two Novels of Ferdinand Oyono». English Studies in Africa, janvier 1986, Vol 29, n°2, pages 97–120 ;
OYONO (Georges, Patrice, Etoa), Ferdinand Léopold Oyono : vie et œuvre d’un diplomate de carrière, Paris, Harmattan, 2023, 294 pages ;
SIMEDOH (Kokou, Vincent), L’humour et l’ironie en littérature francophone subsaharienne. Une poétique du rire, Queen’s University, Ontario, mars 2008, 242 pages ;
VAUCHER (Pierre), «Un regard oblique : «L’œil du sorcier» dans une vie de boy de Ferdinand Oyono», Voix Plurielles, 30 avril 2014, Vol 11, n°1, pages 151–162.
Paris, le 11 septembre 2025, par Amadou Bal BA



