
Agrandissement : Illustration 1

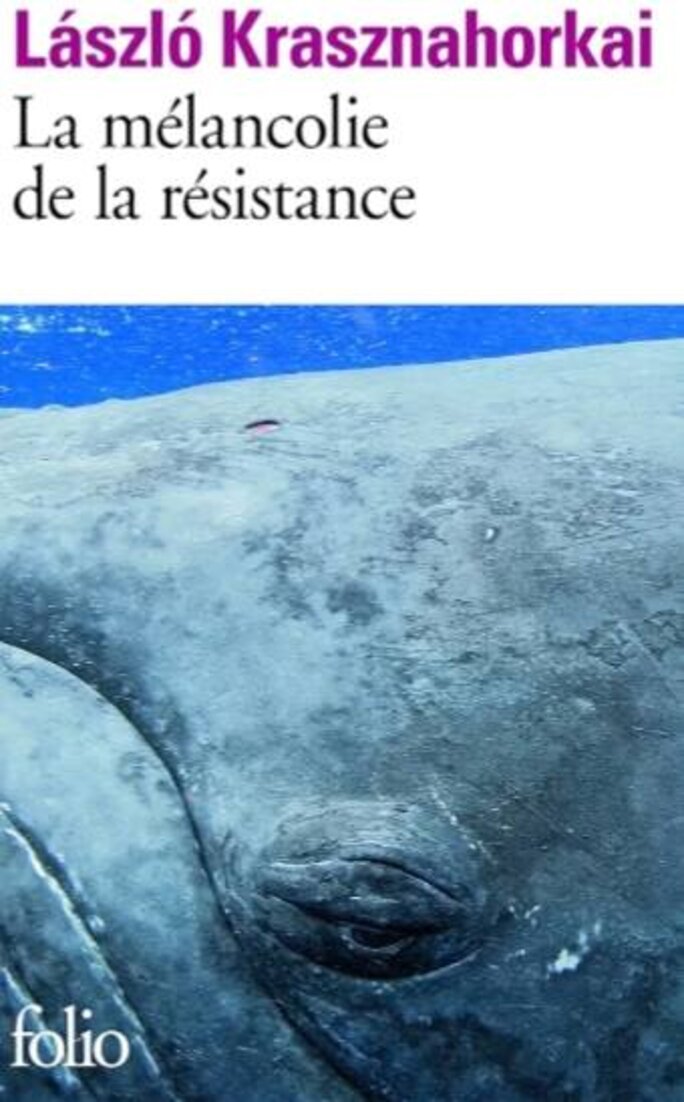
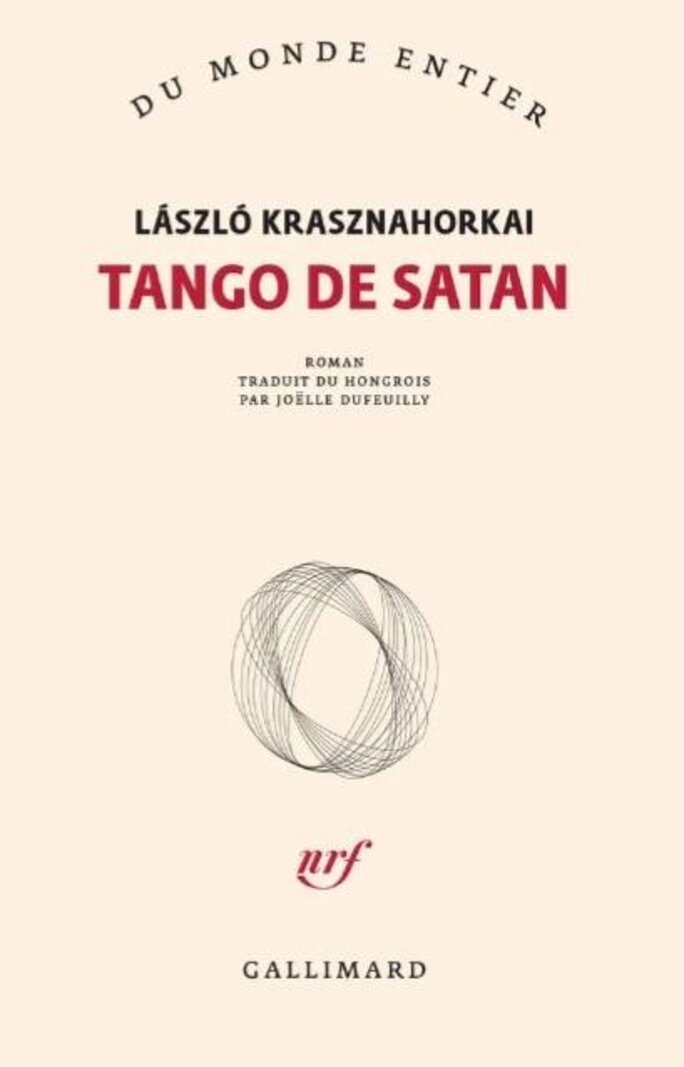
Agrandissement : Illustration 3
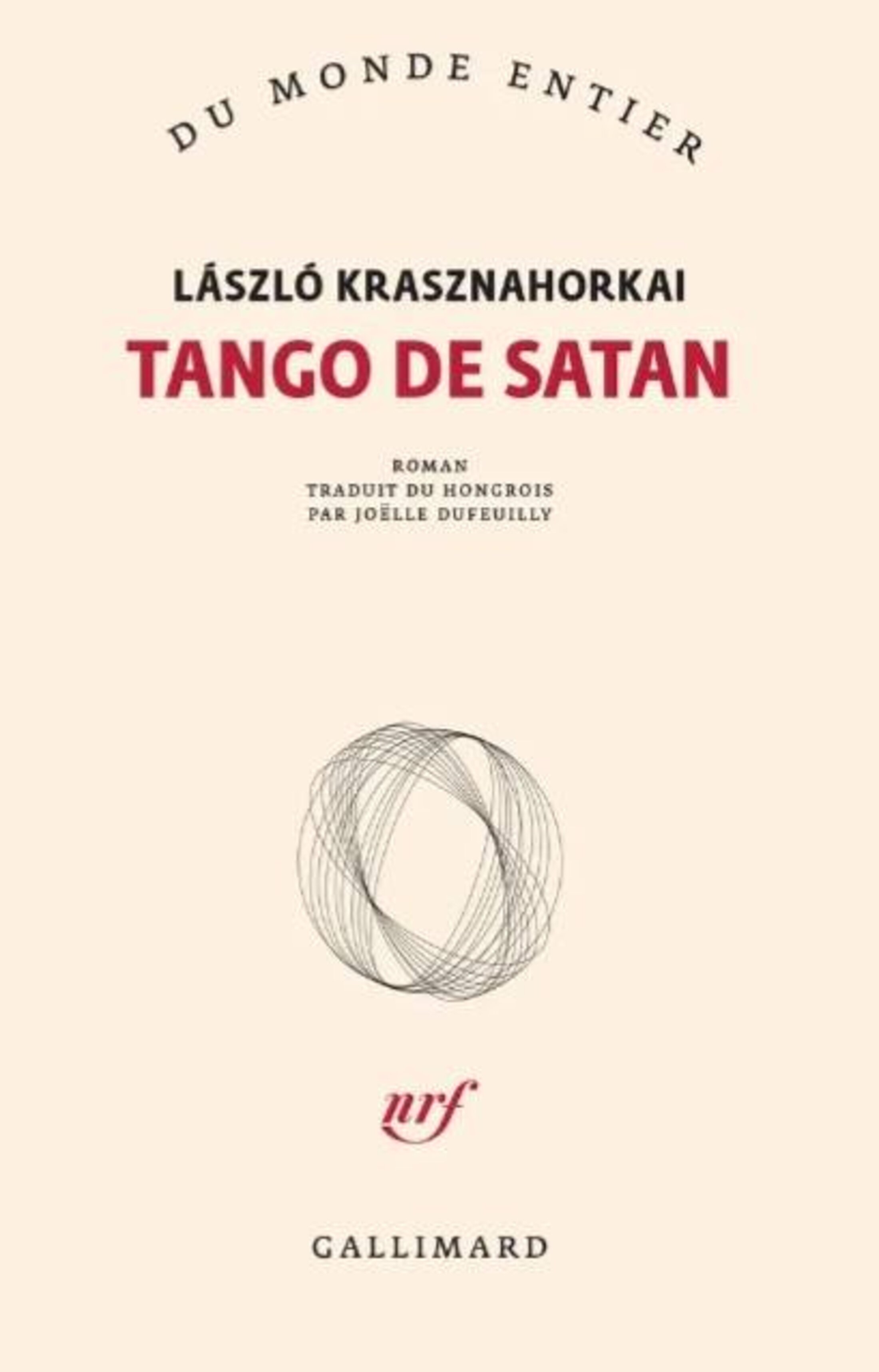
«László KRASZNAHORKAI, écrivain hongrois de l’apocalypse, prix Nobel de littérature 2025 postmoderne de la révolte, de l’absurde, du fantastique, ou du grotesque.», par Amadou Bal BA
László KRASZNAHORKAI, né le 5 janvier 1954 à Gyula, dans le sud-est de la Hongrie, vers la frontière roumaine, un écrivain et scénariste hongrois, est le prix Nobel de littérature 2025 pour sa contribution littéraire «fascinante et visionnaire qui, au milieu d'une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art». Il a été considéré comme «maître de l’apocalypse» par Susan SONTAG. Dans ce monde fascinant et crépusculaire, une conspiration du détail, les longues phrases de l’auteur, au style ciselé, très fouillé, pleines de digressions et de virgules, mais qui retombent toujours sur leurs pattes, récompensent l’effort de tout lecteur patient et exigeant. «Laszlo Krasznahorkai n’interrompt jamais celui qui lui parle. Il sourit, écoute, hoche la tête, répond. Il ne hausse pas la voix. Il parle d’une constante tonalité sourde et lente, portée par la tendresse de ses yeux. Il parle au même rythme qu’il écrit, en marathonien ou danseur, sans perdre son souffle. Lorsqu’il entame une phrase, on ne sait où celle-ci nous mènera, elle semble partir de rien, un détail, une anecdote, une blague, et s’amplifie petit à petit, charriant une pensée limpide, dépourvue de grandiose, mais pas de magnétisme», écrit Oriane JEANCOURT GALIGNANI.
Après une période d’attente de trois ans, László KRASZNAHORKAI est le deuxième prix Nobel de littérature après Imré KERTESZ (1919-2016), prix Nobel en 2002, un survivant de la déportation «Je suis donc mort une fois pour pouvoir continuer à vivre et c'est peut-être là ma véritable histoire» disait Imré KERTESZ. Son ambition littéraire fascinante et visionnaire est d’exorciser les cauchemars légués par l’histoire humaine, en déblayer les scories, pour faire place nette au questionnement, comme Bouddha, Dante et Hérodote.
En 2015, prix The Man Booker International Prize, écrivain épique, de l’absurde et du grotesque de la tradition littéraire Franz KAFKA et de Samuel BECKETT, il est un écrivain hypnotique, dense, sombre, mélancolique, burlesque et teinté d’un humour noir. En effet, son style inimitable, exigeant et hermétique, a été décrit comme «la réalité examinée jusqu’à la folie». Il a collaboré avec le cinéaste hongrois Béla TARR et certains de ses romans ont été portés au cinéma.
Évoluant dans un univers à la fois réel et étrange, repoussant ses propres limites et celles du langage aux confins de l'hallucination, écrivain hypnotique dont l’œuvre et mélancolique, László KRASZNAHORKAI entraîne, par ses assauts répétés, le lecteur dans une troublante confrontation avec les lois de l'imagination. «Il vous attire jusqu’à ce que le monde qu’il évoque fasse écho et se répercute en vous, jusqu’à ce que ce soit votre propre vision de l’ordre et du Chaos», dit Georges SZIRTES, poète et traducteur britannique.
Fils d’un avocat et d’un agent public, après ses études en droit de 1973 à 1976, à la faculté de Szeged et de Budapest László KRASZNAHORKAI il a fait des études de droit et de littérature, en soutenant, en 1983, une thèse sur l’écrivain et journaliste hongrois Sandor MARAI (1900-1980), alors en exil en Italie puis aux Etats-Unis, après la prise de pouvoir, en 1948, des communistes.
L’auteur publie, en 1977, son premier roman. Éditeur dans un premier temps, il s’engage résolument, à partir de 1985, vers l’écriture, avec un premier roman, «Satantango» ou «Tango de Satan». Ce roman, teinté d’humour noir, l’auteur nous transporte dans la grande plaine hongroise balayée par le vent et l'incessante pluie d'automne. Dans une ferme collective démantelée et livrée à l'abandon, quelques habitants végètent, s'épiant et complotant les uns contre les autres, lorsqu'une rumeur annonce le retour de deux autres personnages que l'on croyait morts. Cette nouvelle bouleverse ces êtres en manque de perspective. Certains y voient l'arrivée d'un messie, d'autres redoutent celle de Satan. Farce noire teintée d'ironie, ce roman, conçu comme un tango où les danseurs viendraient les uns après les autres sur la piste de danse, nous plonge dans un voyage poétique peuplé de solitude et de mélancolie, une quête de vérité emplie d'humanité sur la place de notre existence face au Temps.
«Tango de Satan», traite de la géologie historique de la Hongrie, un paysan vieillissant, pauvre et sous la botte, un roman sur la souffrance de ces personnages comme le temps mélancolique automnale, cette pluie habille la nature sombre de cette région isolée, la coopérative fermée, les maisons d'usures maladives dans cet isolement rurale. Une coopérative, dans le souvenir des anciens ouvriers, en ruine, est ce lieu où végètent toutes ses âmes grises, prises dans l'alcool, le sexe, la jalousie, les complots et cette paresse lente et sournoise statufiant leurs rêves. Un tango, source de diablerie, de Satan. Mme Schmidt devient la maitresse de Satan, la chaleur de son corps ondule avec ceux des hommes en érection d'envies, Mme Kraner enflamme l'auberge, le fermier joue le tango, source de diablerie, tous s'embrasent. Estike dernière des Horgos, semble être le souffre-douleur de la famille, ayant quitté l'institut, elle doit être invisible, silencieuse et faire ses taches, Sanyi, son frère la torture tout le temps. Dans son écriture magnétique, l’auteur, un sorcier des mots est d’une imagination débordante. L’alcool coulant à flot, des corps qui se mêlent, dans la luxure, au son de la musique. Dans cette part du fantastique, le fantôme de la jeune fille morte, hantant le château sous le regard de son grand frère et de Irimias, provoque une hallucination collective, source de malédiction. Auteur postmoderne, il règle ses comptes, par la puissance de ses mots, avec un passé politique très lourd.
Ecrivain hostile au régime populiste hongrois de Viktor ORBAN, dans la révolte à travers ses romans, László KRASZNAHORKAI a séjourné pendant longtemps à l’étranger, en Mongolie, en 1990, en Chine, aux Etats-Unis de 1992 à 1998), en 1996, en Bosnie, au Japon, en 1997, 2000 et 2005, en Allemagne et en Italie.
Son roman, «la mélancolie de la résistance», paru, en 1989, a marqué les esprits. Les événements du roman se déroulent dans une ville de province hongroise où un cirque débarque avec un spectacle mystérieux qui sème le chaos dans la société. Les personnages principaux tentent chacun, à leur manière, de résister aux forces oppressives qui menacent leur monde, permettant à l'auteur d'explorer l'impuissance humaine et l'effondrement de l'ordre familier, abordant ainsi de profondes questions philosophiques et existentielles, comme la finitude de toute existence. Dans ce roman hypnotique et crépusculaire, digne de KAFKA, le personnage de Mme Pflaum, une des habitantes de la ville, se débat contre une menace jamais nommée. Ni son intérieur petit-bourgeois ni les opérettes retransmises à la télévision ne peuvent la protéger du désordre ambiant. Son ennemie, Mme Eszter, l'appelle à l'aide pour mener «campagne contre la destruction», mais la venue d'un cirque et l'exhibition d'une baleine sèment le trouble dans la communauté, puis précipitent la ville dans une explosion de violence.
Par conséquent, «la mélancolie de la résistance», un de ses œuvres emblématiques, onirique et glacial, est un roman noir, fantastique, fantasmagorique, un style désabusé, pessimiste, maniant un humour décalé et voyeur, grotesque et ironique. Le récit du roman dystopique ne repose pas sur une intrigue, mais plutôt sur une atmosphère mystérieuse, oppressante et angoissante née d’événements qui surgissent : rumeurs alarmantes venues de la lointaine capitale sur la prolifération de bandes d’enfants, profanations de monuments, collisions ferroviaires ou catastrophes imminentes. Il faut ajouter à cela l’inquiétante baleine et la troupe de forains, atmosphère également due à une forme de folie de chacun des personnages. La ville connaîtra le chaos, l’armée interviendra, écrasera la rébellion. Mme Ezster, cherchera à nettoyer la ville à l’issue d’un discours sécuritaire.
László KRASZNAHORKAI y fait alterner le chaud et le froid. Après que la tempête de violence s’est abattue sur la ville, Valuska et Eszter, tous les deux transformés, sont relégués aux marges de la société de leur ville ; alors que Mme Eszter, qui a tiré profit de la répression d’après les troubles pour imposer son cynisme et son activité brutale, devient la maîtresse des lieux. Dans cette Hongrie de l’Apocalypse, un monde chaotique, en proie à la dislocation, à la décomposition, à la disharmonie, en réalité, le roman revêt une dimension hautement politique et subversive. En effet, il décrit la Hongrie au scalpel de sa lente érosion, sombrant dans le totalitarisme ; il dénonce ainsi la folie des hommes. C’est donc un éloge d’une humanité en déroute, qui résiste. En effet, ce roman campant, au cœur du réel, cette inquiétante étrangeté qui constitue la vérité des rapports humains. À travers le regard naïf d'un candide, en jouant sur plusieurs registres : la terreur, le grotesque, l'ironie, le fantastique. L’auteur s'applique avec joie à y dynamiter systématiquement toute possibilité d'une île, refuge labile contre la barbarie.
Finalement, dans «la mélancolie de la résistance», une métaphore des fins de règne, de système, d’époque d’un régime politique autoritaire, deux personnages, Mme Eszter, Mme Pflaum incarnent deux visions diamétralement opposées du rôle de l’individu face au chaos, à la dictature. La seconde, Mme Pflaum, inquiétante et acariâtre, amoureuse de musique, dans le conformisme, la lâcheté, ou la résignation, opte, comme presque l’ensemble des habitants de la ville, pour le retrait, le quant-à-soi, parmi ses plantes bien soignées et les opérettes encore rediffusées par la télévision. La première, Mme Eszter, séparée de son mari, très habile, une manipulatrice ambitieuse, se saisit au contraire des événements pour «balayer l’ancien pour établir le neuf» et ainsi montrer aux habitants «qu’il vaut mieux brûler de la fièvre de l’action plutôt qu’enfiler ses pantoufles et enfouir sa tête sous l’oreiller». L’auteur, dans son opposition, met en valeur la voie que Mme Eszter trace à la fin du roman pour l’avenir de la commune, parait pourtant sinistre, pour combattre ce régime de violence et de loyauté basé sur la peur.
Un autre roman emblématique de ce prix Nobel 2025 est «le dernier loup», publié en 2009 en langue française, et récompensé du Prix Pulitzer. Dans «le dernier loup», au-delà de l’impressionnante prouesse stylistique, cette phrase tout en circularités temporelles sert une réflexion subtile sur les liens entre l’homme et la nature, opérant dans le même temps une véritable entreprise d’envoûtement du lecteur, le héros du roman est un antihéros. En effet, un homme soliloque dans un bar, dans un quartier crasseux, d’un philosophe désabusé, pour lequel plus rien n'a de sens, jusqu'à l'absurde. Il vient tous les jours, boit sa bouteille, «Sternburger, bitte», une bière, dans une ambiance morose, tandis que ce bar minable diffuse de la musique turque. Dans cette nouvelle longue des volutes, des digressions, un rythme ample, un souffle puissant, le narrateur, traité comme une personnalité illustre, craignant d’être démasqué, comme un imposteur, il est paralysé, impuissant à s’exprimer et à avouer leur méprise à ses hôtes. En effet, un jour, il explique au serveur du bar qu'il a reçu une lettre, une invitation dans une région en pleine mutation. En effet, on s'est souvenu qu'autrefois il était un «enseignant» et on l'invite à séjourner en Espagne, un vaste territoire aride et vide, un paysage sec et ondoyant, plantés de chênes verts, épargné par l’aliénation désastreuse de la modernité. Entre déchéance et mélancolie, il lâche cette phrase : «Nous irons là où le dernier a péri», écrit-il. Plus particulièrement en Estrémadure, une région pauvre proche de la frontière portugaise. Là-bas, il pourra rester le temps qu'il souhaite, et se promener autant qu'il veut, pourvu qu'à la fin il écrive sur ce qu'il a vu et ressenti.
En fait, le récit va se révéler plus complexe qu'il ne semblait, avec des ramifications, des épisodes, une charge émotionnelle, et des interrogations qui vont bien plus loin que le destin du loup. En magicien du verbe et du récit, Laszlo KARSZNAHORKAI nous tient en permanence en haleine, et vous abandonne, au final, avec plus d’interrogations que de réponses, en ouvrant la perspective d’une fin de l’histoire. Au-delà de ces longues phrases envoûtantes, parfois de plus de dix pages, c’est un récit littéraire, un flot de paroles d’un érudit résigné, dans son rêve éveillé vous tenant constamment en haleine, un triomphe par une illumination philosophique sur la vanité et le mépris.
Références bibliographiques
A – Contributions de Laszlo KARSZNAHORKAI
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Au nord la montagne, au Sud, un lac, à l’ouest par des chemins, à l’est par un cours d’eau, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Actes Sud, 2017, 187 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Guerre et guerre, traduction de Joëlle Dufeuilly, Arles, Actes Sud, 2015, 337 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Le baron de Wenckeim est de retour, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Cambourakis, 2023, 523 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Le dernier loup, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Cambourakis, 2022, 74 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Mélancolie de la résistance, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Gallimard, 2016 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Petits travaux pour un palais : pénétrer la folie des autres, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Cambourakis, 2024, 106 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Seiobo est descendu de terre, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Cambourakis, 2018, 410 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Sous le coup de la grâce : nouvelles de mort, traduction de Marc Martin, Sénouillac, (Tarn), Vagabonde, 2015, 183 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Tango de Satan, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Gallimard, 2017, 382 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Thésée universel, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, 2011, 93 pages ;
KRASZNAHORKAI (Laszlo), Venu d’Isaïe, traduction de Joëlle Dufeuilly, Paris, Cambourakis, 2023, 51 pages.
B – Autres références
Anonyme, «Laslo KRASNAHORAI, la mélancolie de la résistance», Passage à l’Est, 14 mars 2018 ;
ASENSIO (Juan), «La mélancolie de la résistance de Laslo KRASZNAHORAI», Stalker, 21 mai 2015 ;
BA (Amadou, Bal), «Franz Kafka (1883-1924) le centenaire de sa mort», Médiapart, 17 mai 2024 ;
BA (Amadou, Bal), «Samuel BECKETT(1906-1989) dramaturge», Médiapart, 7 mars 2023 ;
Hugues, «Laslo KRASNAHORAI, la mélancolie de la résistance, note de lecture», Charybde 27, 16 juillet 2016 ;
JEANCOURT GALIGNANI (Oriane), «Entretien avec Laslo KRASNAHORAI», Transfuge, 9 octobre 2025, archives de mai 2018, n°119 ;
Mimiche, «Le dernier loup de Laslo KRASZNAHORAI», L’univers du livre, l’actualité, 13 juin 2022 ;
VIALLE (Jean-Pierre), «Laslo KRASNAHORAI, la mélancolie de la résistance», Mes belles lectures, 1er mai 2017.
Paris, le 9 octobre 2025, par Amadou Bal BA



