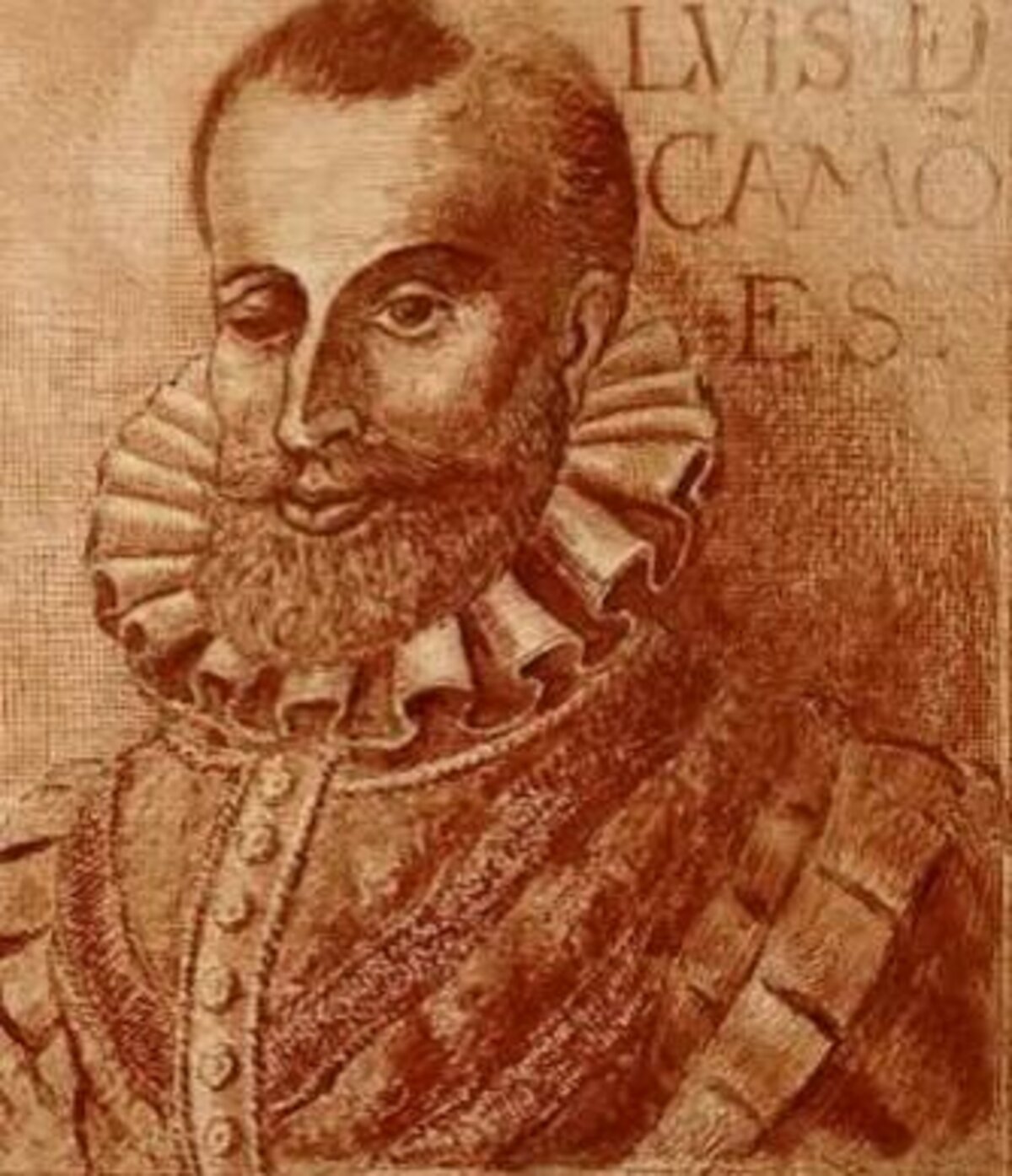
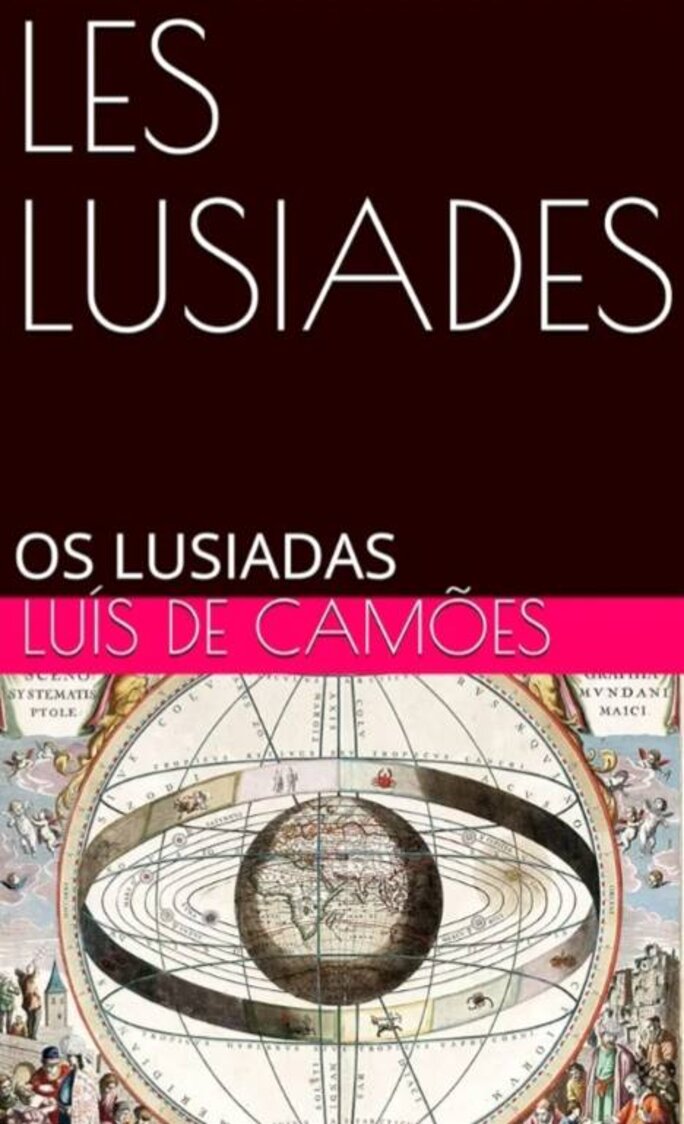
Agrandissement : Illustration 2
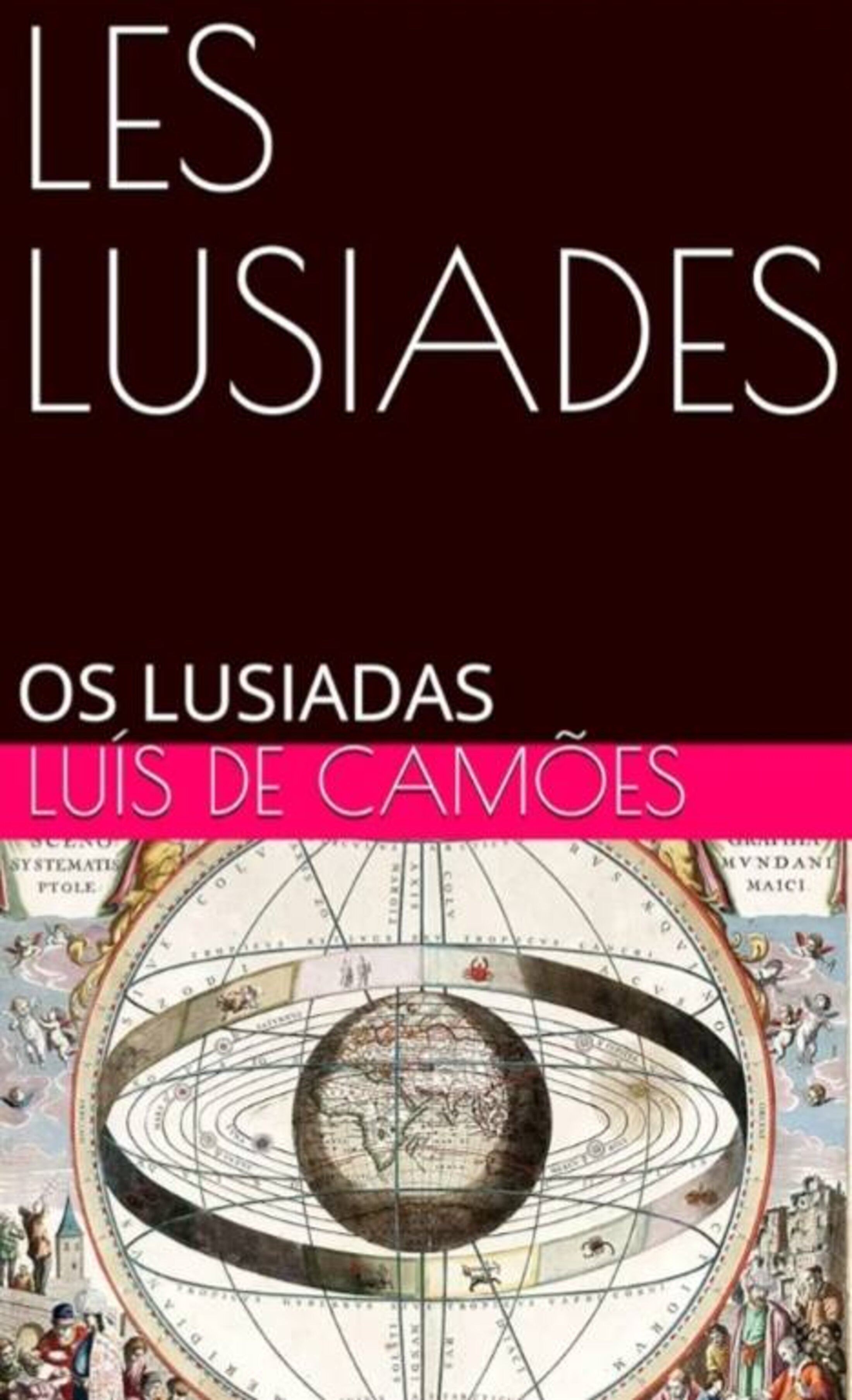

Agrandissement : Illustration 3

«Luis VAZ de CAMOES dit «Le Camoëns» (1524-1580) Prince des Poètes et ses sonnets, «Les Lusiades», poème en 10 chants, ou la glorification des conquêtes coloniales portugaises. La résurgence d’une littérature anticoloniale contre une mémoire collective glorifiant les conquêtes coloniales.» par Amadou Bal BA
Né vers 1524, à Constançia, près de Santarem, donc un contemporain de Pierre de RONSARD, fils de Simon VAZ CAMOENS, le plus grand poète portugais, sa famille originaire de la Galice est passée au Portugal, du temps du roi D. Ferdinand 1er. Sa mère, Ana de SA MACEDO, est apparentée au navigateur Vasco de GAMA. Il fit ses études à Coïmbres, sous l’égide de son oncle, D. Bento de CAMOENS, de l’ordre de Sainte-Croix, un homme érudit, un esprit lumineux. Aussi, le jeune CAMOENS, passionné de lecture, découvre les grands poètes de l’Antiquité, l’école italienne, mais aussi la vieille poésie portugaise, délégitimée et négligée. Il renoue avec la métrique, pour développer une poésie nationale et populaire. Il a aimé passionnément, avec fougue et une foi ardente d’un jeune poète, Catherine d’ATHAYDE, la Béatrice portugaise, travaillant à la cour royale, mais il fut remballé ; cette peine du cœur causa son premier exil, à Santarem, sur les bords du Tage. Il partira par la suite pour l’Afrique, à Ceuta, Macao, Goa, puis pour les Indes. Mort à Lisbonne, le 10 juin 1580, il est enterré au Monastère des Hiéronymites, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans la mémoire collective, Luiz VAZ CAMOES est la poète, dans ses «Lusiades », les Portugais, qui chanté et vanté les conquêtes coloniales. Cependant, certains auteurs, Fernando PESSOA, Jose SARAMAGO et Isabela FIGUEIREDO, ont remis en cause, vigoureusement, cet héritage littéraire colonial.
I – Luis CAMOES, une poésie, une mémoire collective de glorification des conquêtes coloniales
Luiz CAMOENS, poète national du Portugal de la Renaissance, est l’auteur des Lusiades, les Portugais s’appelaient les Lusitaniens, un poème à la gloire des conquêtes coloniales en dix chants. Pendant longtemps, les Arabes qui avaient occupé l’Espagne et le Portugal, dominant le monde. Au début de la Lusiades, Luiz CAMOES invoque d'abord les nymphes du Tage et se recommande au roi Sébastien 1er (1554-1578), pour le relèvement du Portugal contre les occupants. «Je chanterai les combats et ces hommes courageux. qui, de la rive occidentale de la Lusitanie, portés sur des mers que la proue n'avait pas encore sillonnées, franchirent les plages de la Taprobane (Ceylan), déployèrent au milieu des périls et des batailles une force plus qu'humaine, et, parmi des peuples lointains, fondèrent si glorieusement un nouvel empire. Je dirai les vertus héroïques de ces princes qui soumirent à leur domination les contrées infidèles de l'Afrique et de l'Asie, et sur d'impurs débris établirent le règne de la foi. Je dirai ces guerriers que leur valeur a rendus immortels. Si l'art et le génie me secondent, leur renommée remplira l'univers», écrit-il dans le chant 1er. En parlant à ce jeune prince de ceux qui l'ont précédé sur le trône et des héros du Portugal, invite le roi Sébastien, à se montrer l'héritier de leurs vertus et le digne souverain d'un tel peuple : «Écoute, le nom portugais va retentir dans mes chants. Apprends à connaître les hommes que le ciel a soumis à ton empire ; et dis-moi s'il n'est pas plus beau de régner sur eux que de commander au reste du monde», écrit-il dans le 1er chant.
Luiz CAMOES est le créateur d’un roman national du Portugal. Il veut effacer les traces des dominations étrangères sur son pays, celles, jadis, des Barbares, des Visigoths et des Arabes. Dans les «Lusiades», ce vaste poème en dix chants n'a pour théâtre qu'un vaisseau, avec le ciel et la mer pour horizon, un récit glorieux du voyage de Vasco de GAMA (1460-1524à) et de ses braves compagnons, à l’assaut de la découverte, en 1499, de l’Inde. «Je chanterai les combats et ces hommes courageux», écrit -il dans le 1er chant. Dans le second chant, la flotte de Vasco de GAMA, courant des dangers, est sauvée par Vénus.
Comme les grands poètes des temps anciens, Homère et Virgile, Luiz CAMOEZ transporte au milieu de cette expédition coloniale une poésie pastorale, et veut que le Portugal efface les gloires des autres pays des temps anciens. «Qu'on ne parle plus des courses fameuses du sage Ulysse et du pieux Enée. Que la déesse aux cent voix cesse de proclamer les victoires d'Alexandre et de Trajan. Je chante les enfants de Lusus : Mars et Neptune ont marché devant eux. Héros de Virgile et d'Homère, écoutez des exploits qui surpassent tous les vôtres. Et vous qui venez de m'enflammer d'une ardeur nouvelle, Nymphes du Tage, si vous fûtes mes premières amours, si j'ai chanté vos doux rivages, donnez à ma voix un ton plus élevé : donnez à mes vers une harmonie si brillante et si pure que le dieu du Pinde abandonne pour vos ondes les flots de l'Hippocrène (une source d’inspiration des Muses)», écrit-il dans le chant 1er. Les vaisseaux des enfants de Lusus, sous la conduite de Vasco de GAMA, ont doublé le cap des Tempêtes et suivent paisiblement leur course entre Madagascar et la côte Éthiopienne, tandis qu'au sein des célestes demeures, où se préparent les arrêts qui règlent le sort des mortels, les dieux tiennent conseil sur les destinées de l'Orient. Ils sont assis sur des sièges émaillés d'or et de perles, qui s'abaissent par degrés au-dessous d'un trône resplendissant d'étoiles, réservé au dieu qui lance la foudre.
«Ma lyre sera plus célèbre qu'elle ne doit être heureuse», disait CAMOES. Si quelque chose égala sa gloire, ce furent ses malheurs ; il comptait sur la justice de la postérité. De nos jours, le nom de ce grand poète a survécu au temps et sa renommée est devenue immortelle. Ses véhiculent le patriotisme, mais aussi ont fait vibrer des thèmes de l'exploration, de l'amour et de l'héroïsme. En effet, il fait l’objet d’un véritable culte de la part du peuple portugais en général, et des gens de Lettres. Son nom, souvent cité avec révérence, est associé par son génie, à Virgile, Dante ou Shakespeare. En effet, il est à la base de la mémoire collective du Portugal, glorifiant les conquêtes coloniales.
Quand on visite cette belle de Lisbonne, on est interpelé par ces monuments imposants sur les découvertes et les conquêtes coloniales. Le dictateur, Antonio de OLIVEIRA SALAZAR (1889-1970), a récupéré cette mémoire collective conservatrice, pour son projet de colonisation. Si les colonies françaises d’Afrique ont été indépendantes, globalement, à partir de 1960, les possessions portugaises dans le continent noir, n’ont accéder à la liberté, qu’après la Révolution des œillets, la chute du dictateur SALAZAR resté au pouvoir, de 1932 à 1968, et des guerres sanglantes d’indépendance (Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mozambique, Angola).
II – La postérité : une remise en cause de cette mémoire collective coloniale
La mémoire collective coloniale a été remise en cause très tôt par l’écrivain, poète, Fernando PESSOA (1888-935), Même s’il est resté admiratif du poète CAMOES, dans sa poésie, Fernando PESSOA a dénoncé le fascisme, la dictature de Antonio OLIVEIRA de SALAZAR (1889-1970), la plus longue dictature de 41 ans, en raison de sa censure insidieuse, sa mainmise, par des directives sur la création artistique. Satiriste et critique littéraire, Fernando PESSOA s’est insurgé aussi contre le régime fasciste de Benito MUSSOLINI (1883-1945) d’Italie «Le problème que représente le fascisme est simple, dans son essence, il n’est pas à nous. Le peuple italien a reçu, sur la joue droite, la gifle du communisme. Le fascisme, afin de le redresser, l’a giflé avec un peu plus de force, sur la joue gauche», écrit Fernando PESSOA, dans «Gare à Salazar ! écrits et poèmes sur la dictature». L’agression de l’Italie contre l’Ethiopie a été condamnée, sans détour «On dit qu’ils vont présenter à la Société des Nation un livre pour prouver que les Abyssins ont tort ; car l’Abyssinie connaît l’esclavage. En Italie aussi se fasche (fascisme) l’esclavage. En Italie tout est esclavage», écrit Fernando PESSOA. SALAZAR survient après l’abolition de la monarchie en 1910 et instaure un Etat dictatorial. «La terreur éprouvée, lorsque Salazar est arrivé au pouvoir ne venait pas d’une crainte patriotique qu’il puisse échouer, mais d’une peur bien différente : qu’il n’échoue pas», écrit Fernando PESSOA. En effet, l’auteur assimile le fascisme, la colonisation à l’esclavage des peuples. «Telle est la fatalité de tous les peuples impérialistes, en réduisant les autres à l’esclavage, ils se condamnent eux-mêmes à l’esclavage. Salazar est une tirelire, jeunes filles venez le voir. De l’extérieur, terre cuite et vernis, de l’intérieur, cuir et chevelure», écrit Fernando PESSOA. SALAZAR n’est d’autre qu’un tyran «Antonio de Oliveira Salazar, c’est l’arbre, c’est juste un nom. Ce monsieur Salazar est fait de sale et de hasard. Quel pauvre enfant, que notre petit tyran», écrit Fernando PESSOA.
Pour Jose SARAMAGO (1922-2010), Prix Nobel de littérature en 1998, la souffrance humaine est engendrée par les relations de domination induites par la triade capitalisme, colonialisme et patriarcat, triade qui a plongé le monde dans l’inégalité et l’injustice. Par conséquent, pour lui, les pays colonisés, «le Sud n’est pas une entité géographique : il s’agit d’une métaphore de la souffrance humaine causée par l’ordre mondial dominant et une valorisation des résistances qu’elle génère», écrit-il. Le Prix Nobel convoque donc la résistance de tous pour faire échec au colonialisme, à toute logique de prédation et de domination des autres, pour s’accaparer de leurs richesses. Par son indignation contre l’injustice, Jose SARAMAGO estime que la littérature engagée est libératrice. Dans ses colères, sa sérénité et son humanisme, il estime que «La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet, au moins, de respirer». Par conséquent, il a dénoncé le fascisme de SALAZAR, de façon parodique dans son fameux roman, «L’Année de la mort de Ricardo Reis».
Dans ce conflit entre la mémoire collective imprégnée des conquêtes coloniales, Isabela FIGUEIREDO a secoué le cocotier. En effet, Isabela FIGUEIREDO, journaliste, enseignante et écrivaine est née le 1er janvier 1963, à Lurenço Marques, actuelle ville de Maputo, capitale du Mozambique, de parents colons portugais. À l’indépendance du Mozambique, en 1975, elle est rapatriée au Portugal, chez ses grands-parents, ses parents étant restés à Maputo, jusqu’en 1985. Dans ses romans, elle éclaire d’une lumière crépusculaire un passé douloureux et encore peu raconté, l’histoire des «retornadas», une sorte de pieds-noirs. Dans son premier roman, «Carnets de mémoires coloniales», il est bien question de son père «un migrant économique transformé en opérateur de la colonisation par les attributs de la race. Ce qui forge le colonisateur, c’est le principe de la supériorité raciale et les actes qui en découlent, le rapport aux autres qui en résulte. Ainsi un homme fuyant la misère que lui promet son Portugal natal, où l’ouvrier de 12 ans qu’il fut, eut trois doigts broyés par la presse d’une imprimerie, se trouve-t-il propulsé tout en haut de la pyramide humaine, du fait de la suprématie blanche et du système prédateur mis en place par ses concitoyens. Un homme dont l’existence ne pesait pas lourd sur la terre de ses ancêtres acquiert à ses propres yeux une importance toute nouvelle, un pouvoir qu’il lui faut exercer afin de l’éprouver vraiment», écrit Léonara MIANO, dans la préface de «Carnets de mémoires coloniales».
Dans ce roman largement autobiographique, «La Grosse», c’est une histoire complexe, celle de ceux qui ont participé, ici comme ailleurs en Europe, à la grande erreur collective de l’aventure coloniale, emportant dans leur échec une génération un peu oubliée, partagée entre la honte et l’amour de leurs parents. «À propos du colonialisme, on sait tout. Du moins, le pense-t-on, et si la connaissance que l’on en a est plutôt théorique, on se représente plus ou moins le déroulement concret des choses. Pourtant, il reste beaucoup à dire, car le colonialisme européen en Afrique subsaharienne, celui qui nous intéresse ici, eut aussi son versant intime. (…). Cette autre dimension que l’on peut qualifier de secrète puisqu’elle est encore très peu étudiée, encore moins exposée, se rapporte à l’imprégnation du vécu des colons eux-mêmes par la relation nécessairement viciée avec ceux auxquels une présence inamicale fut imposée. Isabela Figueiredo nous précipite sans crier gare dans un domaine rarement arpenté. La pièce dans laquelle nous pénétrons ouvre de plain-pied sur la question raciale. Dès les premières pages, Isabela Figueiredo nous le rappelle. La fillette qu’elle fut autrefois et dont l’adulte qui écrit se souvient vécut dans un monde où «Les Blancs allaient se faire des «négresses». Dans le Mozambique que décrit l’ouvrage, les hommes blancs ne couchent pas avec des femmes noires. Elles ne sont jamais désignées comme femmes, et la couleur de leur peau, qui les nomme et les qualifie, efface non seulement l’identité, mais aussi l’appartenance au continent. Ces «négresses», ces «Noires», ne sont pas dites africaines, encore moins mozambicaines, un peu comme s’il était aberrant de les associer à une région du monde baptisée par d’autres. L’image qu’elles s’inventent des «négresses», de leurs vagins incommensurables et de leur insatiable appétit sexuel, leur permet non seulement d’abolir le chagrin dû à l’infidélité qui ne se commettrait qu’avec des femmes, mais surtout de dénier ce caractère à celles qui attirent leurs maris. L’animalisation des femmes subsahariennes, qui saisit dès les premières pages, pose clairement les termes du colonialisme qui se déploie au fil de la narration : ce fut aussi une affaire raciale, une histoire d’humains forcés de côtoyer une infra-humanité», écrit Léonara MIANO, dans sa préface magistrale sur «Carnet de mémoires coloniales».
Références bibliographiques
A – La contribution littéraire de Luiz CAMOES
CAMOENS (Luiz), Les Lusiades ou les Portugais. Poème en dix chants, traduction avec des notes P J. Millié. Paris, Firmin Didot, 1825. 2 vol, 400 et 414 pages ;
CAMOENS (Luiz), La Lusiade. Traduction poétique, avec des notes historiques et critiques, nécessaires pour l'intelligence du poème, traduction de Jean-François La Harpe, Paris, F. Didot, 1820, 316 pages.
B – Autres références
ADAMSON (John), Memoirs of the Life and Writings of Camoens, with Transcription of his Poems, London, Edinburg, 1820, Vol I, 309 pages Vol II, 392 pages ;
BA (Amadou, Bal), «Fernando PESSOA, poète portugais», Médiapart, 21 mai 2023 ;
BA (Amadou, Bal), «Isabela FIGUEREIDO, écrivaine portugaise décoloniale», Médiapart, 7 mai 2024 ;
BA (Amadou, Bal), «Jose SARAMAGO (1922-2010) Prix Nobel de littérature portugais», Médiapart, 11 juin 2023 ;
DENIS (Ferdinand), Résumé de l’histoire littéraire du Portugal et du Brésil, Paris, Imprimerie Decourchant, 1826, 618 pages, spéc chapitres VIII et IX, pages 66-149 ;
DENIS (Ferdinand), Scènes de la nature sous les tropiques, et de leur influence sur la poésie ; suivies de Camoens et Jozé Indio, Paris, J. Lanet, 1824, IV. 517 pages, spéc pages 408-494 ;
DUPEYRON de CASTERA, La Lusiade du Camoens, poème héroïque sur la découverte des Indes orientales, Amsterdam, François L’Honoré, 1735, tome 1er, 319 pages ;
FRESSARD (Jacques), Camoens, Paris, Pierre Seghers, 1964, 128 pages ;
LAMARRE (Clovis), Camoens et les Lusiades, Étude biographique, historique et littéraire, suivie du poème annoté, Paris, Didier et Cie, 1878, 638 pages ;
LEMOS (Miguel), Luis Camoens, Paris, Siège central du positivisme, 1880, 283 pages ;
LOURENçO (Eduardo), «Petite mythologie portugaise», Revue-des-Deux-Mondes, mars 2000, pages 9-14 ;
LUNARET (Henri), Essai littéraire et biographique sur Luiz de Camoens : sa vie et ses œuvres, Paris, Librairie académique, Paris, Au Qantin, 1882, 24 pages ;
MANGIN (Charles), «Luiz de Camoens», Revue-des-Deux-Mondes, avril 1832, tome VI, pages 145-182 ;
NAVERY de (Raoul), Les voyages de Camoens, Paris, A. Hennuyer, 1880, 364 pages ;
PESSOA (Fernando), Gare à Salazar ! écrits et poèmes sur la dictature, présentation de Joanna Cameira Gomis, traduction de Bernard Haumont, Paris, Chandeigne et Lima, 2025, 190 pages ;
TISSOT (Pierre-François) Études sur Virgile comparé avec tous les poètes épiques et dramatiques des anciens et des modernes, Bruxelles, PM de Vroom, Vol I, 1826, Paris, Imprimerie et librairie classique, Vol II, 1841, 528 pages.
Paris, le 13 novembre 2025, par Amadou Bal BA



