
Agrandissement : Illustration 1

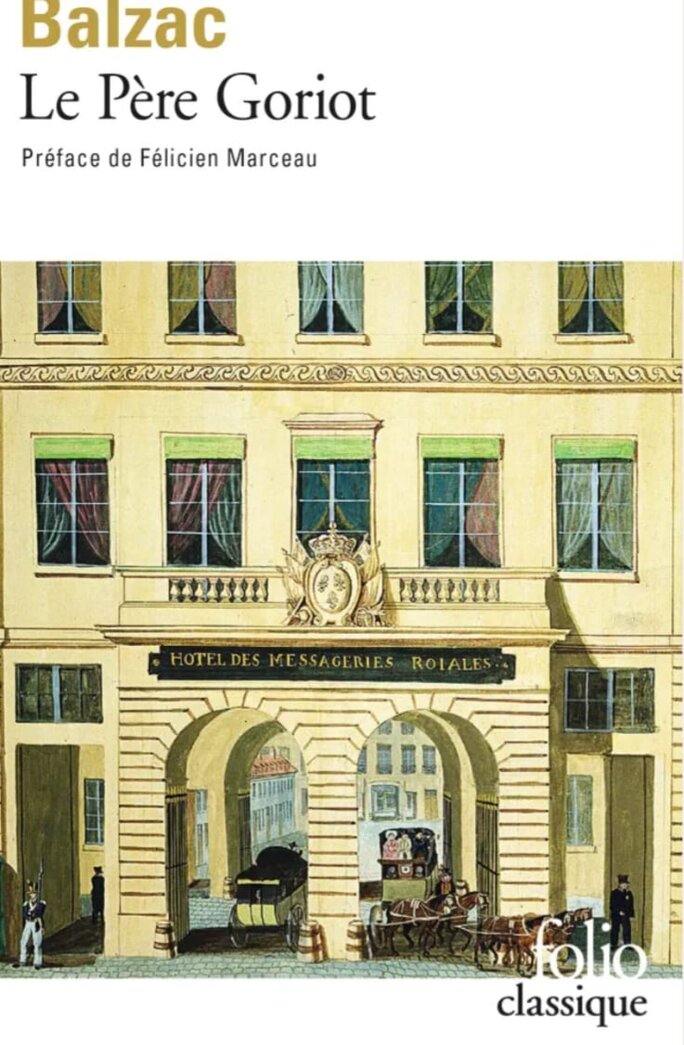
Agrandissement : Illustration 2
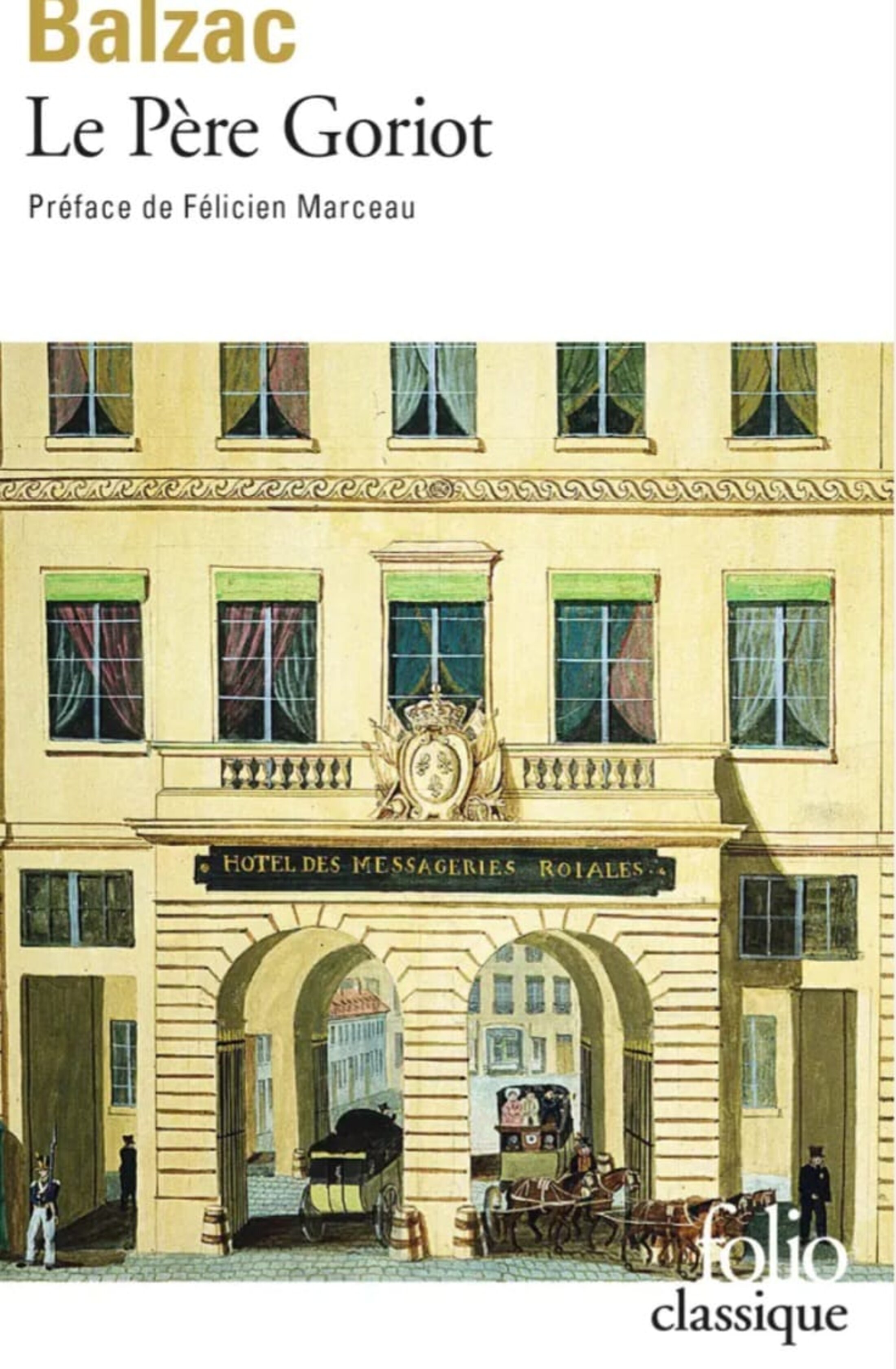
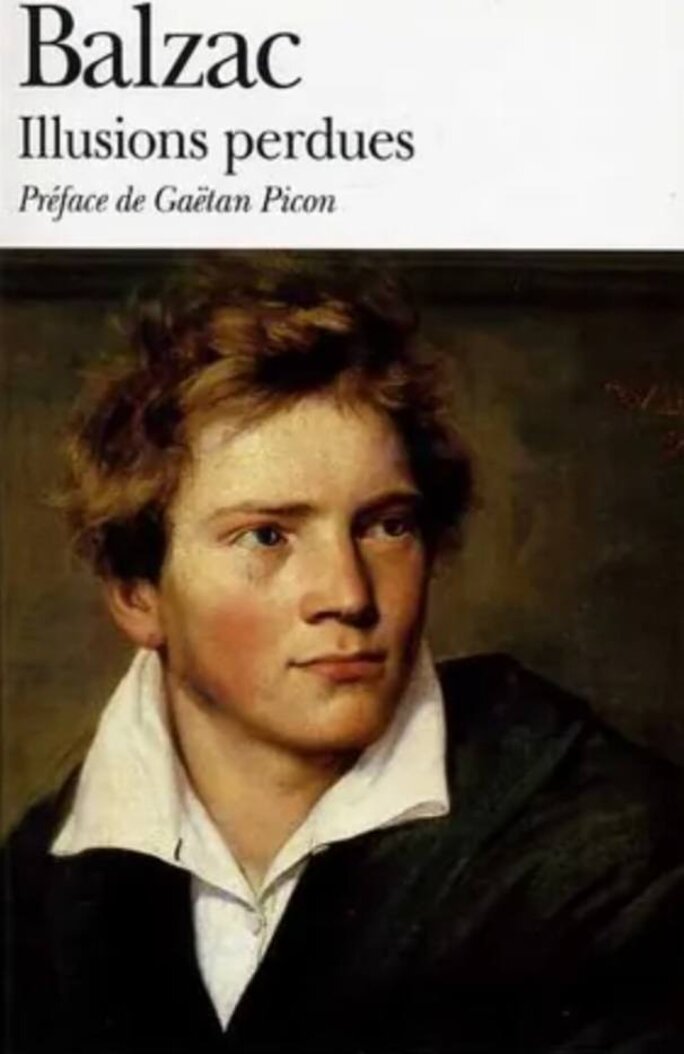
Agrandissement : Illustration 3
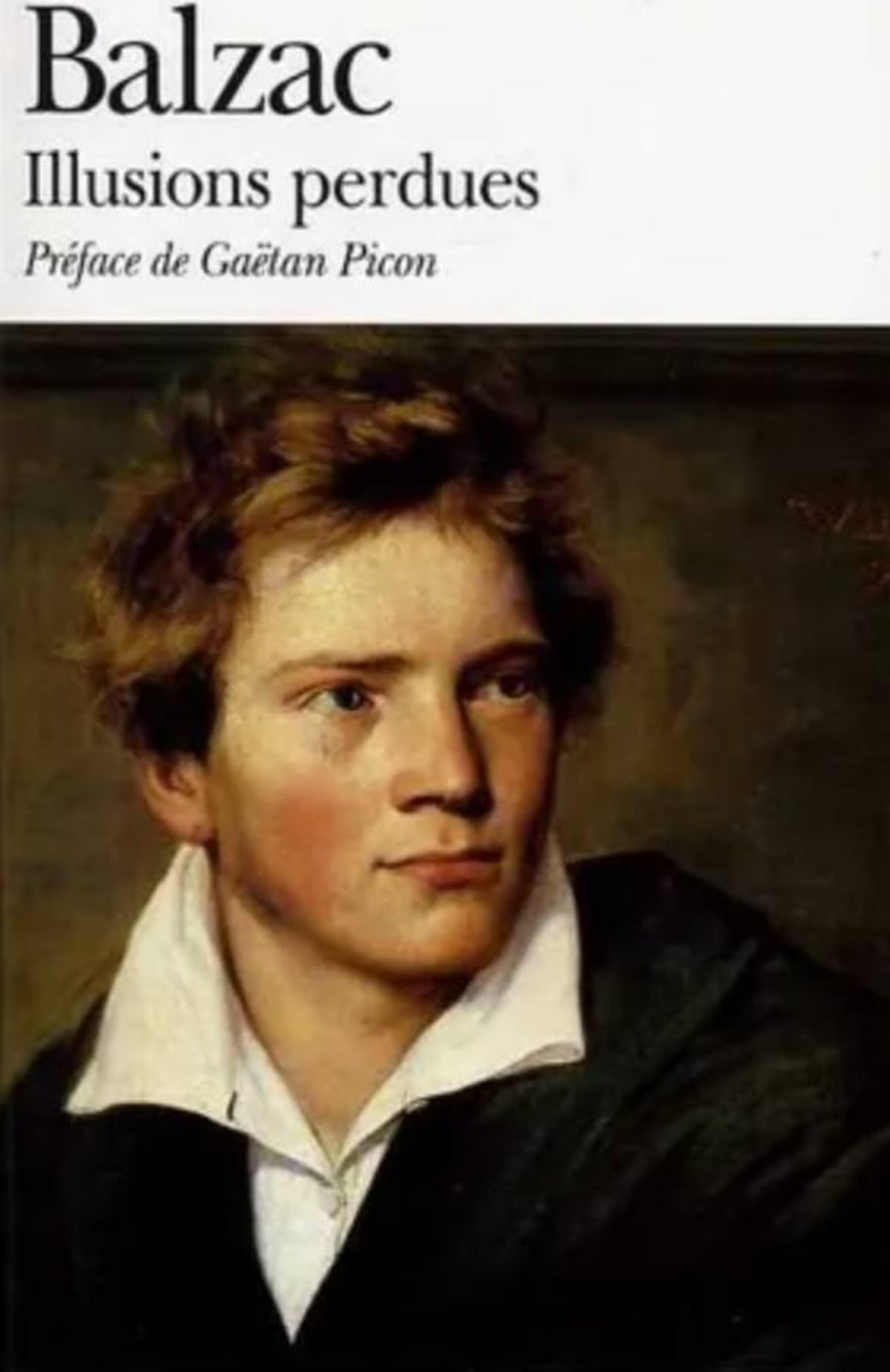
«Honoré de BALZAC (1799-1850), éditeur, journaliste, critique littéraire, conteur, dramaturge, philosophe et romancier de la comédie humaine, une vaste peinture du XIXe siècle entre Révolution et Monarchie, progrès social et conservatisme» Amadou Bal BA
«Ce ne sont pas des romans comme on en avait entendu avant lui, que des livres impérissables de ce grand critique», écrit George SAND. En effet, un nombre important d’écrits ont été produits sur Honoré de BALZAC, sur sa création littéraire, mais aussi sur sa vie privée, notamment ses amours, son existence volcanique et démesurée, pleins de dangers et de défis. Sa comédie humaine, entre l’humanité et l’animalité, inspirée d’immenses lectures, une curiosité étonnante, et des rencontres riches, avait pour ambition de nous éclairer sur la société de son temps. «Les grands événements de ma vie sont dans mes œuvres», dit-il. En effet, dans sa comédie humaine dense et innovante, BALZAC voulait faire une description fidèle de son temps, un conflit entre la Restauration et la Monarchie de Juillet. Sociologue et psychologue, ses personnages reflètent, leur origine ou les mœurs de sa position sociale. Tacticien, stratégiste et homme de génie, extravagant, orgueilleux, mais dénué de vanité, il a tiré son inspiration littéraire de tous les lieux de la société qu’il fréquentait, ceux de la presse, des éditeurs, des salons ou même certaines maisons peu recommandables, avec une puissance d’institution, pour en extirper des personnages riches et multiples. «C’est un créateur d’être vivants, puissamment vivants comme Homère. Il a produit une immense impression sur les hommes et acquis une gloire inaccessible aux coups du temps. Balzac regardait toutes les choses et tous les gens avec des yeux frais et c’est une chose fort rare», écrit Emile FAGUET.
Son ambition littéraire est affichée, dès le plus jeune âge : se hisser au même rang que les grands, par la littérature, dans une peinture du XIXe siècle, un conflit entre la Révolution et l’Empire . «En somme, voici le jeu que je joue, quatre hommes auront eu une vie immense : Napoléon, Cuvier O’Connell et je vais être le quatrième. Le premier a vécu la vie de l’Europe; il s’est inoculé des armées ! Le second a épousé le globe ! Le troisième s’est incarné dans un peuple ! Moi, j’aurai porté une société tout entière dans ma tête», dit BALZAC. L’auteur aura eu ses années de triomphe, de 1830 à 1840, mais aussi de descente dans les abîmes, de 1841 à 1850. Son obstination à réussir dans la vie, n’a d’égale que son infatigable et prodigieuse force de travail. «Ceux qui furent dans le secret de son existence se demandent avec autant d'attendrissement que de respect comment un homme trouva assez de temps, de forces physiques et surtout de forces morales pour suffire à d'aussi grands labeurs», écrit Laure SURVILLE, née BALZAC (1800-1871), sa sœur et biographe.
BALZAC est d’un physique disgracieux, ses adversaires s’en délectent. «Un gros homme. Haut en couleur. Les cheveux noirs crin de cheval. De petits yeux, mais très vifs, yeux d’éléphant, yeux de sanglier, yeux de tout ce que vous voudrez, mais le même avait trois mentons, et, sans mentir, l’air d’un fort marchand de porcs au marché de Sceaux», écrit Léon GOZLAN (1803-1866). En fait, imaginatif, réaliste, malicieux, parfois fantaisiste, d’une verve rabelaisienne, une grosse gaieté, une sonore bonhommie, BALZAC est surtout visionnaire dans son matérialisme génétique et esthétique. Il s’est attaché à rénover profondément l’art de composer ses romans, avec une grande curiosité intellectuelle, afin de mieux cerner les mœurs de son temps, en termes de vie privée, de province, parisienne, militaire et politique. BALZAC, comme Stendhal ou Prosper MERIMEE, «comprirent et dépensèrent la vie différemment ; ils n’ont point vécu pour une foule, ni pour un groupe, mais pour le libre développement de leur imagination, de leur sensibilité, de leur intelligence», écrit, en 1902, Ralph HUGHES. Ses personnages composites envahis, par la passion, le vice et une ambition dévorante, aiment et meurent, dans un fracas d’une mise en scène littéraire bien composée. «Le génie a de cela de beau qu’il ressemble à tout le monde, et que personne ne lui ressemble», écrit-il dans «le curé de village». Comme le duc SAINT-SIMON, en mémorialiste, BALZAC est attaché à la recherche de la Vérité politique, sociale ou religieuse. «On ne lit guère Balzac ; en revanche, on l’a jamais tant étudié. Ce qui fait croire qu’il en est des œuvres littéraires comme des créatures humaines : Quand on les dissèque, c’est qu’elles sont mortes. Pourtant l’intérêt qui s’attache à cette formidable création, qu’est la Comédie humaine, n’est point près de diminuer, car les plus belles scènes qui les composent se reculent dans les ombres du passé, plus elle prend son véritable caractère colossal et grandiose de peintures et de descriptions vivantes», écrit, en 1911, Georges THOUVENIN.
Honoré de BALZAC est né à Tours, le 16 mai 1799, jour de Saint-Honoré, d’une ancienne famille paysanne du Tarn, les Balssa, appartenant désormais à une famille noble de France. «Je ne suis pas gentilhomme, dans l’acception historique et nobiliaire du mot, si profondément significative pour les familles de la race conquérante; mais je le dis en opposant orgueil contre orgueil ; car mon père se glorifiait d’être de la race conquise, d’une famille qui avait résisté en Auvergne à l’invasion, et d’où sont sortis les d’Entragues», dit BALZAC. Son père, Bernard-François de BALZAC (1746-1829), né à La Nougaïrié, dans le Tarn, est d’abord avocat au conseil de Louis XVI (1754-1793), puis secrétaire au Conseil du roi et directeur des vivres. Mais la Révolution vint et renversa la fortune et les espérances de celui-ci. Son père, un homme prévoyant, marié tard, grand observateur des choses et plein de réparties, est un admirateur de François RABELAIS et de Michel MONTAIGNE. Sa mère est Anne Charlotte Laure SALAMBIER (1778-1854), belle et riche, pleine d’esprit et d’imagination, épousée en 1797, à Paris, est la fille d’un chef de son père. Le «Lys dans la vallée» concerne une partie de l’enfance de BALZAC en Touraine, son père étant muté à Tours de 1804 à 1812. «Ceux qui ont connu mon père et ma mère attesteront la fidélité de ces esquisses. Les qualités de l'auteur de la comédie humaine sont certainen1ent la conséquence logique de celles de ses parents; il avait l'originalité, la mémoire, l'esprit d'observation et le jugement de son père, l’imagination et l’activité de sa mère, de tous les deux, enfin, l'énergie et la bonté», écrit Laure SURVILLE. En 1804, sa mère l’amène à Paris, à l’âge de cinq ans, visiter ses grands-parents. «C’est le plus grand évènement de son enfance. Ce séjour à Paris servit longtemps d'aliment à son imagination.», dit Laure SURVILLE.
Délaissé par sa mère qui lui préfère son fils naturel Henri, en 1806, il passa d’un externat de Tours, au collège oratorien de Vendôme, où il se distingua par une insubordination et une paresse, lui ayant valu d’énergiques répressions de ses maîtres. «Nous allions régulièrement le voir chaque année à Pâques et à la distribution des prix; mais fort peu couronné aux concours, il recevait plus de reproches que de louanges», écrit Laure SURVILLE. En effet, BALZAC ne s’intéressait qu’à la poésie, mais de mauvais goût. Il avait aussi écrit un «traité de la volonté», que son enseignant brûla sans le lire. À la suite d’abondantes et boulimiques lectures, d’une bonne partie de la bibliothèque de son collège de Vendôme, devenu maigre et chétif, atteint d’une curieuse maladie cérébrale, il revient donc à Tours, comme externe, avec des enseignants à domicile. «Le classement des idées se fit peu à peu dans sa vaste mémoire, où il enregistrait déjà les événements et les êtres qui s'agitaient autour de lui; ces souvenirs servirent, plus tard, à ses merveilleuses peintures de la Vie de province», écrit Laure SURVILLE. À partir de 1814, il fait des études de droit à la Sorbonne, et s'installe à Paris, et loge, rue de Thorigny, dans le Marais, chez son père muté à la Direction des vivres de la première division militaire. Son père le fait admettre comme clerc chez un notaire d’abord chez maître SCRIBE, puis chez PASSEZ. Cependant, BALZAC rêvait d’une gloire littéraire, la pression de son père ne faiblit que lorsque celui-ci est mis subitement à la retraite, avec une perte de revenu. Aussi, la description des études de notaires, comme celle du monde de la science juridique, dans la Comédie humaine, c’est du vécu. Sa mère s’installe dans une mansarde à la bibliothèque de l’Arsenal, à Paris.
BALZAC rencontre Laure de BERNY (1777-1836) de vingt-deux ans son aînée, qui aura une influence décisive sur sa formation. «Les œuvres d'esprit n'ont pas l'esprit seul pour père. L'homme entier contribue à les produire ; son caractère , son éducation et sa vie , son passé et son présent, ses passions et ses facultés, ses vertus et ses vices , toutes les parties de son âme et de son action laissent leur trace dans ce qu'il pense et dans ce qu'il écrit. Pour comprendre et juger Balzac, il faut connaître son humeur et sa vie» écrit Hippolyte TAINE, historien et critique littéraire. Le jeune Honoré écrit dans les petits journaux et ambitionne de devenir journaliste, et écrit notamment pour la Revue de Paris, la Revue des Deux-Mondes ou Babel. À cette époque, le roman était plutôt une opération commerciale qu’une œuvre littéraire ; alors il n‘y avait que les portiers et les grisettes qui lisaient ce tissu d’impossibilités et d’invraisemblances. S’usant à la besogne et gagnant mal sa vie, des travaux pénibles peu rentables, il s’allia, entre 1826 et 1828, avec l’imprimeur BARBIER pour devenir typographe. Il crée une société de fonderie qui fera faillite. «Je voulais payer une dette immense pour moi, nous dit-il, et vivre honorable ment. Je voulais arriver à ce grand résultat avec une plume d’oie, une bouteille d’encre et quelques mains de papier, dans une ville où la littérature n’a point de crédit, où il faut non seulement du talent, mais du bonheur, et encore travailler nuit et jour pour gagner six mille francs par an; moi, qui devais huit mille francs d’intérêts annuels pour les capitaux dus! N'était-ce pas folie ?», dit-il. Aussi, BALZAC retourne à la vie littéraire, pour payer ses dettes ne cessant de s’accroître. Il fallait amuser, fléchir, séduire, fasciner ou se cacher de ses créanciers, une vie précaire et pleine de craintes. L’argent étant le persécuteur et le tyran de sa vie, BALZAC, devant les difficultés, harcelé, accablé, ne renonce jamais «La résignation est un suicide quotidien», écrit-il dans les «Illusions perdues».
Plusieurs thèmes traversent la contribution littéraire de BALZAC, riche, intemporelle, ambitieuse, intimidante et colossale, avec un savoir-faire commercial : le désir, l’ambition ou l’arrivisme, le fanatisme, le patriotisme, la cupidité, l’amour, les passions contrariées, la jalousie, la haine, l’avarice, une quête de vérité, etc. BALZAC, qui a publié, en 1829, «les Chouans», a écrit, en quantité industrielle, plus de 97 livres entre 1827 et 1848, dans sa comédie humaine, une vaste fresque sociétale du XIXe siècle, chaque personnage, chaque intrigue révèle les luttes, les passions et les ambitions d’une époque en pleine mutation. Il explore le réalisme, mettant en lumière les rouages de la vie quotidienne, trace des portraits saisissants, capture la complexité humaine. «J'ose dire qu'ici Balzac est monté au niveau de Shakespeare. Ses personnages vivent ; ils sont entrés dans la conversation familière ; Nucingen, Rastignac, Philippe Bridau, Phellion, Bixiou et cent autres sont des hommes qu'on a vus. S'il est si fort, c'est qu'il est systématique ; ceci est un second trait qui complète le savant; le philosophe en lui s'ajoute à l'observateur. Il voit avec les détails les lois qui les enchaînent», écrit Hippolyte TAINE. Le romancier s’investit en miroir d’un pays partagé entre tradition et modernité. Dans «peau de chagrin» et «les Chouans», c’est la société France en quête d’identité. Il décrit, avec une grande justesse, les grandes inégalités sociales, la lutte des classes, avec une bourgeoisie montante, avec les aspirations contrariées. Dans «Eugénie Grandet», la ladrerie du père est un signe des normes sociales de son temps. Dans ses romans, comme la «cousine Bette», la femme à la victime, mais aspire aussi à prendre le pouvoir ; elle est à la fois ambitieuse et tragique, écrasée par le poids d’une société encore rigide. Le temps et la mortalité sont traités dans son roman philosophique, «Peau de chagrin».
I – BALZAC et son roman, «le Père Goriot»
À la maison Vauquer, dans le Quartier latin, qu’il situe dans les Mouffetard, à l’église Saint-Médard, Vautrin et un vieillard, le père Goriot, étant les principaux personnages. Victorine Taillefer, une orpheline, et Eugène de Rastignac, un étudiant, sont ceux qui sortent du lot. C'est Rastignac qui perce le mystère du père Goriot grâce à sa cousine, la vicomtesse de Beauséant, qui l'initie aux mystères du grand monde. Goriot s'est ruiné pour ses filles, Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen. Mais celles-ci le tiennent à l'écart : elles ont honte de leur père, enrichi sous la Révolution dans la fabrication des pâtes alimentaires. En effet, Vautrin c’est l’incarnation de la révolte, et révèle les autres à eux-mêmes. Pour lui, la société est gangrénée, l’État, comme les familles ou les individus. Vautrin révèle cyniquement à Rastignac les rouages de la société et les moyens de parvenir. Il veut faire sa fortune et le pousse à épouser Mlle de Taillefer, dont il s'arrange pour faire tuer le frère en duel afin de lui rendre la disposition d'un riche héritage. Rastignac refuse de le suivre ; il s'engage dans une relation amoureuse avec Delphine. Au moment où il croyait pouvoir quitter la pension, Goriot est frappé à mort en apprenant brutalement la situation familiale et financière désastreuse de ses filles, qui lui réclament son aide sans ménagement.
BALZAC étant un provincial à Paris, il est un peu de Rastignac, un jeune ambitieux, viril, la réussite, l’argent étant les seules valeurs sûres de cette bourgeoisie montante.
Aussi, son «Père Goriot» est avant tout un roman d’apprentissage, Rastignac s'initiant aux réalités de la vie sociale parisienne, et au monde des femmes et des sentiments, mais il est comme le personnage de Julien Sorel dans le Rouge et le Noir de Stendhal, c’est un piètre amoureux. Esprit mobile, Rastignac est constamment en évolution, dans ses calculs, mais aussi dans ses transformations. Paris corrompt irrémédiablement tous les esprits purs qui s'en approchent. Son éducation s'achève après son dernier bal chez sa cousine.
Le «Père Goriot» est aussi un roman de mœurs, dans lequel le héros découvre aussi bien les beaux quartiers, les Faubourgs de Saint-Germain, que le côté obscur de Paris. BALZAC est un écrivain réaliste ; ce n’est pas en une simple reproduction photographique du monde. L’auteur, dans sa peinture de la capitale, témoigne d’une vision et d’un souffle poétique.
Finalement, «le Père Goriot», est un retentissant chant d'amour, paternel du héros à ses filles. «Père et martyr, martyr parce que père, Goriot brille au firmament des figures mythiques comme l'incarnation du dévouement superlatif, de la dépossession absolue», écrit Philippe BERTHIER, dans la préface de l’édition 2006 chez Flammarion. «L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas», dit Jacques LACAN. Ce roman, une comédie humaine, est aussi une peinture satirique du XIXe siècle corrompu par l'argent, un monde de paradoxes, naviguant entre la richesse des uns, et leur entourage, l’artifice, l’égoïsme et le dénuement des autres, une société plombée par la haine et le mensonge. «Ta vie, ton bonheur seraient attachés à paraître ce que tu n'es pas, à voir un monde où tu ne saurais aller sans faire de dépenses d'argent que tu ne peux soutenir, sans perdre un précieux pour tes études ?», écrit-il.
II – BALZAC et son roman, «Les illusions perdues»
Ce roman décrit la vie de Lucien Chardon, jeune écrivain provincial, fils d’un pharmacien d’Angoulême, sa mère, née Rubempré, se laisse emmener à Paris, où la grande dame l'abandonne bientôt à lui-même, pour rentrer dans son monde. Le jeune ambitieux a de l'esprit, du talent, des avantages physiques, mais ni principes solides ni volonté fixe. Il se lie avec ce qu'il y a de meilleur dans la jeunesse ; des jeunes gens travailleurs probes, désintéressés, sincèrement royalistes comme d'Arthez ou sincèrement républicains comme Michel, Chrestien, dont nous apprendrons plus tard qu'il a été tué sur une barricade. Mais ces jeunes gens représentent la vie pauvre, la conscience, l'obscurité et la marche continuellement ralentie vers le succès. Lucien de Rubempré les admire en rongeant son frein. Il va connaitre la vie parisienne onéreuse, le snobisme de la haute société. Il va également rencontrer un succès illusoire en se lançant dans le journalisme. «L'avarice commence où la pauvreté cesse», dit BALZAC.
Ce roman sur le thème du désenchantement a été déjà traité par d’autres auteurs, comme Alfred de MUSSET, Sainte-Beuve ou Théophile GAUTIER. Mais nul ne l’a fait de façon plus vaste et plus profonde que BALZAC, nul mieux que lui n’a cherché à représenter, dans une suite romanesque de grande ampleur qu’il qualifiait lui-même «d’œuvre capitale dans l’œuvre», le drame d’une génération tout entière, «la mêlée des passions et des intérêts, des souffrances et des rêves, des désirs et des pouvoirs dans la société française des premières années de la Restauration, réfractée à travers la destinée exemplaire de deux poètes de province, voués de façon différente, mais également désastreuse à l’échec de leurs ambitions et à la perte de leurs illusions», écrit dans la préface de chez Gallimard, Jacques NOIRAY.
Dans ces illusions perdues, c'est «la lutte des intérêts, des ambitions qui se heurtent et s'entre-dévorent; c'est le progrès et les ravages de l'esprit individualiste dans le monde issu de la Révolution ; c'est le triomphe du tiers état, le règne dos parvenus dont il peint les lourdes allures et les furieux appétits; c'est la tragédie bourgeoise cachée dans le salon ou l'arrière-boutique et dont l'argent est le grand ressort; c'est la puissance croissante et chaque jour plus dégradante de l'argent», écrit André Le BRETON. Honoré de BALZAC, s’il enlaidit l’image de la vertu, toujours il enseigne qu'ici-bas le métier d’honnête personne est un métier de dupe. Les forts sont pressés de s’enrichir davantage, peu importe les moyens employés.
En particulier, les «Illusions perdues» sont une attaque frontale de la presse, «cette religion des sociétés modernes», appelée à devenir aux mains des financiers un terrible instrument de domination, et la prend, à l'origine de sa puissance, sous la Restauration où, par ses railleries, ses perfidies, elle s'est évertuée à affaiblir le prestige des Bourbons et à préparer la victoire de la bourgeoisie, qui d'ailleurs l'en a récompensée en lui maintenant les chaînes sous lesquelles elle avait mené sa fronde. Le journalisme, qui l'enlève à ses amis, la lui promet. Il lui montre un gouvernement qui a peur de ce qu'on écrit dans des petites feuilles ; les gens du monde tremblant d'y voir des allusions à leurs scandales ; les auteurs dont le succès dépend de son bon plaisir. Lucien n’était pas de force à résister. Ses premiers articles éveillent l'attention. On le flatte, on le jalouse, on le craint ; il se croit arrivé. Mais sa confiance en lui, son impertinence, ses maladresses, son entraînement aux plaisirs, peut-être aussi quelque reste d 'honnêteté provinciale qui, sans l'empêcher de descendre à de basses compromissions, ne lui permet pas assez d'envergure, le font trébucher dans ses succès. Le terrain, sur lequel il s'avançait d 'un pas allègre et triomphal, s'affaisse et le quitte au milieu d'un marécage où il s'enlise. Ils ont tous de l'esprit à vendre et à revendre : ils le vendent et le revendent. Les dernières pages du roman nous le peignent la nuit, au lit de mort de sa maîtresse Coralie, une comédienne de dix-neuf ans, obligé, pour payer les frais d 'enterrement, de composer une chanson égrillarde qu’il vendra le lendemain matin.
En raison du sang enflammé par le travail des nuits et l'abus du café, Honoré de BALZAC, souffrant d’hypertrophie du cœur, était allé se marier en Russie, le 14 mars 1850, avec Mme Ewelina HANSKA (1804-1882), son admiratrice, mécène et compagne de longue date. Il a tenu à revenir mourir en France, et disparaît le 18 août 1850, à Paris. BALZAC n’avait que cinquante et un ans ; il est mort dans toute la vigueur et toute la sève de son talent qui vit désormais parmi nous. «Balzac était un des premiers parmi les plus grands, un des plus hauts parmi les meilleurs. Ce n'est pas le lieu de dire ici tout ce qu'était cette splendide et souveraine intelligence. Tous ses livres ne forment qu'un livre, livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine. L'auteur de cette œuvre immense et étrange est de la forte race des écrivains révolutionnaires. Balzac va droit au but. Il saisit corps à corps la société moderne. Il arrache à tous quelque chose, aux uns l'illusion, aux autres l'espérance, à ceux-ci un cri, à ceux-là un masque. Il fouille le vice, il dissèque la passion. Il creuse et sonde l'homme, l'âme, le cœur, les entrailles, le cerveau, l'abîme que chacun a en soi. Sa vie a été courte, mais pleine ; plus remplie d'œuvres que de jours. Il sort des contestations et des haines. Il entre, le même jour, dans la gloire et dans le tombeau. Il va briller désormais, au-dessus de toutes ces nuées qui sont sur nos têtes, parmi les étoiles de la patrie !» dit le 29 août 1850, Victor HUGO.
En définitive, dans son imagination créatrice et sa vision créatrice, son réalisme, sa cosmogonie, ses allégories, sa morale et sa métaphysique de ses récits, Honoré BALZAC décrit, avec minutie et souci de détail, chaque objet, chaque meuble, chaque élément du décor, surprenant et saisissant, avec tous ses matériels, le spectacle interdit de la vie privée, pour le dévoiler par un acte érudit et philosophique, la comédie humaine, «un miroir concentrique de l’univers», entre le visible et l’invisible, comme il le dit dans «Peau de chagrin». Son imagination prolifique et débordante reconstitue le monde ; elle est dans l’authenticité et le vrai.
La comédie humaine a suscité presque tant d’attaques que d’admirations. «Je ne sais si, à aucune époque, il y a eu en France un peintre des moeurs qui n'ait pas été accusé de faire scandale, et quelle littérature sortirait des principes sévères qu'on veut imposer aux écrivains. Je n'ai ni le pouvoir la volonté d'appeler de ces arrêts, et je ne prétends pas ici défendre mon frère. Le temps, qui a consacré tant de génies contestés ou insultés à leur époque, lui assignera sa place dans la littérature française. Rapportons-nous-en à ce juge, le seul qui soit impartial et infaillible», écrit Laure SURVILLE. Bas du formulaire
Références bibliographiques
A – Contributions d’Honoré de Balzac
BALZAC (Honoré), Eugénie Grandet, édition de Jacques Noiray Paris, 2021, 384 pages ;
BALZAC (Honoré), Illusions perdues, Paris, Librofilio, 2022, 320 pages ;
BALZAC (Honoré), La cousine Bette, éditeur scientifique Roger Pierrot, Paris, Le livre de poche, 1975, 540 pages ;
BALZAC (Honoré), La Duchesse de Langeais, éditeur scientifique Constance Cagnat-Deboeuf, Paris, Le livre de poche, 1998, 248 pages ;
BALZAC (Honoré), La peau de chagrin, dossier d’Isabelle Mimouni, Paris, Gallimard, 2022, 400 pages ;
BALZAC (Honoré), La recherche de l’absolu, éditeur scientifique Eric Bordas, Paris, Le livre de poche, 1999, 383 pages ;
BALZAC (Honoré), Le colonel Chabert, Paris, J’ai Lu, 2007, 95 pages ;
BALZAC (Honoré), Le curé du village, éditrice scientifique Nicole Mozet, Paris, Gallimard, 1975, 377 pages ;
BALZAC (Honoré), Le Lys dans la vallée, préface de Paul Morand, éditrice scientifique Anne-Marie Meininger, Paris, Gallimard, 2004, 448 pages ;
BALZAC (Honoré), Le père Goriot, édition d’Isabelle Mimouni, Paris, Gallimard, 2025, 496 pages ;
BALZAC (Honoré), Les Chouans, préface de Pierre Gascar, éditeur scientifique Roger Pierrot, Paris, Gallimard, 2004, 512 pages ;
BALZAC (Honoré), Splendeurs et misères des courtisanes, éditeur scientifique Pierre Berbéris, Paris, Gallimard, 1973, 694 pages.
B – Critiques et biographies
ALAIN, En lisant Balzac, Paris, Laboratoires Martinet, 1935, 183 pages ;
BARBERIS (Pierre), «La pensée de Balzac : histoire et structure», Revue d’histoire littéraire de la France, janvier, mars 1967, n°1, pages 18-54 ;
BARON (Anne-Marie), «Curiosité et imagination chez Balzac et Baudelaire, fondements balzacien d’une métaphysique des choses et des moeurs», L’année balzacienne, 2017, Vol 1, n°17, pages 297-310 ;
BASCHET (Armand), Les physionomies de ce temps littéraire de ce temps. Honoré de Balzac : Essai sur l’homme et sur l’œuvre, notes historiques de Champfleury, Paris, D Gireaud et J. Dagneau, 1852, 248 pages ;
BEGUIN (Albert), Balzac lu et relu, préface de Gaétan Picon, Paris, Seuil, 1965, 280 pages ;
BELLESSORT (André), Balzac et son œuvre, Paris, Perrin, 1936, 10e édition, 373 pages ;
BIRE de (Edmond), Étude critique sur la littérature contemporaine, Paris, Calmann-Lévy, 1886, tome IV, 376 pages ;
CHANCEL de (Camille), «Genèse de la comédie humaine», La Nouvelle revue de Paris, 15 juin 1854, tome III, pages 453-479 ;
DENOIRESTERRES (Gustave), «M. Honoré de Balzac», Psyché, 15 octobre 1850 n°4, pages 5-10 ;
FAGUET (Emile), Balzac, Paris, Hachette, 1913, 201 pages ;
FELICIEN (Marceau), Balzac et son monde, Paris, Gallimard, 1955, 544 pages ;
FERRY (Gabriel), Balzac et les femmes, Paris, Calmann-Lévy,1888, 281 pages ;
FLAT (Paul), Essai sur Balzac, Paris, Plon Nourrit, 1893, 323 pages ;
GAUTIER (Théophile), Honoré de Balzac, Paris, E. Hédouin, 1859, 177 pages ;
GAUTIER (Théophile), Honoré de Balzac, sa vie et ses œuvres. Biographie. Analyse critique de la Comédie humaine, Bruxelles, Meline Cans, 1858, 96 pages ;
GENGEMBRE (Gérard), Balzac, le forçat des lettres, Paris, Perrin, 2013, 396 pages ;
GUGLIELMETTI (Agnès), Feu et lumière dans la peau de chagrin de Balzac, Paris, Lettres modernes, 1978, 132 pages ;
GUYON (Bernard), «Balzac et le mystère de la création littéraire», Revue d’histoire littéraire de la France, 1950,, n°2, pages 168-191 ;
HANOTEAUX (Gabriel) VICAIRE (Georges), La jeunesse de Balzac ; Balzac imprimeur 1825-1828, Paris, 1902, 263 pages ;
LAMARTINE (Alphonse), Balzac et ses œuvres, Paris, Michel Lévy, 1866, 316 pages ;
LE BRETON (André), Balzac, l’homme et l’œuvre, Paris, Armand Colin, 1905, 293 pages ;
LEMER (Julien), Balzac, sa vie, son œuvre, Paris, L. Sauvaitre, 1892, 48 pages ;
LICHTLE (Michel), «Balzac, une référence pour le XXe siècle», L’année Balzacienne, 2015, Vol 1, n°16, pages 41-46 ;
MAUROIS (André), Prométhée ou la vie de Balzac, Paris, Robert Laffont, 1993, 592 pages ;
PARRAN (A.), Honoré de Balzac, Paris, P. Rouquette, 1881, 50 pages ;
RAMON (Fernandez), Balzac ou l’envers de la création littéraire, Paris, Grasset, 1980, 284 pages ;
REBELL (Hugues), Les inspiratrice de Balzac, Stendhal et Mérimée, Paris, 1902, 260 pages, spéc sur Balzac, pages 1-44 ;
SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin), Causeries du lundi, Paris, Garnier, 1868, tome 2, 568 pages, spéc sur Balzac pages 443-463 ;
SCHERER (Edmond), Étude sur la littérature contemporaine, Paris, Calmann-Lévy, 1886, Vol 4, 375 pages, spéc Balzac, pages 63-74 ;
Société littéraire de la France, Avec Balzac pour le centenaire de la mort : 1850-1950, Paris, Armand Colin, 1950, 256 pages ;
SPOELBERCH de LOVENJOUL (Charles, vicomte), Autour d’Honoré de Balzac, Paris, Calmann-Lévy, 1867, 294 pages ;
SPOELBERCH de LOVENJOUL (Charles, vicomte), Histoire des œuvres de Balzac, Paris, Calmann-Lévy, 1879, 408 pages ;
SPOELBERCH de LOVENJOUL (Charles, vicomte), La genèse d’un roman de Balzac. Les paysans, Paris, Société des éditions littéraires et artistiques, 1901, 324 pages ;
SURVILLE née BALZAC (Laure), Balzac, sa vie et ses œuvres, d’après sa correspondance, préface de Florent Batard et Tarik Hamidouche, Paris, Librairie nouvelle, 1858, 210 pages ;
TAINE (Hippolyte), Nouveaux essais de critique et d’histoire, Paris, Hachette, 1865, 396 pages, spéc chapitre 5, Balzac pages 63-170 ;
THOUVENIN (Georges), «La genèse d’un roman de Balzac «La recherche de l’absolu», Revue d’histoire littéraire de la France, 1911, n°4, pages 865-884 ;
VACHON (Stéphane), «Balzac, entre 1856 et 1858», Études françaises, 2007, Vol 43, n°2, pages 13-29 ;
ZWEIG (Stefan), Balzac, le roman de sa vie, traduction de Fernand Delmas, Paris, Le livre de poche, 1996, 506 pages.
Paris, le 10 mai 2025 par Amadou Bal BA



