
Agrandissement : Illustration 1


Agrandissement : Illustration 2


Agrandissement : Illustration 3
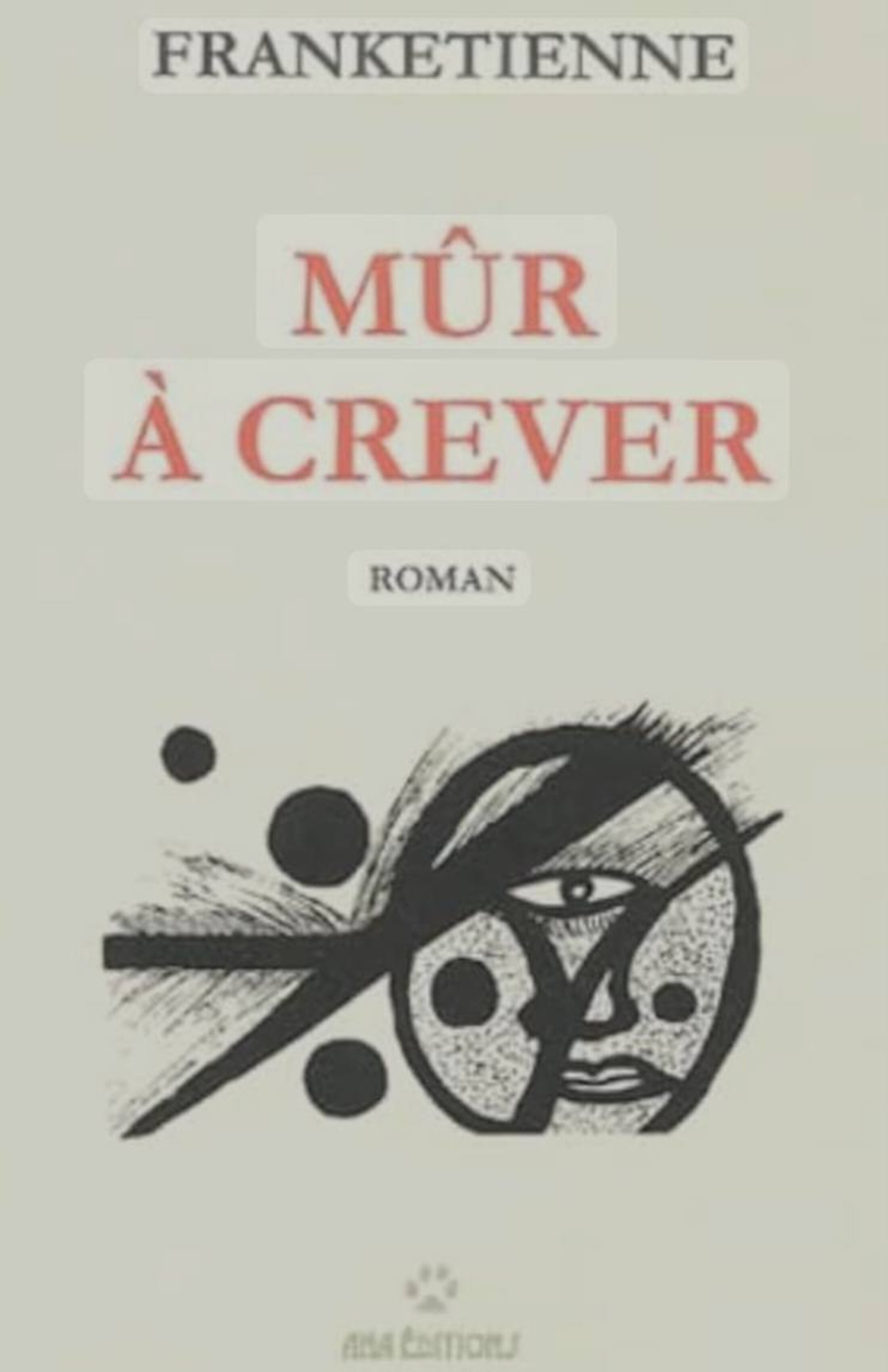
«Frankétienne (1936-2025), écrivain haïtien, ancré dans l’histoire de son pays. Un théoricien de la Spirale, un art complet. In Memoriam», Amadou Bal BA
Haïti, ce n’est pas seulement que les dictatures, les bandes mafieuses et les catastrophes naturelles, c’est aussi, et surtout, un pays à grande concentration de forces intellectuelles et artistiques (Jacques ROUMAIN, René DEPESTRE, Dany LAFERRIERE). Par ailleurs, Haïti a été le premier pays noir, indépendant depuis le 1er janvier 1804 ; c’est la patrie de TOUSSAINT-LOUVERTURE (1743-1803), le libérateur de l’esclavage, mort en exil en France (Voir mon article, Médiapart, 9 mai 2021). Ces désastres politiques ou climatiques sont fortement présents dans la contribution littéraire et artistique de Frankétienne, symbolisant l’âme de son peuple. Frankétienne est resté attaché à l’identité haïtienne, à la liberté d’expression et à la justice sociale. «Frankétienne était bien plus qu’un artiste : il était une force vivante, un phare pour Haïti et pour l’humanité. Avec sa plume incisive, sa voix captivante et son regard visionnaire, il s’est imposé comme un mapou géant, un pilier inébranlable de l’art et de la pensée haïtienne» a écrit dans un communiqué, Evans PAUL, un ancien premier ministre. En effet, en raison de son insoumission aux forces du Chaos, il disait «je ne reconnais plus ma terre, jadis rebelle, aujourd'hui travestie, soumise à la servitude des ombres, endormie dans la moelleuse routine insubversive».
Jean-Pierre Basilic Dantor Franck ÉTIENNE, alias Frankétienne, un «Mapou», un arbre sacré, de la littérature, de la langue et de la culture haïtienne, nous a quittés le jeudi 20 février 2025, à Delmas. «Ma grand-mère, Anne Etienne, et ma mère, Annette Étienne, se sont mises d’accord pour m’octroyer un chapelet de noms vaillants, à résonance mystique et baroque, susceptibles de protéger le «petit blanc» contre les méfaits et les maléfices d’éventuels sorciers», dit-il en 2023, à l’UNESCO. Franck est né le 12 avril 1936 dans une section rurale, à Ravine-Sèche de la commune de Saint-Marc, département de l'Artibonite en Haïti, où le culte du Vaudou est largement dominant. Sa mère, Anette ETIENNE, est une paysanne haïtienne et d’un père blanc à la suite «du viol d’une paysanne haïtienne de treize ans par un industriel américain», dit-il. L’enfant naît chabin, il est blanc de peau et «noir» de morphologie. Et il a les yeux bleus. «Je suis un bélier rebelle, opiniâtre et têtu. Marginal irrécupérable. Éternel insoumis. Je naquis en ce dimanche de Pâques dans la rumeur babélienne et chaotique d’un rara explosif. Initié dès ma naissance aux brûlures rougeoyantes du zinglin, j’allais devenir beaucoup plus tard un artiste écrivain zinglindor, massacrant allégrement les formes, les couleurs, la syntaxe et les normes esthétiques traditionnelles. Dérangeur infatigable, saccageant les remparts derrière lesquels sommeillent les mazorats, les impuissants, les paresseux et les débiles, j’apporte le scandale pour secouer les dormeurs, réveiller les inconscients et faire chier de rage diarrhéique les hypocrites et les jaloux. Joyeusement, je voyage à l’intérieur d’un labyrinthe, lieu privilégié des catastrophes lumineuses», écrit-il, en 2004, dans son «Autoportrait». Frankétienne a grandi dans le bidonville de Bel-Air à Port-au-Prince, dans un environnement créolophone, mais aussi avec la langue française.
Vivant sa différence, non pas comme un handicap, mais un atout, très intelligent, Franck ETIENNE a choisi de se distinguer par les études, pour son ascension sociale. «Je crois que nous sommes tous interconnectés avec l’univers, que nous avons d’immenses potentialités avec l’univers qui n’ont jamais été exploitées, parce que nous avons été empoisonnés par une rationalité à outrance qui a tué l’intuition, atrophié l’imaginaire», dit-il. Après avoir renoncé aux études de médecine, diplômé de l’Institut des Hautes Études internationales, il poursuivit une carrière d’enseignant puis de directeur d’école, et dans les années 1970, il fonda le Collège Franck Étienne, illustrant ainsi son engagement pour l’éducation. En 1962, au début de l’ère du président François DUVALIER dit Papa-Doc (1907-1971), un grand bouillonnement intellectuel et politique, il fréquente le groupe «Haïti littéraire», un atelier de recherches faisant résonner le créole avec le français. En raison de la forte dégradation de la situation politique, si bon nombre d’intellectuels sont partis en exil, Franck ETIENNE a choisi la résistance intérieure, pour écrire, pour lutter. «Les mots sont des pistolets chargés», dit Jean-Paul SARTRE (Voir mon article, Médiapart, 14 février 2023). «Je suis un survivant de la misère, des Duvalier, de l'alcool» dit-il à Delphine PERAS de l’Express.
Fondateur du spiralisme, un mouvement littéraire chaotique et pluraliste, poète, romancier, dramaturge, comédien, peintre, chanteur, musicien, peintre, Frankétienne est un artiste prolifique «Pluridimensionnel, j’ai enseigné la Littérature haïtienne, la Littérature Française, les Sciences Sociales, la Physique, les mathématiques et la philosophie. Cela m’a permis de constater que nous vivons dans un Univers d’Énergie Mystérieuse et que tous les éléments de cet étrange UNIVERS sont interconnectés en permanence. L’UNIVERS est holistique, tout en étant marqué par la diversité, l’unité, la symbiose, la synergie, la polyphonie, l’infinitude et paradoxalement aussi par le fragile, le vulnérable et l’éphémère» dit-il à Agnès BARDON. Il est un artiste hors du commun, entre corps et esprit ; il n’écrit pas des romans, mais de la «spirale» et non du «spiralisme», une démarche pluridimensionnelle, entre écriture, peinture, musique, théâtre, arts visuels en tout genre. «Je devins, à l’âge de 17 ans, Franck Étienne tout simplement. Lorsque je fis mon entrée officielle dans le champ de la création artistique et littéraire, je devins Frankétienne d’un seul tenant. Bien plus tard, je découvris que «Frankétienne» résonnait étrangement comme «Frankenstein». Mystère insolite lié à la Spirale et à la nature dérangeante de mon œuvre» dit en 2023, à Agnès BARDON, de l’UNESCO. Le spiralisme, un mouvement littéraire et esthétique cherchant à exprimer la fécondité du chaos à travers une écriture qui conjugue invention verbale et transgression des règles classiques du récit, entend redonner sa place à l’invisible, par opposition aux matérialismes qui excluent la dimension spirituelle de l’existant. «L’idée de spirale en tant que forme d’expression de la pensée, c’est essentiellement le refus du linéaire pour une libre expansion de sa pensée au gré de l’imaginaire», écrit-il en juillet 2003, dans «Haïtiens aujourd’hui».
Autodidacte, prolixe, inventif, armé d’une grande ambition littéraire, jouissant d'une renommée mondiale, couronné de nombreux prix, un géant de la création artistique et littéraire de notre époque, il a fondé en 1968 avec René PHILOCTÈTE et Jean-Claude FIGNOLE «la Spirale», prônant l'art total. «J’avais 23 ans à l’époque. Depuis ma tendre enfance, j’ai toujours été attiré par la science, jusqu’à mes vingt ans, quand je devais enseigner plusieurs matières. J’ai surtout brillé dans le domaine des mathématiques et de la physique. Moi, je crois qu’Ulysse de Joyce, c’est une spirale, mais je ne peux pas demander à James Joyce d’appeler ça «spirale». Le monde n’a pas cessé de connaître, jusqu’à aujourd’hui, les ravages de cette folie de domination. Dans ce pays on a connu ses catastrophes les plus terribles. La mondialisation se fait sous les apparences d’un humanisme planétaire, les portes sont ouvertes, nous sommes devenus un village global. Ce n’est pas vrai. C’est une machine qui a la couleur, la peau d’un mouton, mais au fond c’est un tigre qui est en dessous, qui te dévore, qui prend ce qu’il y a chez toi. Eh bien, ce qui va nous permettre de nous libérer, c’est ce que j’appelle la solidarité à l’échelle de la planète avec toutes les victimes de la mondialisation», dit-il, en 2021, à Africultures.
Frankétienne utilise son art pour témoigner et lutter contre les injustices. Son grand roman, en 1975, «Dezafi», signifiant le défi, est devenu le premier roman moderne écrit en créole haïtien. «D’avoir vécu près d’un demi-siècle dans un milieu populaire créolophone à proximité de mes racines rurales, j’ai très tôt flairé et pénétré l’essence, les nuances et la profonde beauté de ma langue maternelle. À travers le dictionnaire Larousse, les ouvrages classiques et les romans narratifs, je me suis initié à l’apprentissage du français. Et j’ai d’abord produit mes premières œuvres littéraires en langue française. Il m’a fallu attendre l’année 1975 pour produire DÉZAFI qui a été le premier vrai roman de la langue créole en général, par son authenticité et sa modernité» dit-il à Agnès BARDON. «Dézafi» de Frankétienne, écrit en créole haïtien. Une couverture rouge. Une impression sans luxe sur gros papier. Un contact amical, presque chargé de terre. Dezafi est une allégorie de la situation haïtienne. Klodonis, le jeune homme que le méchant houngan Sintil résuit à l'état de zombi pour en faire son esclave, est la figure de l'Haïtien réduit à l'état de zombi sous la férule de l'état duvaliérien. Et la révolte qui met fin à la tyrannie de Sintil est l'image souhaitée de la révolution qui libérerait pareillement l'Haïtien. «Le mot «Dézafi» évoque une fête populaire où les combats de coqs tiennent une place centrale. Dans ce texte, Frankétiene évoque la lutte du peuple haïtien zombifié par la dictature, mais aussi sa propre lutte pour survivre en écrivain dans une langue dominée. Des mots créoles jaillis des profondeurs rurales (et d'un imaginaire rebelle) sont soudain mis au service, non de la langue postée dans d'offensives guérites, mais d'une fête langagière inouïe, d'une structuration tourbillonnante, déflagration monumentale que je pensais inconcevable dans une langue écrasée. La langue créole fissurant soudain sa gangue, et se dressant en œuvre d'art», dit-il dans «écrire en pays dominé», Patrick CHAMOISEAU. Pour écrire ce livre, son auteur s’était basé sur son expérience de vie sous la dictature brutale de François DUVALIER. «Militant communiste jusqu’à l’âge de 40 ans face à la dictature féroce des DUVALIER, les événements de l’Histoire haïtienne et mes expériences personnelles m’ont progressivement orienté vers la rupture avec le Parti Communiste et l’idéologie marxiste. Pourtant, je ne suis pas devenu un pratiquant religieux. Je suis Christique, par ma foi dans la mythologie exceptionnelle du Christ qui a su transcender humblement toutes les bêtises humaines pour accéder très tôt à la Sublime et Pathétique Nature Divine» dit-il à Agnès BARDON.
Sa contribution littéraire, enracinée dans les combats de son peuple, témoigne de ses souffrances, mais aussi de ses espoirs d’un monde meilleur. «Le rêve est incontestablement le premier des chemins qui conduisent à la liberté. Rêver, c’est déjà être libre», écrit-il. Frankétienne est notamment reconnu pour son importante œuvre poétique dont on peut citer les recueils au fil du temps (La Marche en 1964 ; mon côté gauche en 1965 ; Chevaux de l'avant-jour en 1965 et Œuf de lumière / Huevo de luz en 2000). Frankétienne était également connu pour des œuvres telles que «Au Fil du Temps», Ultravocal et Pèlin Tèt ainsi que pour ses peintures Désastre, qui représentent les victimes du tremblement de terre de 2010, et difficile émergence vers la lumière, qui évoque les victimes des ouragans. «Ses toiles sont une extension visuelle de son univers littéraire, où l'on retrouve la même énergie foisonnante qui rappelle ses textes denses et polysémiques», a écrit Le Centre d'art, une institution culturelle haïtienne.
«À travers ses écrits, il a illuminé le monde, porté l’âme d’Haïti et défié le silence. Que son verbe demeure, que son esprit souffle encore. Adieu, maître», a écrit le Premier ministre haïtien, Alix Didier FILS-AIME. En 1988, il fut brièvement ministre de la Culture, sous la présidence de Leslie François MANIGAT, et décoré de l’Ordre des arts et des lettres de la France. Frankétienne fut nommé artiste pour la paix de l’UNESCO, en 2010, en reconnaissance «de son apport à la littérature francophone, de son engagement pour la sauvegarde et la défense de la culture haïtienne et de sa contribution à la promotion des idéaux de l'Organisation». Il a reçu l’insigne de Commandeur des Arts et des Lettres en juin 2010. Il a obtenu entre autres, en 2002, le Prix Carbet de la Caraïbe pour Héros chimères ; en 2004, le Prix Pablo Neruda ; en 2005, le grand Prix insulaire d'Ouessant ; en 2006, le Prix Union latine de Littératures romanes et fut lauréat, la même année, de la Fondation du Prince CLAUS de Hollande, pour l’ensemble de son œuvre artistique, son usage poétique de la langue, son engagement en faveur des langues locales et sa contribution à la langue et à la culture régionales. «S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute», dit-il.
I – Contribution de Franketienne
Frankétienne, «Autoportrait», Le Nouvelliste, 24 janvier 2004 ;
Frankétienne, Au fil du temps, Port-au-Prince, Imprimerie des Antilles, 1964, 56 pages ;
Frankétienne, Cacophonie, Mémoires d’Encrier, 2011, 90 pages ;
Frankétienne, Chevaux de l’avant-jour, Port-au-Prince, Imprimerie Serge L. Gaston, 1967, 83 pages ;
Frankétienne, Dezafi, Vents d’Ailleurs, 2002, 304 pages ;
Frankétienne, Galaxie Chaos-Babel, Port-au-Prince, Spirales, 2006, 814 pages ;
Frankétienne, La Marche, Port-au-Prince, Editions Panorama, 1965, 71 pages ;
Frankétienne, La Marquise sort à cinq heures, Vents d’Ailleurs, 2017, 129 pages ;
Frankétienne, Les affres d’un défi, Vents d’Ailleurs, 2010, 219 pages ;
Frankétienne, Les échos de l’abîme, Vents d’Ailleurs, 2013, 185 pages ;
Frankétienne, Mon côté gauche, Port-au-Prince, Imprimerie Serge L. Gaston, 1965, 49 pages ;
Frankétienne, Mûr à crever, Genre total, Port-au-Prince, coll. «Spirale», Presses au Port-princiennes, 1968, 181 pages ;
Frankétienne, Rap Jazz, journal d’un paria, Mémoire d’Encrier, 2018, 138 pages ;
Frankétienne, SAINT-ELOI (Rodney), Anthologie secrète, Mémoire d’Encrier, 2001, 172 pages ;
Frankétienne, Sphinx en énigmes, Vents d’Ailleurs, 2009, 92 pages ;
Frankétienne, Spirale de la métamorphose de l’oiseau schizophone, Vents d’Ailleurs, 2006, 174 pages ;
Frankétienne, Traité de l’art du cuir, Vents d’Ailleurs, 2006, 216 pages ;
Frankétienne, Ultra-vocal Spirale, Port-au-Prince, Imprimerie Serge L. Gaston, 1972, 415 pages ;
Frankétienne, Vigie de verre, Port-au-Prince, Imprimerle Serge L. Gaston, 1965, 47 pages.
II – Critiques et biographies
ALLEN-PLAISANT (Jason) «Frankétienne, pour sauver le monde, il nous faut l’invisible», Africultures, 10 avril 2021 ;
ANTONIN (Arnold), réalisateur, «La traversée des mondes Frankétienne», 2014, durée 1h26minutes5secondes ;
BARDON (Agnès) «Frankétienne, la création est un Odyssée sans escale», UNESCO, 29 septembre 2023 ;
CHAMOISEAU (Patrick), Ecrire en pays dominé, Paris, Gallimard, 2002, 368 pages, spéc pages 92-93 ;
HADJADJ (Bernard), Frankétienne : l’universel haïtien, Riveneuve, 2012, 290 pages ;
JONASSAINT (Jean), «Frankétienne : écrivain haïtien», Dérives, 1987, n°53-54, pages 5-12 ;
OHO BAMBE (Marc, Alexandre) «Chaophonie de Frankétienne, testament vibrant d’un poète révolutionnaire», Africultures, 3 février 2015 ;
WABERI (Abdourahman) «L’oiseau schizophone, le pouvoir acoustique de Frankétienne», Africultures, 31 mars 1999.
Paris, le 21 février 2025 par Amadou Bal BA



