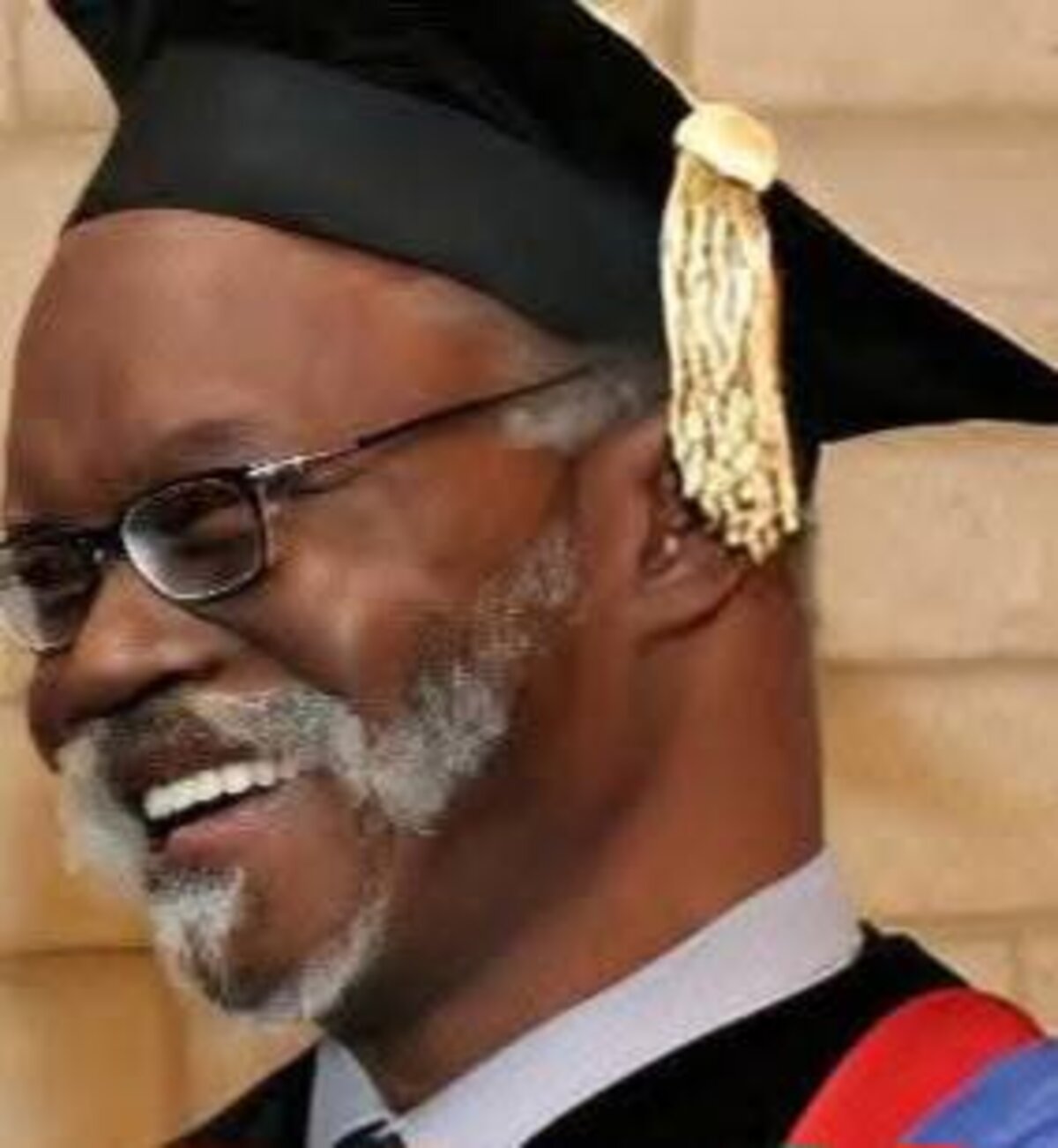
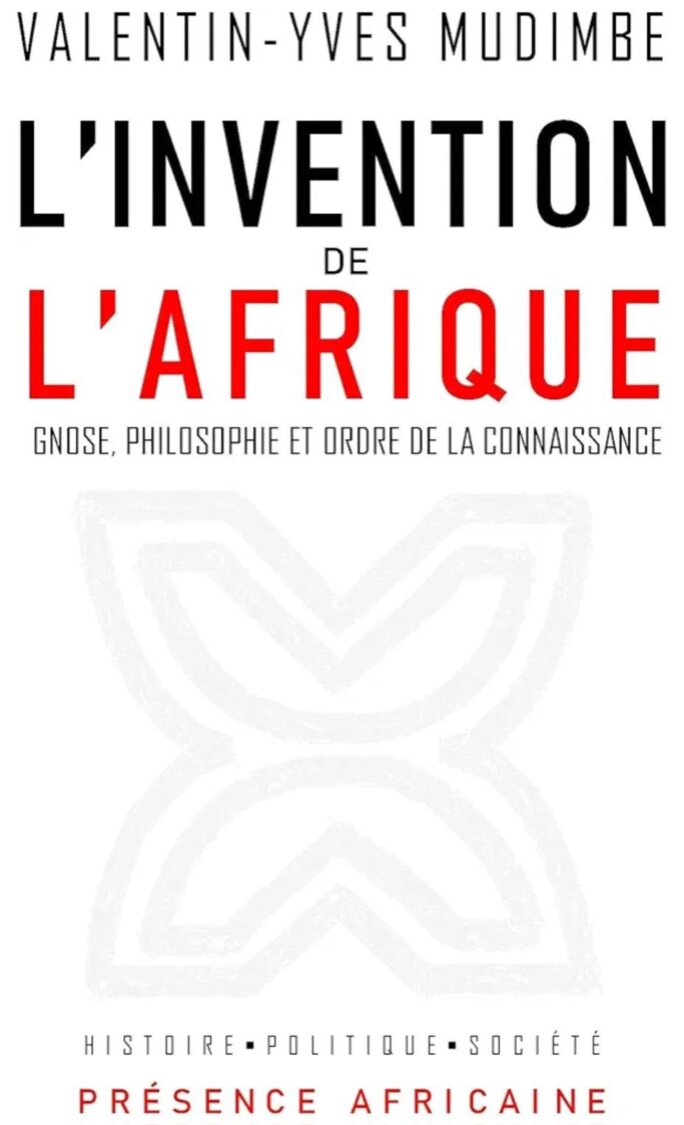
Agrandissement : Illustration 2
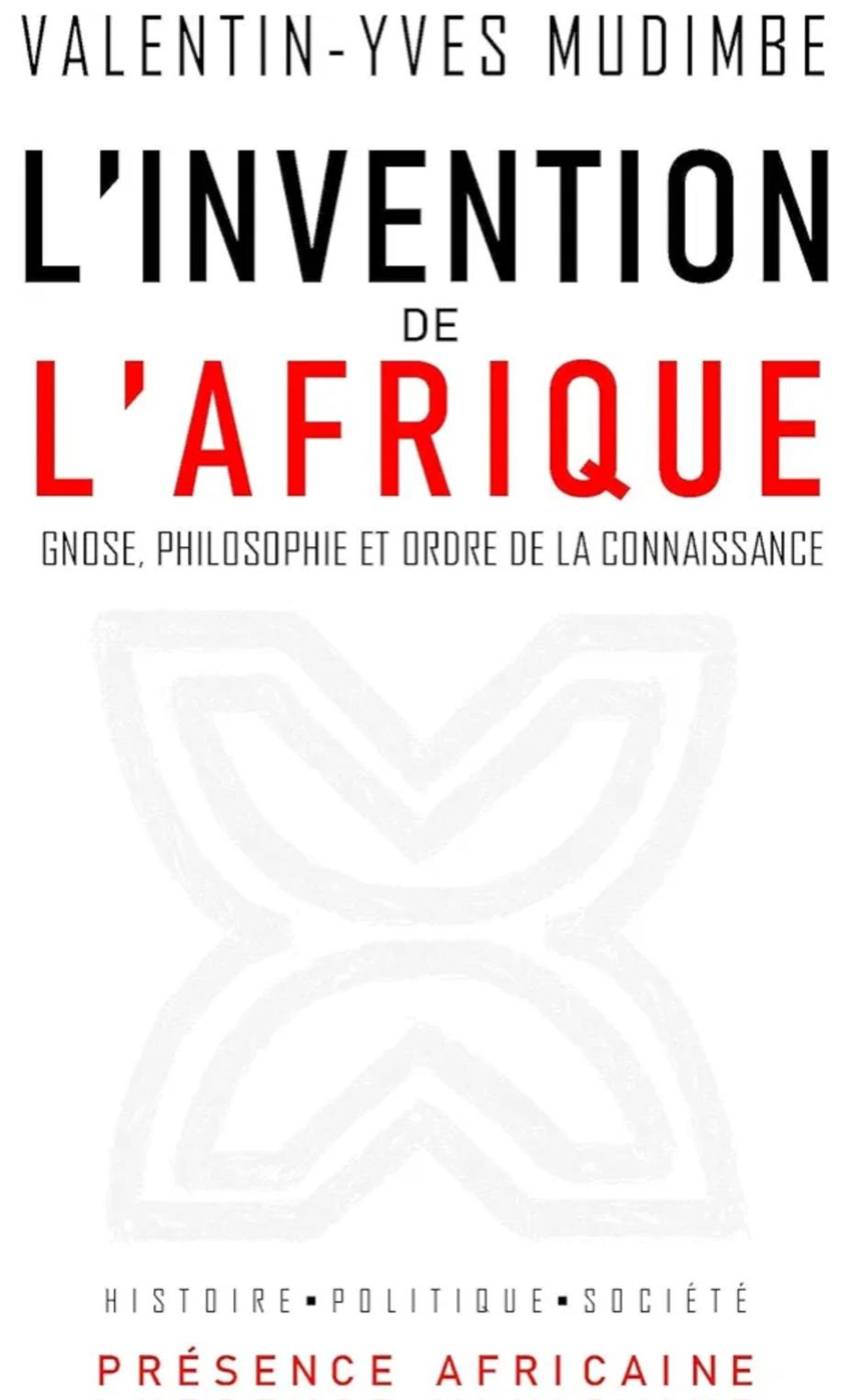
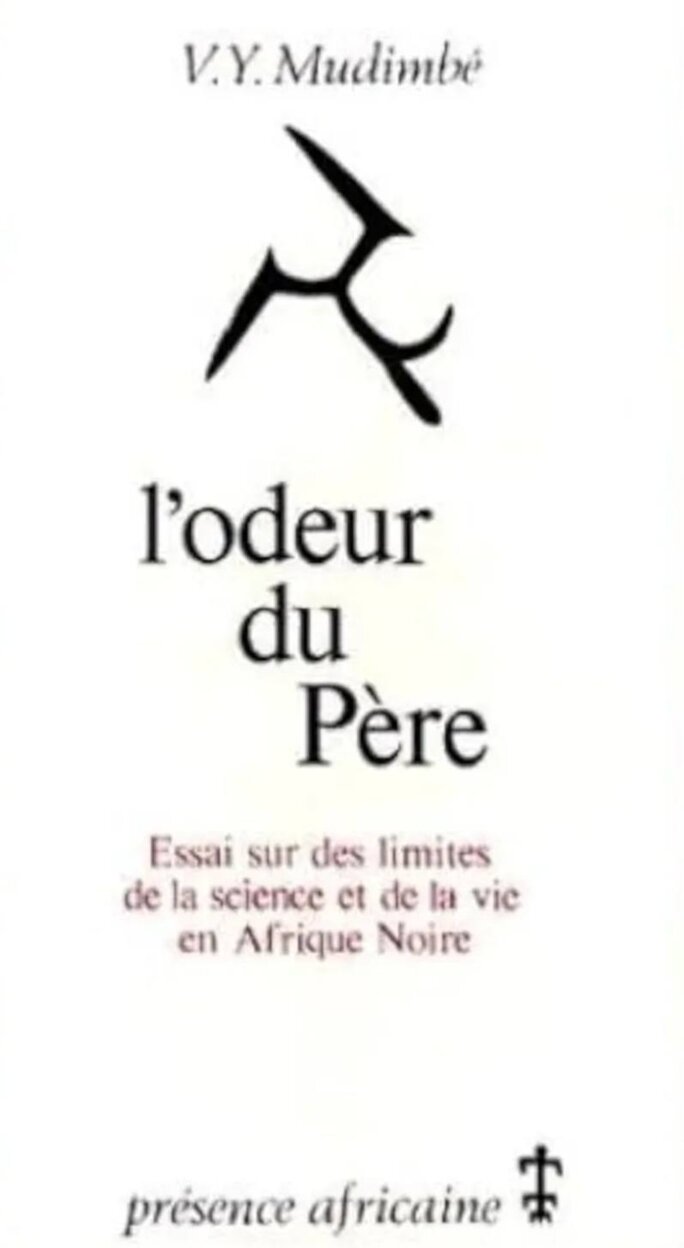
Agrandissement : Illustration 3
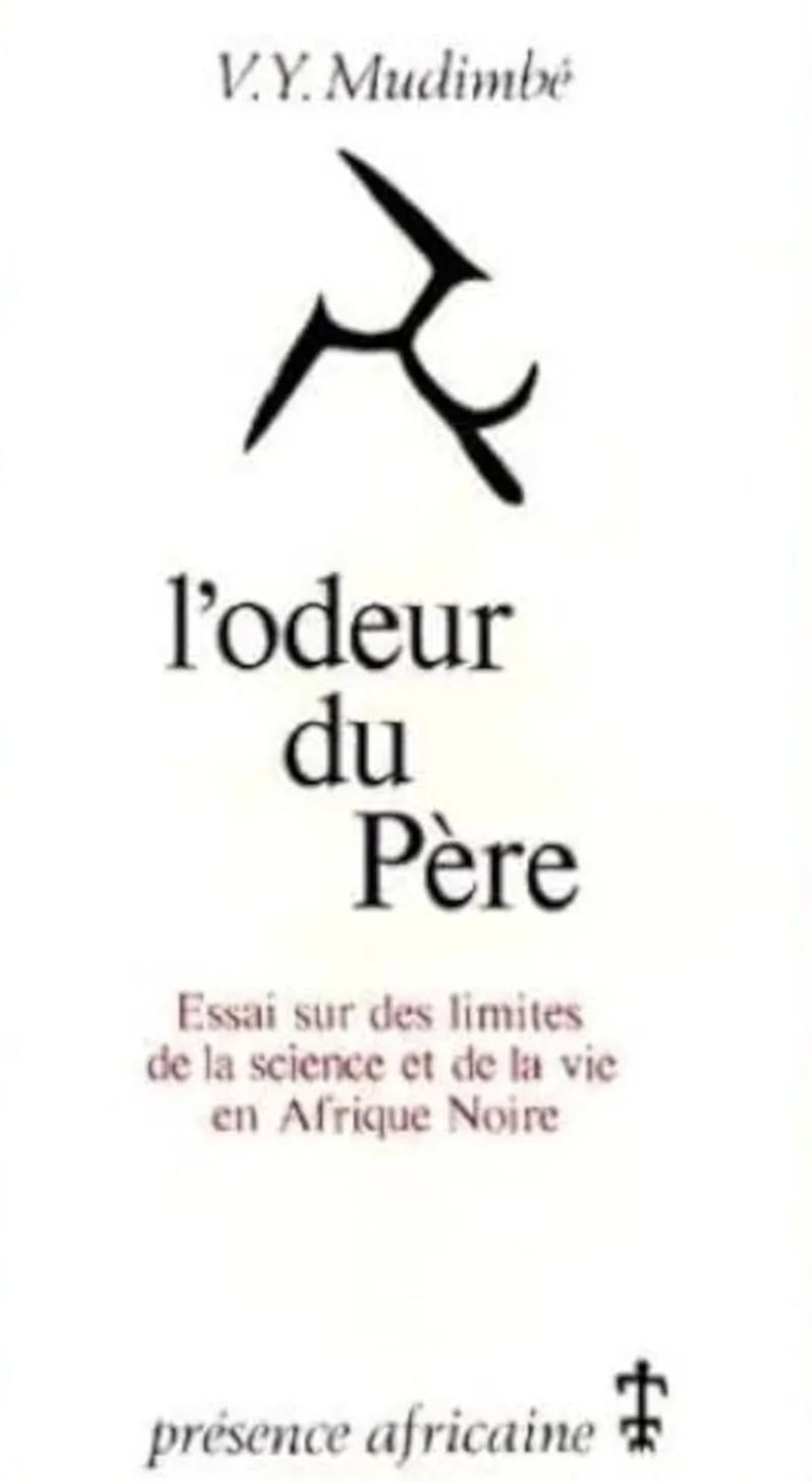
«Valentin-Yves MUDIMBE (1941-2025), philosophe de la postcolonie, poète, critique littéraire et romancier congolais. Un écrivain décolonial de la négritude, de génie, doué, savant et entièrement à part, à l’écart. In Memoriam» Amadou Bal BA
Né le 8 décembre 1941 à Jadotville (Likasi) au Congo-Kinshasa, ou du Zaïre, l’ancien Congo belge, dans la province du Haut-Katanga. MUDIMBE est mort dans la nuit du 21 au 22 avril 2025 en Caroline du Nord aux États-Unis. Une pétition, coordonnée par Richard ALI, circule pour un hommage national «Le professeur Valentin-Yves MUDIMBE a manqué de son empreinte indélébile le paysage littéraire congolais et africain. Son œuvre abondante et diversifiée a éclairé nos consciences et inspiré des générations. Il est impératif que la nation congolaise lui rende hommage», disent les signataires de la pétition. Les réactions sont nombreuses à la hauteur et à la dimension de l'héritage littéraire de MUDIMBE. «Mort d’un géant. C’était le plus africain vivant. Dans le roman national du Congo, je le plaçais dans le triangle mythique aux côtés de Wendo KOLOSOY, Patrice LUMUMBA et Simon KIMBANGU n’est pas loin. Lisons Mudimbe. Penson Mudimbe. Entre mains se trouve déjà son immortalité», écrit Blaise NDALA. «Sage penseur qui, sans tambour, ni trompette, a su construire une œuvre savante, mais aussi et surtout utile, pérenne, pierre par pierre, du début à la fin», renchérit Saër Maty BA. «Notre dette envers ton œuvre est immense», dit le professeur et philosophe, Felwine SARR. Il a légué sa bibliothèque personnelle, de plus de plus de 8000 livres, l’université de Lumumbasi ; «c'est un dernier geste lumineux qui accompagne désormais ses écrits : la pensée ne s'atteste et n'existe que dans l'acte généreux de transmettre», écrit, dans le Point, Nadia Yala KUSIKIDI.
Jeune, MUDIMBE a grandi dans une famille chrétienne de troisième génération. Ses grands-parents étaient cultivateurs. Son père travaillait à l’Union Minière du Haut-Katanga en qualité d’ajusteur, donc d’ouvrier qualifié. C’était un «évoluant», qui aurait ambitionné de faire de son fils un ingénieur. Bien qu’il ait été initié par un animiste, le jeune Valentin-Yves, après des études auprès des moines bénédictins, va finalement renoncer à la vie religieuse. Par conséquent, il fera, en 1962 et 1970, des études de philosophie à l’université catholique de Louvain en Belgique. «En septembre 1968, je passai, officiellement, de Lovanium à Louvain comme assistant de Monsieur Bal à la Faculté de Philosophie et Lettres. Rapidement, je me mis à partager mon temps entre Louvain et Paris. En ce lendemain de Mai 1968, l'université tenait d'une drogue pour les marxistes. A Paris, j'étudiais la sociologie, le hébreu et le russe ; je m'exposai autant que je pouvais aux enseignements et aux idées des «étoiles» à la mode : Georges Dumézil, Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss ; bref à une ambiance intellectuelle », écrit-il dans «Le corps glorieux des mots et des êtres». Évoluant entre deux cultures, c’est donc une déchirure, un écartèlement dont rendent compte certains titres de ses ouvrages. Dans son «penser autrement» hérité de Michel FOUCAULT, «Mudimbe rejette le monde pour une quête personnelle, permanente, sans fin, pour un questionnement de soi. Mudimbe, un homme inquiet, en savoir et dans l’existence, ouvert à une invitation constante à la solitude et à l’austérité spirituelle», écrit Willy BAL.
En 1972, MUDIMBE entame sa carrière universitaire à l’université Lovanium de Kinshasa et la poursuit à Lubumbashi (ex-Élisabehtville) où est transférée la faculté de Philosophie et Lettres à la suite de la nationalisation de l’enseignement universitaire décidée par le régime en place. MUDIMBE devient très actif dans les revues publiées alors au Congo. En 1979, le régime voulant le coopter au Bureau politique, l’universitaire rebelle, MUDIMBE quitte le Zaïre de Mobutu pour un long exil, qui le conduit en Europe, puis aux États-Unis où il enseigne notamment à la Duke University, à Durkam, en Caroline du Nord, au collège d’Haverford en Pennsylvanie, à l’université de Stanford (Californie), puis de nouveau à la Duke University l’Université de Stanford. Il est associé à de nombreuses universités, notamment en Allemagne. «La pensée de Mudimbe, qui est née sur les terres du jeune Congo indépendant, a emprunté de nombreuses routes passant par l'Europe puis les États-Unis. Quel est le prix d'une vie intellectuelle libre ? Sous la dictature de Mobutu, le chemin de la liberté est celui de l'exil», écrit dans le Point, Nadia Yala KUSIKIDI.
Poète, romancier, philosophe, linguiste, psychanalyste, historien de l’art, Valentin-Yves MUDIMBE est un savant resté à l’écart du microcosme, parfois vaniteux du monde de la littérature. Il fuyait la lumière. «L’œuvre de V-Y Mudimbe occupe une place à part dans l’ensemble de la production littéraire en Afrique. Cette œuvre, à «l’écart» ne laisse jamais indifférent : tour à tour, elle suscite l’admiration, surprend, étonne ou irrite franchement. On la lit, la commente, la réfute, la cite. La personnalité de l’écrivain, lui-même, provoque, elle aussi, des réactions, souvent passionnées, une curiosité insatiable», écrit, en 1988, Bernard MOURALIS.
Valentin-Yves MUDIMBE est un philosophe et l’un des livres majeurs, le plus cité de la littérature africaine, «The Invention of Africa», traduit, en 2021, par Présence africaine, est au carrefour de plusieurs domaines, la philosophie grecque et latine, l’ethnographie et les bibliothèques religieuses. Dans un autre ouvrage, il questionne, comment les Africains pourraient, dans leur subconscient qui les inhibe, se débarrasser de «l’odeur du père ?». Il appelait déjà à se détacher de cette pensée dominatrice «du père», dans «une perspective critique, mais aussi fondatrice, d’une réappropriation d’un discours africain authentique. Il faut assumer, librement, la responsabilité d’une pensée qui porte sur notre destin et notre milieu avec pour objectif la réadaptation de notre psychisme aux violences subies», écrit-il. En effet, dans une sorte de «bibliothèque coloniale», tout un logiciel de pensée vise à la domination et à la prédation de l’Afrique. Pour cette idéologie faite pour assujettir, l’Afrique, c’est la culture orale ou traditionnelle. En revanche, l’Occident serait la modernité, l’écrit et la production, et dont la mission serait donc de coloniser et civiliser une Afrique arriérée. Ecrivain majeur de la postcolonie, «Valentin Mudimbe a fait sauter les verrous de la «bibliothèque coloniale», ce corps de textes et de discours visant à déchiffrer le signe africain, pour le maîtriser et le domestiquer. Cette bibliothèque ratifie l’impossible subjectivation du colonisé. En démontant les règles qui organisent le discours des sciences coloniales africanistes, Mudimbe a pu tracer une voie de sortie possible du grotesque de ces écrits ; un sujet africain peut dès lors émerger, tenter de se constituer lui-même dans l’épaisseur de son propre dire», écrit Achille M’BEMBE, dans la «Postcolonie». En effet, pour MUDIMBE l’Afrique, berceau de la civilisation de l’humanité, n’est pas la périphérie, mais le centre. Par conséquent, dans «l’invention de l’Afrique», Valentin-Yves MUDIMBE a pour ambition de repenser la philosophie et «l’ordre du savoir», par une gnose, authentiquement africaine, «un savoir structuré, commun et conventionnel, mais qui est ordonné par des procédures spécifiques de contrôle dans son usage et sa transmission d’où sa spécialisation en un savoir supérieur et ésotérique», écrit-il. En effet, grâce à cette notion «L’aventure telle que la qualifie Mudimbe est une archéologie de la production des connaissances africanistes et «africanisées». Ce livre, qui a déjà produit une littérature importante, figure parmi les lectures obligatoires dans toutes les formations en études africaines aux États-Unis», écrit Mamadou DIOUF, dans la préface. MUMDIBE, en partisan de la négritude, reste un universaliste «Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou la dilution dans l’universel. Ma conception de l’universel, est celle d’un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers», écrit-il dans «l’odeur du père».
Je signale que contrairement au style de Paulin HOUNTONDJI (Voir mon article, Médiapart, 2 février 2024), un style savant, mais accessible et compréhensible par les non-philosophe, celui de Valentin MUDIMBE est parfois trop savant, abscons, ardu et difficile à suivre pour les non-initiés ; parfois on se sent complètement largué. Pour faire simple, le propos essentiel de l’auteur est de dire que, depuis l’esclavage jusqu’au néocolonialisme en passant par la colonisation, l’Africain s’est vu sans son consentement attribuer une histoire, une épistémè et une religion. Dès lors, l’Africain vit dans l’alter ego en ce sens que son histoire est écrite par l’autre. Cela signifie que l’image actuelle de l’Afrique n’est rien d'autre qu'une construction intellectuelle de l’Occident. L’image que l’Africain croit avoir de lui n’est rien d’autre qu’une invention. Si l’Africain semble être politiquement et économiquement indépendant, il faut travailler à décoloniser son esprit. Par conséquent, c’est une enquête sur les fondements du discours de l’Afrique, l’orientalisme, et dans le savoir parler africain, il examine les narrations de l’extérieur, et surtout une pensée africaine propre. Selon MUDIMBE, il est devenu urgent «de mettre à jour non seulement la compréhension rigoureuse des modalités de notre intégration aux mythes de l’Occident, mais aussi des questions explicites qui permettraient d’être sincèrement critique face à ce corpus», écrit-il. Dans sa «gnose africaine», soit le discours tant scientifique qu’idéologique sur l’Afrique, une bibliothèque de données, afin de combattre la caricature ou la méconnaissance de la pensée africaine.
Valentin-Yves MUDIMBE est aussi un romancier, ayant connu le Zaïre au temps de l’authenticité de Mobutu, avec une interdiction de porter des noms chrétiens. Son premier récit, «Entre les eaux», publié en 1973, comme les suivants, est marqué par les interrogations et les doutes d'un personnage tiraillé entre deux cultures. C’est un roman sur deux engagements, deux choix de vie, impossible et douloureuse, la rencontre de deux cultures, le déchirement et la rupture, l'impossible conciliation. Il s'agit ici d'un prêtre déchiré entre sa foi et son sacerdoce d'une part, ses convictions et son désir d'engagement politique, d'autre part. Un dilemme douloureux, développé dans un long monologue introspectif, écrit à la première personne. Le héros de mon roman est tiraillé entre plusieurs fidélités, tendu entre plusieurs amours; il aurait pu être un universitaire, un banquier ou un magistrat africain. «Je ne suis pas prêtre et ne me souviens pas d'avoir vécu les tentations violentes du héros de mon livre. Je pense toutefois me retrouver, un peu en cet être surgi de mes songes. «Entre les Eaux» est ainsi, pour moi, ma première tentative pour témoigner des tensions culturelles et spirituelles existant actuellement en Afrique. L'on a dit que «Entre les Eaux» était à la fois un roman catholique et un roman antireligieux. Je ne sais que penser. Catholique, mais extrêmement attentif à la valeur opératoire de 1 'analyse marxiste pour la compréhension des formations sociales africaines, je me demande si en essayant de rendre simplement compte de nos misères et de nos déchirements en Afrique, je ne pourrai pas, témoignant pour la promotion de l'homme, témoigner aussi pour l 'Esprit», écrit-il dans «Les corps glorieux des mots et des êtres.». En effet, l’auteur, comme le personnage de Julien Sorel de Stendhal, a hésité entre le rouge et le noir. Le roman d’un écrivain de la négritude recèle une grande part autobiographique. Élevé dans le cadre des institutions catholiques, très tôt tenté par la vie religieuse, élève brillant et doué, MUDIMBE a suivi des études classiques, travaillé comme ouvrier puis s'est engagé dans la vie monacale en devenant bénédictin en 1960. Il quittera le couvent en 1962 et poursuivra des études supérieures, pour s’engager dans une carrière universitaire. Le thème unique de ce roman sera, en effet, celui du déchirement et de la douloureuse alternative. Le héros, Pierre Landu, après avoir poursuivi ses études en Europe, est devenu prêtre. Très vite, la controverse s'installe en lui et autour de lui. Il se revendique "prêtre noir", donc un prêtre d’une religion étrangère. Il hésite entre son sacerdoce et un engagement politique chez les maoïstes. Aussi, il rejoint un maquis, participé à des opérations militaires, pour lesquelles, il sera arrêté. «Pierre Landu est une personnalité attachante par ses fragilités et sa sincérité et il est évident que le romancier a mis une large part de lui-même dans la construction de ce personnage», écrit Bernard MOURALIS.
A 50 ans, MUDIMBE a écrit l’ouvrage le plus autobiographique de sa contribution littéraire, pour faire un point d’étape «En 1990, à la veille de mon cinquantième anniversaire, je décidai de faire le bilan d'un parcours, le mien. Pendant plusieurs semaines, je vécus en retrait, ou pour reprendre une expression de ma jeunesse, fis retraite, mis par écrit les souvenirs de mes expériences, leurs élans et inflexions, leurs intuitions et naïvetés, leurs mauvaise foi et générosité. Me faisant face à moi-même, un débrouillage complaisant de mon passé ne me semblait d'aucune utilité. Pourquoi me mentir ?», écrit dans l’avant-propos, «Les corps glorieux, des mots et des êtres». Devenu agnostique, il est cependant resté prisonnier de la géographie de son enfance «Les trente dernières années, au fil des contacts avec le monde, le marxisme, la philosophie, je m'espérais, au moins, libéré du cadre bénédictin de mon enfance et de mon adolescence. Le constat du contraire m'effraya et m'amusa tout à la fois. Une autobiographie de mes cinquante années passées n'est, donc, qu'un témoignage. Si elle s'attache à l'archéologie de mon parcours, elle ne pourra offrir qu'un reflet d'un modèle écrasant et multiséculaire, le bénédictin», écrit-il. MUDIMBE a été un enfant brillant qui avait fait la fierté de ses parents «Mes parents admirent l'aisance avec laquelle j'ai appris le français et me suis intégré, sans crise, en de nouvelles manières d'être. On s'amuse de mes dons linguistiques. Ma famille en tire des raisons de fierté. Je parle français à mes maîtres à l'école, swahili à mes condisciples, Songhye à mon père et luba à ma mère. En somme, un petit miracle», écrit-il. Devenu agnostique, en disciple de Maurice MERLEAU-PONTY et de Michel FOUCAULT, Valentin-Yves MUDIMBE y évoque ses croyances religieuses «Le Dieu unique de mes ancêtres ne me parle pas. Il appartient à un décor mythique que je respecte, rien de plus. Jésus-Christ m'intrigue un peu plus. Il est, en effet, presque mon contemporain. Dieu paraît transcender, de manière absolue, l'univers des hommes et ne semble pouvoir être atteint que par la médiation d'esprits intermédiaires. Le christianisme signifie ainsi l'échec de mon passé, de ma tradition et des croyances de mes ancêtres. Les vaincus adoptent la religion des vainqueurs, presque toujours», écrit-il.
Valentin-Yves MUDIMBE a rencontré Elisabeth BOYI, en 1963, maintenant une universitaire de Stanford, et ils se sont mariés en 1966, à Lumumbasi. Son livre, «l’écart et le récit», est dédié à son épouse, et relatant la vie et les combats d’Ahmed NARA, un jeune historien, un archéologue ayant entrepris une thèse sur l’ethnie Kouba, une ambition de décoloniser la pensée africaine, un écart entre rêve et réalité qui conduira à la mort du héros. «Dès mon jeune âge, j'avais appris que la femme constituait le malheur de l'humanité. Elle était, en effet, responsable de la chute originelle et demeurait, de manière permanente, l'occasion du péché. Voilà que je rencontrais une jeune africaine intelligente, rationnelle et, à tous égards, mieux en prise sur le monde que je ne l'étais.», écrit-il. Valentin-Yves MUDIMBE semble rejeter non pas l’immortalité littéraire, du moins, mais accueillir, avec apaisement, la mort physique «L'immortalité me paraît indécente. En effet, elle affirme une victoire incompréhensible sur la nature. Elle m'inquiète en ses prétentions. Je mourrai satisfait de ma vie, de mes actions, de mes insuffisances, n'attendant rien de plus. De l'avoir vécue, suffit à ma joie. Elle m'a été jusqu'ici, bonne. J'y ai investi ce que j'ai pu. Lorsque ma mort viendra, je serai heureux de rentrer, en cendres, à la terre. De penser que je pourrai, peut-être, nourrir quelques herbes et quelques plantes, et contribuer, ainsi, à la continuité de la nature, est la plus belle promesse de ma mortalité», écrit-il.
Dans l’héritage littéraire ?
Je crois que pour reprendre une expression de Bernard MOURALIS, il y a une sorte de «canonisation» des écrits de Valentin-Yves MUDIMBE, un philosophe postcolonial. La contribution littéraire de MUDIMBE est paradoxale, puisqu’elle est à l’écart des idées dominantes ; c’est une œuvre non classique, dans un contexte congolais, un héritage de la négritude, mais très cohérente, tenant à la dimension intellectuelle de l’auteur et à sa vision du monde. C’est une œuvre critique et intemporelle, dans son exigence de la quête de la vérité, refusant les dogmes ou toute autre pensée prédatrice ou dominatrice.
Références bibliographiques
A – Contributions du professeur MUDIMBE
1-1 Ouvrages
MUDIMBE (Valentin-Yves), Air, étude sémantique, Vienne, éditions Elisabeth Stiglmayer, 1979, 454 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Autour de la nation. Essai, Kinshasa, éditions du Mont noir, 1972, 95 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Bel immonde. roman, préface de Jacques Howlett, Paris, Présence africaine, 1976, 171 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Carnet d’Afrique. journal, Paris, éditions du Saint-Germain-des-Prés, 1976, 202 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Carnets d’Amérique. Septembre-novembre 1974, Paris, éditions du Saint-Germain-des-Prés, 1976, 203 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Cheminements. Carnets de Berlin (avril-juin 1999), Québec, Humanitas, 2006, 223 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Déchirures. Poèmes, Kinshasa, éditions du Mont noir, 1971, 47 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Entrailles. Précédé de Fulgurance d’une lézarde. Poèmes, Paris, éditions du Saint-Germain-des-Prés, 1973, 79 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Entre les eaux. Dieu, un prêtre, la révolution, Paris, Présence africaine, 1973, 184 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), L’autre face du royaume. Une introduction à la critique des langages en folie, Lausanne, l’Age d’homme, 1973, 157 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), L’écart. récit, Paris, Présence africaine, 1979, 159 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), L’invention de l’Afrique. Ngnose, philosophie de l’ordre de la connaissance, traduction de Laurent Vannini, préface de Mamadou Diouf, Paris, Présence africaine, 2021, 506 pages ; The Invention of Africa, Bloomington, Indiana University Press, 1988, 241 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), L’odeur du père. Essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique noire, Paris, Présence africaine, 1982, 203 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Les Corps glorieux des mots et des êtres. Esquisse d’un jardin africain à la bénédictine, Québec, Humanitas, 1994, 150 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Les fuseaux parfois. Poèmes, Paris, éditions du Saint-Germain-des-Prés, 1974, 144 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Réflexions sur la vie quotidienne, Kinshasa, éditions du Mont noir, 1972, 72 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Shaba Deux : Les carnets de Mère Marie-Gertrude, Paris, Présence africaine, 2000, 151 pages ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), sous la direction de, La dépendance de l’Afrique et les moyens d’y remédier, Paris, Berger-Levrault, 1980, 792 pages, texte en français et en anglais ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), Visage de la philosophie et de la théologie contemporaines du Zaïre, Bruxelles, Centre d’étude et de documentation africaine, Les Cahiers du CEDAF, 1981, 44 pages.
1-2 Articles
MUDIMBE (Valentin-Yves), «Humanisme et négritude», Présence universitaire, Congo, janvier 1964, n°14, pages 5-13 ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), «In Memoriam. Léon-Gontran Damas (1912-1978)», Zaïre-Afrique, mai 1978, n°125, pages 311-313 ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), «La littérature de la République démocratique du Congo», L’Afrique littéraire et artistique, juin 1970, n°11, pages 14-16 ;
MUDIMBE (Valentin-Yves), «Orphée noir», Congo-Afrique, Congo, mars 1966, n°3, pages 149-153.
B – Critiques ou biographies
BAL (Willy), «Présence, parcours et paradoxes de Valentin-Yves Mudimbe», Bruxelles, académie royale de langue et de littérature française de Belgique, 10 avril 2004, 8 pages ;
BANYWESIZE (Emmanuel, M.). «De Valentin-Yves Mudimbé à Achille MBembé, des concepts à renouveler en sciences sociales.», Afroglobe, avril-mai 2024, Vol 2, n°1, pages 102-127 ;
BISANSWA (Justin, K.). «Contrepoints romanesques. Poétique du clair-obscur dans le roman de V.Y. Mudimbe». in Justin BISANSWA, Entre inscriptions et prescription: V.Y. Mudimbe et l’engendrement de la parole, Paris, Honoré Champion, pages 317-392 ;
BISANSWA (Justin, K.). «V. Y. Mudimbe : réflexion sur les sciences humaines et sociales en Afrique», Cahiers d’études africaines, 2000, Vol 40, n°160, pages 705-722 ;
BOMO-MAURIN (Marie-Rose), «De l’écriture de L’Écart à l’examen d’une mémoire». in Justin BISANSWA, Entre inscriptions et prescription: V.Y. Mudimbe et l’engendrement de la parole, Paris, Honoré Champion, 2013, pages 139-150 ;
DIAWARA (Manthia) «Reading Africa through Foucault : V. Y. Mudimbe’s Reaffirming of the Subject», Quest, hiver, octobre 1995, n°55, pages 79-92 ;
GREEN (Mary, Jean) et autres, Postcolonial Subjects : Francophone Women Writers, Minneapolis, Indiana University Press, 1996, 359 pages, spéc sur le chapitre 8, sur Elizabeth MUDIMBE-BOYI, épouse de Valentin-Yves MUDIMBE et universitaire, ;
JACQUEMIN (Jean-Pierre), «Entre les eaux. Un roman de VY Mudimbe», Zaïre-Afrique, janvier 1974, n°81, pages 55-58 ;
KAPANGA (Kasongo) «Le héros de Mudimbe à la croisée des discours antagonistes : un héritage suivi ?», in Justin BISANSWA, Entre inscriptions et prescription: V.Y. Mudimbe et l’engendrement de la parole, Paris, Honoré Champion, 2013, p. 247-258 ;
KAVAKA (Noël), Le rapport à l’autre dans «Entre deux eaux» et «L’autre face du royaume» de Valentin-Yves Mudimbe, maîtrise en littérature francophone sous la direction de Kasereka Kavwahirehi, Ottawa, Canada, 2022, 113 pages ;
KAVWAHIREHI (Kasereka), VH Mudimbe et la réinvention de l’Afrique. Poétique et politique de la décolonisation des sciences humaines, Amsterdam, NY, Rodopi, 2006, 421 pages ;
KUSUKIDI (Nadia, Yala), «Qui était Valentin-Yves Mudimbe, auteur de «L’invention de l’Afrique», et pilier des études africaines», Le Point, 23 avril 2025 ;
MANGEON (Anthony), La gnose africaine de Valentin-Yves Mudimbe, ou, le discours, l’écart et l’écriture, Paris, HAL, Honoré Campion, 2013, 47-56 pages ;
MATESO (Locha), «Mudimbe (MV). Le bel immonde», Notre Librairie, octobre-novembre 1978, n°44, pages 20-24 ;
MOURALIS (Bernard), «Mudimbe et l’odeur du pouvoir», Politique africaine, mars 1984, n°13, pages 21-32 ;
MOURALIS (Bernard), VY Mudimbe, ou, le discours, l’écart et l’écriture, Paris, Présence africaine, 1988, 148 pages ;
NIMONTA (François), La pensée décoloniale chez Valentin-Yves Mudimbe, Décolonialité, Grin Verlag, 2023, 72 pages ;
OBENGA (Théophile), «L’œuvre littéraire de Mudimbe», in Théophile Obenga, Le Zaïre, civilisations traditionnelles et culture moderne, Paris, Présence africaine, 1977, 270 pages, spéc pages 230-234 ;
PAGEAUD (Daniel Henri), «L’écart (1979) de Vumbi Yoka : nouveau roman africain, altérité, impossible, écriture, spéculaire», Jean BESSIERE, Etudes romanesques, L’autre roman et la fiction, Paris, Lettres modernes, 1996, pages 131-138 ;
SEMUJANGA (Josias), «La mémoire transculturelle comme fondement du sujet africain chez Mudimbe et Ngal», Tangence, 2004, n°75, pages 15-39.
Paris, le 22 avril 2025 par Amadou Bal BA



