
Agrandissement : Illustration 1

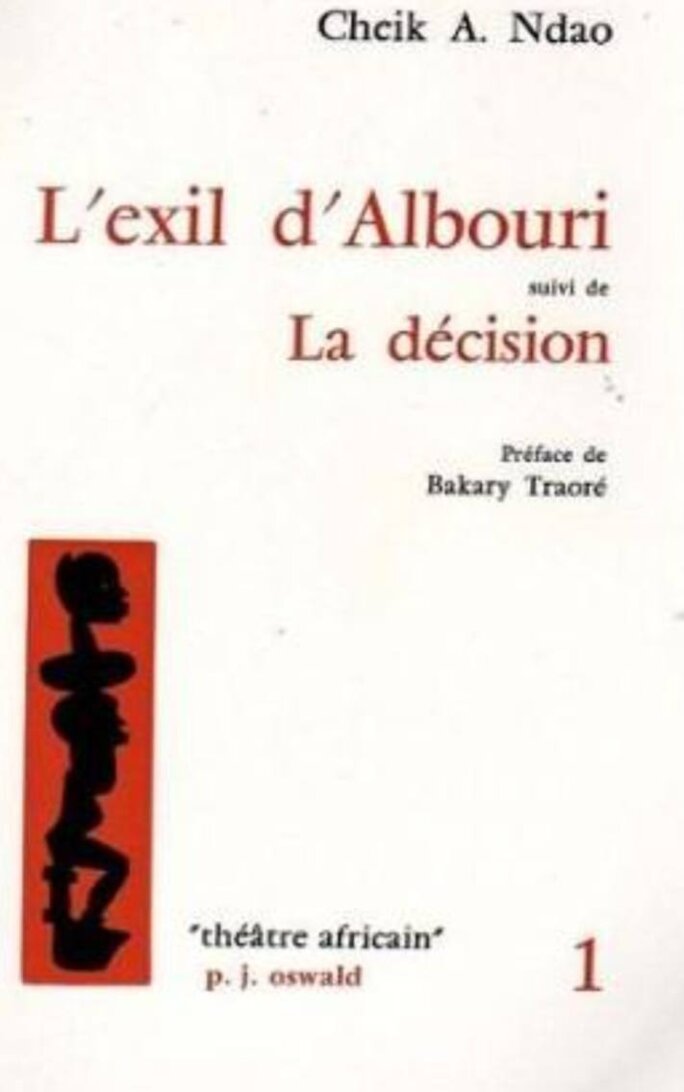
Agrandissement : Illustration 2
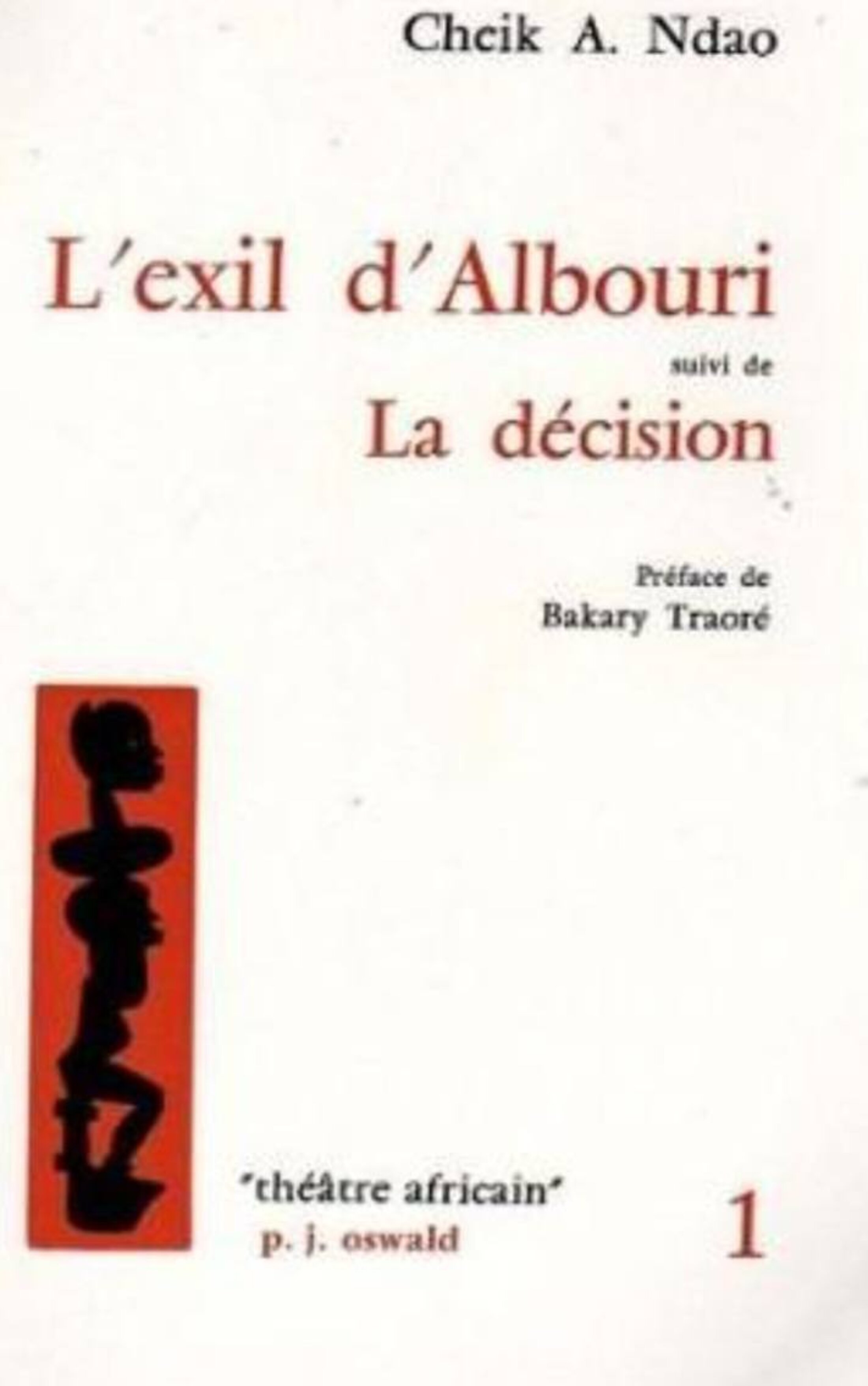
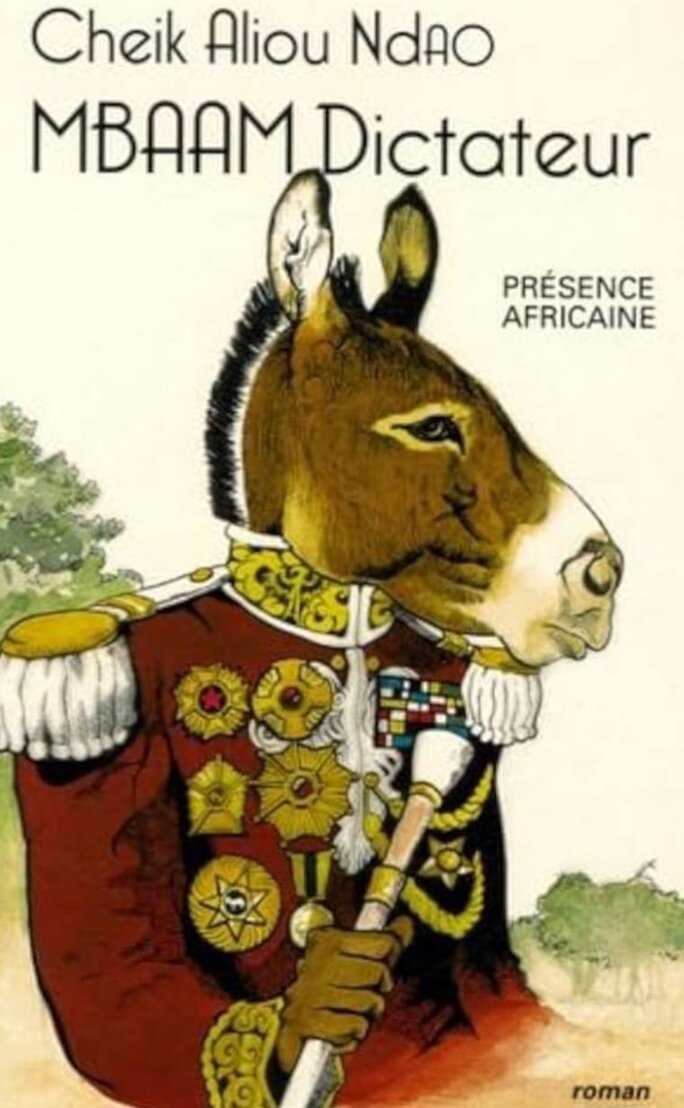
Agrandissement : Illustration 3
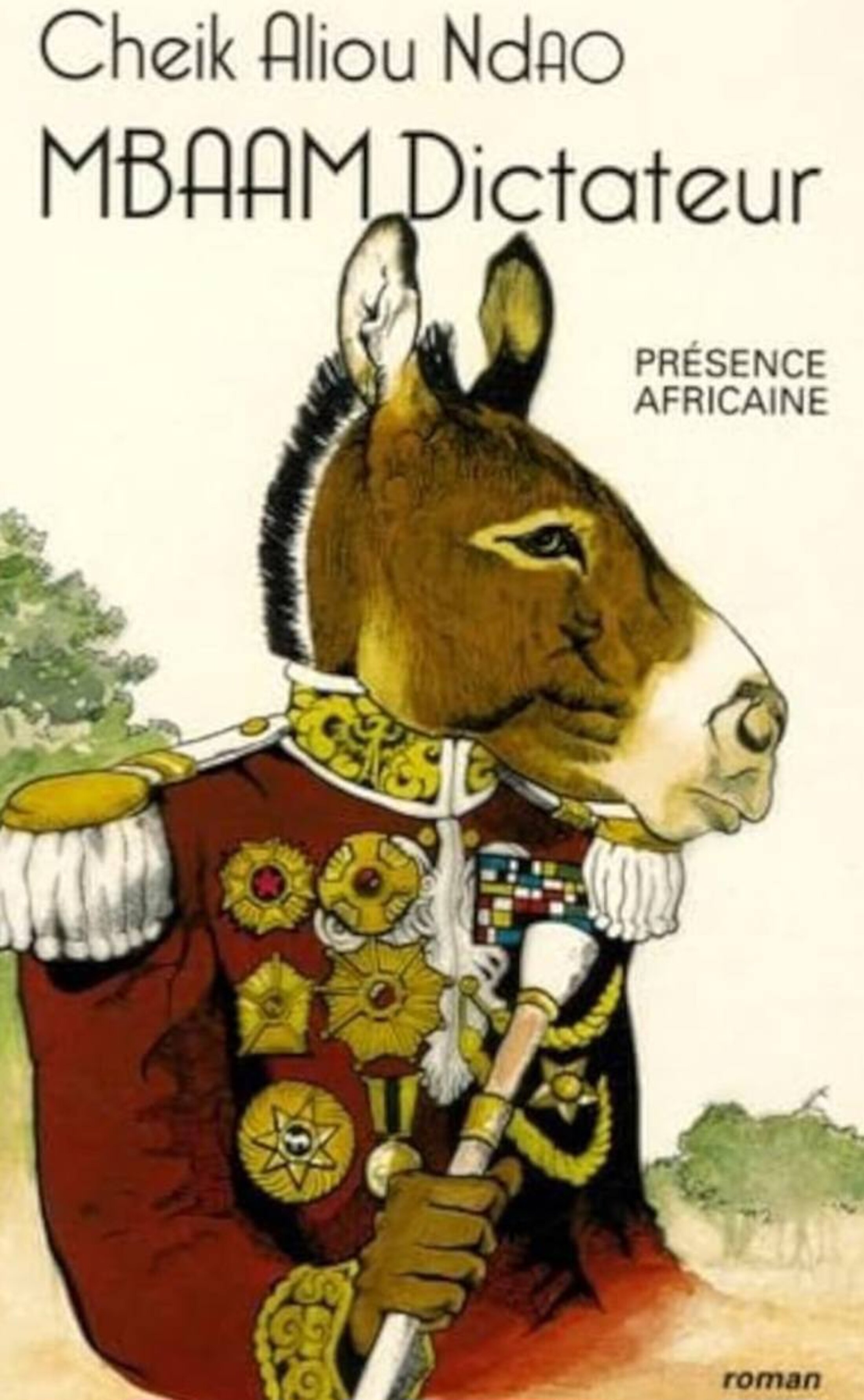
«Cheik Aliou N’DAO, écrivain, poète, dramaturge et enseignant sénégalais, artiste de la mémoire, de la tradition, de la modernité, de l’estime de soi, de la liberté, du sens de la mesure et de la bienveillance.» par Amadou Bal BA
Poète, romancier, nouvelliste et dramaturge, Sidi Ahmed Aliou Cheik NDAO est né le 3 août 1933, à Kartiack en basse Casamance, mais sa naissance en fait été déclarée à Bignona, son père un vétérinaire et par la suite chef de canton à Koumpentoum (région de Tambacounda), étant en fréquents déplacements. Ses ancêtres sont originaires du Djolof et ses parents ou alliés, sont de toutes les ethnies du Sénégal. Aussi, il prêche la tolérance, une valeur qui est au centre du bien-vivre ensemble, de ce «Grand petit pays» qu’est le Sénégal. Il recommande donc aux autorités publiques, dans leur gouvernance, le sens de la mesure, l’exemplarité et le souci du Bien commun. «Accueil cordial à Kanène. Pagnes multicolores à Podor. Pour l’union des cœurs et la paix Ayré Lao. L’errance qui fait escale au Niani, Kouthia Ba Kouthia Gaïdi, au Fouta, Ouro Madiyou Ouro Fondé. L’ouverture vers l’ailleurs, le voyage vers l’humain, la soif de tout horizon. Du bonheur, sans jamais descendre du sentier hérité de l’Ancêtre», écrit-il, à Dakar, en avril 2021, dans le poème «Ma part de Sénégal».
Contemporain d’Abdou Anta KA (1931-1999) et Thierno BA (1926-2010), la communauté littéraire, le 18 janvier 2023, à l’occasion de ses 90 ans, lui a rendu un vibrant hommage, à la Maison de la Culture Douta Seck. Cheik Aliou NDAO a fait ses études primaires à Louga, une partie de ses études secondaires à Dakar, au collège Eva Mariste, et en France, au Lycée Henri IV, puis dans les Alpes ; il a fréquenté l'Université de Grenoble en France et fait un stage au Pays de Galles. La vocation littéraire, pour lui, est un mystère, mais il existe de prédispositions. «Mes études m'ont ouvert la voie à la littérature puisque j'ai une formation classique. En outre, j'ai toujours aimé la lecture. Il se peut que tous ces éléments conjugués aient attisé mon sentiment pour la culture d'une façon générale. Cependant, je ne pense pas qu'on choisisse consciemment de venir à la littérature. Je suis persuadé qu'au départ, il y a eu une espèce de don qui pousse à écrire ses impressions. D'abord d'une manière maladroite et au fur et à mesure que l'on acquiert de la maturité, on se corrige et là le don devient un métier» dit à FOFANA. Sa femme professeure de Lettres, relit attentivement ses manuscrits.
Ancien enseignant d'anglais à l'Ecole Normale William Ponty, fonctionnaire un laps de temps au Ministère de la Culture, sous Assane SECK, récipiendaire des Palmes académiques, Cheik Aliou NDAO a également enseigné aux Etats-Unis en 1972 à De Pauw University de Greencastle (Indiana) ; il a été aussi conseiller technique à la Primature, pour Abdou DIOUF, puis à la Présidence de la République ; il a été décoré, en 2012, Grand Prix pour les Lettres. «Trois étapes ont joué un rôle important dans ma vie future d'écrivain. A l'époque, je fréquentais l'école primaire de Louga et Abdoulaye Sadji avait prêté à mon père le premier numéro de la "Revue Présence Africaine". Pour la première fois de ma vie, je lisais des noms d'auteurs africains au bas d'un texte. Je me souviens que dans ce numéro, la pièce d'Amadou Cissé Dia intitulée La mort du Damel, ainsi que le conte de Birago Diop L'os de Mor Lam, y étaient imprimés. Le deuxième événement décisif a été ma lecture de L'Anthologie de la nouvelle Poésie Nègre et Malgache de Lépold Sédar Senghor. Un auteur de ma génération doit reconnaître publiquement sa dette à l'égard d'aînés tels que: Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, Alioune Diop, Birago Diop, Abdoulaye Sadji, Ousmane Socé Diop. J'ai lu tous ces auteurs et j'ai essayé de les imiter. Je crois que cela est essentiel. Des écrivains tels que Lamine Diakhaté, Djibril Tamsir Niane, Abdou Anta Kâ ont influencé inconsciemment ma vie littéraire.» dit-il à Pierrette FOFANA.
Le théâtre africain de langue française est né en Côte-d’Ivoire avec la pièce de Bernard DADIE (Voir mon article, Médiapart, 19 janvier 2024), «Assymen Dahyle», jouée en 1933, à Bingerville. Rompant avec le théâtre de William Ponty, c’est le sénégalais Abou Anta KA (1931-1999), qui le précurseur et le révolutionnaire en matière de création théâtrale «Pour lui l'environnement africain dans lequel évoluent les personnages doit être compris comme un simple cadre, éphémère. Le dramaturge s'adresse a tous les humains. Mahdi et Awa, ces frère et sœur, bannis et proscrits de La Fille des dieux, posent le problème de la solitude ils nous montrent jusqu'où l'arbitraire, !'injustice, Ia bêtise peuvent aller. Le «fanatisme» sous sa forme la plus brutale, lorsqu'il n'est fonde que sur Ia superstition, donne Ia mesure des méfaits de l’'ignorance. Abdou Anta Ka se contente de mettre les spectateurs face a des interrogations. La tyrannie du groupe devant les exigences de la liberté individuelle. Les risques encourus par ceux qui sortent de la norme dans une société ou la régie est de suivre le grand nombre comme un troupeau de moutons», écrit en 1999, dans Présence Africaine, Cheik Aliou NDAO, en hommage à son aîné, qui venait de disparaître.
Son premier recueil de poésies, «Kairée» publié en 1964 a obtenu le prix des Poètes Sénégalais de langue française. Sa pièce de théâtre, en 1967, «l'Exil d'Albouri» a été mise en scène en 1968 au théâtre Daniel Sorano de Dakar, et a été jouée sur de nombreuses scènes africaines et européennes, notamment à l'Odéon (Paris), ainsi qu'en Belgique. Présentée au Festival culturel panafricain d'Alger en 1969, elle obtint le premier prix, ainsi qu’en Côte-Ivoire et adaptée par Sidiki BAKABA. Dans la pièce originale, plane une ambiguïté savamment entretenue, Alboury N’DIAYE est-il un héros ou un traitre ? La pièce s’ouvre sur une atmosphère de fête de nomination du Prince Laobé Penda, dont le courage et la vaillance sont connus dans tout le Djolof. La place de Yang Yang est le lieu de cette intronisation. C’est à ce moment qu’un guerrier vient annoncer l’invasion imminente du royaume du Djolof par le Gouverneur qui vient de rompre les traités qu’il avait signés. Afin de faire face à la menace, le roi Alboury convoque une réunion pour permettre à l’assemblée de se prononcer, mais il sera obligé de suspendre la séance à cause des esprits qui s’échauffent. En tête à tête avec son frère, Bourba lui annonce sa décision de s’allier avec les autres rois contre l’armée du gouverneur. Rien que la décision d’aider le roi de Ségou, Ahmadou fait entrer Laobé Penda dans une colère ; il s’oppose à la décision de son frère. En effet Laobé Penda ne peut cacher son indignation devant ce qu’il considère comme une fuite indigne d’un descendant de Ndiadiane NDIAYE.
Il ne fait pas de doute, pour Sidiki BAKABA, artiste ivoirien, l’un des grands héros du Sénégal, ce n’est pas Lat-Dior DIOP monté en épingle, mais c’est bien Alboury N’DIAYE (1848-1901). Grand résistant, il a quitté le Djoloff en 1890, sous la pression du colonel Alfred DODDS (1842-1922) ; il meurt en exil, et donc héritage de résistant est bien encore vivant parmi nous. «dans ce monde où l'homme devient chose, où nous sommes en face d'une dévalorisation du monde sur une trajectoire où le mépris domine, il s'agit de restituer le noir dans sa dimension humaine. Et pour cela, il nous paraît d'abord essentiel de valoriser la fonction de l'art africain plus particulièrement du théâtre, un des aspects essentiels de la culture. Il faut préconiser le théâtre, parce que tout comme l'être humain a besoin d'oxygène, il a besoin de théâtre. Au contraire de l'idéologie, l'art rétablit la dialectique du monde : de participation et de dialogue. Il s'agit à travers l'apport africain de redonner au monde sa signification profonde en le reclassant dans sa vitalité profonde. Quand la mythologie s'effondre, c'est dans la poésie, c'est dans le théâtre que s'allume la haute passion des peuples pour l'éclat.», écrit, dans la préface de l’exil d’Albouri, Bakary TRAORE.
Partisan de la transcription des langues africaines, véhiculant le riche patrimoine du Sénégal, sans rejeter la langue française, il est dans la défense de la culture africaine «Nous Africains n’écrivons pas en Français par amour ou à cause d’un choix délibéré. Nous employons la langue de Molière par accident historique. La Francophonie n’est pas notre héritage, car notre Moi profond s’exprime dans nos langues maternelles», dit-il en 1999. Par conséquent, Cheik Aliou NDAO a publié un roman, en Wolof «Buur Tillen», mais aussi «Mbaam Dictateur», réédité en français chez Présence africaine. Le théâtre africain est d’abord dans l’émotion, mais aussi le refus de toute dépersonnalisation, réification de l’Homme africain. «Je vais cesser d'écrire en français. Cette langue n'arrive plus à habiller mes émotions», dit-il, en mars, 1995.
Dans «Mbaam, Dictateur, le peuple d’un pays d’Afrique se tourne vers le pouvoir occulte des ancêtres, pour se débarrasser de son dictateur, en le transformant en âne. C’est ainsi que «Mbaam Dictateur» se trouve transformé en âne qui continue sa vie dans la peau de l’animal, ne perdant pour autant ni ses capacités intellectuelles ni ses sentiments d’homme. C’est une part de réalisme magique, que ne renierait pas Gabriel GARCIA MARQUEZ, prix Nobel de littéraire et son fameux roman, «Cent ans de solitude» (Voir mon article, Médiapart, 24 décembre 2024). Dans une cour familiale, un âne réfléchit et s’étonne car il réfléchit en humain. Il agit en humain et ne mange pas de paille, ni d’herbes. Autour de lui, les gens ne parlent que de la disparition du dictateur. Personne ne sait où il est et nul ne s’en plaint. Au contraire. Mbaam a pitié de cet homme haï de tous. Cet homme dont tout le monde parle n’avait que des tares, des défauts et Mbaam le juge. Sans concession. Puis, vint le déclic. La stupeur. L’indignation. Les souvenirs. Un jour. Un matin comme les autres. Un dictateur se réveille dans sa luxueuse chambre. Mais, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va plus. Il se réveille dans la peau d’un animal: un âne (Mbaam). La vie ne sera plus la même. Cet homme adulé par certains, craint par d’autres se trouve en fâcheuse posture: Il doit quitter le palais sans être vu. Dans cette tragédie-comédie, on entre dans l’intimité de ce Roi, jadis craint ou adulé, devenu un âne, en face de lui-même et de sa conscience. Son repentir lui fera gagner une seconde chance ?
Cheik Aliou NDAO a commencé à écrire des poèmes en wolof, depuis 1956, alors qu’il était encore étudiant à Grenoble. Depuis 1990, il ne cesse plus d’écrire dans cette quasi-langue nationale du Sénégal, qui n’ose pas encore s’afficher comme telle. C’est une démarche encore rare en Afrique, où l’on ne trouve guère de cas similaire, exception faite du Kenyan, Ngugi w’a Thiongo (Voir mon article, Médiapart, 27 septembre 2024). Valorisant les langues africaines, il estime que «s’exprimer en langue locale, c’est un acte de dignité et de libération. Le Chinois écrit en mandarin, le Japonais en japonais. Même si les Indonésiens, qui avaient été colonisés par les Néerlandais et qui avaient dans la tête qu’il ne fallait écrire que dans sa langue néerlandaise, se sont mis, après leur indépendance, en 1945, à écrire dans leur langue.». Dans son style de narration, il fait recours souvent aux contes, proverbes, métaphores et images.
Cheikh Aliou NDAO est non seulement un féministe, mais il prêche aussi, dans les cas complexes de la vie, le sens de la mesure et la bienveillance. Dans «Un bouquet d’épines pour elle», le personnage principal, Faatu, ne semble mener, aux yeux des autres, qu'une existence vouée aux plaisirs interdits, au vice et à la débauche. Dans ce combat de la chair et de l’esprit, Cheik NDAO procède à une interpellation, à notre examen de conscience. Faatu, devenue à l’aise, sur le plan matériel, délaisse la luxure, et écoute les forces de la divinité, de la religion.
Cheikh Aliou NDAO est attaché aux valeurs traditionnelles africaines, mais qui sont bousculées par un monde qui bouge. Dans «Buur Tilleen, Roi de la Médina», un texte en Wolof traduit en français, Gorgui, qui a été dans l’obligation de quitter son village après avoir tancé un fonctionnaire français qui aux yeux de tous l’avait déshonoré. Réfugié avec sa femme Moram et sa fille Raki dans le bidonville de la capitale, il affiche, stoïque, sa noblesse en dépit des sarcasmes de ses voisins, compagnons d’infortune. Peu lui importe la déchéance dans la misère ; les valeurs ancestrales qui font la dignité de l’homme et de la famille se doivent d’être respectées. Gorgui n’est toutefois pas opposé à toute évolution de la tradition dans la mesure où la nature même de celle-ci reste entière. A son grand malheur, l’humiliation s’abat sur son foyer lorsque sa fille Raki tombe en ceinte en dehors des liens du mariage. Faisant fi des supplications de sa femme, il chasse la pécheresse. Celle-ci trouve refuge auprès de sa tante propriétaire d’un maquis où à l’écart des beuveries, des clients avertis. La naissance de l'enfant va peut-être rassembler de nouveau cette famille désunie. Hélas ! l'enfant et la mère meurent à l'hôpital. Chacun, à sa façon, subit ce coup du sort. Par la confrontation de l'honneur, de l'amour et de la mort, c'est l'essence même du tragique qui se révèle en ce petit roman rigoureusement écrit.
Références bibliographiques
I – Contributions de Cheikh Aliou NDAO
NDAO (Cheik, Aliou), Buur Tilleen, roi de la Médina, Paris, Présence africaine, 1997, 335 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Dignité, ô femmes ! nouvelle, Dakar, Nouvelles éditions africaines, 2010, 189 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Du sang pour un trône ou Gouye Ndiouli un dimanche, Paris Harmattan, 1983, 157 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Excellence, vos épouses !, roman, Dakar, Nouvelles éditions africaines, 1983, 139 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), L’exil d’Albouri suivi de la décision, préface de Bakary Christophe Traoré, Honfleur, J-P Oswald, 1967, 131 pages et l’Harmattan, 1995, 272 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), L’Ile de Bahila, drame en cinq actes. Théâtre, Paris, Présence africaine, 1975, 66 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Le fils de l’Almamy, suivi de la case de l’homme. Théâtre, Honfleur, J-P Oswald, 1973, 76 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Le marabout de la sécheresse, Paris, Présence africaine, 1997, 335 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), MBaam, Dictateur, Paris, Présence africaine, 1997, 335 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Mogariennes. Poèmes, Paris, Dakar, Présence africaine, 1984, 54 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Un bouquet d’épines pour elle, Paris, Présence africaine, 1997, 335 pages ;
NDAO (Cheik, Aliou), Singali, l’orphelin, Abidjan, éditions Eburnie, 2015, 94 pages ;
NDAO (Cheik Aliou), «Abdou Anta Ka et le théâtre africain», Présence africaine, 1er semestre 1999, n°159, pages 204-206 et Walfadjiri, du lundi 15 maes 1999, n°2101 ;
NDAO (Cheik Aliou), «Le théâtral historique», Notre Librairie, octobre, décembre 1985, n°81, pages 85-89 ;
NDAO (Cheik Aliou), «Tradition africaine et Education», Demb ak Tey Ndao, 1982, n°7.
II – Critiques et biographies de Cheik Aliou NDAO
BA (Ibrahima), La tradition dans le théâtre de Cheik Aliou Ndao, thèse de 3e cycle, Lettres modernes, sous la direction du professeur Ousmane Diakhaté, Dakar, Université de Cheikh Anta Diop, CODESRIA, 12 mars 2003, 243 pages ;
DIADJI (Iba, Ndiaye), «L’esthétique de la plasticité africaine dans «MBaam dictateur» de Cheik Alioune Ndao», Présence africaine, 1999, Vol 3, n°161-162, pages 217-239 ;
DIOP (Boubacar, Boris), «Les langues africaines et la création littéraire», L’autre, 2011, pages 82-88 et Africultures, 2010, Vol 3, n°82, pages 134-144 ;
HERZBERGER - FOFANA (Pierrette), «Entretien avec Cheik Alioune Ndao, écrivain», Mots Pluriels, décembre 1999, n°12 ;
MBAYE (Moustapha), «La vie et l'œuvre de Cheik Aliou Ndao : quelques éléments de dramaturgie», Contributions à l'Étude dans le cadre
ROUSSIN (Claude), «Retour d’Afrique», Jeu, 1979, Vol 11, pages 10-16 ;
DIOP (Cheikh, S.), «Tradition théâtrale et identité sénégalaises. Contribution sur la pratique dramatique au Sénégal. Approche historique et analytique», Africultures, 22 juillet 2004 ;
KA (Abdou, Anta), La fille des Dieux, Les Amazoulous, Pinthioum Fann, Gouverneur de la rosée, Paris, Présence africaine, 1972, 203 pages ;
WANE (Ibrahima), enseignant à l’UCAD, «Conversation avec Cheik Aliou NDao», Amani TV, 10 février 2024, durée 1h14minutes03.
Paris, le 25 février 2025, par Amadou Bal BA



