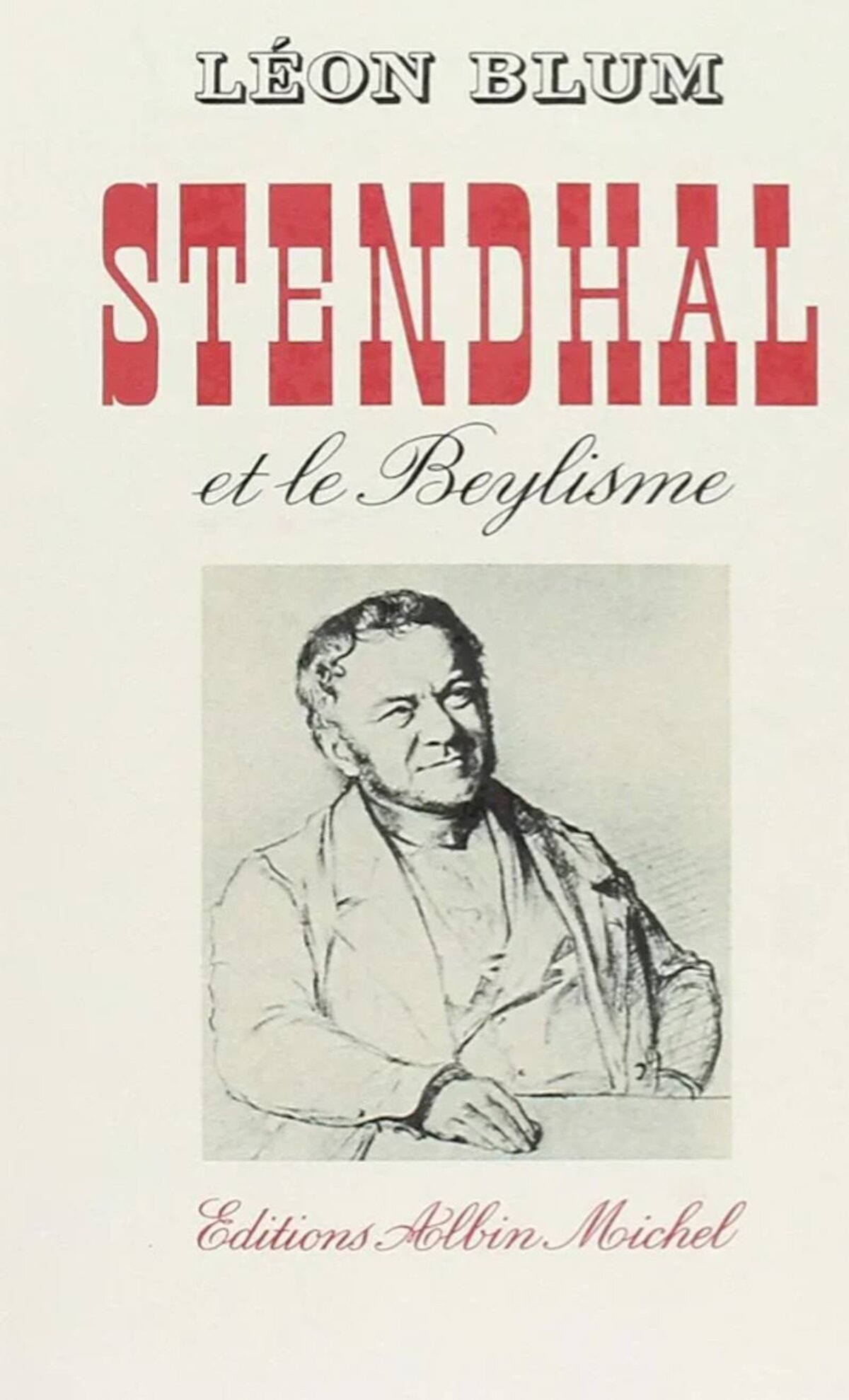
Agrandissement : Illustration 1
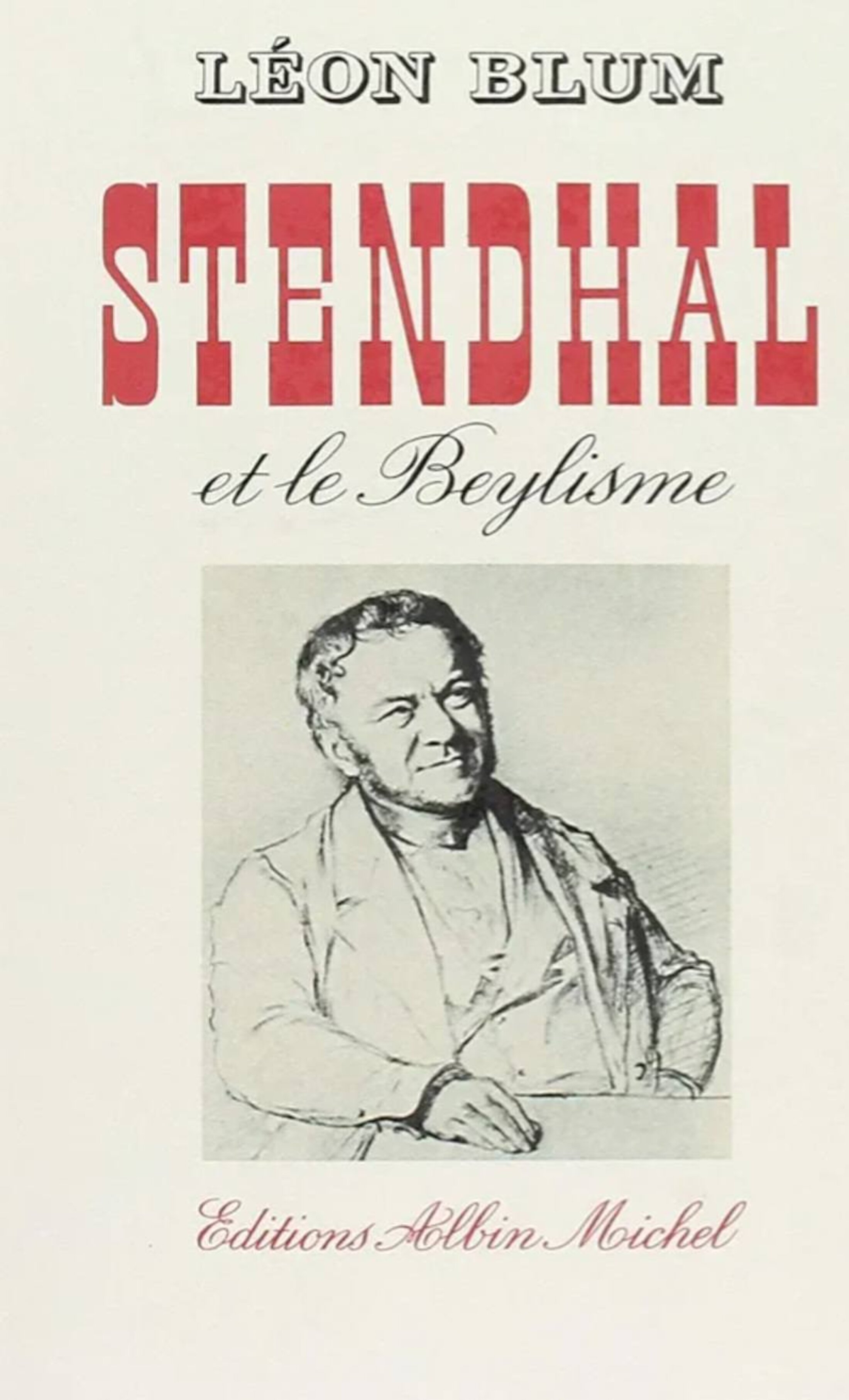
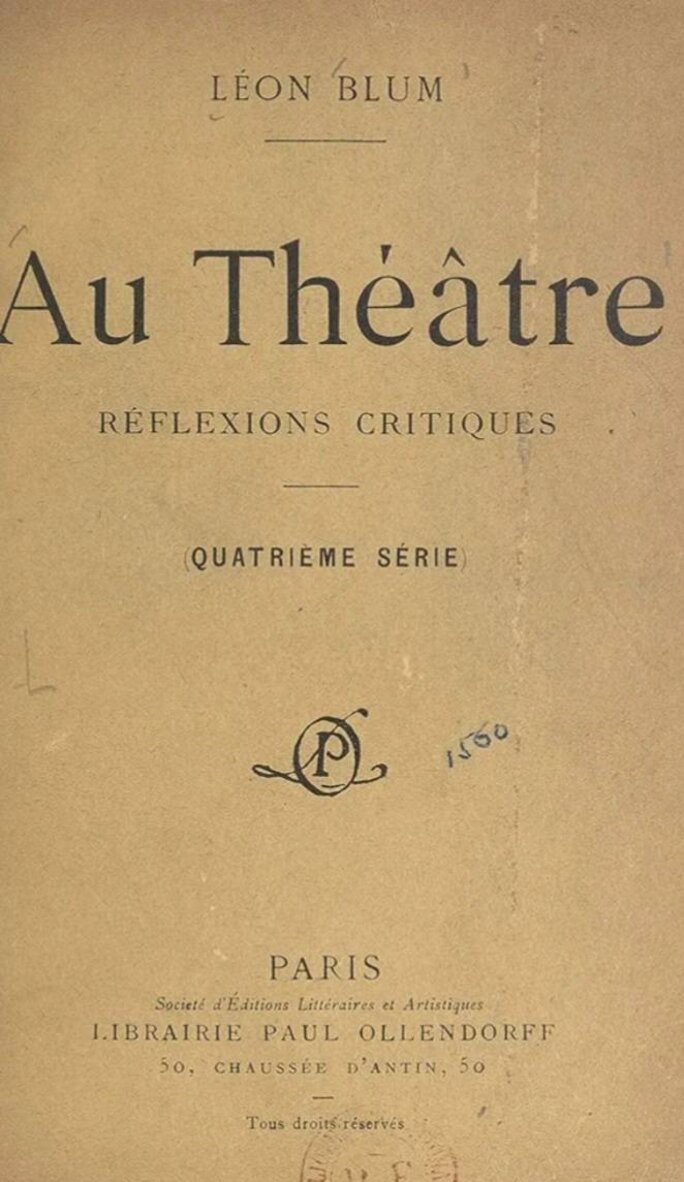
Agrandissement : Illustration 2
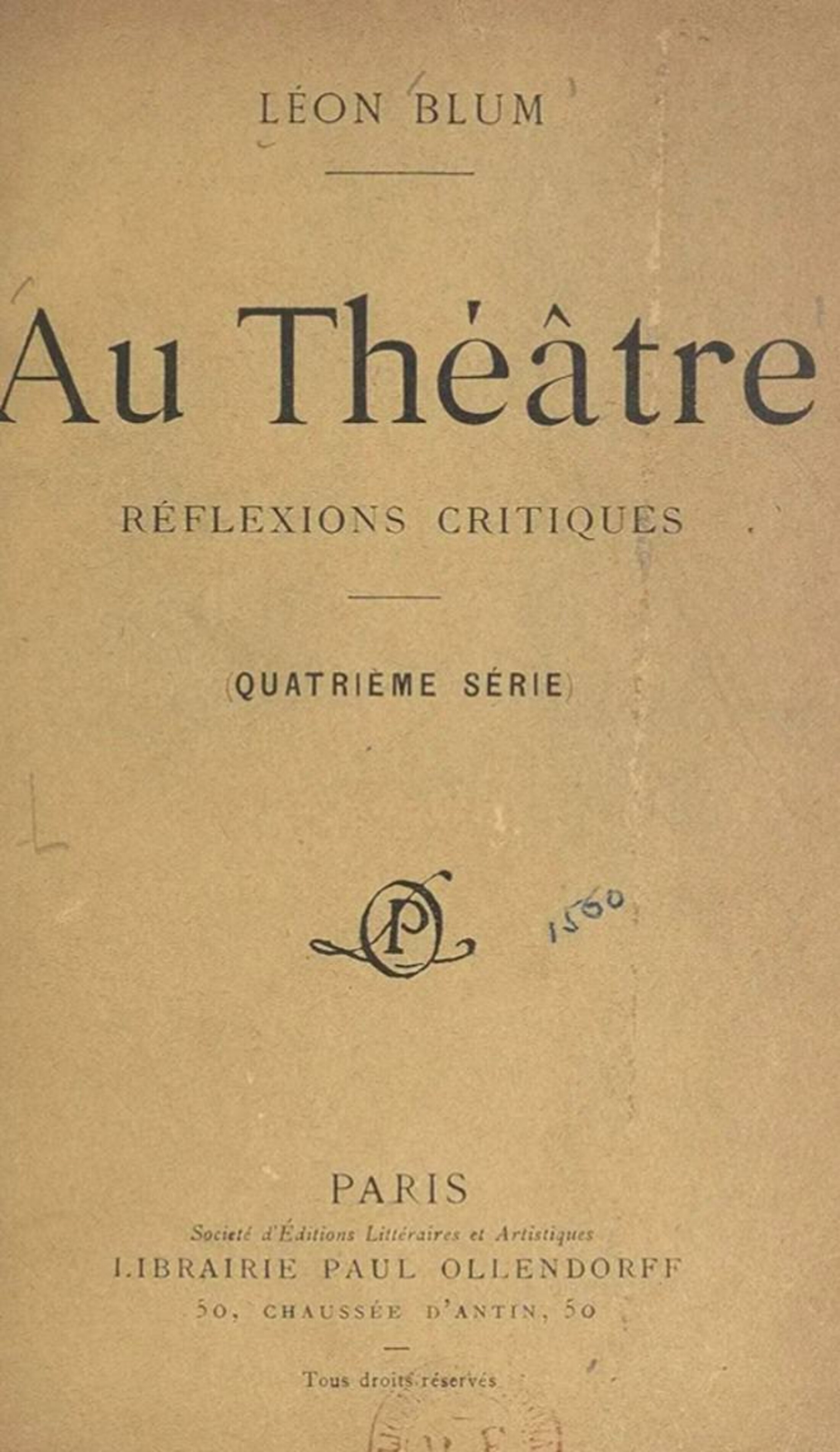
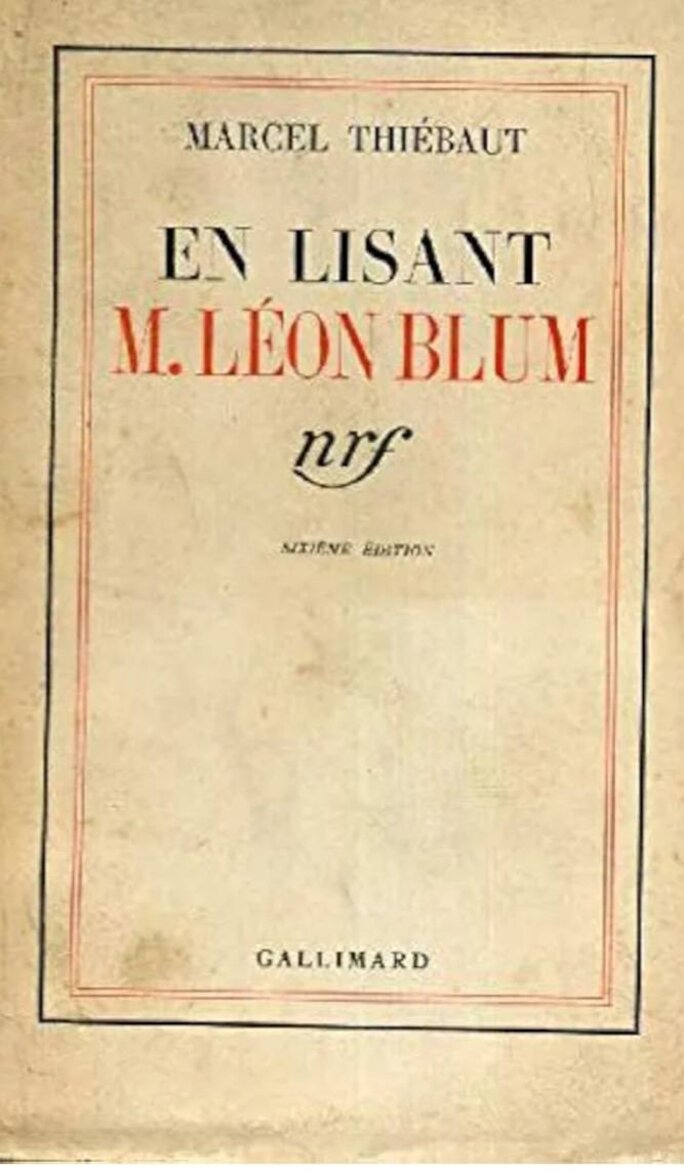
Agrandissement : Illustration 3
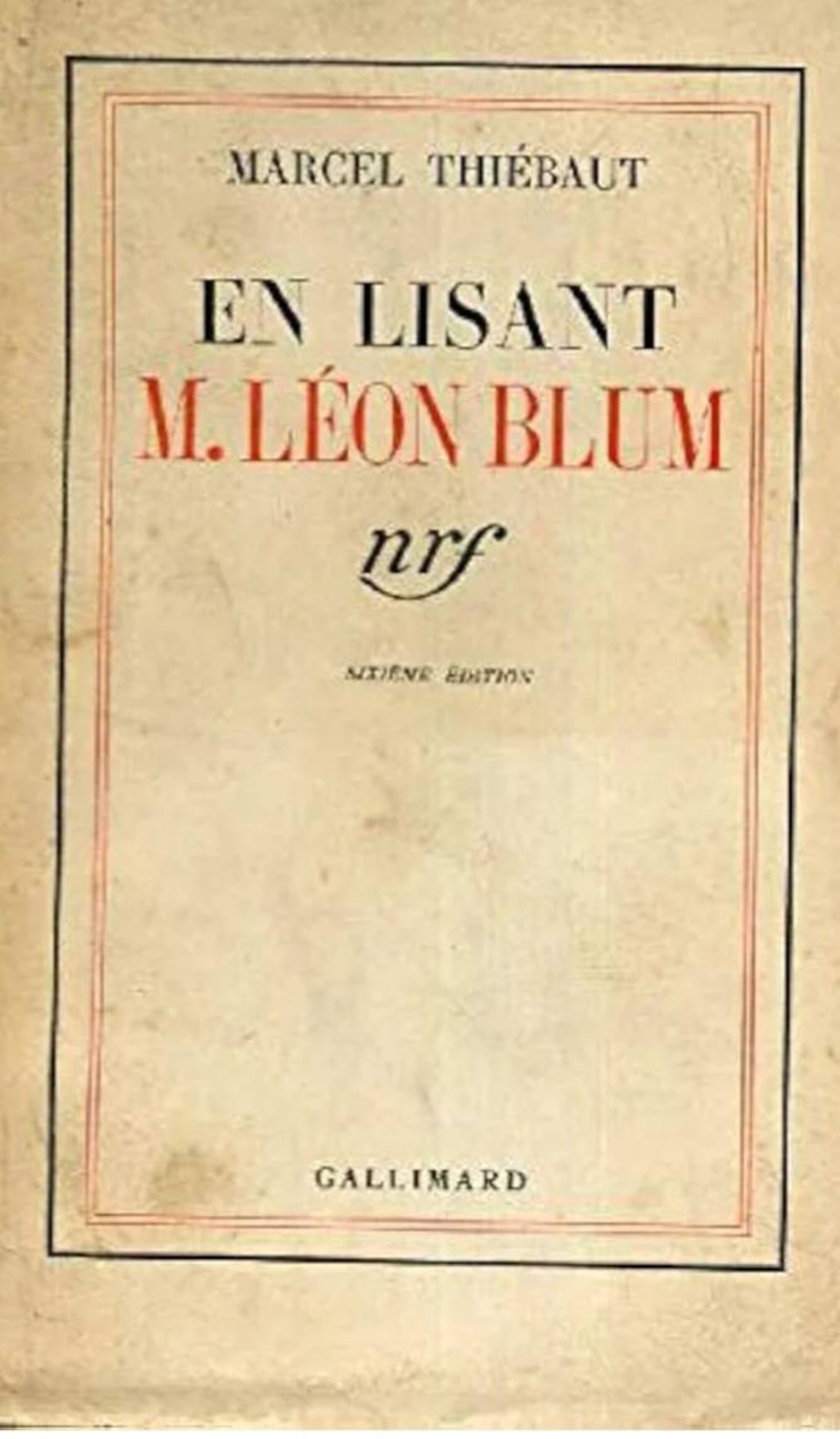
«Léon BLUM (1872-1950), chef du Front populaire, un critique et un génie littéraire. Une forte ambition littéraire phagocytée et occultée par son action politique» par Amadou Bal BA
Dans sa langue, ductile, riche et sobre, témoignant d’une vaste et savante culture, l’ambition littéraire de Léon BLUM, un avocat comblé et un homme politique de premier plan, vient d’une grande passion désintéressée. Les idoles littéraires de Léon BLUM sont notamment le britannique Thomas HARDY (1840-1928), l’Italien Gabriele d’ANNUNZIO (1863-1938), mais aussi et surtout, le Russe, Léon TOLSTOI (1828-1910). «Tolstoï domine de toute la hauteur du génie de la littérature européenne. «Guerre et paix» est le grand plus roman qui existe, plus beau que l’éducation sentimentale, et pour moi, c’est tout dire», écrit-il dans «En lisant». Aussi, Léon BLUM est sévère à l’égard du roman de ses contemporains, une critique littéraire qui sied bien à notre époque, pleine superficialité, de financiarisation, de marchandisation du livre ayant largement quitté sa plus-value culturelle. «L’influence sociale et intellectuelle du roman français contemporain me paraît tout simplement nulle. Le roman ne garde de la doctrine qu’une image atténuée ou infidèle. Souhaitons que, de plus en plus, nos romanciers prennent souci d’ajouter la culture au talent.», écrit-il dans «En lisant». En fait de la mévente des livres a émergé une culture de la «camelote» ; on vend des livres comme une paire de chaussures. Le livre est devenu «une marchandise brillante, flatteuse à l’œil, qui aguiche et qui tente, mais qui ne donne rien à l’usage», écrit-il. Pourtant, l’ambition littéraire ne doit pas être réservée uniquement aux riches. Cependant, «on aura un métier pour vivre, et on écrira, si un instinct impérieux l’exige, pendant les loisirs que laisse le métier dont on vit. Un seul homme n’a pas besoin d’écrire tant de livres. La plupart des vocations littéraires d’aujourd’hui sont faites moitié d’orgueil, moitié de paresse», écrit-il dans «En lisant».
Léon BLUM, né le 9 avril 1872 à Paris d’une famille juive de négociants d’origine alsacienne, composée de cinq enfants (Lucien, Mary, Thérèse et Jeanne). En 1870, à la suite de la défaite à Sedan, sa famille s’installe à Paris, une aristocratie séculaire, des travailleurs acharnés, bien intégrée en France. Son père est Abraham BLUM (1831-1921), un employé dans une affaire de tissu, en deviendra le patron. Sa mère, Adèle PICART (1841-1914), une femme très réservée, timide a un goût passionné pour l’équité. Il est décédé, le 30 mars 1950, à Jouy-en-Josas (Essonne). A l’école Normale supérieure, il rencontre Lucien HERR (1864-1926), un laïque et socialiste et accompagne les lectures des plus jeunes. Il entre, en 1905, au Conseil d’État. Il adhère en 1902 et participe à la fondation du journal l’Humanité. L’affaire Alfred DREYFUS (1859-1937) provoque son engagement littéraire à la revue Blanche, et rencontre l’intelligentsia (André GIDE, Paul VALERY, Marcel PROUST). En 1914, après la publication de «Stendhal et le Beylisme», il entre en politique, durablement. Il a marqué l'histoire politique française en tant que leader socialiste et président du Conseil, avec des réformes sociales majeures, notamment en 1936, lors du Front populaire, nous impact encore très favorablement dans nos conditions de vie, comme les congés payés.
Notre temps où on like, on commente sans lire, nous invite à plus de modestie, d’humilité et donc à revisiter, avec un grand profit, certains écrivains, comme Léon BLUM. En effet, 75 ans après sa mort, ce qu’on sait moins de Léon BLUM, avocat et homme politique, c’était un éminent critique littéraire, un génie littéraire. À la fin du XIXe et au début du XXe face à l’anarchisme, à la violence et à l’intolérance, ainsi qu’aux procès contre les intellectuels menés par les conservateurs et l’extrême droite, la gauche contre-attaque et Léon BLUM a pris sa plume de critique de littéraire, pour défendre la République «Le plus habile orchestreur et directeur de conscience intellectuelle de ce groupe s'appelait Léon Blum, promis depuis à de plus hautes directions. Né en 1872, il n'avait pas vingt ans lorsque, après un passage sans suite à l'École normale, lui fut confiée, en 1891, la critique littéraire de la Revue blanche, qu'il devait y exercer dix ans ; prélude à une autre collaboration aussi régulière à la Grande Revue. Politique à part, c'est exactement de premier ordre et d'un indéniable intérêt. S'il n'eût été tenté par l'action, et peut-être à la fin par le pouvoir, Léon Blum, critique, essayiste, aurait fait une belle carrière d'écrivain», écrit en 1954, Emile HENRIOT. La postérité a rendu hommage au talent littéraire de Léon BLUM. En effet, quand on lit, de nos jours, ses écrits, on se rend compte encore de leur vigueur et de leur pertinence. «Le plus remarquable de la critique de Léon Blum est qu'elle peut se relire encore avec intérêt après cinquante et soixante ans ; non toujours à cause des livres traités, mais en raison de la personnalité de l'essayiste et de ce qu'il est devenu depuis, en raison aussi de son réel talent d'écrivain, de son intuition, de son art de décortiquer et de dissocier les composantes des idées. Il sait tout, et il a tout lu ; sa culture était grande et belle, et déjà réaliste, il avait un sentiment», rajoute Emile HENRIOT. La qualité de son expression rend agréable et limpide sa contribution littéraire fluide, agréable à lire. «Il ne s'embarrassait pas de phrases et n'entortillait pas son discours, même sur des sujets subtils : il savait ce qu'il voulait dire, et on le savait avec lui. Son style va de même, agile, limpide et musclé, sans effets ; d'une dextérité parfaite dans la prise, et d'une intelligence extrême dans l'explication. L'intelligence quelquefois un peu glacée, cet homme supérieur et attaché à une idée avait plus de plaisir à comprendre et à avoir raison qu'à être ému», dit Emile HENRIOT.
Cependant, dans ces critiques littéraires, il est parfois impossible de distinguer l’homme politique de l’intellectuel. Aussi, il a réservé des charges violentes contre Maurice BARRES (1862-1923), et ses amitiés françaises, un brillant intellectuel de son temps, mais un homme d’extrême droite, ayant voulu être maître de la jeunesse. Comme Charles MAURRAS (1868-1952), cet écrivain est animé par la haine. «Il me semblera toujours, quant à moi, qu’en retrouvant, M. Barrès, j’ai regagné le pays de ma jeunesse. (…). La haine, le mépris, la volonté de devenir les plus forts par la violence physique, la certitude que la victoire définitive est due à la supériorité, à la primauté de notre race, voilà donc dans quel excès tombe finalement, M. Barrès», écrit en 1906, Léon BLUM, dans «En lisant, réflexions critiques». Il a aussi dépeint Anatole FRANCE (1844-1924). «On retrouve, dans ses écrits, l’affirmation résolue de convictions politiques et sociales, un ton continuel d’ironie qui s’amuse à dissoudre les idées et les institutions à en montrer la barbarie et l’absurdité, une négation tranquille étendue sur toutes les sortes de notions religieuses et politiques. Anatole France a pour but principal d’être utile et de servir ce qu’il croit être la vérité.», écrit Léon BLUM, dans «En lisant». En fait, Anatole FRANCE est l’héritier naturel de Voltaire et de Diderot, «de grands auteurs recherchant des vérités politiques et morales qui préparèrent une Révolution, et par-delà cette Révolution inachevée, c’est leur action qu’il continue et poursuit», écrit Léon BLUM.
Par ailleurs, c’est Léon BLUM qui a exhumé l’histoire de la «Chartreuse de Parme» de Henri BEYLE dit Stendhal (1783-1842), un roman majeur, mais largement éclipsé par le «Rouge et le Noir». En effet, suivant Léon BLUM, «La Chartreuse de Parme», roman d’apprentissage, écrit en 52 jours, en 1839, relatant Bonaparte, Waterloo, les royaumes italiens et leurs luttes intestines, est une comédie humaine, au sujet de l'itinéraire spirituel d’un jeune aristocrate italien, Fabrice del Dongo, «héros fort peu héros», un antihéros. À l’origine, à Parme, en 1832, Stendhal avait trouvé un manuscrit du XVIe siècle relatant une histoire scandaleuse d’une famille, celle de Vanossa Farnèse, un mélange de raffinement et de fureur, la brutalité primesautière des passions, le goût du risque, un amour farouche de l'art. Par ailleurs, Stendhal, attaché à la vérité, déteste l’histoire officielle, celle des courtisans, qui flatte, trompe et ment. Ce manuscrit relève donc de la vérité littéraire, à l’état brut, sans artifice. En effet, à Rome, vers 1450, la voluptueuse, Vannossa Farnèse, qui fut la femme la plus fantasque et la plus séduisante du temps, avait inspiré une ardente passion au cardinal Roderic Lenzuoli. Vanessa élevait un fils de son frère, Alexandre, aussi voluptueux qu’elle. Le jeune Alexandre, qui avait enlevé une très belle femme, est mis en prison et sévèrement gardé, mais parvient à s’échapper grâce à une corde que lui procure un complice. Dans cette Italie autrichienne et papaline, Alexandre devient donc le personnage de Fabrice, dans la Chartreuse de Parme, mais avec part d’autobiographie chimérique de Stendhal, modernisant ainsi ce roman.
Léon BLUM souligne que les romans de Stendhal ont une grande part autobiographique. Aussi, Stendhal décrit, de façon rapide et expéditive, ses personnages «Stendhal ne s'intéresse plus à ses héros. Si le plan du livre l'oblige à les faire vivre, il se débarrasse d'eux au plus court et les dépêche en de brefs épilogues. Sa sensibilité d'écrivain n'étant que sa sensibilité de jeune homme miraculeusement préservée au-delà des temps, il n'a pu et voulu saisir que les chaleurs d'émotion de la jeunesse, ses finesses de souffrance. Entre ses héros règne une communauté plus intime que celle de l'âge et du moment», écrit Léon BLUM. «Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route», écrit Henri BEYLE dit Stendhal, dans le «Rouge et le Noir». Maître du roman réaliste, Stendhal insiste sur la ressemblance quasi symétrique entre le monde réel qui inspire le romancier réaliste et celui qui est décrit dans l'œuvre. Léon a rendu hommage en 1914 à Stendhal. La vraie leçon de Stendhal, c’est l’éveil à la vie, l’ambition, les émotions, les souffrances, dans l’énergie. Le beylisme, par sa tonicité, est une drogue incitant à l’action. Stendhal «est dans l'histoire littéraire, des personnages qui déroutent les procédés ordinaires de la critique et qu'on se sent envie de traiter comme des personnages de roman. Stendhal appartient à cette famille d'esprits rebelles et singuliers, pour lesquels le goût prend un caractère tout personnel, et qui ont tour à tour souffert ou profité d'une sorte de partialité inévitable. Notre admiration pour lui fut de celles qu'on partage avec un orgueilleux silence, comme un trésor ou comme un secret. Nous l'avons aimé ; son influence est passée dans notre vie. La lecture infatigable du Rouge et Noir et de la Chartreuse fut vraiment une leçon d'énergie, ou si l'enseignement qu'en tiraient les fidèles ne tendait pas à l'inverse de l'action», écrit Léon BLUM, dans «Stendhal et le Beylisme».
Parmi les grands écrivains français on sent que Léon BLUM a hésité «Le roman est un genre incertain et vaste ; à défaut d’une supériorité éclatante, et qui s’impose, il est mal aisé d’y établir une hiérarchie», écrit-il. Cependant, en fréquentant ses écrits, on sent qu’il a une certaine tendresse pour certains grands écrivains français. En particulier, il a loué les romans écrits par certaines grandes de la littérature «Le roman sera devenu un domaine féminin, une sorte de genre réservé où on ne verra plus un homme s’aventurer sans un peu de surprise choquée. Mais les femmes que le succès pousse, redoublent d’efforts, et chaque jour, elles étendent, elles consolident leur conquête», écrit Léon BLUM. Il a vanté les talents littéraires d’Ana de NOAILLES (1876-1933) qui sont admirables «La qualité, l’abondance, la liberté spontanée de l’inspiration, une inquiétude qui se porte tout, une acuité extraordinaire du jugement et de sensation qui perçoit les rapports les plus secrets, les plus frappants entre les sentiments ou les objets, entre les gestes, les parfums ou les couleurs. Le style est, dans l’ensemble, d’une variété, d’une justesse, d’une abondance poétique que je ne puis qu’admirer», écrit-il. George SAND incarne le roman de «d’imagination envahissante et effrénée où s’est vrai débattu son grand talent», écrit-il.
En 1907, son livre, «Du mariage», fait un grand scandale en France, en préconisant, pour les femmes, des expériences préconjugales. «Le mariage, ou la monogamie, est une institution qui fonctionne mal, je me suis demandé s’il fallait l’abandonner radicalement, pour s’en tenir aux formes modernes de la polygamie, c’est-à-dire aux unions multiples et précaires ou s’il était possible de l’amender», écrit-il. En fait, Léon BLUM était trop en avance sur son temps. «J’ai été conduit à conclure que le mariage n’était pas une institution mauvaise, mais une institution mal réglée, dont on tire un mauvais parti», écrit-il. Pour lui, le bonheur conjugal repose sur la liberté. Léon BLUM dit aux jeunes filles, «Mariez-vous, vous ferez bien ; Ne vous mariez pas, vous ferez mieux».
À la mort de sa deuxième épouse, en 1938, Léon BLUM se rapproche de Jeanne LEVYLIER (1899-1982), une jeune femme de 27 ans sa cadette, amoureuse de lui depuis de nombreuses années. Soutien indéfectible durant ses années de détention, Jeanne parvient à rejoindre Léon Blum au camp de Buchenwald et à l’épouser en 1943. Après la Libération, ils reviennent s’installer dans la maison que Jeanne avait achetée en 1937 à Jouy-en-Josas, le Clos des Metz. Après la mort de son mari en 1950, Jeanne BLUM se consacre à une longue recherche universitaire et fonde en 1974, une école de la deuxième chance existe toujours aujourd’hui et affiche un taux de réussite exceptionnel. Jeanne BLUM a légué sa Maison à la municipalité de Jouy-en-Josas pour que celle-ci devienne un lieu de mémoire et de vie culturelle. Elle devient musée en 1986. Son fils, Eugène (1902-1975), est le père de Catherine et de Charles BLUM.
Références bibliographiques
I – Contributions de Léon Blum
BLUM (Léon), Au théâtre. Réflexions critiques, Paris, Paul Ollendorff, 1906, 362 pages ;
BLUM (Léon), En lisant. Réflexions critiques, Paris, Société d’édition littéraire et artistique, 1906, 376 pages ;
BLUM (Léon), L’œuvre de Léon Blum. Critique littéraire, 1891-1905, Paris, Albin Michel, 1954, 632 pages ;
BLUM (Léon), Nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann, Paris, éditions de la Revue Blanche, 1901, 312 pages ;
BLUM (Léon), Stendhal et le Beylisme, Paris, Paul Ollendorff, 1914, 318 pages.
II – Critiques ou biographies
Cercle Léon Blum, Léon Blum, une figure dans l’histoire, Paris, l’Encyclopédie du socialisme, 2006, 126 pages ;
CLOOUZET (Maxime), «Léon Blum, l’homme, l’écrivain», Homme du jour, 15 avril 1937, pages 1-10 ;
HENRIOT (Emile), «Léon Blum, critique littéraire», Le Monde, 23 juin 1954 ;
MONTETY de (Etienne), «Quand Léon Blum était critique littéraire et théâtral», Le Figaro, 30 novembre 2023 ;
PAGOSSE (Roger), DATTA (Venitta), Léon Blum, les années littéraires, 1892-1914, Paris, Société des amis de Léon Blum, 1988, 211 pages ;
PLANCHON (Ronan), «Léon Blum a investi la critique dramatique, pour mener la bourgeoisie vers le socialisme», Le Figaro, 3 novembre 2023 ;
REGNIER (Philippe), «La gauche, la littérature et les arts, de la Révolution à 1914», Histoire des gauches en France, 2005, pages 210-225.
Paris, 30 mars 2025, par Amadou Bal BA



