Le 10 mars 2023 la Silicon Valley Bank (SVB), la banque des start-uppers californiens, a fait faillite. Le bank run, la ruée massive d'épargnants vidant leur compte, a été déclenché par Peter Thiel, un célèbre investisseur, qui avait compris que quelque chose n'allait pas dans le fonctionnement de la SVB1. Thiel était un élève de René Girard, l'auteur de la théorie mimétique, à Stanford dans les années 1980. En retirant son argent, il a déclenché un mouvement mimétique, dont on craint encore les risques de contagion au reste du système financier. Revenons sur cette chronologie.

Agrandissement : Illustration 1

SVB, feu de paille ou Big One du système financier mondial
Un des problèmes des banques est celui de la liquidité, c'est-à-dire la disponibilité de l'argent pour leurs clients. Et leur hantise, quelque soit leur taille est le bank run, l'idée que tout le monde voudrait récupérer son argent au même moment. L'argent de l'épargne est placé à plus ou moins long terme, il n'est souvent pas disponible immédiatement. Depuis la crise des subprimes et les Accords de Bâle, une banque est tenue d'avoir 3% de liquidité immédiate. Le bank run, mettrait alors la banque en faillite, celle-ci serait obligée d'emprunter des liquidités à d'autres banques. Cet événement est improbable, il n'y a aucune raison pour que tous les clients viennent retirer du liquide au même moment, mais comme pour les labos P4 ou les centrales nucléaires, le risque zéro n'existe pas.
Le bank run peut aussi être une prophétie auto-réalisatrice. En pensant que la banque à des problèmes, les épargnants vident les coffres et génèrent ces problèmes. Aucune banque n'a assez de liquidité pour répondre à un bank run, un événement grandement incertain, elles peuvent donc toutes potentiellement s'effondrer. D'où l'intérêt pour les élites financières de mentir pour rassurer, à l'image d'un Bruno le Maire (Ministre de l'économie) ou d'une Christine Lagarde (Présidente de la BCE) en expliquant que « le système bancaire est sain » ou que « cela ne peut pas arriver en Europe ». Des affirmations fausses puisque 4 banques françaises sont dites « systémiques », c'est-à-dire intégrées au système financier ce qui représente un risque de contagion.
Après le bank run de 1929, le gouvernement américain accoucha du Glass Steal act de 1933, la grande loi de séparation des activités bancaires qui visait à séparer les activités de dépôts et d'investissements. Une banque ne pouvait plus jouer au casino boursier avec l'épargne de ses clients. Une loi qui sera progressivement détricotée par les démocrates de l'administration Clinton à la fin des années 1990.
Depuis sa création en 1983 la SVB était la banque des start-uppers de la baie de San Francisco. En 2022 elle est classée au seizième rang des plus grosse banques américaines. Le bilan financier de la banque était phénoménal, son chiffre d'affaire y avait été multiplié par quatre en cinq ans. Le fonctionnement de cette banque était légèrement différent des autres. Les start-ups bénéficient de beaucoup de fonds mais sont rarement rentables. Les premières années elles ne dégagent souvent aucun bénéfice, mais mise sur un rachat par un plus gros groupe.
L'idée de la direction de la banque était de faire fructifier ces sommes colossales d'argent reçu avec des obligations à long terme.
En 2020 et 2021, les taux d'intérêts étaient très bas, il ne coûtait rien de s'endetter, et la FED inonda l'économie américaine de monnaie (4.000 milliards de dollars) pendant les confinements. C'est cet argent que l'on retrouve dans les dépôts de la banque.
Durant les deux années de COVID, du fait du ralentissement de l'économie la banque n'accordait que peu de crédits et elle se retrouva avec d'importantes liquidité. Cet argent (98 milliards) fut placé à long terme et devait rester bloquer pour dix ans minimum. Quand la FED augmenta les taux, en passant en un peu plus d'un an – c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, de 0% à 5% les placements devenaient soudainement moins avantageux. On estime que la hausse de 1% des taux d'intérêts fait perdre 7% de la valeur de revente d'une obligation2.
Fin février les actionnaires s’inquiétèrent de cette situation. Toute leur épargne était bloquée dans des investissements qui se révélaient de moins en moins avantageux au gré de la remontée des taux. L'information circula rapidement sur les fils de discussions des réseaux sociaux.
Le bank run de mars 2023 se fit par smartphone. Les smartiens échangent entre eux et gèrent leur compte via une app. C'est la plus grosse panique bancaire de l'histoire, la plus rapide surtout. La banque se retrouve à terre en moins de 24 heures.
Ce risque de contagion est nouveau. Car si la banqueroute a toujours existé, la technologie accélère le processus. Le 11 mai 2019, suite à la diffusion sur WhatsApp d'une fausse information, la Metro Bank dû faire face à une foule d'épargnants de la communauté Tamoule de Londres voulant vider leurs comptes. Quelques jours après, Jens Weigmann le président de la Deutsche Bundesbank, la banque fédérale allemande note dans un discours intitulé Prométhée à l'ère technologique que ces évolutions représentent un danger pour la stabilité et accroît la volatilité. Grâce aux smartphones, les clients ont accès plus facilement et rapidement aux informations, et aux rumeurs, et peuvent transférer les sommes en en clic.
Les mouvements de paniques ou d'euphories, les bulles ou les krachs ne seraient plus simplement l'oeuvre des professionnels de la finance, mais aussi celle des smartiens.
Comportement mimétique
En théorie, les marchés sont efficients et les acteurs qui y interviennent disposent tous des mêmes informations. Personne ne peut avoir une information dont d'autres ne pourraient pas jouir, auquel cas il s'agit d'un délit d'initié.
Dans ce cas comment fonctionnent les marchés ? Si tous les acteurs qui y interviennent sont à égalité, comment prendre une bonne décision ? C'est ici qu'intervient une théorie qui remet en cause la rationalité économique et l'idée de marchés efficients. Celle d'une forme de mimétisme.
Peter Thiel et René Girard
Revenons à l'affaire de la SVB. La banque fût créée en 1983, au moment où Reagan changeait la réglementation bancaire. Un appel d'air qui participa à la création de 72 banques en Californie et près de 400 au niveau national. Cette banque fût créée au cour d'une partie de poker3. Un jeu, qui repose sur le bluff, c'est-à-dire non pas tant sur la qualité du jeu que vous avez en main, mais sur votre capacité à faire croire à votre adversaire que vous avez autre chose en main que ce que vous avez réellement. Si vous faites tapis avec un mauvais jeu , alors votre sort dépendra de la perception de la situation qu'aura votre adversaire.
Un des clients de SVB était Peter Thiel, un des investisseurs star de la Silicon valley. C'est lui, qui en retirant en urgence ses cinquante millions de dollars, allait déclencher la boucle mimétique de la panique bancaire. 4Peter Thiel a la réputation d'avoir le nez fin. Paypal, Facebook, Air Bnb, Spotify ... il a participé au lancement des start-ups les plus célèbres ces vingt dernières années.
Dans sa biographie The Crontrarian, il est décrit comme « un homme dont l'identité s'est construite dans l'opposition, dans le contre-pied, autour d'un désir de singularité, à l'écart des troupeaux collectivistes »5. Thiel est un original. Il est de droite, une hérésie pour laSilicon Valley, soutien de Trump, il vomit le conformisme, la bien-pensance, le politiquement correct et le multiculturalisme de façade de San Francisco. Il est le pendant réactionnaire de la technocratie, même si il reste en accord sur les sujets fondamentaux avec les boudhistes végétariens d'Apple (techno-solutionnisme, transhumanisme …)
Thiel a été l'élève de René Girard dans les années 1980 à Stanford. Girard est une véritable boussole dont il conseille les livres à ses partenaires économiques, et il lui rend régulièrement hommage dans ses écrits, interviews et discours. Thiel a crée l'Imitation Institute pour continuer les recherches sur la théorie mimétique de Girard. Le risible de cette histoire est donc que ce soit un adepte de Girard qui déclenche le mouvement mimétique de la panique boursière.
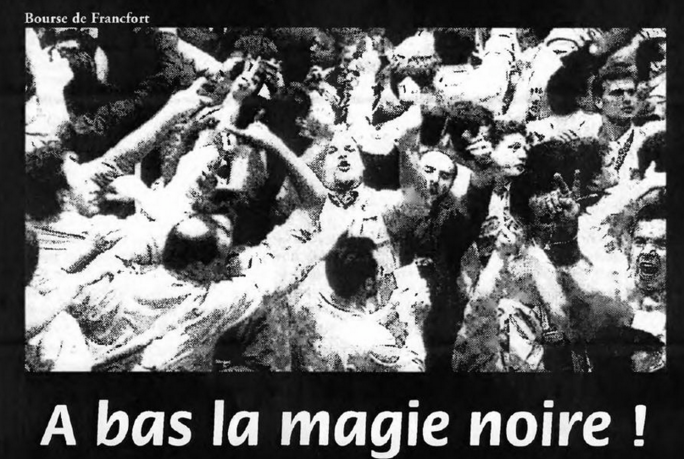
Agrandissement : Illustration 2
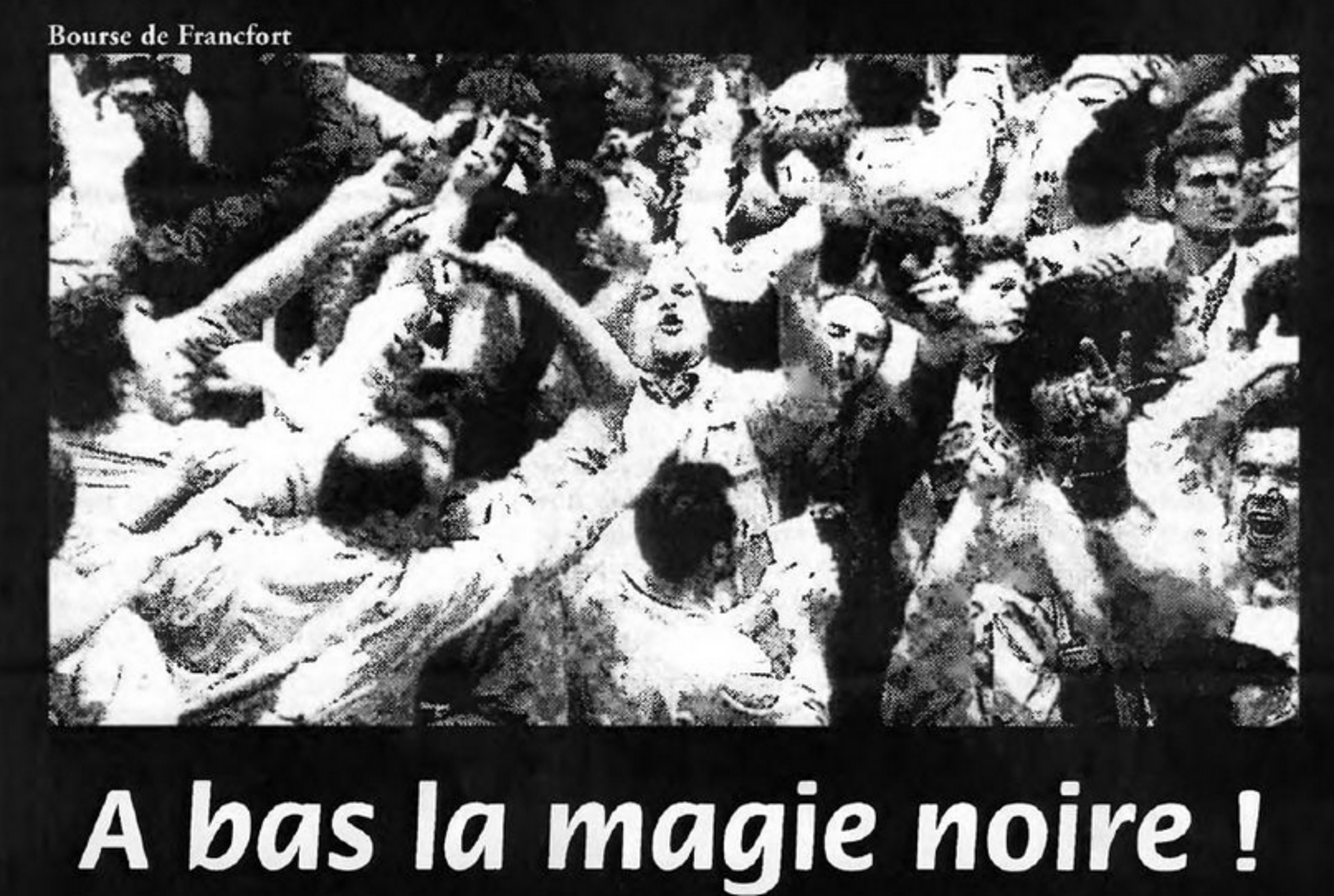
Mieux vaut avoir tort avec tout le monde que raison tout seul
À la fin des années 1970, André Orléan rédige une thèse d'économie et découvre René Girard à travers son livre La violence et le sacré6. Pour Orléan, les mécanismes propres aux dynamiques spéculatives sont en contradictions avec l'analyse traditionnelle des marchés de la loi de l'offre et de la demande. La théorie, celle d'acteurs ayant une attitude rationnelle, celle d'un signal-prix, marche en théorie. Avec la pensée de Girard, Orléan trouve une explication à certains phénomènes que la science économique ne peut expliquer.
Résumons. Girard a vécu l'ensemble de sa carrière de 1947 à sa mort en 2015 aux USA. L'économie est très éloignée de ses domaines de prédilections : étude littéraire, analyse des religions, anthropologie religieuse. Au fil des années il a développé une explication totale des relations entre les individus et les sociétés fondée sur ce qu'il appelle le désir mimétique. Pour résumé schématiquement, l'individu ne sait pas ce qu'il désir, car le désir naît du désir de l'autre. De ces désirs contrariées naît la violence. C'est là qu'entre en jeu l'institution qui contient, dans les deux sens du terme, la violence. Elle la contient en son sein, autant qu'elle l'empêche de se répandre. L'économie est certes la guerre de tous contre tous, mais c'est aussi une façon de canaliser la violence du désir mimétique.
Girard ne s'est intéressé qu'à un type d'objet dont le partage est impossible : les humains. Avec la fin du sacré, l'économie va devenir le système de régulation des relations entre les humains. Le désir mimétique, va se porter sur des biens reproductibles à l'infini, comme la marchandise ou la monnaie (Jean-Pierre Dupuy, L'enfer des choses, 1979). Ainsi, deux hommes ne s'entretueront plus pour une femme, mais pourrons rivaliser de conformisme dans l'accumulation matérielle. Un des domaines où la théorie mimétique fonctionne le mieux est celui de la mode, ou le désir de conformisme ou d'anti-conformisme se fait toujours par rapport au regard de l'autre. On n'achète pas une Rolex pour regarder l'heure et on ne porte pas des « claquettes-chaussettes » comme un touriste hollandais, symbole du mauvais goût, par choix. On le fait parce que c'est une façon de se conformer ou se distinguer via le regard de l'autre.
Dans La violence de la monnaie, Orléan et Aglietta montrent que l'analyse de Girard est opérante pour un certain nombre de fait économique : les marchés boursiers, phénomènes spéculatifs, l'euphorie (bulle) ou la panique (krach). Faire appelle à un penseur ne s'étant jamais intéressé à l'économie pour faire une analyse des marchés financiers pose question admettent les auteurs, mais comme le rappelle Orléan « Il n'est pas de théorie économique sans hypothèses sur la nature humaine » car le marché est avant tout une institution sociale. Et c'est Girard qui offre l’explication la plus rationnelle à l'irrationalité apparente des marchés.
L'analyse girardienne de la Bourse apporte un certain nombre de réponse à la question pourquoi cela ne fonctionne pas ? Le marché est auto-référentiel, il se regarde lui-même. Il se regarde le nombril. Les humains s'observent mutuellement pour prendre des décisions, comme le font les algorithmes aujourd'hui. C'est l'instinct grégaire qui domine.
Actuellement 95% des ordres boursiers sont annulés7. Nombre de techniques de trading consistent à « bluffer », comme au poker, c'est-à-dire à provoquer le marché pour voir sa réaction. Les investisseurs ne regardent pas la stratégie économique de Total ou les décisions de Macron, ils observent comment le marché va y réagir. Certains marchés essentiels, comme celui des matières premières ou celui du logement, sont régit par cette logique spéculative. Plus ils augmentent, plus ils augmentent. Qu'importe le réel, il est plus rentable d'avoir tort avec tout le monde que raison tout seul.
La théorie mimétique trouve son acmé dans les marchés à termes. Un contrat à terme (future) comme l'écrit William Cronon dans son livre sur l'histoire de Chicago (Nature's metropolis, 1994 non traduit), est un contrat, où des gens achètent une marchandise qu'ils ne veulent pas et qu'ils n'ont pas les moyen d'entreposer, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, et qu'ils revendent à des gens qui n'en veulent pas non plus. Sur un marché à terme on n'achète pas une marchandise, on paris sur l'évolution de son prix. On tire profit du désir de l'autre. Speculum,racine de spéculation, signifie en latin « regarder quelque chose dans un miroir », il s'agit d'acheter le reflet de la marchandise.Ceux qui échangent des dérivés de pétrole se fichent bien des rapports du GIEC et de l'état d'avancée du peak oil, mais pas de la façon dont le marché va en prendre connaissance.
Keynes, trente ans avant Girard, dit sensiblement la même chose « la spéculation est l'activité qui consiste à prévoir la psychologie du marché » et que le bon spéculateur est celui qui « devine mieux que la foule ce que la foule va faire »8. Steve Keen, qui fait parti de la petite dizaine d'économistes à avoir vu venir la crise des subprimes, estime que les trois quart de l'instabilité des marchés est endogène. « De la même manière que des chiens voisins peuvent parfois continuer d'aboyer presque sans fin après que l'un d'eux ait commencé »9. L'instabilité du marché correspond à sa propre réaction devant sa volatilité. La théorie girardienne adaptée à l'économie reste étonnamment d'actualité.
NOTES
1 Le meilleur article sur ce sujet est celui de Olivier BERRUYER, « Silicon Valley Bank, Crédit Suisse etc : tout le système bancaire est instable », Élucid Média, 23 mars 2023
2 C'est ce qu'il se passe en France avec le livret A. L'inflation annule le rendement.
3 « La chute de la Silicon Valley Bank : née au cours d'une partie de poker, détruite par un pari risqué », Vanity Fair, 20 mars 2023
4 En vérité la première alerte est celle de Byrne Hobart, un bloggeur influent dont la newsletter est suivie par beaucoup de monde. Mais c'est une semaine plus tard, quand Thiel a retiré son argent que le bank run a commencé.
5 « Peter Thiel, le cavalier solitaire de la Silicon Valley » Le Monde, 19 novembre 2021
6 « Pour une approche girardienne de l'homo oeconomicus », dans René Girard, l'Herne, cahier n°89, 2008.
7 Laurence SCIALOM, La fascination de l'ogre, Fayard, 2019
8 Théorie générale de l'emploi, 1936
9 Steve KEEN, L'imposture économique, éditions de l'Atelier, (2011) 2014, page 430



