Réflexions stratégiques sur une marche poussive vers l'indépendance et la République catalane ... (suite)
(extraits, traduits de l'espagnol, de Projet de République ou République imaginaire ? de Josep María Antentas)
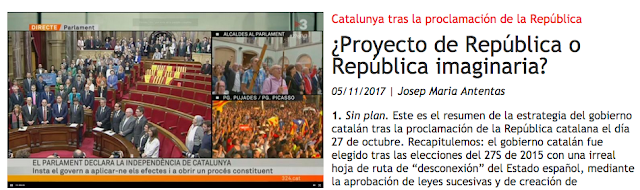
[…] La polarisation réactive, impulsée par l’accélération du processus indépendantiste en septembre-octobre, a favorisé, à court terme, les forces conservatrices dans l’Etat espagnol, en amenant le bloc pro-Régime et tout l’appareil d’Etat, sous hégémonie des secteurs les plus conservateurs, à serrer les rangs. Leur projet de restauration est une sorte de résistancialisme offensif. Un « résistancialisme » car il est incapable de prendre en charge une réforme menée d’en haut qui, d’une part, intègre partiellement les demandes de ceux qui aujourd’hui se retrouvent en dehors du cadre politique de 1978 [année du référendum constitutionnel établissant l’actuelle monarchie parlementaire] (la base sociale de Podemos et de l’indépendantisme catalan) et, d’autre part, génère une autre répartition du pouvoir politique et institutionnel ainsi qu’une intégration économique et sociale du gros des classes moyennes, des travailleurs qualifiés et de la jeunesse qualifiée précarisée. « Offensif » car, très agressif et autoritaire, il caresse l’idée de profiter de la crise catalane pour recentraliser toute la structure de l’Etat espagnol et isoler et minoriser Podemos. Mais, à court terme, la logique même de ce résistancialisme offensif aggrave toujours plus les causes de fond de la crise du cadre politique crée en 1978.
[…] La principale complexité de la politique catalane vient de ce que, d’une part, le 15M [mouvement des Indigné-es de 2011] et ses vies postérieures et, de l’autre, le processus indépendantiste ont fait naître des attentes sur l’avenir qui ont bifurqué, bien qu’elles présentent, sans aucun doute, des zones de contact. Cette bifurcation d’horizons exprime, dans un sens plus large, la complexité de l’ajustement entre la question sociale et la question nationale dans la politique et la société catalanes. Et, sur un plan plus concret, cette complexité ouvre sur un défaut d’alliance entre indépendantistes et fédéralistes défenseurs du droit d’autodétermination, suivant un scénario où la non-normalisation de l’exercice dudit droit pourrait permettre de trouver un terrain d’action commun.
La limite politique fondamentale du mouvement indépendantiste a été de dissocier son objectif d’un Etat propre d’une politique concrète anti-austérité et de régénération démocratique. Obsédés par l’idée de ne pas perdre en chemin la droite catalane, les promoteurs du mouvement indépendantiste ont été dépourvus, depuis le lancement de celui-ci, d’une analyse solide de la structure sociale catalane, des secteurs que tout projet de changement social doit pousser à s’impliquer, de la façon de s’adresser à la base sociale de la gauche non-indépendantiste, en somme d’une analyse qui aille au-delà de penser que, tôt ou tard, ils se laisseraient convaincre ou ils s’adapteraient. Une République catalane compatible avec une visée indépendantiste ou confédérale, un processus constituant catalan et un plan de sauvetage citoyen immédiat, voilà les trois éléments sur la base desquels il aurait été possible de dépasser la série de contradictions enchaînées qui surgissaient de la bifurcation des futurs entre ce que fut le 15M et ce qu’a été le processus indépendantiste. Aussi grave que l’impossibilité d’opérer ce dépassement aura été la surprenante faible attention stratégique que les principaux acteurs de la politique catalane lui auront consacré durant ces cinq années. Une tentative de s’atteler à résoudre ces contradictions impliquait de circuler à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du procés, une tâche indiscutablement complexe mais que la gauche aurait dû assumer comme sienne.
[…] Dans l’indépendantisme, la CUP a, évidemment, représenté un projet qui allait beaucoup plus loin que l’indépendantisme « pur et simple » et elle a défendu un programme qui, non seulement reliait la question nationale et la question sociale et se coltinait les apories de l’indépendantisme officiel, mais aussi défendait une option ouvertement anticapitaliste et de rupture qui établissait une contre-tendance à la croissante institutionnalisation de la majorité des « forces du changement » ayant surgi en 2014 et 2015. Mais elle est trop restée prisonnière de son honnête et sincère rôle de garante que le processus indépendantiste aille jusqu’au bout et elle n’a pas eu une politique offensive de discussion et de positionnement en direction de la gauche et de sa base sociale qui circulait hors du processus indépendantiste. De son côté, la gauche extérieure à l’indépendantisme, comme Catalunya en Comú [le parti d’Ada Colau, la maire de Barcelone], a pratiqué une politique passive d’observatrice. Elle a pointé beaucoup de problèmes réels inhérents à la proposition indépendantiste officielle, parmi lesquels, on trouve la vacuité de l’idée d’« indépendance » présentée comme la panacée, la difficulté à matérialiser le projet indépendantiste, la polarisation identitaire qu’il pouvait générer et le silence fait sur d’autres questions et conflits sous l’omniprésence du débat national. Mais le manque d’implication réelle de cette gauche dans le processus l’a empêché d’intervenir sur les problèmes qu’elle soulignait. Sa politique représente une sorte de paradoxe de la passivité selon laquelle les contradictions et les aspects négatifs d’une situation qui justifient une politique passive ne font qu’augmenter comme conséquence de cette dernière. Cette spirale infernale de la passivité présente un côté de prophétie autoréalisée et, en quelque sorte, reflète une espèce de nostalgie stratégique d’une réalité inexistante d’où seraient absents le processus indépendantiste et la question nationale.
[…] Le chemin qui mène au 21 décembre est encore difficile à cerner. L’incarcération des membres du gouvernement catalan qui ne sont pas à Bruxelles montre que les élections ne vont pas se dérouler, heureusement ou malheureusement, dans un contexte de normalité. C’est là, précisément, la clé de la situation. Empêcher que la dynamique imposée par Rajoy ne finisse pas par être acceptée, par résignation, comme normale. Le putsch contre le gouvernement catalan arrive suite à un énorme vide de leadership et une crise de direction dans l’indépendantisme. Le message enregistré depuis Bruxelles, le jeudi 2 novembre, par le président Puigdemont, où il critique les arrestations, résume l’incapacité montrée ces jours-ci par le gouvernement catalan : la condamnation logique de l’offensive répressive a été suivie d’un vague appel à la mobilisation, mais sans que soit faite la moindre proposition concrète ni donnée la moindre perspective. Les premières réactions après les arrestations (rassemblements devant le Parlament et les principales places de plusieurs municipalités) devraient être suivies d’une grève générale le 8 novembre et d’une grande manifestation le 11. Il est encore trop tôt pour estimer l’importance que tout cela va prendre mais, avec la moitié du gouvernement en prison et l’autre moitié sans initiative politique, tant l’ANC et l’Omnium que les forces politiques indépendantistes et celles qui s’opposent à la répression d’Etat, doivent assumer un rôle de leadership et fixer un agenda clair de mobilisation inscrite dans une perspective stratégique qui lui donne du sens. Les préparatifs électoraux n’aident pas à se concentrer sur cette tâche. Si se met en place d’en haut un agenda défini, la dynamique par en bas, impulsée par les Comités de Défense de la République (CDR) pourrait redevenir importante. Les CDR pourraient jouer, comme ils l’ont fait entre le 20 septembre et le 3 octobre, un rôle de débordement partiel des structures officielles. Mais ils ne semblent pas avoir la force de mettre en place un agenda de lutte menée d’en bas, si d’en haut n’arrivent pas les signaux qui poussent dans ce sens et si, au contraire même, s’y affirment des symptômes de paralysie et de désorientation.
[…] Il s’avère complexe de dessiner les contours du possible résultat électoral, mais il pourrait ne pas entraîner une altération très significative de ce qui s’est produit lors des précédentes élections, de 2015. L’indépendantisme a, sans conteste, gagné des appuis suite à la répression du référendum du 1er octobre. Mais les zigzags du gouvernement catalan entre le 1er et le 27 octobre et sa paralysie, après cette date, ont décontenancé une partie de sa base sociale. A l’inverse, le bloc espagnoliste a réussi, pour la première fois en cinq ans, à émerger comme une force sociale pesant dans la rue et, avec la convocation d’élections le 21, il a trouvé un objectif pour se battre. Ce n’est pas tant dans les sympathies pour telle ou telle option que dans la capacité de mobilisation de leurs partisans que se trouve la clé du résultat de ces élections. Et c’est là le point faible des forces indépendantistes. Voilà pourquoi la campagne pour le 21 décembre doit être rapportée à l’existence ou pas d’une dynamique de mobilisation extra-électorale significative.
Suite et fin de cet article dans un prochain billet de ce blog.
Traduction et précisions entre crochets : Antoine Rabadan
L’article en version originale est à lire ici
Josep Maria Antentas, est professeur de Sociologie à l’université Autonome de Barcelone (UAB) et fait partie du Conseil éditorial du site électronique et de la revue papier viento sur.
Première partie de cet article : Comprendre les faiblesses de l'indépendantisme catalan pour essayer de rebondir (1)



