Le participatif relèverait d’une forme de probité candide et de lin blanc, s’il faut en croire la définition du Littré : « Participatif : qui a la vertu de participer. » Quant à la participation, elle procède aussi bien du religieux (participer de la divinité chez saint Augustin), que du commerce (société en participation). Le modèle participatif de la presse en ligne en général et de Mediapart (apocope de « média participatif ») en particulier, n’est donc pas né de la dernière pluie.
Le surgissement participatif n’en fut pas moins surprenant. Une foule électronique est apparue sous nos yeux, se massant sur la Toile, chamboulant l’ordre des choses. Le financement participatif (« crowfunding » pour les franglaisants) a permis aux internautes de prendre en main ce que l’aboulie des économies en crise avait laissé tomber. Poussant l’avantage des 3 D (désintermédiation, décloisonnement, déréglementation), le peuple numérique conquiert le pouvoir et s’impose aux banquiers qui s’émeuvent.
L’émotion est reine, comme l’illustrent les multiples chapelles ardentes, ces structures agrégatives qui se forment, se développent et prospèrent ; qui prennent corps à l’occasion d’un trépas. La modernité dématérialisée a revivifié l’archaïsme le plus puissant : le culte des morts. On ne se déplace plus au cimetière mais on se mobilise sur Internet, lieu de cérémonies, de lamentations, d’embaumement, de nécropoles et de stèles. Le thrène est désormais numérique. Les pleureuses itou. C’est une sensation physique étreignant le passant, qui ralentit sur des autoroutes de l’information encombrées de rites funéraires.
TARDE, LE BON, OU CANETTI ?
De la foule à la horde – héroïque ou criminelle –, il n’y a parfois qu’un pas, franchi en toute défiance par Gustave Le Bon : « Évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans un même sens, tendance à transformer en actes les idées suggérées, tels sont les principaux caractères de l’individu en foule. » (Psychologie des foules, 1895).
On sait que Gabriel de Tarde (Le public et la foule, 1898) réfutait de tels dangers outranciers et despotes propres aux masses, en lesquelles il préférait distinguer des publics physiquement séparés – les lecteurs d’un journal, par exemple –, aux centres d’intérêts et aux appartenances sociologiques différenciés. Le public se vérifiait foule apprivoisée, horde domptée : un ensemble démocratique constitué d’alvéoles, de niches, de communautés spirituelles, bref, de courants d’opinion.
Or la révolution numérique semble venir ruiner le commerce rationnel, l’interactivité civile et civilisée, la transaction policée entre émetteurs et récepteurs analysés par Tarde, au profit de l’irruption déraisonnable que craignait Le Bon. N’y a-t-il pas péril en la demeure du fait d’une agrégation électronique effrénée, qui se métamorphose en incarnation digitale extravagante ?
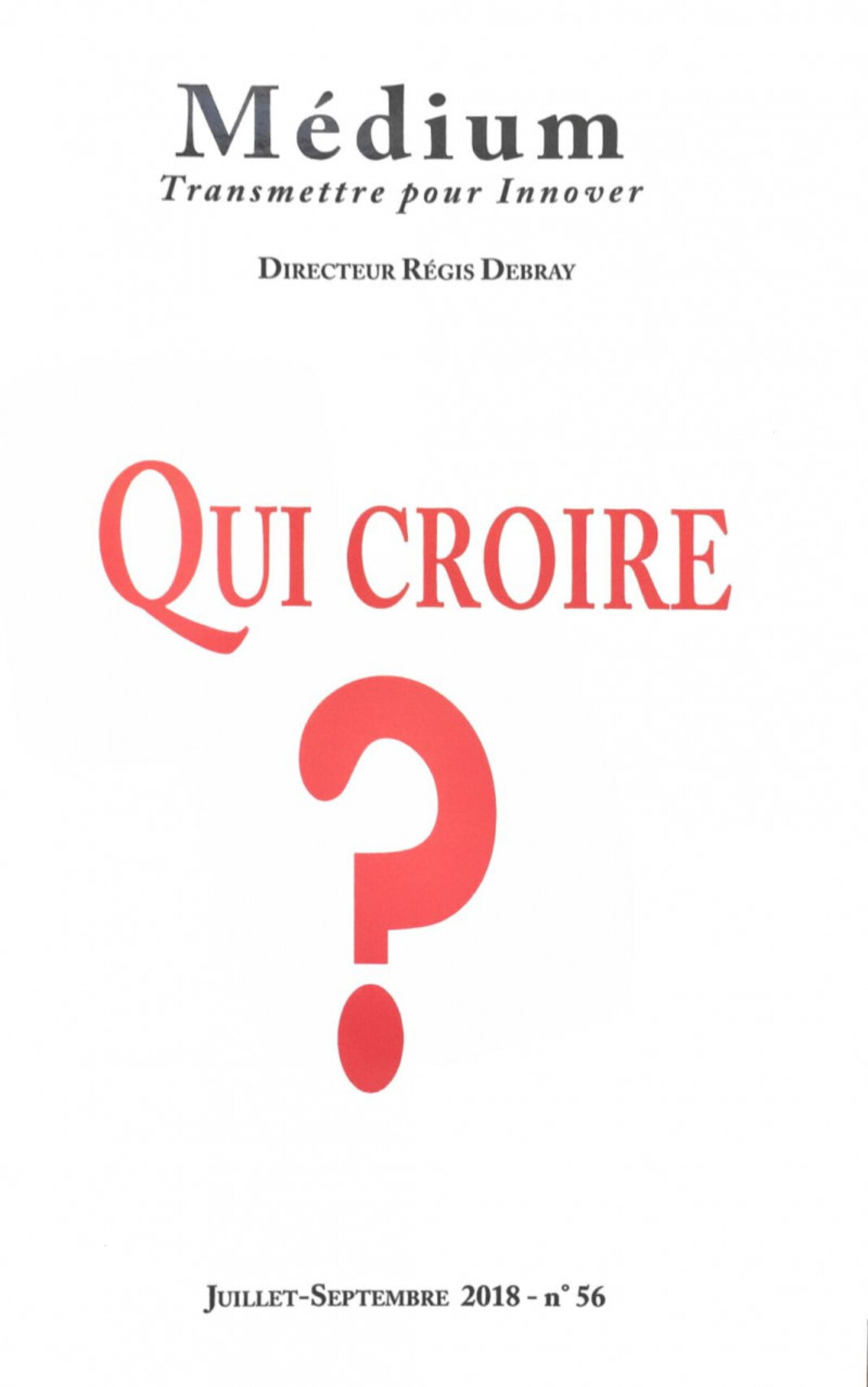
Agrandissement : Illustration 1
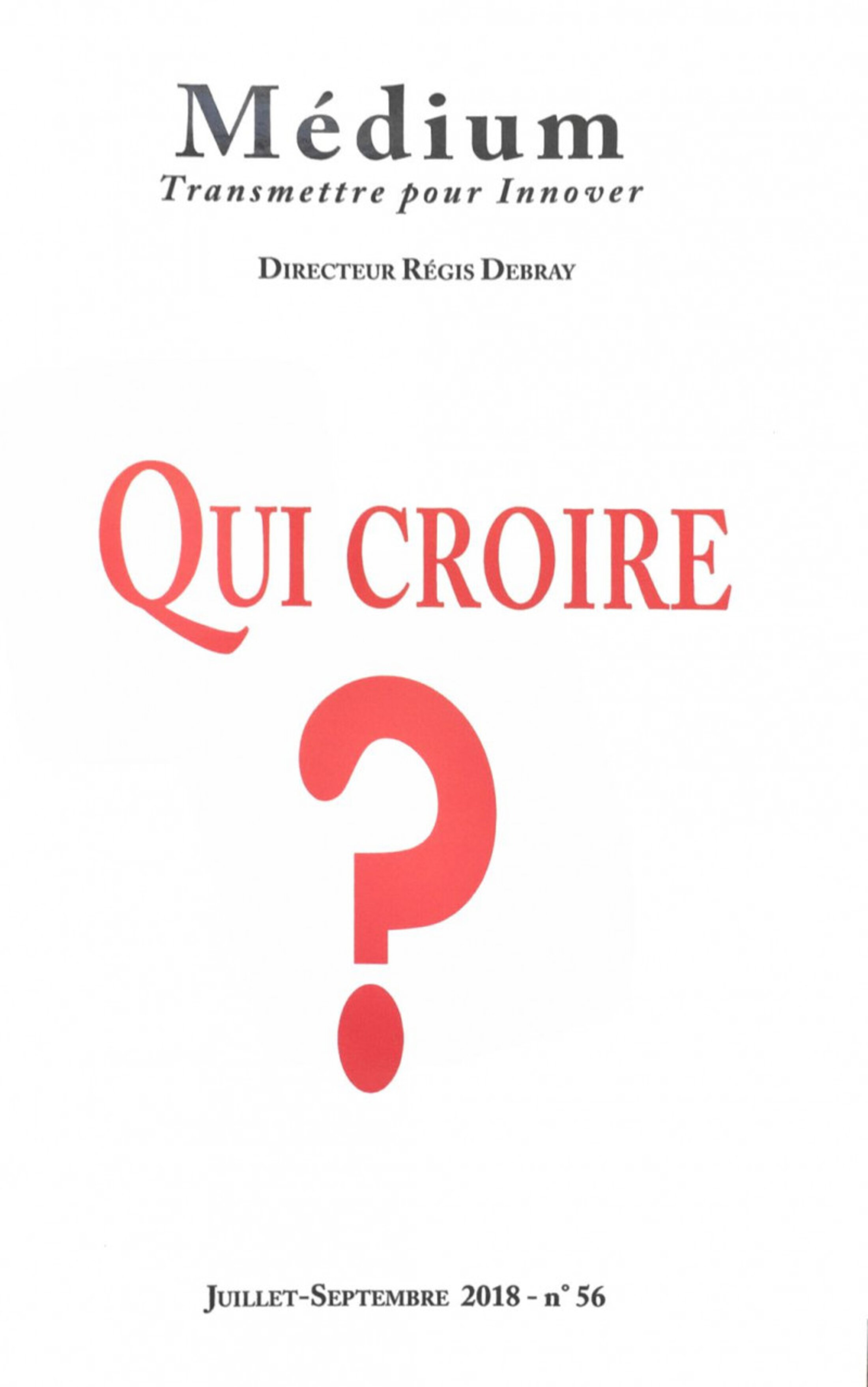
Pour qui se plonge dans les forums de la presse en ligne, les prétendus débats tournent souvent à la razzia rhétorique. Face aux débordements d’internautes injurieux, enragés, haineux, le sens commun songe d’emblée aux incidents qui ternissent certaines rencontres de football, lorsque les spectateurs disruptifs s’emparent du terrain. La fragmentation a vécu, le public ne protège plus de la foule : c’est la revanche de Gustave Le Bon sur Gabriel de Tarde.
En permettant cette fin de l’atomisation de la foule originelle, qui retrouve ainsi ses ressorts envahissants, la révolution numérique ne sape-t-elle pas notre modernité politique, sous couvert de progrès technique ? C’en serait alors fini de la participation du chacun affranchi de la présence de tous : place au collectif débarrassé des brise-lames de l’individualité !
Constatons comment l’effet de meute fait son office sur la Toile. Des commentateurs se greffent et s’implantent dans des débats, quand ils ne les suscitent pas. Ils nouent des alliances redoutables – populistes de toutes les obédience unissez-vous contre l’élite ! Ils progressent telles des bactéries en plaques. La violence symbolique mute jusqu’à sembler réelle. Certains mots assénés font l’effet de coups dans les tibias digitaux, ou d’huile de ricin électronique !
Dans Masse et puissance, Elias Canetti rend compte des ravages auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. Canetti avait expérimenté, à Vienne, le 15 juillet 1927, un bain de foule à la fois dissolvant et fondateur, lors de l’incendie du palais de justice. Il y revient dans son autobiographie :
« J'avais éprouvé que la masse est condamnée à se décomposer et qu'elle craint cette décomposition ; qu'elle met tout en œuvre pour l'éviter, qu'elle se voit elle-même dans le feu qu'elle allume et enfin qu'elle échappe à cette dispersion tant que le feu continue de brûler. Elle repousse toute tentative de l'éteindre, car la durée de son existence dépend de celle du feu lui-même (…) Aussi longtemps qu'elle ne se dissocie plus en individus isolés, remplis seulement d'eux-mêmes, de leur propre personne, la masse continue d'exister, toujours en fuite et, lorsqu'elle s'arrête, elle peut reprendre ses attaques. » (Le Flambeau à l’oreille)
Un tel somnambulisme pluriel vient à nous en ce premier quart du XXIe siècle, alors qu’il fallait le dénicher au XXe siècle – des colonnes de L’Humanité à celles de L’Action Française. Nous n’y coupons pas, sauf à nous couper du seul espace public qui vaille désormais ; non plus l’imprimé ni les ondes, mais la Toile.
REÎTRES NUMÉRIQUES
Au début, voilà une dizaine d’années, bien des puissances établies (universitaires, journalistes) acceptèrent, souvent de bonne grâce, de descendre de leur prétendu piédestal pour se mêler au grand remous égalitaire : le modèle participatif signait la fin des privilèges par trop patents.
Maints articles fautifs ou déficients se sont retrouvés corrigés en temps réel, non par un rédacteur en chef aussi béotien que le plumitif sous ses ordres, mais par des lecteurs avertis, souvent ferrés, parfois érudits. Le triomphe de l’imposture touche à sa fin. Bien.
Petit à petit toutefois, les échanges ont évolué. Plus question d’assister passivement à des dialogues entre « sachants ». Les débats ne sauraient plus porter sur telle pièce de théâtre non vue, ou sur tel roman non lu – cela ne concerne que les nuées –, mais sur des sujets travaillant l’esprit public en général et chacun en particulier, forcément doté d’un avis sur la question : Israël, la Syrie, le Venezuela, la vraie gauche (variante : la vraie droite), la corruption, l’injustice, la fin des services publics et, bien évidemment, Celui ou Celle capable de remettre debout le pays, le continent et, partant, la planète.
Des reîtres numériques se sont organisés, prenant leur tour de garde, faisant des rondes, se livrant à des ratonnades électroniques, éliminant les rivaux voire les tièdes – ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Les puissances établies qui avaient joué le jeu, découvrent avec stupeur qu’au nom de la liberté d’expression se sont imposés des séides, voire des nervis d’une cause ou d’une autre. Certains journalistes se retirent de ce cloaque à ciel ouvert en maugréant : « La bêtise n’est pas mon fort ». D’autres en viennent à se dire, le plus cyniquement du monde, qu’il faut sans doute du pain et des jeux dans leur sillage ; histoire de « générer du clic », selon l’idiolecte en vigueur.
Quelques uns des pionniers du participatif laissent pointer leur amertume d’avoir été ainsi trompés sur la marchandise civique. Daniel Schneidermann, par exemple, intervient régulièrement sur le forum de son site Arrêt sur images, pour raisonner – ou remettre à leur place – ceux qui l’injurient. Ainsi, le 8 mars 2018 : « “Leader minimo”, “la radicalisation de votre bêtise”, “allez vous faire foutre” : merci à quelques uns, ci-dessous, d'illustrer ce que je veux dire à propos de “petits coqs” du forum. Heureusement, ils ne sont pas (tout à fait) les seuls. Quelques réponses bienveillantes et constructives me laissent penser qu'une discussion est possible. Mais, camarades gallinacés, n'êtes-vous jamais effleurés par l'idée que la violence de votre ton est dissuasive, pour tous ceux qui hésiteraient à contribuer ? Pour ce ton-là, des lieux existent : les réseaux sociaux. Ici, on va continuer de s'efforcer de lutter contre la prime au plus fort en gueule. »
L’économie générale des discussions sur les sites de presse paraît obéir à une loi observée par le banquier anglais Thomas Gresham, au XVIe siècle – autre ère de grandes mutations : « La mauvaise monnaie chasse la bonne. » Non seulement les mauvais commentateurs ont eu tendance à chasser les bons, de Mediapart à Arrêt sur images en passant par Le Monde et Le Figaro, mais ces journaux et ces sites leur laissent libre carrière, en vertu d’un adage valant jurisprudence dans l’univers du participatif : « Ne pas nourrir les trolls. »
En croyant bien faire et laisser braire, la presse en ligne abandonne le pouvoir symbolique à des foules jugées dématérialisées. Alors que celles-ci prennent corps, sur les écrans et dans les esprits, tels les manifestants du 6 février 1934 coupant les jarrets des chevaux de la garde républicaine en hurlant leur détestation de « La Gueuse » ; ou tels les gros bras bellicistes du PCF contribuant à la militarisation de la rue dans l’entre-deux-guerres – ainsi que le démontre Marc Lazar dans Le communisme, une passion française.
En ne voulant surtout pas de vagues digitales ni de feu aux poudres numériques, la plupart des responsables de presse vont même jusqu’à reprocher de déraper aux journalistes qui occasionnent quelques dérapages haineux en descendant dans l’arène pour « dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. » (Péguy). Et âprement la vérité âpre, oserai-je ajouter...
Pour le coup, notre cher et jeune participatif, malgré tant d'apports fructueux, en dépit de maintes contributions remarquables, est en crise. Au point de trop souvent consister à se taire face à ceux qui s’expriment sinon pour ne rien dire, du moins pour n’être jamais écoutés. Comme si ce participatif était devenu un théâtre d’ombres qui laisse en partie la foule à quai, dans la mesure où le jeu reviendrait à vivre, pour une multitude égarée, ce que Lacan dit de l’amour : « Offrir à quelqu’un qui n’en veut pas quelque chose que l’on n’a pas. »
****************************
Médium : n° 56 – juillet-septembre 2018 : Qui croire ?



