Tout a commencé dans le Ve arrondissement de Paris, au printemps 1974, année de mes 15 ans. Je venais de traverser le Luxembourg avec ma mère pour regagner l’appartement familial du 26, rue Gay-Lussac.
« Sais-tu qui est cet homme en saharienne ? », me demanda l’autrice de mes jours en désignant un passant d’un geste ample (« on ne montre pas du doigt » était chez elle un principe d’éducation cardinal). « Non maman » (toujours ajouter « maman » après « oui », « non », ou « merci »).
La solution de l’énigme est tombée de la bouche maternelle : « C’est Gabriel Matzneff, un écrivain bizarre. Il habite le quartier, rue des Ursulines. Je le croise assez souvent. L’un de ses livres s’appelle Nous n’irons plus au Luxembourg. »
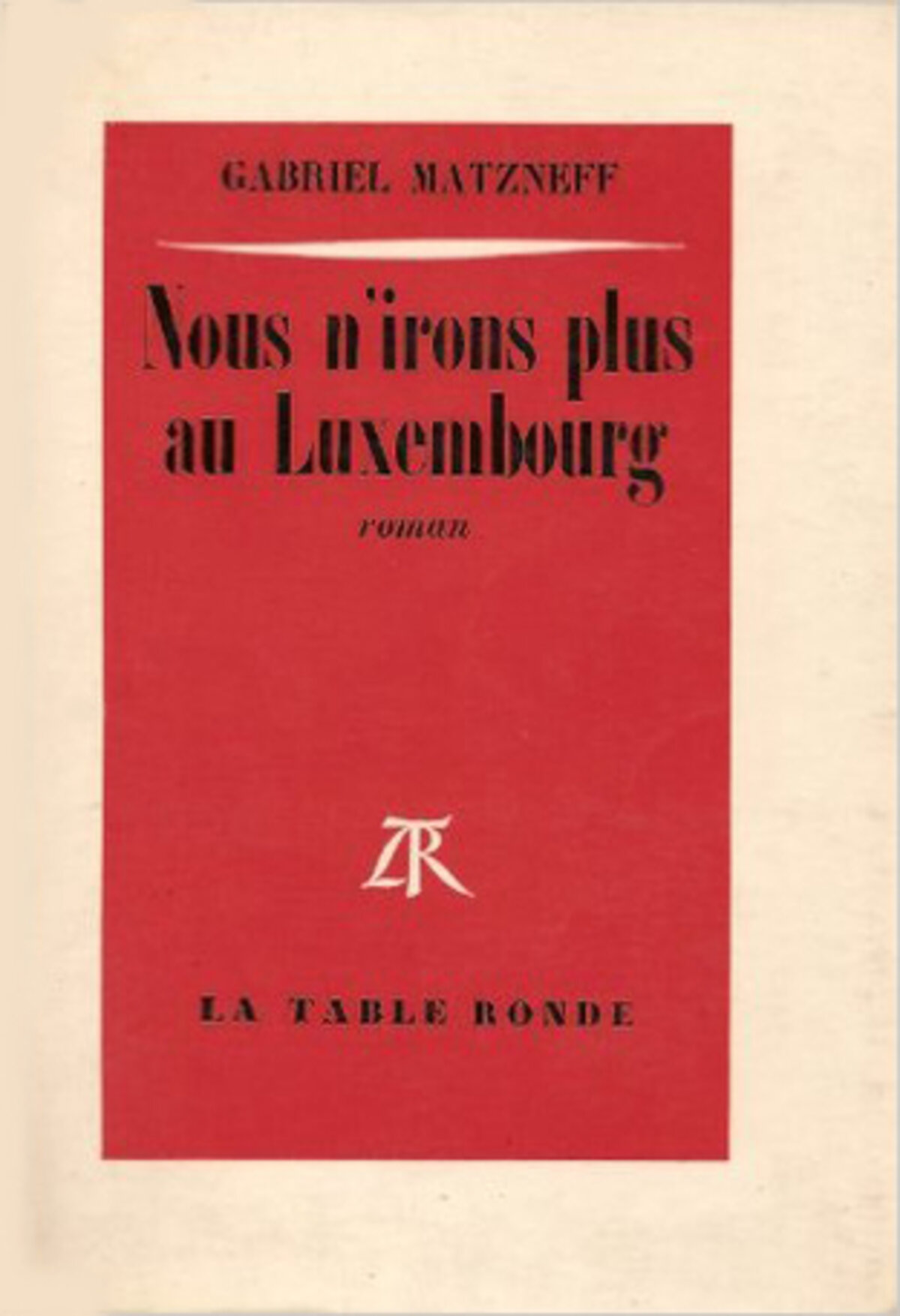
De même qu’un mot tout juste découvert se retrouve par la suite sans relâche, je devais, après coup, tomber à tout bout de champ sur Matzneff : longiligne, chauve et glabre, hâlé, frais comme un gardon, courant un jour après son 84, place Edmond-Rostand, laissant en plan une jeune fille de mon âge qui parut étonnée d’être soudainement abandonnée pour un autobus.
À l’époque, des amis de mes parents, également enseignants cathos de gauche, me surnommaient « le petit con d’Henri IV ». Cela m’allait comme un gant. Cela m’enchantait pourtant : le plaisir aristocratique de déplaire s’avère un poison dont abusent les dandys en herbe.
À partir de 1977, la lecture austère du Monde s’agrémenta d’une chronique hebdomadaire signée Gabriel Matzneff. Du nanan pour le petit con d’Henri IV. Un peu de latin par-ci, une expression du Littré tirée de l’oubli par-là (« chanter sa gamme ») ; des références constantes aux Trois Mousquetaires et à Vingt ans après qui m’avaient tourné la tête à 8 ans – je me prenais pour Athos –, au point que mon père dut m’interdire la lecture du Vicomte de Bragelonne en guise de sevrage. Et puis, dans ces chroniques du Monde, attendues chaque samedi, il n’était question que de mes lieux et itinéraires quotidiens : la bibliothèque Sainte-Geneviève – où Matzneff bichait en découvrant de « belles studieuses » appliquées à lire ses livres –, ou encore le bus 21 dans lequel, miracle à nouveau, une sylphide était surprise en train de dévorer sa prose.
Sous l’emprise d’articles troussés d’une écriture précieuse et obsessionnelle – le nec plus ultra de l’élégance aux yeux du petit con d’Henri IV –, j’en étais venu à ne jurer que par « l’oncle Arthur » (Schopenhauer), à citer Montherlant, à me gargariser de Byron. Et surtout à ne pas perdre de vue l’essentiel dans la vie : ne jamais prendre de ventre et toujours se retenir de tousser au concert ou au théâtre – « Les voyeurs enrhumés », tel était le titre d’une chronique qui fustigeait la horde de fâcheux troublant sans vergogne l’attention si délicate des grands esprits dans les salles de spectacle parisiennes.
Bref, j’étais ferré, dans tous les sens du terme: champion de l’univers matznévien et accro à celui-ci. Drôle de dépendance, portée en bandoulière. Si bien qu’en 1981, passant le concours d’entrée du CFJ (Centre de formation des journalistes) et confronté à un sujet aussi lapidaire que vertigineux, « Narcisse », je terminais ma copie avec la chute d’une ancienne chronique de Gabriel Matzneff : « Il n’y a qu’une aventure qui me captive : la mienne ! »
Cette profession de foi nombriliste ne m’a pas empêché d’être reçu dans une école fondée, au lendemain de la Libération, pour régénérer la presse au nom d’engagements collectifs dévolus à l’intérêt public. Mystère de la sélection…
L’une de mes condisciples, m’entendant débagouler mon admiration pour Matzneff, allait me présenter W., qui, jusqu’à l’âge de 17 ans, avait été on ne peut plus liée à « l’archange aux pieds fourchus » – selon l’appellation contrôlée devenue marque de fabrique du personnage. W. devint, pendant une dizaine d’années, ma meilleure amie. Tout, chez elle, m’apparaissait merveilleusement excentrique : des parents divorcés, originaires de pays qui me faisaient rêver, une petite enfance ballotée en Orient, sa bougeotte perpétuelle la menant de New York à Madrid. Et puis ce départ dans la vie amoureuse, cette initiation sous l’égide d’un Gabriel. Je prenais ses failles pour des atouts.
Je vivais dans le contresens Matzneff. Lorsque ma mère me reprochait d’être entiché de ce « pervers », je me cabrais, persuadé de défendre la liberté d’aimer face à ma génitrice normative, qui stigmatisait notre voisin du dessus de l’époque, l’écrivain homosexuel Dominique Fernandez – elle lui reprochait en fait, assez finement, d’avoir reproduit au sein d’un couple gay l’antique domination patriarcale, avec un partage des tâches et des habitudes fort bourgeois ; alors qu’un tel carcan eût pu être brisé en profitant d’amours non conventionnelles…
Je ne voulais rien entendre. Me portant garant de la subversion maznévienne, je me voyais en chevalier servant des affranchissements d’aujourd’hui comme de demain. Cet écrivain était le grain de sable grippant notre société cadenassée gaullo-pompidolo-giscardienne !
Je finis par perdre de vue W., qui m’avait offert Les Trois Mousquetaires et Vingt ans après en Pléiade. Et, journaliste professionnel, je payais mon tribut à Gabriel Matzneff au détour d’articles dans Télérama.

Agrandissement : Illustration 2
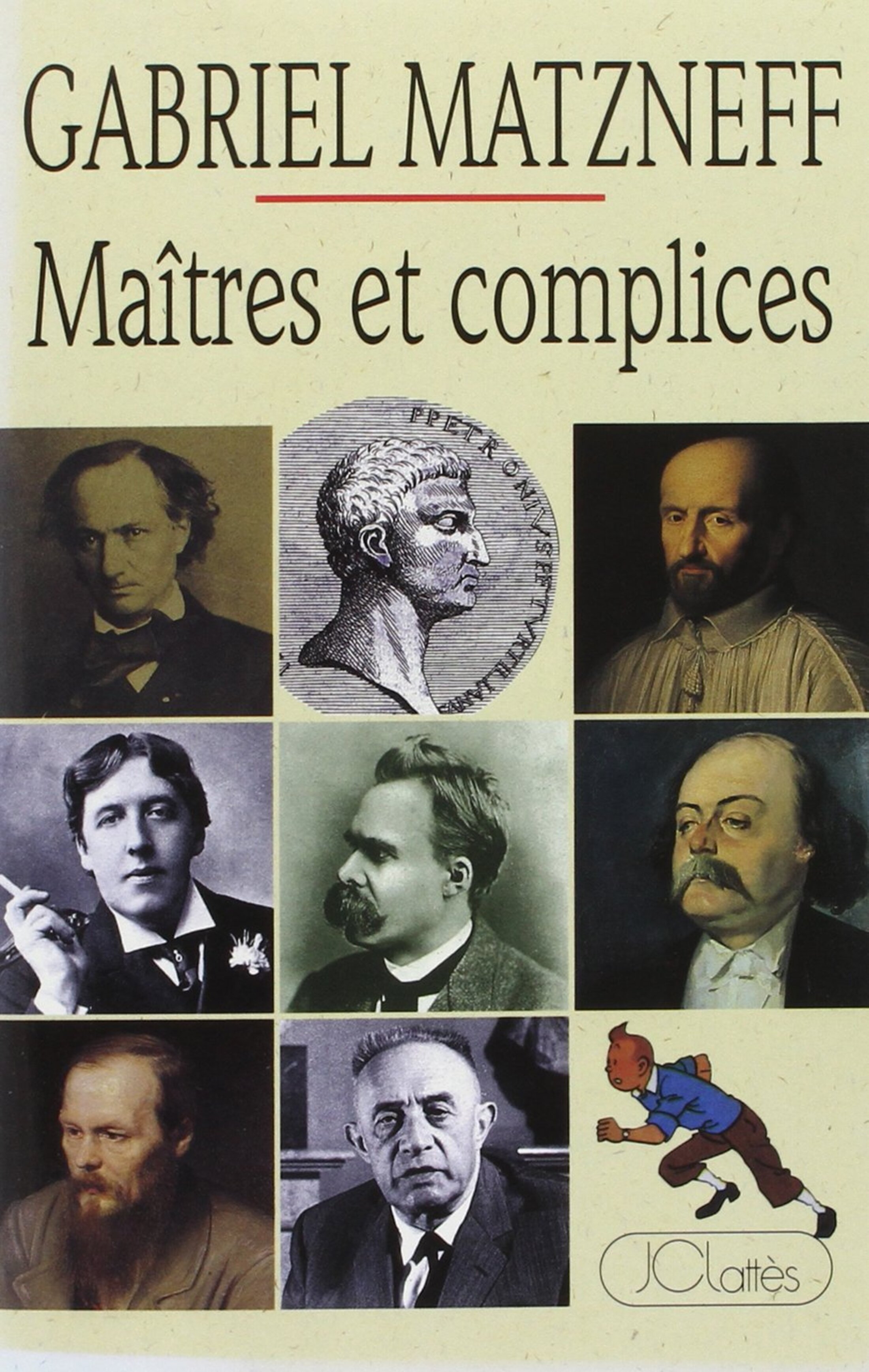
De plus, je l’ai reçu deux ou trois fois à France Culture, l’interrogeant sur son goût pour la langue italienne, son amour du latin, ses « maîtres et complices » – il me raconta le délice de s’être vu proposer par Hergé un verre de Château La Lagune, le cru préféré du créateur de Tintin, et de tendre son verre en réclamant « une larme… un soupçon », à l’instar du capitaine Haddock dans L’Étoile mystérieuse.
Certes, assurément, bien sûr (quidem en latin) : mais le principal, l’essentiel, l’obsession, l’idée fixe, la hantise de Matzneff ? Ne fut-il jamais question du tigre altéré de sexe ? Non, l’émission s’appelait « Tire ta langue » – rien que de chaste et d’érudit dans ce titre. Au mieux, j’ai dû railler mon invité en notant qu’il était persuadé de ne rencontrer Dieu qu’au septième ciel.
Je n’ai jamais lu de lui que quelques romans ou essais : la face présentable de l’œuvre. Ma première déception, qui me permit de me déprendre de Gabriel Matzneff, fut donc d’ordre littéraire. Son style, si longtemps prisé pour être raffiné, m’est apparu tournant à vide hors du cadre d’une chronique.
Ivre de soi-même, l’écrivain patinait dans la fiction, incapable de donner chair à des personnages qui ne fussent pas ses répliques. Au lieu de nous entraîner vers l’imaginaire et le grand large, Matzneff rabâche ses monomanies et enferme le lecteur dans son subconscient obsessionnel. Impuissance créatrice patente. J’ai regimbé face à l’emprise d’ordre sectaire que tente d’imposer une telle prose, récurrente, lassante : une écriture qui ne cesse de récidiver.
Deux ou trois fois, j’ai déjeuné ou dîné avec l’écrivain. Son contentement de soi finit par avoir raison de moi – j’étais prêt à l’admirer autant que peut l’être un petit maître crucial ; il exigeait la dévotion due aux géants des lettres.
Je continuais néanmoins de participer de loin en loin à son culte, mais le cœur n’y était plus. J’ai cependant tenté de débrouiller auprès des services de Radio France son dossier de retraite pour qu’il touchât une petite pension en tant qu’ancien producteur d’émissions consacrées à l’orthodoxie, certains dimanches de l’autre siècle sur France Culture. « Le pauvre homme ! » (Tartuffe, acte I scène 4).
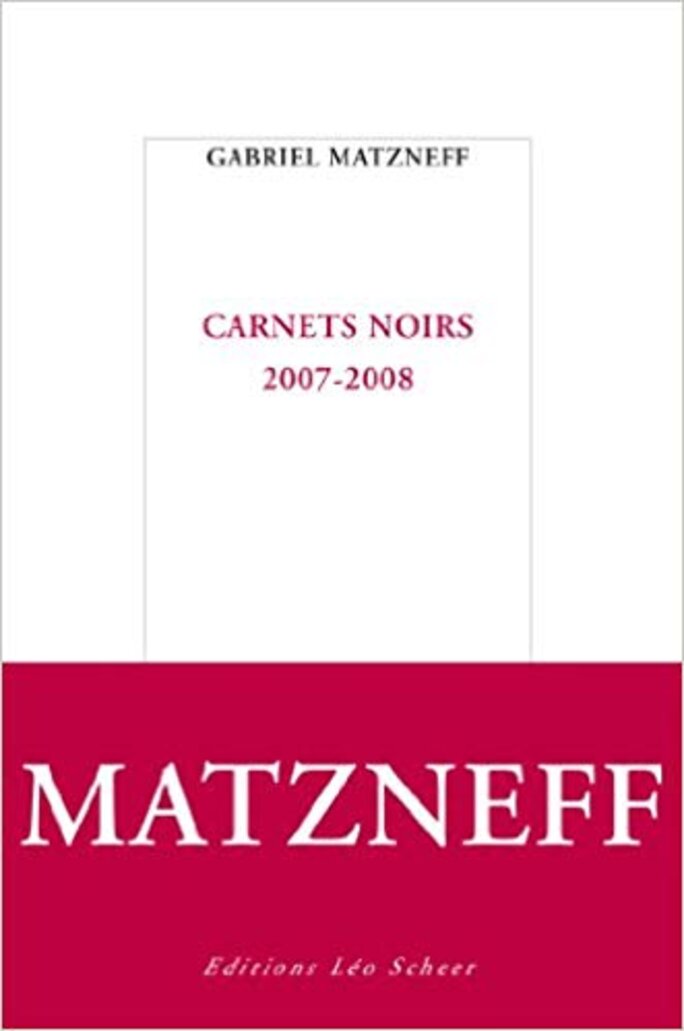
Le voile se déchira enfin, comme chez Molière. En 2016, Martine B. de chez Grasset, m’apprend que W. avait écrit un livre de témoignage, jadis refusé par sa maison d’édition. Les souffrances endurées par W., telles qu'elles me sont alors rapportées, me font l’effet d’un coup de poignard. Abasourdi par ces révélations, j’ai cessé de tourner autour du pot, de pratiquer le déni du noyau dur de la production matznévienne. J’ai renoncé à m’abriter derrière des afféteries de style – ce style au nom duquel je soutenais mordicus l’écrivain, quand mon entourage le plus proche me reprochait ma fascination pour cet être écœurant. Je me suis démis de ma pseudo vocation : prendre le parti du soufre au nom de l’art. Cela revenait, en l’occurrence, à défendre le renard libre dans le poulailler libre, à protéger le droit du plus fort sous couvert de garantir l’expression d’un écrivain. Car il y avait des proies dans l’ombre.
J’ai enfin ouvert certains livres, reçus mais aussitôt remisés au fond de ma bibliothèque. J’ai ainsi parcouru Les Passions schismatiques (Éd. Léo Scheer), que m’avait adressé l’auteur le 4 janvier 2005, avec ses « vœux de bonheur ». Page 132, il y est ainsi question de W. : « Lorsqu’en 1976, j’ai dû mettre fin à une passion hétérosexuelle qui avait occupé trois années de mon existence, ce qui n’a pas laissé, on se l’imagine, d’être fort douloureux, ce sont moins des aventures féminines de traverse – ça, c’est le tout-venant – qu’un jeune garçon de treize ans par qui j’ai recouvré mon bonheur, et mon aplomb. »
Il n’y a qu’une aventure qui le captive : la sienne. Mais à quel prix ? Je l’ai découvert en lisant des passages des Carnets de ce sous-Gide privé de colonies – donc d’une provision de petits garçons doublement captifs – et qui s’en alla chasser les petites filles.
Je me suis souvenu de ce que m’avait lâché, en 1982, alors qu’étudiant au CFJ j’enquêtais sur l’orthodoxie en France, le responsable du SOP (Service orthodoxe de presse) : « Quand Gabriel Matzneff vient, nous cachons les enfants. » Mon interlocuteur l’avait dit en souriant, mais c’était sans doute la politesse de l’indignation. Je l’avais prise pour de la gaudriole.
En 2016, m’est revenu en mémoire le livre magnifique d’Anne-Marie Garat, Une faim de loup (Actes Sud, 2004), qui fait découvrir que Le Petit Chaperon rouge raconte une histoire de viol. Comprenne qui pourra.
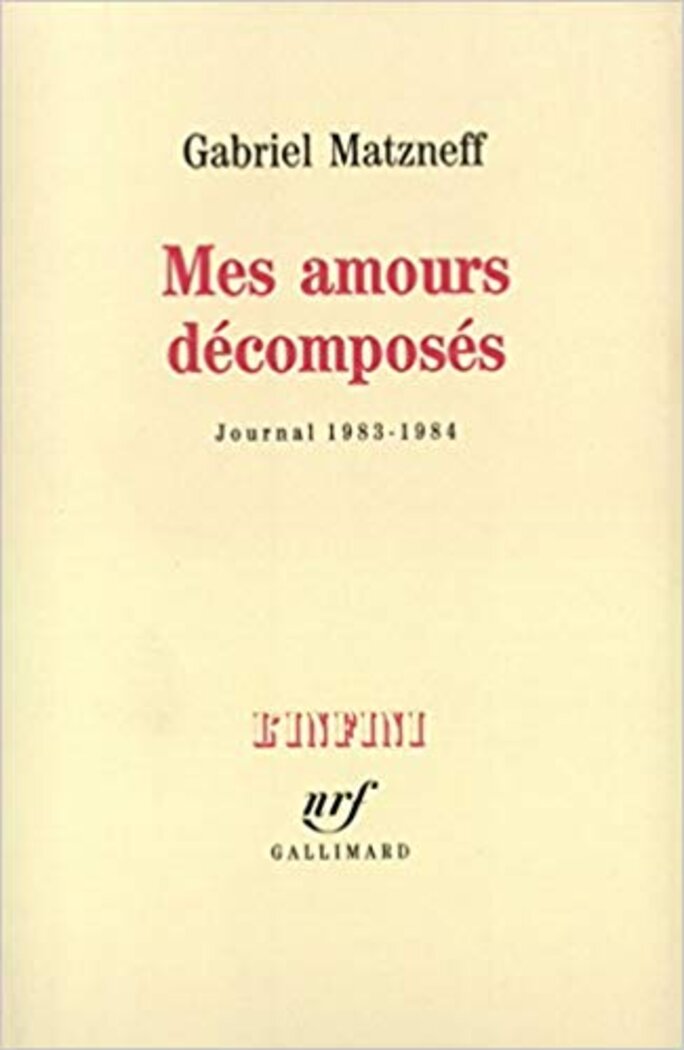
Je me suis enfin rendu compte que l’ogre Matzneff n’entendait me voir, durant ces deux ou trois repas que nous avions partagés, que pour me soutirer des nouvelles de W., dans le dessein de se persuader que son emprise sur elle continuait par mon truchement, qu’à travers moi il la tenait à l’œil, qu’elle n’en aurait jamais fini avec lui tant que resterait la moindre miette du régal passé.
Je réalisai que je m’étais, pour l’amour du prétendu beau style, jeté dans la gueule du monstre, tel un idiot isolé mais utile. Dans mon petit coin, je lui avais apporté sur un plateau mon soutien, parallèle aux puissantes protections dont sut toujours s’entourer le roué Matzneff dans le milieu de la presse et de l’édition ; tissant ses réseaux tout en jouant les artistes maudits. Il m’avait possédé sans avoir à lever le petit doigt : j’étais venu à lui tel un gamin de Hamelin attiré par un air de flûte.
J’ai fini par deviner ce que permet de comprendre, en 2020, le récit de Vanessa Springora si judicieusement intitulé Le Consentement : Gabriel Matzneff envisage les familles comme des conteneurs de chair fraîche à barboter au nez et à la barbe des parents. Chaque naissance est pour lui promesse de festin futur, de débauche différée, de ripaille retardée. Il n’y a qu’un appétit qui le captive : le sien ; enrobé de délicatesses doucereuses mais diaboliques, aux pouvoirs d’attrape-nigauds.
Ainsi revenu de quarante ans d’errance consistant à « Égaler l’artifice à la sincérité,/ Confondre l’apparence avec la vérité,/ Estimer le fantôme autant que la personne,/ Et la fausse monnaie à l’égal de la bonne » (Molière : Le Tartuffe, ou l’Imposteur), j’ai écrit dans Mediapart, à l’occasion du scandale Weinstein, en octobre 2017, un article enfin juste parce que sévère, au sujet de Gabriel Matzneff : Ce temps où la pédophilie était en vogue.
C’était deux ans et deux mois en amont de l’affaire qui vient d’éclater. Une telle avance relevait cependant du retard, pour les raisons que j’ai tenté de faire comprendre ; en espérant indiquer le chemin d’un panneau dans lequel d’autres petits cons d’Henri IV et d’ailleurs sauraient peut-être, à l’avenir, ne pas tomber…
*****
N. B. : j’ai modifié l'initiale du prénom de « W. », histoire de ne pas la livrer ici en pâture – ce qui serait fâcheusement matznévien.
***
P.-S. J'ai accepté de me rendre, le 16 janvier 2020, en qualité de témoin, dans les bureaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (à Nanterre), où une fonctionnaire a consigné sur procès-verbal mes propos. Ceux-ci ont consisté à confirmer ce que j'avais écrit dans le présent billet – selon la norme en usage à Mediapart.
***
Additif du 30 avril 2020 : Je regrette d'avoir publié, dans une première version de ce billet de blog, des faits relevant de l'intimité de la vie privée de W.. Dans ce billet, évoquant une amitié éteinte depuis des décennies, j'ai rapporté les propos d'un tiers faisant état d'éléments inexacts et qui lui ont causé une blessure inutile. Je les ai retirés sur sa demande légitime et lui présente mes excuses pour le tort que je lui ai infligé.



