À Mediapart, nous avons la “boîte noire”, en pied d’article, qui dévoile nos coulisses en cas de besoin : à quels désir ou logique répondait un papier ; dans quelles conditions fut-il réalisé ? Avec Marc Angenot, la boîte noire devient billet de blog, tant était attendue la rencontre avec ce théoricien québécois de la littérature, des discours sociaux, de la rhétorique, des idéologies, du militantisme, de la philosophie politique…
Il y eut la lecture d’un essai magistral paru en 1982 : La Parole pamphlétaire (Payot). Marc Angenot y suit à la trace, en France, une « vision crépusculaire du monde », de 1868 (Henri Rochefort lance alors La Lanterne contre le Second Empire) à mai 1968. Or il se trouve qu’au début des années 1980, toutes ces ruminations propres à Léon Bloy et autre Louis-Ferdinand Céline étudiées par Marc Angenot, semblaient soudain réactivées par la montée en puissance médiatique d’un raté devenu coqueluche : Jean-Marie Le Pen.
Devant le politicien d’extrême droite de retour après ses fracassants débuts poujadistes de 1956, vis-à-vis de cet histrion craignant les « sidaïques » capables de contaminer avec leur sueur – un tel délire eut lieu lors de l’émission “L’heure de vérité” – face, donc, à Jean-Marie Le Pen, à ses pompes et à ses œuvres, la lecture du livre de Marc Angenot servait de boussole, même si nous étions passés de la graphosphère à la vidéosphère. On y lisait ceci :
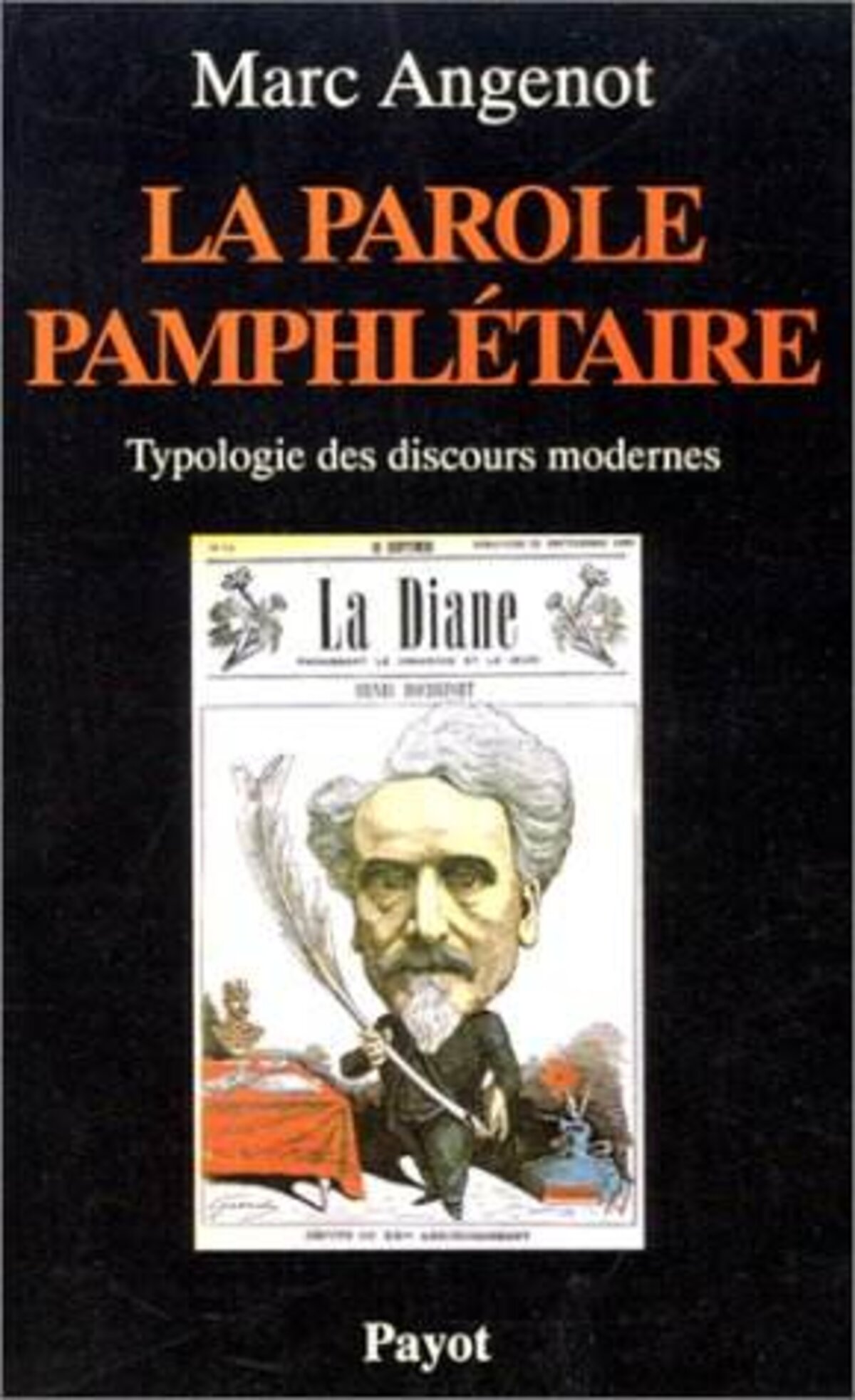
« Le pamphlet est une spectacle ; le pamphlétaire y “fait une scène”, au sens hystérique de ce mot. Tout le pamphlet tient alors à une dénégation : il dénonce un pouvoir abusif en se posant comme hors des pouvoirs et même réduit à l’impuissance (…) Le pamphlétaire ne critique pas l’erreur, il la transmue en usurpation, c’est-à-dire qu’il est affamé de légitimité. Sa vérité s’authentifie en virilité. Face à la violence des appareils, le pamphlétaire joue une violence verbale qui doit le dédouaner (…) Forme réactionnelle, souvent tournée vers un passé mythique, le pamphlet est un mode de fausse conscience spécifique à des sociétés en “déstabilisation” idéologique constante. »
Contrairement à bien des mandarins français qui, une fois leur thèse soutenue, évitent les archives tout en y déléguant leurs étudiants afin de les cannibaliser, Marc Angenot va au charbon. Chercheur un jour, chercheur toujours. Avec une boulimie que rien ne semble altérer.
Il a ainsi écrit, après immersion dans des corpus oubliés, un ouvrage majeur : La Critique au service de la révolution (Peeters-Vrin, 2000). En se plongeant dans la critique littéraire communiste des années trente en France (Henri Barbusse, Paul Nizan, Louis Aragon, Paul Vaillant-Couturier, Georges Sadoul, Pierre Unik, Jean-Richard Bloch, etc.), en pistant une telle phraséologie aboutissant à une « herméneutique collective » se muant en machine à expertiser, à juger, à condamner (ça manque de réalisme socialiste !), l’étude démontre la naissance d’un sectarisme à faire frémir.
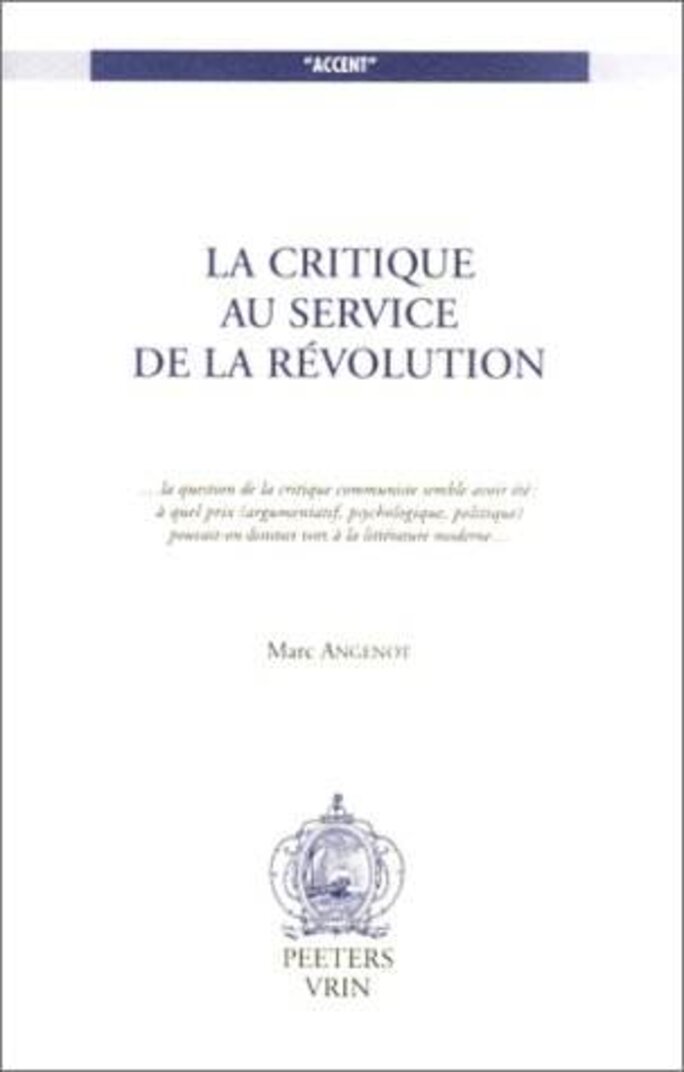
Marc Angenot note cependant, avec une honnêteté, un regard de biais, un pas de côté qui en font sa marque de fabrique : « S’il faut appréhender la critique communiste topographiquement, en confrontation polémique avec la critique de la presse culturelle établie, sa brutalité et sa rigidité apparaissent inséparables du fait qu’elle a cru devoir rappeler inlassablement aux critiques “bourgeois” que ces choses – la politique comme destinée, les luttes sociales, la “vie” comme elle disait – existent. Sans dispenser d’analyser ses dogmes, ses aveuglements et ses erreurs, on peut penser que la critique ASDLR (au service de la révolution) redresse le bâton dans l’autre sens pour marquer son légitime refus d’une critique à la fois hédoniste, illusionniste, chauvine et éclectique qui occupait une grande partie du terrain. » Tout est là : contextualiser et donner à comprendre, sans verser dans l’anachronisme ni le jugement moral ou politique rétrospectif. Lire Marc Angenot, c’est à chaque fois arracher nos œillères franco-françaises, pour enfin y voir clair !
Natif de Bruxelles (en 1941), étudiant de Chaïm Perelman (1912-1984) – grand observateur des logiques rhétoriques et juridiques –, Marc Angenot s’exila en 1967 au Canada, après avoir soutenu en Belgique une thèse principale sur la rhétorique du surréalisme et une thèse annexe sur le créole haïtien. Il est professeur (émérite depuis 2013) à l’université McGill de Montréal, au département de langue et de littérature françaises.
Il faut citer sa Critique de la raison sémiotique (Presses universitaires de Montréal, 1985), qui confronte les théories sémiotiques de Charles Peirce à Umberto Eco, jugées « diversement oublieuses du fait social ». Il faudrait quasiment passer en revue 160 livres, articles savants, contributions à des cahiers de recherche ou à des ouvrages collectifs. Voici que paraît sa dernière publication en date : L’Histoire des idées (Presses universitaires de Liège).

Agrandissement : Illustration 3
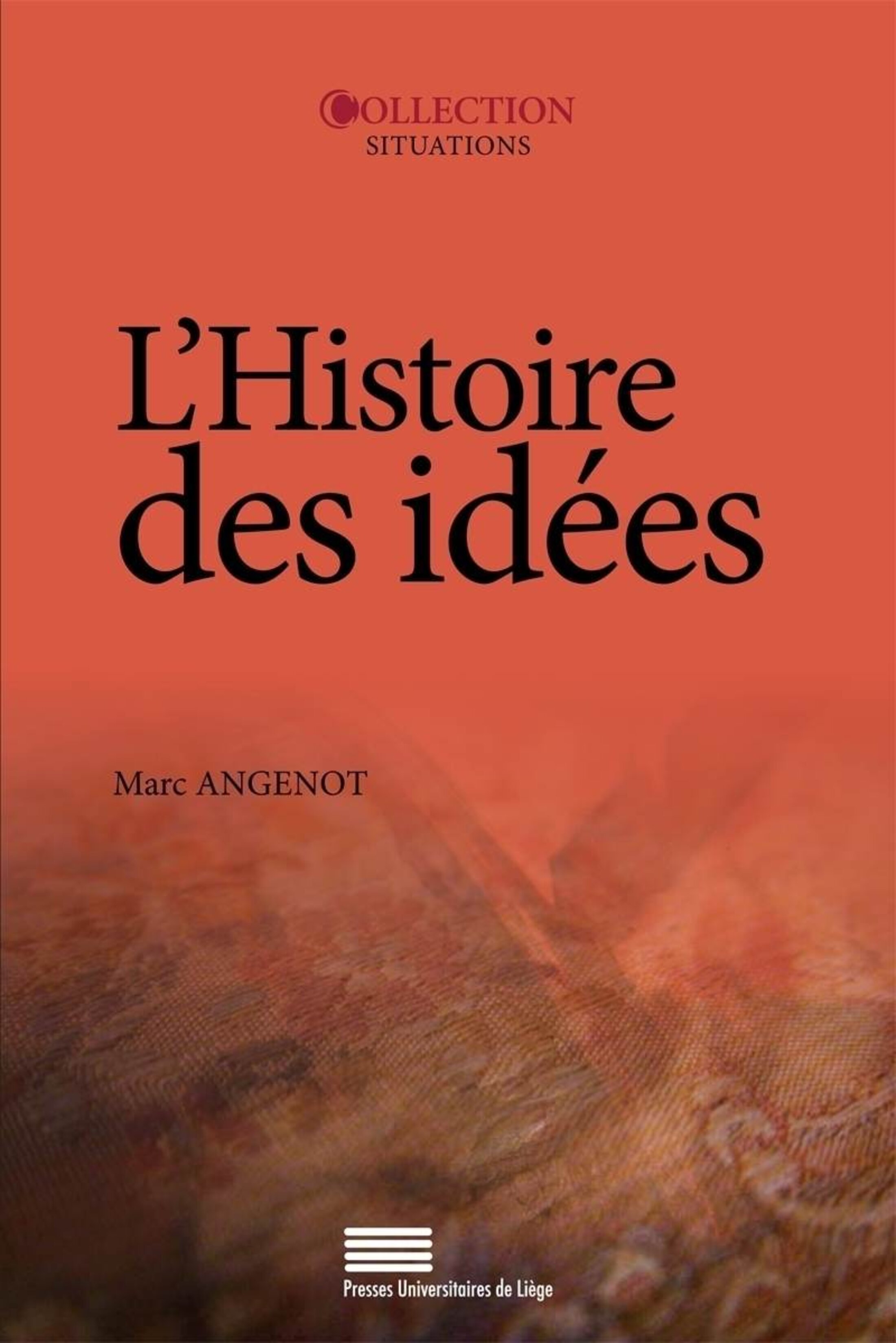
Marc Angenot a passé, pour l’occasion, trois jours à Paris, présentant son ouvrage devant un aréopage de chercheurs invités par les éditions de la Maison des sciences de l’homme en son Comptoir des presses (86, rue Claude-Bernard, dans le Ve arrondissement de Paris). Il a insisté sur l’importance qu’avait eue pour lui la lecture du Ni droite ni gauche de l’historien israélien Zeev Sternhell : « Il m’a fait comprendre que pour expliquer la “Révolution nationale”, il ne s’agit pas de commencer en mai 1940. Pourquoi le statut des juifs fut-il en France un phénomène autochtone ayant devancé toute pression. Zeev Sternhell, même s’il y a sans doute moyen de s’y prendre mieux, remontre le flux temporel pour savoir d’où ça vient. Il ne s’agit pas d’accuser Barrès, ni de l’exonérer, mais de saisir comment cet écrivain fut le premier à flairer l’alliage de l’antisémitisme et du nationalisme. Il inventa quelque chose. Ce qui ne fait pas de lui un complice avant le fait, mais ce qui ne doit pas nous empêcher de montrer les enchaînements. Alors que les historiens français ont tendance à se satisfaire du malheur des circonstances… »
Marc Angenot fait allusion à un livre collectif paru voilà deux mois, sous la direction de Serge Bernstein et Michel Winock : Fascisme français ? La controverse (CNRS éditions). La querelle n’est pas nouvelle. En 1983, Raymond Aron mourait après avoir témoigné, au palais de justice de Paris, en faveur de Bertrand de Jouvenel, qui avait intenté un procès à Sternhell pour avoir été décrit comme un fasciste français. La France ne saurait être considérée comme une terre d’élection voire de mission du fascisme, protestent aujourd’hui d’honorables universitaires liés à Sciences-Po et au sillage de feu René Rémond (Jean-Noël Jeanneney, Jean-Pierre Azéma, Alain-Gérard Slama…).
Nous avons préféré passer le chemin d’une telle querelle : Pétain fut-il une sorte de Franco pris dans un engrenage inévitable pour avoir été occupé par son voisin immédiat nazi ? Nous avons plutôt voulu lier connaissance avec Marc Angenot pour sa vision d’ensemble, à cheval sur plusieurs cultures et continents. Ce Belge devenu canadien, qui se repaît de la France des XIXe et XXe siècles, étonne par sa liberté d’esprit. Son livre réserve des surprises que les professeurs cantonnent généralement à l’oral. Par exemple, au détour d’un chapitre consacré aux « origines intellectuelles » des grands événements de l’histoire moderne, notre auteur écrit ceci : « Il n’y a pas à ma connaissance de réflexion, sinon occasionnelle, sur le schéma inverse : le rôle des événements et des circonstances vécues, celui des grands traumatismes historiques sur les idées “abstraites”. »

Agrandissement : Illustration 4

Lors de son bref séjour parisien, Marc Angenot a reçu Mediapart dans le petit hôtel de la rue Le Goff, au cœur du Quartier Latin, où l’avait installé l’université Paris III (Sorbonne Nouvelle). C’est là que Freud avait logé, en 1885-1886, quand il suivait les cours de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière. C’est là que nous avons interrogé un homme qui ressemble à ses ouvrages : érudit, provocateur, paradoxal, passionné par la transmission du savoir et attaché à des problématiques aussi pertinentes qu’insolentes.
Cet entretien, à la fois vidéo et sous forme de questions-réponses écrites, sera bientôt mis en ligne. Il s’agit moins, en ce présent billet de blog, d’un aguichage (“teasing” pour les franglaisants) que d’une manifestation de joie partageuse : un véritable intellectuel francophone, à la fois pénétrant et décentré, va s’adresser à nous, à propos de l’angle mort français par excellence, l’histoire des idées !...



