Le miracle sonnera trois fois. Le 9 novembre 2006, à la Philharmonie de Berlin, le pianiste Pierre-Laurent Aimard avait organisé un concert-lecture avec Imre Kertész (1929-2016). Auréolé du prix Nobel de littérature qui lui avait été conféré en 2002, Kertész lisait l’ultime chapitre d’Être sans destin, ne cessant de se passer le relais avec Aimard au clavier.
L’événement eut lieu le jour même du 77e anniversaire de l’écrivain. Mais ce 9 novembre 2006 marquait également les 68 ans de la Nuit de cristal et les 17 ans de la chute du mur de Berlin. L’écoute du public berlinois fut à la mesure de ce qu’induisait la date de l’exécution. Ce mot exécution résonne avec l’univers concentrationnaire, autour duquel voulait faire réfléchir tout en donnant à éprouver Pierre-Laurent Aimard, qui habite sa condition de musicien avec une conscience, une exigence et une intelligence exemplaires.
Le regretté critique Jacques Drillon, dans un bref essai aussi lumineux que crépusculaire, La Musique comme paradis, écrivait : « À la différence de la peinture, la musique laisse les penseurs tout à fait muets, à quelques brillantes exceptions près. »
Volontairement muet (« Je suis un moteur à combustion lente », me dit-il un jour que je lui proposais une émission pour France Culture qui ne se fit jamais), Pierre-Laurent Aimard pense son art et son époque. En témoignent les pièces de Schönberg, Cage, Ligeti et Kurtág, qui, sous ses doigts, épaulent et révèlent le texte de Kertész.
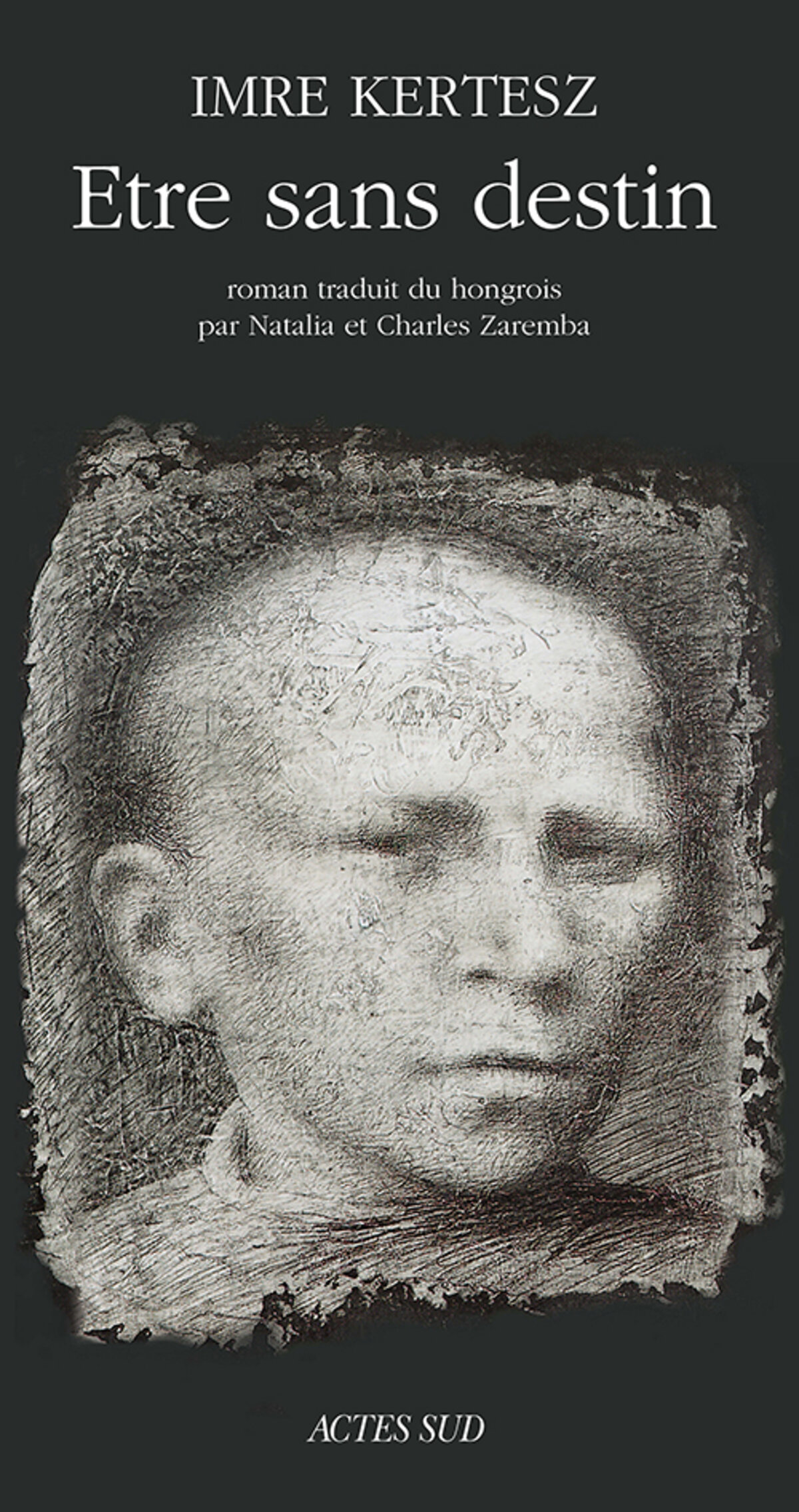
Agrandissement : Illustration 1

Deux ans plus tard, en décembre 2008, un récital à Paris pétrifia le public, avec le comédien Denis Podalydès et le renfort de chambristes : le clarinettiste Pascal Moraguès, la violoniste Julia Fischer et la violoncelliste Valérie Aimard, cadette de son pianiste de frère.
Ce dimanche 28 avril 2024, au Théâtre des Champs-Élysées, Pierre-Laurent Aimard est seul au piano, comme voilà dix-huit ans à Berlin. Et Denis Podalydès, de la Comédie Française, lit le dernier chapitre d’Être sans destin de Kertész.
Ce livre en forme de zoom avant vers l’abomination d’un camp d’extermination – c’est la Shoah à petits pas –, ce livre qui retrace en la recomposant une expérience concentrationnaire, ce livre à travers le regard d’un enfant naïf encore, à 15 ans, qui découvre le camp de la mort, nous ferait presque nous écrier : « Attention ! ces cheminées aperçues en arrière-plan par un adolescent qui n'a d'yeux que pour le terrain de football d'Auschwitz, ces cheminées mentionnées presque à la légère par le narrateur, ce sont des crématoires... »
Dans Le Refus, un récit relatant l'écriture puis le rejet par le régime de la Hongrie socialiste d'Être sans destin, Imre Kertész évoque le bracelet en cuir d'une montre qui lui rappelle le temps des camps. Et il écrit : « Je l'ai reniflé jusqu'à la corde. »
Kertész fut sourcier autant que sorcier du souvenir, (res)suscité en lui, mais pour aboutir, comme l'explique son cotraducteur, Charles Zaremba, à « un hurlement à froid, maîtrisé, repensé, reformulé en termes littéraires et non comme un témoignage brut ».
Kertész, c'est tout son art, a passé sa rage intérieure au tamis d'une maîtrise esthétique de fer. Comme un loup blessé qui parviendrait à nous parler avec la voix d'un Petit Chanteur à la croix de bois : « J'ai recommencé cinq cents fois le début d'Être sans destin entre 1961 et 1973, pour trouver une distance, une structure, un cadre où les mots puissent avoir leur vie. »
Ce hurlement transposé, Kertész nous en transmet le fardeau : « Je n'ai pas voulu reléguer le lecteur à une place de voyeur. Mes livres ne lui laissent aucune sortie de secours, il ne peut se contenter de regarder le spectacle du monde. »
Le lecteur finit ainsi contaminé par l'expérience concentrationnaire. Le style de Kertész nous embringue et nous emberlificote, à coups de parenthèses, d'incises, de redites, dans l'univers, collant, poisseux, violent du camp.
Voilà ce que nous fait ressentir Pierre-Laurent Aimard, en jouant les pièces qu’il a choisies – dont 4’33’’, cette composition de John Cage qui n’est que silence apparent, avec un pianiste roide à la manière d’une figure de cire assise devant un Steinway, et qui ne laisse entendre que la respiration du public s’accordant avec la pulsation du temps.
La prose d’Être sans destin est tout emplie d’une beauté incongrue et surprenante, comme lorsque le narrateur, à Auschwitz, entend des femmes chanter derrière des barbelés : « Et dans ce grand silence, je distinguai pour la première fois, portée par le souffle de la brise de ce soir d'été, à peine perceptible, mais apaisante, cela ne faisait pas de doute, une mélodie joyeuse qui, là, avec ce spectacle devant les yeux, nous surprit vraiment tous, y compris moi-même. » (p. 159).
Pierre-Laurent Aimard et Kertész avaient non pas choisi ce passage mais, donc, le dernier chapitre. Celui-ci, rappelle le pianiste, retrace l'après-camp : « Le personnage, de retour à Budapest, revisite une forme de normalité à travers les lieux et les gens de sa vie d’avant. L’expérience du camp y est évoquée, non pas directement, mais par les questions qui lui sont posées, les commentaires qui sont faits ou les récits que lui-même en fait – ajoutant un degré de distanciation supplémentaire, qui ne rend le propos que plus choquant. Il n’y a en effet là nul sentimentalisme, nul pathos, nul jugement. »
La lecture qu’en propose Denis Podalydès ressemble au plus près à ce qu'entendait Kertész : un Et incarnatus est (« il a pris chair ») laïque et littéraire. Dans son discours de Stockholm, l’écrivain lâchait ceci : « J'ai l'impression qu'en pensant à l'effet traumatisant d'Auschwitz, je touche les questions fondamentales de la vitalité et de la créativité humaines ; et en pensant ainsi à Auschwitz, d'une manière peut-être paradoxale, je pense plutôt à l'avenir qu'au passé. »
Dimanche 28 avril 2024, le public fut invité à un voyage au bout de ce paradoxe, en expérimentant, de surcroît, que la musique est un autre réel qui mériterait d’être le réel soi-même : ce réel enfin idéal. Mais déjà la voix d’Imre Kertész vient à grincer, telle que nous la retrouvons dans un ultime ouvrage publié en français, à l’automne dernier, Le Spectateur : « Nous tenons tant à notre vie, alors qu’elle ne nous appartient même pas.»
*
Rendons hommage à la productrice Jeanine Roze, qui a eu le cran de programmer ce moment si puissant, au risque de rebuter un certain public bourgeois – donc philistin –, se voulant mélomane... jusqu'à un certain point.



