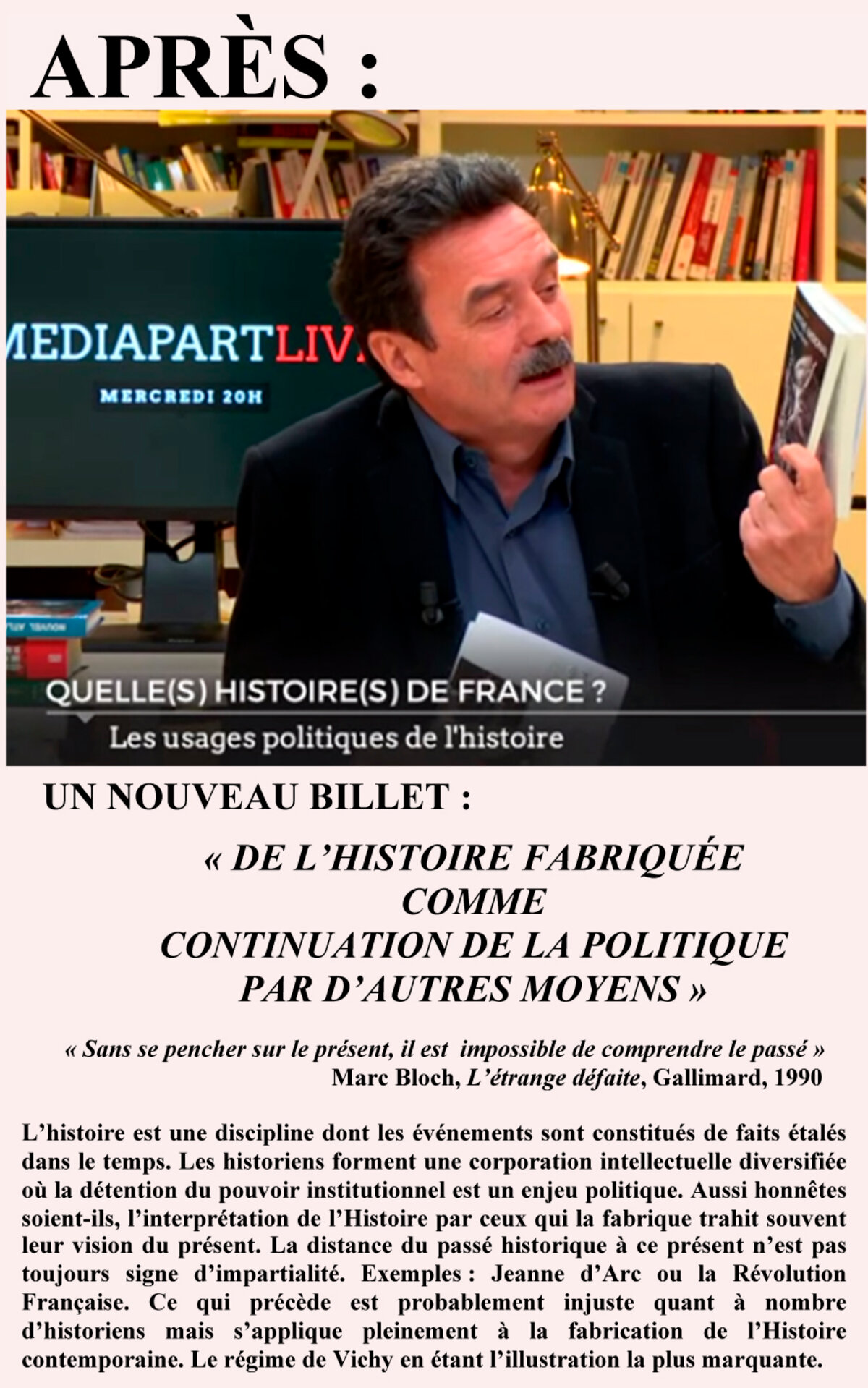
Agrandissement : Illustration 1
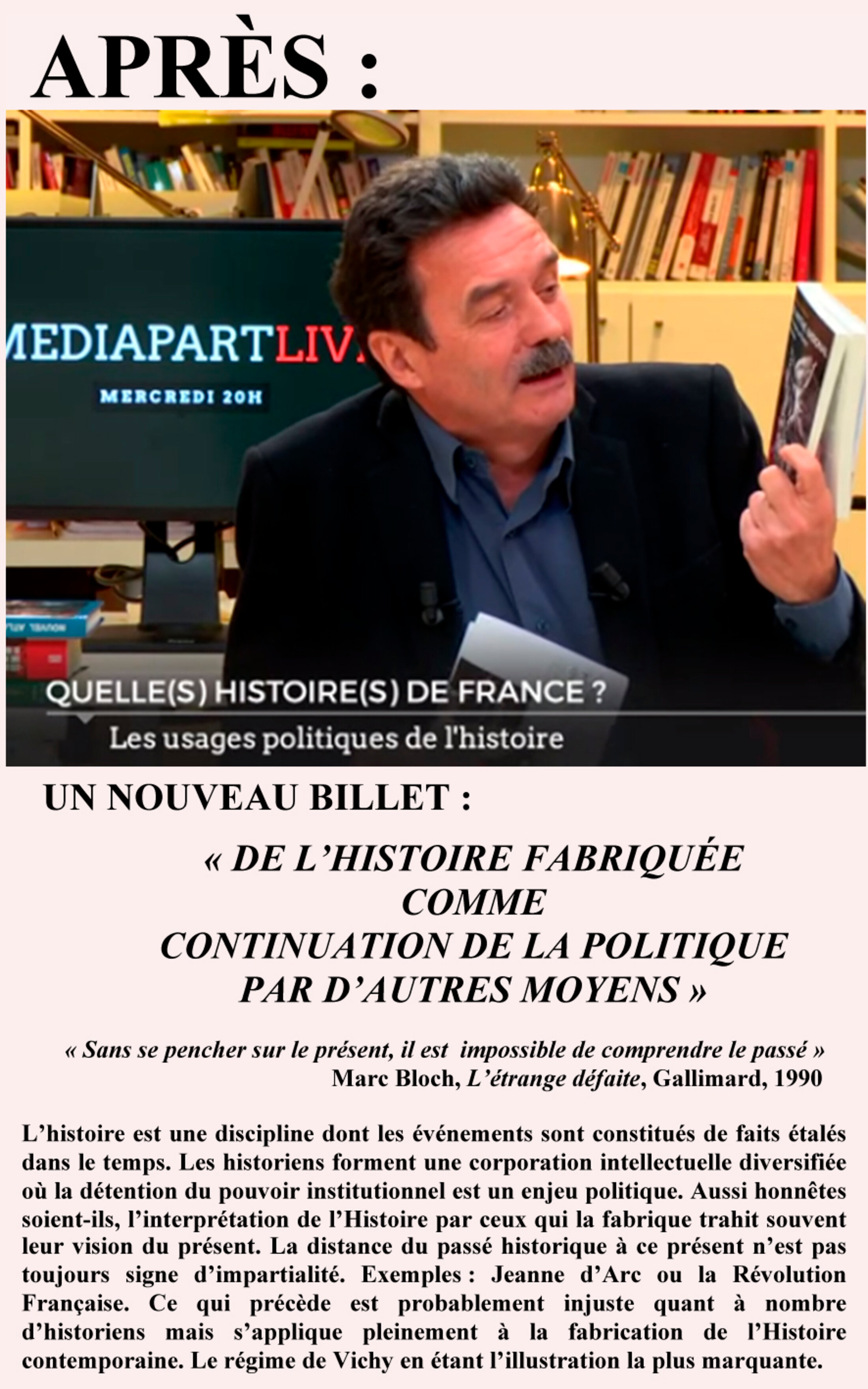
Où la manière de qualifier aujourd’hui ce régime d’hier, dirigé par Pétain, Darnand et Laval… et les autres, est révélatrice d’une idéologie gouvernant les historiens : le régime pétainiste, fasciste ou seulement autoritaire ? Il y a d’un côté les historiens témoins à charge contre ce régime, et de l’autre ceux se faisant les avocats à décharge de celui-ci.
Dans le premier camp, celui des témoins à charge, pour qui le régime de Vichy était bien fasciste, d’abord l’historien israélien Zeev Sternhell. Pour lui, en France, existaient avant guerre des forces fascistes. Celles-ci ayant ensuite été installées au pouvoir à la faveur de la défaite et de l’occupation de la France par les nazis. D’autres historiens ont des analyses approchantes. Exemples : l’américain Robert Soucy, pour qui la France fut « plus perméable aux idées fascistes dans les années 1930 qu’on ne veut l’admettre généralement ». Mais encore, Henri Michel, Roger Bourderon et Germaine Willard, Yves Durand…
Pour l’historien américain Robert O. Paxton « Le régime de Vichy n’est certainement pas fasciste au début, car il ne possède ni parti unique ni institutions parallèles. Mais au fur et à mesure qu’il se transforme en État policier, sous les pressions de la guerre, des institutions parallèles apparaissent : la milice, les cours martiales, la police aux questions juives »…et il devient fasciste. » (Les fascismes, 1994, article mis en ligne le 30.05.2006 – URL : http://cmb.ehss.fr/51).
Dans le second camp, celui des historiens se faisant avocats à décharge du régime pétainiste et estimant que celui-ci n’était pas un régime fasciste mais seulement autoritaire. Cette dernière désignation étant une manière et de relativiser la nature de ce régime et les responsabilités pouvant lui être imputé. Dans la fabrication de l’Histoire, ces historien(ne)s érigent le plus souvent en postulat, avant toute argumentation, la conclusion à laquelle ils veulent parvenir. L’autre catégorie d’historiens n’échappe pas toujours non plus à ce travers. Qu’est ce qu’un régime simplement autoritaire ? C’est en tout cas moins mal qu’un régime fasciste. Parmi ces historiens d’abord : Robert Aron pour qui « Pétain » n’était qu’un « bouclier » face à l’Allemagne. Analyse tellement caricaturale qu’elle n’est pratiquement plus reprise par aucun autre historien. D’autres encore qualifient le régime de Vichy comme ayant été seulement « autoritaire » : André Sigfried, René Rémond, Serge Berstein, Alain-Gérard Slama, Philippe Burrin…
Pour Denis Peschanski, le régime de Vichy a mené des essais fascisants d’encadrement total de la société civile par l’État mais ces essais ont échoué. Pour Jean-Pierre Azéma, « les enjeux historiographiques ont été pour partie obscurcis par une certaine focalisation des débats sur l’existence d’un fascisme vichyssois ».
Un journaliste du Figaro, Eric Roussel, dans un article du 27.11.2014, c’était à propos de la sortie d’un ouvrage collectif Fascisme français ? La controverse, sous la direction de Serge Berstein et Michel Winock, CNRS Editions (Jean-Pierre Azéma, Serge Berstein, Jacques Julliard, Jean-Noël Jeanneney, Alain-Gérard Slama..), résumait leur contre offensive menée contre les thèses de Zeev Sternhell : « Pour les auteurs ici rassemblés, la vision de l’auteur de Ni droite, ni gauche est fausse. Non, clament-ils d’un seul cœur, la France ne fut pas la terre d’élection du fascisme. Vichy, qui attira évidemment d’authentiques admirateurs des « expériences » italienne, voire allemande, ne saurait être assimilé, aux yeux de Jean-Pierre Azéma, à la doctrine de Mussolini. Régime certes autoritaire et responsable d’actes indéfendables, le système mis en place par le maréchal Pétain s’apparentait davantage à celui de Salazar au Portugal. Avec malheureusement une connotation antisémite plus marquée ».
En bref, à propos du régime de Vichy, l’Histoire est bien la continuation de la politique par d’autres moyens. Ce qui n’a rien de nouveau et ne concerne pas que cette discipline. Cela vaut aussi, par exemple, pour les économistes, les philosophes, les sociologues…
Fascisme, autoritarisme : de quoi parle-t-on ?
Robert O. Paxton, dans le texte déjà signalé, constate que « d’énormes difficultés surgissent dès que l’on s’engage à définir le fascisme. Ses frontières sont floues ». Et il ajoute un peu plus loin : « Disparates dans leurs symboles, dans leur décor, et même dans leurs slogans, les mouvements fascistes se ressemblent plutôt par leurs fonctions ». Par État fasciste, on entend généralement, aujourd’hui, État totalitaire dont un Chef détient le pouvoir absolu.
Les images les plus abouties des régimes fascistes ayant existé sont celles de l’Italie de Mussolini et celle de l’Allemagne d’Hitler, qu’on préfère qualifier avec raison de nazi. L’image actuelle la plus aboutie d’un régime autoritaire est celle de la Turquie d’Erdogan.
Pour comprendre de ce qu’il en était réellement du régime de Vichy, et des autres, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, j’ai utilisé la méthode de l’histoire comparée chère à Marc Bloch. Même si pour lui la comparaison est « une manière de penser plus qu’un méthode ». Il s’agira donc, reprenant cette manière de penser, de l’étude parallèle de « sociétés limitrophes et contemporaines » ayant connu « des évolutions de même sens ».
Et puisqu’il s’agit du régime en France personnalisé par Pétain, nous le comparerons à ceux personnalisés par Salazar au Portugal, par Mussolini en Italie, par Hitler en Allemagne et par Franco en Espagne. Il y a en effet unité de temps dans leur accession au pouvoir : la première moitié du 20e siècle.
À suivre : de la « guerre froide » comme moteur de l’Histoire fabriquée



