Mesdames, Messieurs les Journalistes : Le temps est venu d’appeler un chat un chat… et de nommer « fascisme » ce qui vient
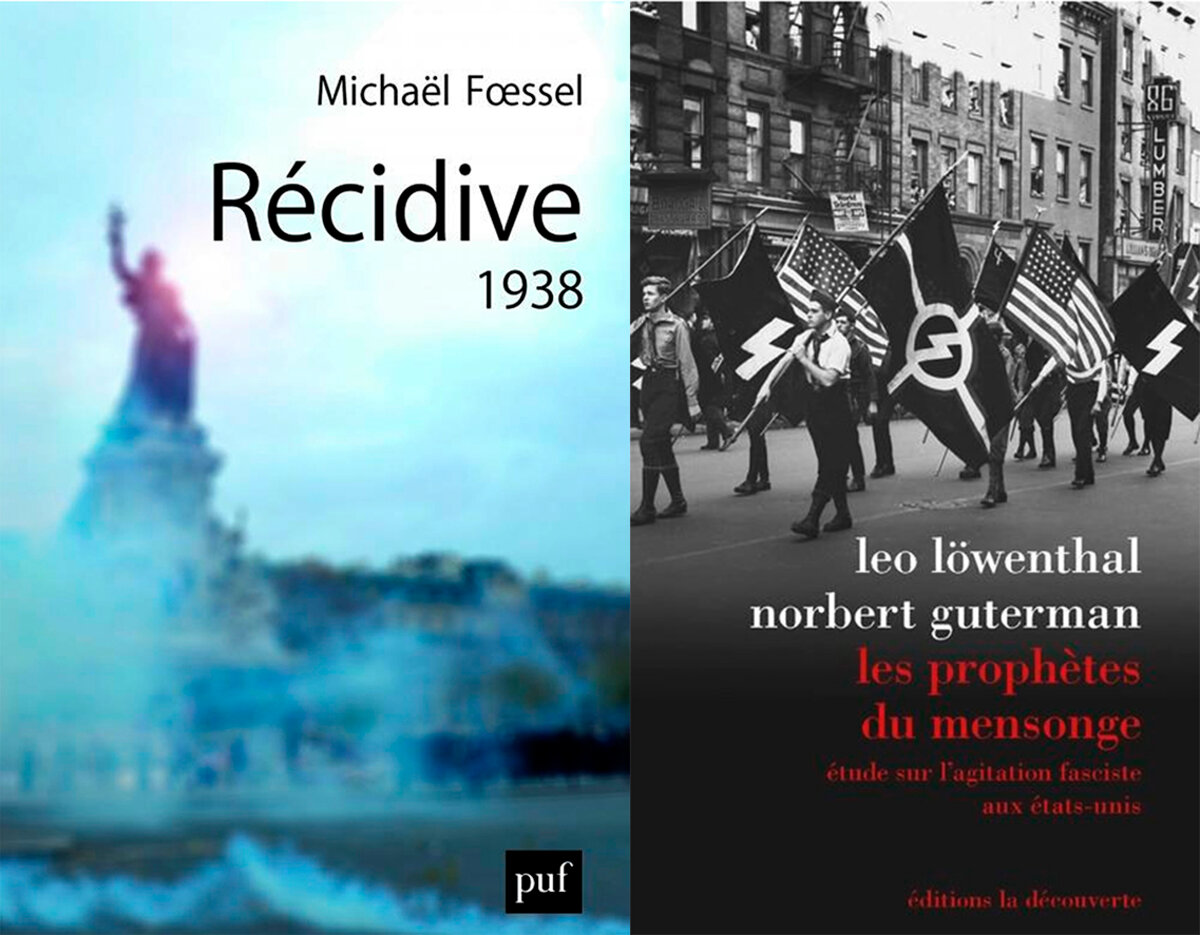
Agrandissement : Illustration 1
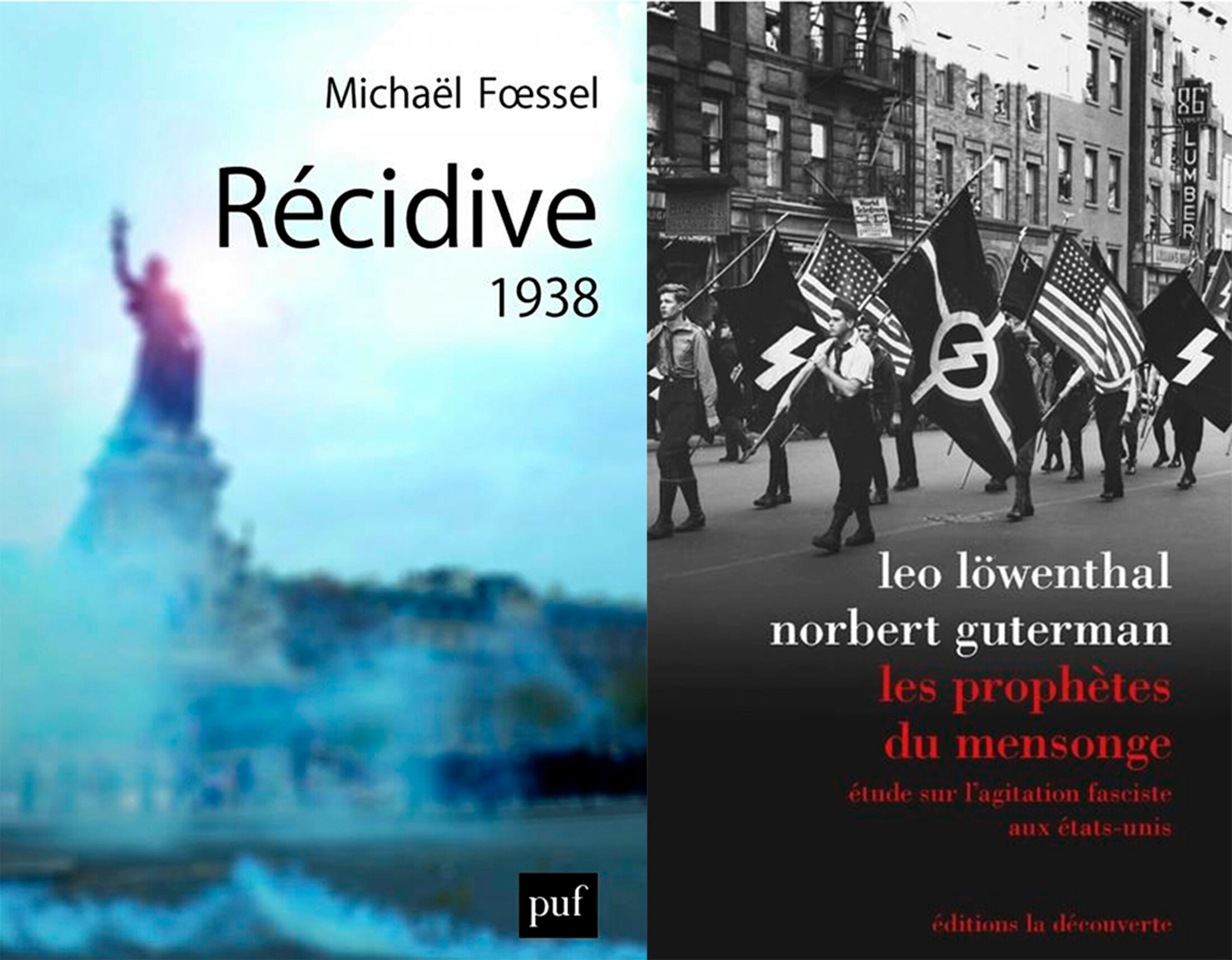
Le hasard des lectures de cet été 2019 font que j’ai emprunté le titre de cet article au philosophe Michaël Fœssel. Titre pioché dans l’avant-propos de son livre, Récidive 1938 (puf, mars 2019), où inquiet du présent il a découvert que des faits datant de l’année 1938, mais aussi une langue, une logique et des obsessions, étaient étrangement parallèles à ce que nous vivons aujourd’hui.
Dans le numéro de juillet-août 2019 de futuribles, revue consacrée à la prospective, j’ai découvert un article d’André-Yves Portnoff (consultant en prospective et management du changement), intitulé Relents du fascisme et traitant de l’ouvrage d’un historien italien des mentalités, Filippi Francesco (Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascsima, mars 2019), ouvrage consacré à l’usage du mensonge en politique, hier et aujourd’hui.
Enfin, troisième ouvrage lu cet été, sur un sujet voisin : Les prophètes du mensonge, étude sur l’agitation fasciste aux Etats-Unis. Livre publié par La Découverte en avril 2019, qui est la traduction d’un ouvrage publié en 1949 des sociologues et philosophes Léo Löwental et Norbert Guterman (1), relatant l’agitation fasciste aux Etats-Unis dans les années 1940 (années qui ne sont pas si éloignées de l’année 1938) et précédé d’une longue présentation (près de 28 pages) du sociologue Olivier Voirol.
Le populisme ? À son propos, analyses concordantes dans les trois livres. Pour Michaël Fœssel, « Il arrive que le présent ne laisse plus le choix : il faut bien lui donner un nom ou le saisir par une formule. On parle aujourd’hui de « populisme » à propos de mouvements qui, pour s’emparer du pouvoir, misent sur le ressentiment populaire à l’égard des institutions et des élites économiques. On nomme aussi « démocraties illibérales » des régimes qui, tout en respectant les formes du suffrage universel, détruisent les unes après les autres les protections constitutionnelles garanties par l’État de droit à la société civile. Le spectre des années 1930 hante ces tentatives pour définir la nouveauté du présent ; on dit « populisme » ou « illibéralisme » pour ne pas avoir à dire « fascisme » ».
Pour Pour André-Yves Portnoff, « L’historien (Filippi Francesco) lance un avertissement que devraient prendre en compte tous les aveugles qui n’ont pas vu, depuis 20 ans la montée des totalitarismes cachés derrière les vagues populistes : « Je n’aime pas le terme néofasciste, car je ne crois pas qu’il existe un vieux et un nouveau fascisme. Si celui-ci, historiquement, naît et meurt avec Mussolini, les comportements et les idées fascistes sont de tous les temps. Dès que que l’on abuse de la force, que prévaut la loi du plus fort, le fascisme n’est pas loin ». »
Enfin, pour Olivier Voirol dans sa présentation du travail de Leo Löwenthal et Norbert Guterman, « La distinction opérée par Löwental et Guterman entre deux modes d’action et d’argumentation est particulièrement intéressante. En différenciant l’agitation fasciste de l’activisme progressiste, avec ses visées de « réforme » ou de « révolution », les auteurs mettent au jour leurs modalités rhétoriques et politiques opposées – souvent maladroitement associées par des analyses hâtives, sous le terme fourre-tout de « populisme ».
Vers des clarifications ? « Faut-il franchir le Rubicon ? Certains pensent que le temps est venu d’appeler un chat un chat et de nommer « fascisme » ce qui vient. La question de ce qui arrive déjà en 1938, du moins pour ceux qui percevaient que la France d’alors (à l’unisson de l’Europe et exception faite de la Grande-Bretagne) perdait un à un les attributs d’une société démocratique. Faut-il se tourner vers 1938 pour résoudre un problème qui se pose en 2018 ? » écrit Michaël Fœssel.
« Les formes discursives de l’agitation mises en évidence par Löwenthal et Guterman dans les années 1940 n’ont rien perdu de leur actualité. […] Les principaux ressorts de l’agitation sont restés les mêmes, en particulier l’« exploitation de la frustration généralisée, en détournant l’attention des racines du mécontentement et de son remède » (Herbert Marcuse, préface à la seconde édition des « Prophètes du mensonge », août 1969). On retrouve ces formes d’agitation à l’heure actuelle sous des traits similaires au sein des diverses formes d’agitation des droites extrêmes en Europe et dans le monde. Avec ces analyses ancrées dans la réalité politique et sociale américaine du milieu des années 1940, l’enquête de Löwenthal et Guterman permet d’enrichir l’examen des techniques et des stratégies discursives de l’agitation contemporaine » nous dit Olivier Voirol.
« Aujourd’hui, après des années de désinformation, une partie considérable des citoyens en Europe et notamment en Italie, oublie l’importance des principes démocratiques. Aussi, ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini a-t-il pu se permettre de choisir pour son livre-interview, l’éditeur Altaforte, créé par un politicien sous le coup d’une enquête pour apologie du fascisme. Ce Francesco Polacchi, dirigeant d’un parti néonazi, se proclame fier d’être fasciste et professe que « le mal de l’Italie, c’est l’antifascisme » » écrit pour sa part André-Yves Portnoff. Qui écrit aussi : « « la base d’un possible futur totalitaire passe aussi par la réhabilitation du passé totalitaire ». Ces mensonges permettent à beaucoup d’Italiens de s’auto-innocenter par rapport à un passé présenté comme « le récit mythique d’un bonheur perdu », note l’essayiste Guido Caldiron. En France, le voile passé sur la collaboration fait que les bonnes consciences ont moins besoin de mensonges ».
Faire éclater la plaie pour en faire sortir le pus »
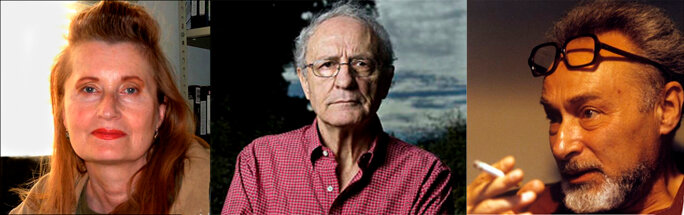
Agrandissement : Illustration 2
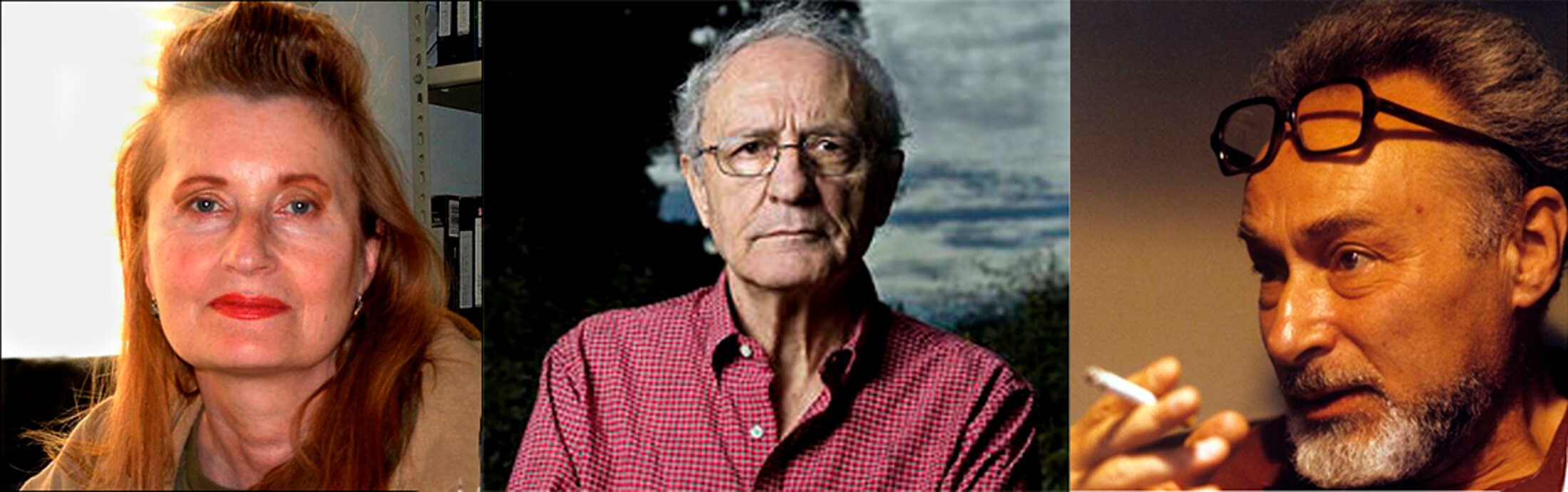
Dans une interview accordé au Monde daté du 16 août 2019, la prix Nobel de littérature autrichienne Elfriede Jelinek déclarait : « on ne dévoile pas le racisme ou le sexisme d’une langue en l’édulcorant, ou en inventant d’autres mots parce que les anciens sont usés. Ces mots soi-disant nouveaux ne sont en réalité que des clichés, qui servent à discipliner les gens. […] C’est une façon d’édulcorer ou d’euphémiser les rapports sociaux. […] Il faut sans cesse faire éclater la plaie pour en faire sortir le pus ». Cela vaut aussi, o combien, s’agissant du fascisme.
C’est pourtant ce que ne font pas, jour après jour, les journalistes de la presse écrite. Tous, ou à peu près. « Faire éclater la plaie pour en faire sortir le pus » ? Pour ne pas avoir à dire « fascisme », ces « aveugles » utilisent le fourre-tout de « populisme », ou quelque équivalent. Et ainsi n’appellent pas « un chat un chat ». Et il en va de même, largement, sur les chaînes de télévisions et sur les radios.
Le jeudi 8 août 2019, le ministre de l’intérieur italien, Matteo Salvini, faisait éclater la coalition au pouvoir et réclamait de nouvelles élections générales. Il espérait ainsi prendre seul le pouvoir en Italie et devenir, en quelque sorte, son « Führer ». Événement révélateur pour examiner les mots utilisés par les journalistes à propos de ce moment significatif.
J’ai examiné ce qu’en ont dit les journalistes du Monde et de L’Humanité. À aucun moment, dans ces deux journaux, Salvini, ce nostalgique du fascisme mussolinien (voir ci-dessus), n’est taxé de fasciste. Pour les journalistes de ces deux journaux, mais dans les autres publications il en va probablement de même, « un chat n’est pas appelé un chat ». Le parti de Salvini est présenté comme un parti d’extrême-droite, ce qui est un progrès par rapport à l’expression « populiste » qui mélange tous les populismes, de droite comme de gauche (qui est encore largement utilisé). Mais il reste qu’un parti d’extrême-droite, qui peut aussi être taxé de populiste, a cette conséquence : il lave ce parti, dit d’extrême-droite ou populiste, de tout lien avec un parti fasciste, qui répond à une définition bien plus précise.
Pour l’historien israélien Zeev Sternhell, « le fascisme, c’est la mise de toute l’autorité, de toute la puissance de l’État concentrée entre les mains du chef, au service de nouvelles valeurs. Le fascisme est une révolte contre les principes des Lumières, ou plus concrètement contre la démocratie, le socialisme d’origine marxiste et le libéralisme. Vichy n’était rien d’autre. La dictature de Vichy n’était ni plus ni moins pluraliste que le régime mussolinien et l’ascension de Pétain a été plus facile que celle d’un Mussolini ou d’un Hitler » écrit-il dans son dernier livre (L’histoire refoulée, Cerf, janvier 2019).
Mais le fascisme c’était alors aussi, dans les années 30-40, l’antisémitisme d’État, c’est-à-dire l’adoption de législations anti-juives. C’était le cas pour l’Allemagne de Hitler, dès 1935, avec les lois issues du Congrès de Nuremberg. C’était le cas pour l’Italie de Mussolini, dès 1938, avec notamment l’exclusion des juifs de la fonction publique. C’était le cas, encore, pour la Hongrie de Horty, dès 1920 avec l’adoption d’un numerus clausus. Lois renforcées en 1938, quand la Hongrie devient l’alliée de l’Allemagne hitlérienne.
C’était bien sûr alors le cas de la France occupée, dès le 3 octobre 1940 avec la loi portant le premier statut des juifs, sans que l’occupant l’ait demandé, jusqu’à celle du 11 décembre 1942 relative à l’apposition de la mention « juif » sur les titres d’identité, en passant par celle du 21 juin 1941 limitant à 3% le nombre d’étudiant juifs admis dans l’enseignement supérieur, ou par celle du 22 juillet 1941 instaurant des administrateurs provisoires dans les entreprises détenus par un juif (ceci, disait la loi, « En vue d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale »).
Ces États, l’Allemagne hitlérienne, l’Italie mussolinienne, la Hongrie de Horty, la France pétainiste étaient tous des États fasciste ayant promulgué, entre autres, des lois anti-juives. Aujourd’hui, après la Shoah, il est bien difficile de revenir à des lois discriminatrices anti-juives. Les migrants et autres catégories de population non-blanches deviennent aujourd’hui les juifs d’hier.
On le voit, pour les journalistes, en général, en France et en Italie notamment, s’agissant de cette tentative de prise de pouvoir par les urnes de Salvini (qui, à l’heure où ces lignes sont écrites, est loin d’être acquise et semble même, provisoirement, s’éloigner), il leur reste encore à « faire éclater la plaie pour en faire sortir le pus ». Il y aura probablement en Italie une alliance gauche-droite barrant provisoirement la route à des élections législatives, mais celles-ci auront lieu, tôt ou tard, ouvrant la marche vers un fascisme de notre époque ?
En effet, « Chaque époque a son fascisme : on voit ses signes avant-coureur partout là où la concentration du pouvoir empêche le citoyen de s’exprimer et d’agir selon sa volonté. Cela se fait de bien des façons, pas nécessairement par la terreur de l’intimidation policière, mais aussi en niant ou en déformant l’information, en polluant la justice, en paralysant les écoles, en répandant subtilement la nostalgie d’un monde où l’ordre règne en maître et où la sécurité de quelques privilégiés repose sur le travail forcé et le silence forcé du plus grand nombre » nous disait Primo Levi (« Un passé que nous croyions ne devoir jamais revenir », Corriere della sera, 8 mai 1974). C’est ce que nous rappelle André-Yves Portnoff dans son article.
(1) Henri Lefebvre et Norbert Guterman avaient publié ensemble, en France et en 1936, La conscience mystifiée. Dans sa présentation, Olivier Voirol ne dit pas que cet ouvrage a été réédité en février 1999 par les Éditions Syllepse, avec en supplément un résumé de La conscience privée du seul Henri Lefebvre. Voici les précisions que j’apportais, à propos de ce dernier texte, dans la courte introduction que j’avais alors faites : « Seule La Conscience mystifiée sera écrite par les deux auteurs. Projet non-abouti donc s’agissant de la série. D’une part, Norbert Guterman, arrivé à Paris (venant de Varsovie) dans les années 20 avec le mathématicien Mandelbrjte, et logent alors à trois (Politzer en était aussi) dans une même chambre du Quartier latin, avait été exclu publiquement du Parti communiste vers 1930. En situation irrégulière – sans papiers – il dut se réfugier à New York. D’autre part, en 1939, autre événement : la guerre. Henri Lefebvre entre en Résistance ».
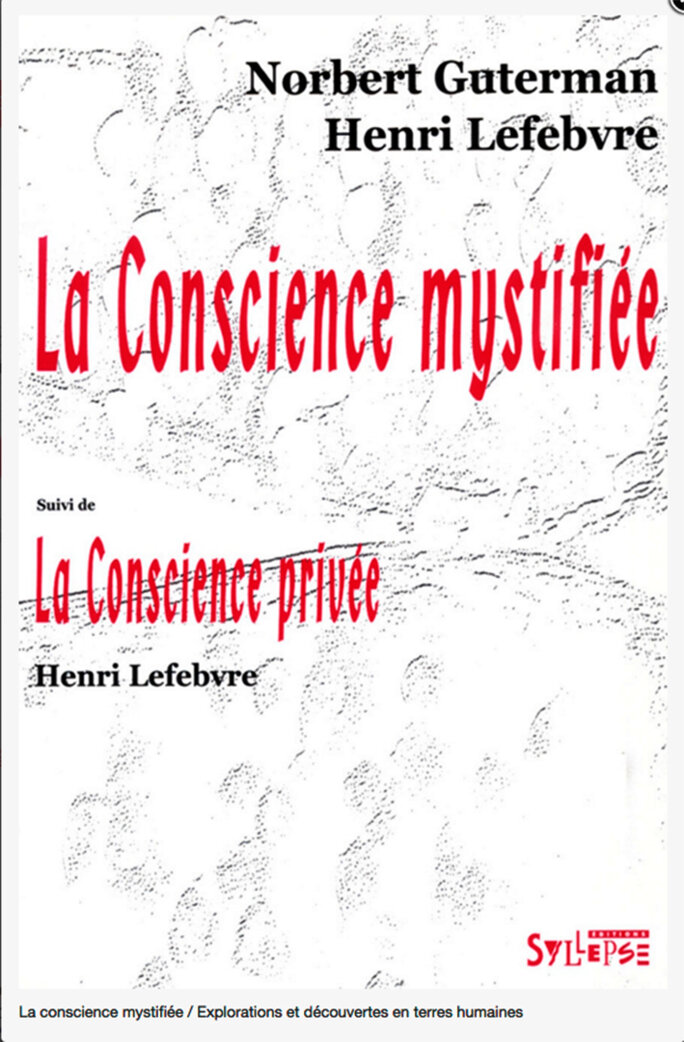
Agrandissement : Illustration 3




