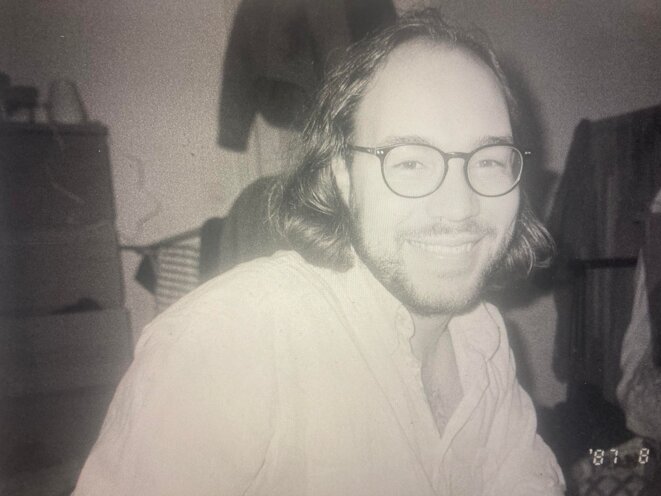Bide & Musique, « la webradio de l'improbable et de l'inouï », est l'un des meilleurs sites d'internet. Il est à la chanson ce que Nanarland est au cinéma : un répertoire de ce qui a été effacé, oublié, mis sous le tapis, souvent au prétexte de l'insuccès commercial et/ou du mauvais goût de ces productions. Évidemment, il faut de tout pour faire un monde et de même que s'est développée une nanarophilie qui tire justement un plaisir particulier des films fauchés, avec des doublages à la ramasse, des acteurs dignes de Christophe Barbier ou des monstres gants de toilette, il se trouve des amateur·ices de sensations fortes pour chiner parmi les Inécoutables de B&M.
Bien entendu les catégories esthétiques sont discutables, la beauté est avant tout dans l'oreille de cell·lui qui écoute, et il est particulièrement réjouissant, par exemple, d'entendre Denis Lavant faire l'éloge de Normand L'amour : il s'agit pour lui d'« art brut musical », où il y a « une sorte d'élan, de bonne santé, de grande générosité, de grande convivialité », dans lesquelles le comédien hyperactif et amateur de formes expérimentales (même s'il est visiblement amusé par ce titre bizarre) se reconnaît sans doute un peu. « C'est une pure merveille », conclut-il. Les mêmes paradoxes esthétiques sont soulevés dans l'excellent podcast de Raphaëlle Berlanda-Beauvallet L'Hymne à la daube qui, d'après sa description, « aspire à l’abolition de l’idée de bons et mauvais goûts musicaux. Parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. » Les invité·es, systématiquement des musicien·nes, y parlent de leur « daube » préférée, des chansons qu'iels apprécient sans que ce soit forcément très avouable, « Ces soirées-là », « Jamais je n'avouerai » ou autres démons de minuit. Au fil de la conversation on découvre à chaque fois que la daube qu'iels choisissent a toujours profondément à voir avec leurs propres valeurs esthétiques, avec leur façon d’envisager la musique, d’écrire, de composer, d’être ému·e – ce qui rend la daube inavouable, ce n'est pas tant une condescendance individuelle (la plupart des invité·es aiment vraiment la daube dont iels parlent) qu'une pression sociale qui dévalorise certain·es artistes et certaines chansons.
Ces processus de (dé)légitimation me fascinent dans leur arbitraire (relatif). Et quand je me promène sur Bide & Musique, le sentiment qui domine en général, davantage que « Wow qu'est-ce que c'est que cette horreur comment est-ce qu'on a pu enregistrer ça » (même si ça arrive), c'est plutôt la surprise devant cet arbitraire qui fait de telle chanson un tube incontournable des années 60/70/80, quand telle autre, qui n'est pas forcément moins bonne, est tombée dans l'oubli. Si la sociologie de la littérature a beaucoup éclairé la façon dont se construisent les canons littéraires, dont certaines œuvres sont encensées par la critique, couronnées par des prix, intégrées à des manuels scolaires, des cursus universitaires, citées, référencées, monumentalisées, etc., l'établissement d'un « canon » de la chanson française a sans doute reçu un peu moins d'attention, mais des processus similaires sont à l'œuvre, aboutissant à la domination de certains grands noms (Johnny, Gainsbourg, Goldman...), perçue comme naturelle, alors qu'elle a été construite au fil du temps par une variété d'acteurs : maisons de disque, presse, radios, etc. En 15 titres qui auraient pu être des tubes inoubliables, je vous propose un bref voyage dans cette contre-histoire de la chanson française.

Agrandissement : Illustration 1

1. Henri Porte des Lilas - Philippe Timsit (1981)
Le sujet de cette première chanson fait directement écho à mes brèves remarques introductives. Elle met en scène Henri, ancien bassiste du groupe de rock fictif les Toreros (qui jouait au Golf-Drouot, haut lieu du rock'n'roll en France dans les années 60), dont la carrière a été interrompue pour cause de service militaire. De retour à Paris, il trouve un champ musical complètement changé – il s'adresse au chanteur de son ancien groupe, qui a poursuivi sa carrière en solo avec succès (on pense à Johnny ou Eddy Mitchell), à qui il demande du travail. Malgré son refrain euphorique sur l'arrivée du rock en France, il ne s'agit pas seulement d'une chanson nostalgique : elle parle aussi de la fragilité des carrières artistiques, qui peuvent s'arrêter sur un aléa défavorable (on pense au film Jean-Philippe de Laurent Tuel, qui imagine une réalité parallèle où le jeune Jean-Philippe Smet, incapable de se rendre à une audition décisive, n'est pas devenu Johnny Hallyday). Elle montre également la dimension collective de la musique, peut-être un peu oubliée au début des années 80, alors que justement beaucoup d'artistes qui ont commencé au sein de groupes lors des décennies précédentes sont devenus des têtes d'affiche solitaires. Mais que seraient ces stars sans musiciens, sans auteurs-compositeurs ou sans techniciens ? (avant de se lancer dans la chanson, Philippe Timsit a notamment été éclairagiste pour Claude François). Il faut un village pour faire une chanson – et pour le coup cette dimension collective n'est pas du tout prise en compte dans Jean-Philippe, où les chansons de Johnny semblent émaner magiquement de sa personne (dans la réalité parallèle où il n'a pas fait carrière dans la musique, il griffonne quand même dans son coin quelques textes... dont un en réalité signé Goldman).
2. Ô Sophie - Étienne Auberger (1987)
Pour enchaîner sur un autre titre qui rend visible (cette fois sur le mode de l'humour) les coulisses de l'industrie musicale, je ne pouvais pas faire l'impasse (ne serait-ce que par chauvinisme strasbourgeois) sur Étienne Auberger, cette étoile filante des années 80, et son titre phare « Ô Sophie » (extrait du bien nommé album Ô). On y suit l'histoire d'un aspirant chanteur qui rêve de vivre de son art mais doit multiplier les pubs et les cachets précaires, ce qui semble quelque peu courir sur le haricot de sa compagne. « Il a eu une expérience musicale un peu malheureuse, raconte son fils Jacques. Il était très satisfait de ses maquettes qui lui avaient permis de signer un beau contrat, mais lors de l’enregistrement au studio du château d’Hérouville, le producteur et les musiciens sont partis dans une direction qui ne lui plaisait pas. Il s’est senti dépossédé de ses chansons. [...] Cette expérience l’a traumatisé, il n’a plus jamais enregistré. » Le ton guilleret de cette chanson satirique n'en apparaît que plus élégant.
3. Ça dépend des filles - Patrick Loubié (1980)
De Patrick Loubié je ne trouve pratiquement rien sur internet, sinon un avis de décès et quelques chansons qui ont vraiment du charme, avec des petits côtés Nino Ferrer ou Bashung fin 70. Ma préférée, « Ça dépend des filles » transcrit quelque chose des désirs frustrés de l'adolescence, d'une attitude cynique et goujate qui cache mal un profond besoin d'aimer. Une chanson peut-être un peu trop Tinder blues pour 1980 ?
4. L'Hymne à l'amour - Cyclope (1984)
Je vois théoriquement en quoi c'est bidesque. Je saisis l'idée d'une tentation ironique. Mais – peut-être parce que le texte d'Édith Piaf est lui-même déjà très premier degré et en quelque sorte « excessif » – pour moi c'est une reprise certes inattendue mais qui marche juste incroyablement bien.
5. Ça m'arrive encore - Éric Charden (1981)
Si quelqu'un a fait des chansons à la chaîne en France, c'est bien Didier Barbelivien (plus de 2500 selon Wikipédia, on en trouve 310 dans la base de donnée de B&M). Évidemment dans le lot, certaines sont de purs bides, certaines ont été des tubes comme « On va s'aimer », « Est-ce que tu viens pour les vacances ? » ou « 28° à l'ombre » (c'était super chaud à l'époque), d'autres, peut-être un peu plus confidentielles aujourd'hui, ont une qualité indéniable, comme « Mon mec à moi », « Nice baie des Anges » ou « Je te survivrai » (premier degré une excellente chanson si on me demande mais je ne suis pas sûr que le monde soit prêt pour cette conversation). Parmi les plus secrètes, j'aime particulièrement « Ça m'arrive encore », qui repose, comme beaucoup de ses chansons, sur le principe de la liste (ça m'arrive encore de penser à toi dans telle, telle, telle situation) – c'est rapide à écrire, et ça fonctionne plutôt bien !
6. J'essaierai d'oublier - Émilie Bonnet (1983)
Un peu dans le même mood mélancolie post-rupture, une autre chanson qui aurait très bien pu être un tube, dans la mesure où elle est signée d'un habitué des succès populaires s'il en fut jamais : Jean-Jacques Goldman. Qui la recyclera d'ailleurs quelques années plus tard sous le titre « Si tu veux m'essayer » pour Florent Pagny. Sous cette forme, la chanson connaîtra le succès. Son rythme vif correspond peut-être en effet davantage aux débuts d'une histoire d'amour plutôt qu'à sa fin difficile... Mais justement, je trouve la version d'Émilie Bonnet certes moins intuitive, mais d'autant plus intéressante, et environ vingt fois mieux écrite que la version Pagny. On se prend à rêver d'uchronies : que serait devenue cette Bonnie Tyler française si cette chanson avait connu le même succès que sa version ultérieure ?
7. Quand tu pars - Rose Laurens (1986)
Pour moi Francis Cabrel est l'un des meilleurs auteurs de la chanson française. Et je ne suis pas sûr que ce soit une unpopular opinion, parce que pour le coup ses titres les plus célèbres sont diffusés quotidiennement sur Nostalgie... Mais on ne parle jamais de « Quand tu pars », l'un des seuls textes qu'il a écrits pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence Rose Laurens, surtout connue pour son tube « Africa », pour le moins exotisant, et que je ne trouve appréciable que quand il est au cœur d'une battle karaoké entre Dick Rivers et Julien Doré. Je préfère mille fois « Quand tu pars », qui sublime ce moment fragile où les amants qui viennent de se séparer ne sont pas encore complètement revenus de la sensualité qu'ils partagent, un beau sujet que Cabrel reprend sur le mode mineur dans « À l'aube revenant ». Mais là encore le succès a ses raisons que la raison ignore...
8. Mes universités - Philippe Clay (1971)
On a l'impression qu'un tube c'est une chanson qui arrive à condenser quelque chose de l'air du temps, qui touche une corde sensible collective, qui a posteriori nous raconte son époque. Parmi tant d'autres, je pense à « Une belle histoire » (1972) : la 4e semaine de congés payés, les longs trajets sur les autoroutes qui s'étendent, l'amour libre, sa simplicité, son ivresse, sa mélancolie. J'écoute cette chanson et c'est comme si je lisais Les Années d'Annie Ernaux. Inversement, un bide c'est une chanson qui souvent a du potentiel mais qui pour une raison ou une autre est un peu décalée, un peu à l'ouest. Par exemple ici Philippe Clay qui à la même période, une longue carrière au music-hall derrière lui, se moque de la jeunesse contestataire au nom de son passé de résistant. Des punchlines comme « Quand on écoutait Londres / Dans nos planques sur les ondes / C'était pas les Beatles qui nous parlaient » en font en quelque sorte le boomer originel, celui à qui même les boomers ont sans doute eu envie de répondre « OK boomer ».
Au-delà du fait que je trouve cette chanson hilarante, je ne sais pas pourquoi j'ai au fond une certaine affection pour les vieux chanteurs de droite comme Philippe Clay et Michel Sardou. Peut-être que ce que je regrette en eux c'est une époque où les droitos avaient au moins un certain panache, de la voix et du swing : aujourd'hui ils mènent la bataille culturelle avec Tibo InShape. La droite c'était mieux avant.
9. La plus belle chanson - Jacqueline Taïeb (1967)
Un titre extrait de son premier album, moins connu que quelques autres : « 7 heures du matin », « Le cœur au bout des doigts », et surtout « La fac de lettres », hymne indémodable aux études littéraires. Qu'après de tels débuts elle ne soit pas devenue une figure centrale de la chanson française dans les décennies suivantes me dépasse complètement.
10. Si vous connaissez quelque chose de pire qu'un vampire, parlez m'en toujours, ça pourra peut-être me faire sourire - Stella (1966)
En hommage à Nosferatu.
11. La nuit te ressemble - Jo Lemaire (1990)
Je vois sur Wikipédia qu'elle a connu un certain succès dans les années 80-90, notamment en Belgique. Pour moi, Jo Lemaire c'est surtout une très belle reprise de Gainsbourg, qui éclaire comme d'un éclat de lune mélancolique le premier film de Leos Carax. « La nuit te ressemble », un peu « Les dingues et les paumés » meets « Self Control », donne envie de mieux connaître la new wave ténébreuse de cette artiste ma foi stylée. On trouve aussi sur Bide & Musique une intéressante reprise titi parisienne de « Dirty Old Town ».
12. D'être à vous - Marie Laforêt (1969)
Adapter des chansons en français c'est un art subtil, qui était très pratiqué notamment dans les années 60-70 : les sélections V.O.-V.F. de Bide & Musique permettent de se rendre compte du nombre immense de chansons françaises adaptées de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, du portugais ou d'autres langues. Ça peut donner des choses magnifiques, mais c'est un exercice où il est très facile de se planter complètement, un peu comme la récente reprise de « Hallelujah » par Vianney, qui a montré au monde à quel point l'écriture de Leonard Cohen lui passait au-dessus. Contre-exemple, la reprise de « I want you » par Marie Laforêt (texte de Jean Schmitt), qui n'est pas une retranscription littérale du sublime texte de Dylan, mais reste admirablement fidèle à sa galanterie hallucinatoire.
13. La camomille - Michel Berger (1963)
L'une des choses les plus amusantes/instructives à faire sur Bide & Musique c'est de taper le nom de ses artistes préférés dans la barre de recherche et découvrir des aspects moins connus de leur carrière, les errances crooner d'Alain Bashung, les débuts rockabilly de Christophe ou le niveau d'allemand désastreux de Michel Delpech. Ainsi, si on retient de Michel Berger son romantisme des années 80 et les incroyables tubes qu'il a signés pour France Gall, Françoise Hardy et Starmania, on oublie souvent que c'était déjà un petit génie à l'âge de 16 ans.
14. Jamais nous - Elsa (1988)
Encore un Barbelivien pour la route ? Je ne sais pas à quel point on s'en souvient aujourd'hui, mais Elsa (Lunghini) a interprété plusieurs tubes mélancoliques dans les années 80 : « T'en vas pas », « Un roman d'amitié » et peut-être mon préféré, le délicat « Jour de neige ». Quant à « Jamais nous », j'ai personnellement un faible pour cette chanson qui dessine, en négatif, les contours d'une relation exceptionnelle, inoubliable, peut-être justement parce qu'elle ne se réalisera jamais. (ps - encore une liste, ceci, ceci, cela, ce sera jamais nous, y'a pas à dire, le système Barbelivien est bien rodé !)
15. Baudelaire - UTA (1969)
Juste une chanson comme on en fait plus - est-ce qu'on n'ose plus toucher aux grands textes à moins de s'appeler Feu Chatterton ? À l'époque Jean Ferrat a fait de magnifiques chansons sur des textes d'Aragon, Ferré sur Apollinaire ou Rimbaud, le jeune Gainsbourg a livré des bangers à partir de Musset, Nerval ou Félix Arvers. Mais je dois à Bide & Musique la découverte de cette version rock psychédélique du poème « Recueillement » de Baudelaire. C'est bien entendu absolument parfait.