Dans cette contribution, Stéphane Le Lay, sociologue du travail, chercheur à l’Institut de psychodynamique du travail et notamment co-directeur (avec Delphine Corteel) de l’ouvrage Les travailleurs des déchets (Érès, 2011), examine de manière critique le traitement médiatique, pendant le confinement, de l’activité des éboueur.e.s. Ce faisant, il propose des réflexions, notamment, sur les représentations sociales des travailleurs et travailleuses avant, pendant et après la crise, sur les formes d’invisibilisation et de reconnaissance du travail, et sur les manières de parler du travail effectif. Un chantier que nous souhaiterions contribuer à développer.
C’est un truisme commun à de nombreux espaces professionnels : certaines catégories de travailleur.euse.s ne sont guère représentées dans la plupart des médias d’information, ou sous une forme tellement déformée que les principaux.ales intéressé.e.s ne reconnaissent pas ce qui constitue les éléments les plus saillants de leur travail effectif. Constat banal particulièrement avéré dans le cas des éboueur.e.s[1], professionnel.le.s dont il va être surtout question dans cet article[2].
Il n’aura échappé à quiconque un tant soit peu concerné par la catastrophe actuelle du coronavirus que se sont très récemment multipliés articles de presse, reportages télévisés ou tribunes militantes mettant sur le devant de la scène « ceux qui sont d’ordinaire invisibles » (pour reprendre le titre malvenu de l’interview du sociologue Camille Peugny[3]). Cette soudaine attention médiatique est directement liée à la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser un peu rapidement, elle ne traduit pas un intérêt profond pour ces travailleur.euse.s du « bas de l’échelle[4] ». Selon moi, elle constitue avant tout la marque d’une sidération puis d’un sentiment de peur face à la virulence virale parmi une large frange de la population – y compris chez des individus habituellement peu enclins à s’émouvoir des difficultés rencontrées par les membres des classes populaires, qu’ils/elles soient ou non en emploi.
Il me semble en effet que cette attention s’exprime parce que beaucoup de nos concitoyen.ne.s, arrêté.e.s dans leur course quotidienne frénétique, travaillé.e.s par la peur, voient ce que d’habitude ils/elles peuvent/veulent ne pas regarder : des corps au travail dans l’espace urbain. Ces corps présents dans des rues quasi désertes représentent soudain des remparts entre la propagation de la maladie et la population – confinée ou non. Contrairement aux livreurs à vélo, travailleur.euse.s précarisé.e.s et dévalorisé.e.s y compris pendant la crise du coronavirus, qui dégoulinent de sueur et sont suspecté.e.s de véhiculer le virus[5], les éboueur.e.s œuvrent à son élimination.
Malheureusement, le problème avec la sidération et la peur, c’est qu’elles empêchent de penser clairement à ce que l’on fait. Et l’on admettra aisément qu’écrire en prétendant décrire et analyser des événements – qui plus est « à chaud » – sans pouvoir penser, ce n’est pas facile. Les recherches en psychodynamique du travail documentent en effet les difficultés que rencontrent de nombreux.euse.s travailleur.euse.s dans le cours de leurs activités, et elles ont montré en quoi ne pas réfléchir à ce que l’on fait permet de faire ce que sinon l’on ne voudrait pas faire. Pour ne prendre qu’un exemple, la situation catastrophique des personnes âgées dans de nombreux EHPAD remonte à bien plus loin que la crise du coronavirus – d’aucuns n’hésitaient pas à alerter sur la maltraitance alors vécue par les résident.e.s. Et pourtant, ces établissements fonctionnaient encore au moment du déclenchement de l’épidémie ; on n’ose alors imaginer le degré de dégradation de la « prise en charge ».
« Mais pour qui il se prend, ce type, avec son ton de donneur de leçons ? » Question légitime qui mérite d’être posée, et à laquelle je vais répondre en espérant que la colère dont elle a pu se nourrir subsiste sous la forme d’une volonté de savoir plutôt qu’elle ne retombe dans une angoisse léthargique ou d’un activisme théâtral[6]. Je vais m’intéresser à la manière dont sont représenté.e.s les éboueur.e.s dans l’espace public médiatique (presse, télévision et réseaux sociaux), en comparant le traitement pré-crise et le traitement actuel. En dehors de quelques supports, généralement courts, qui ont donné la parole aux intéressé.e.s et n’en ont pas retenu que l’accessoire, j’ai repéré trois types de présentation de l’éboueur.e[7].
L’éboueur, ce « héros » printanier qui est un vrai « branleur » le reste de l’année
À l’instar des soignant.e.s (mais aussi des caissières, des livreurs à vélos, etc.), les membres de la profession ont découvert – sans doute avec étonnement, comme l’indique un article du Républicain Lorrain donnant la parole à Christophe Batt, ripeur messin[8] – qu’ils[9] appartenaient à cette catégorie particulière du héros célébré (Illustration 1).
Illustration 1
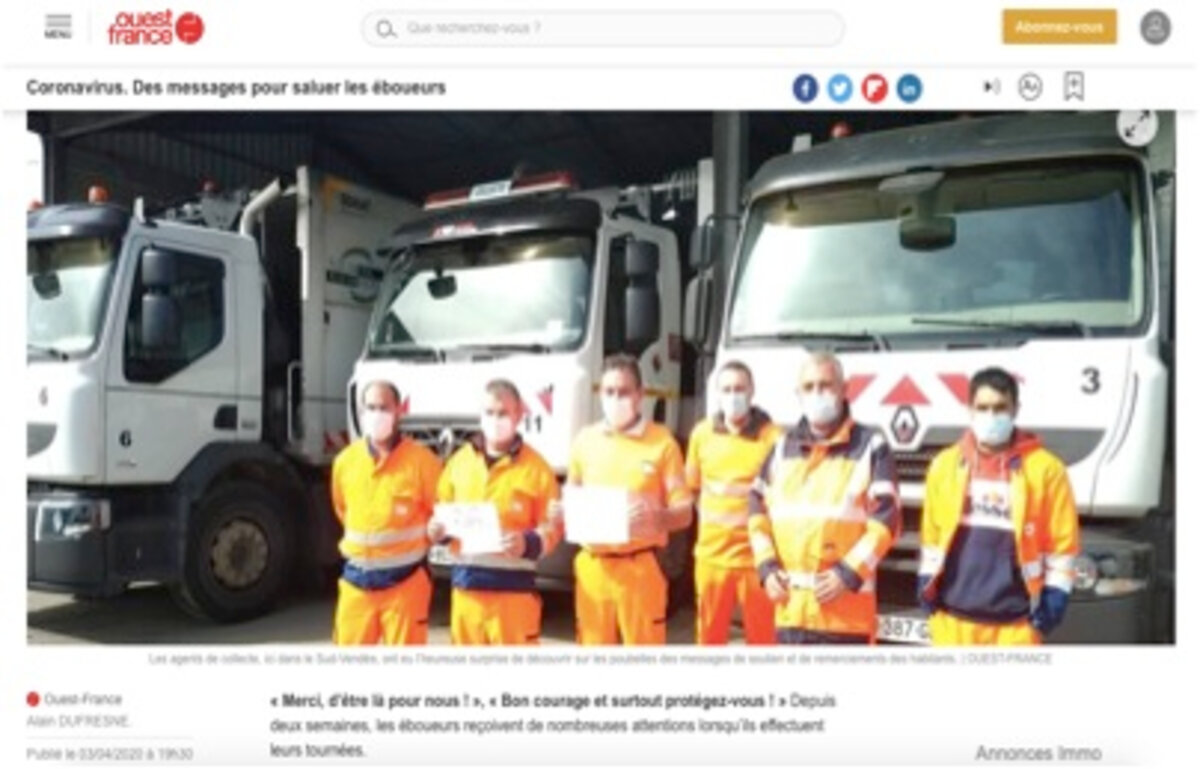
Non pas le héros maudit, tel Sisyphe, condamné à refaire ce qui a systématiquement été défait, par exemple par les passant.e.s balançant au sol leurs mégots de cigarette, avec cette grâce désinvolte signifiant au reste du monde le sentiment merveilleux d’être au-dessus de la mêlée quotidienne, en dépit des coûts écologiques et sanitaires que représente cette petite pichenette mégotique[10]. Non, le vrai héros, le positif qui rassure par sa simple présence. Celui grâce à qui le monde peut continuer de tourner lorsque tout se met à aller de travers (Illustration 2). Celui qui, par sa puissance, son intelligence, son courage, voire son sens du sacrifice – autant de notions renvoyant à l’idée de héros –, va nous protéger. On est en droit de voir dans cette image, répétée dans de nombreux articles, un cliché. Cliché dont on trouve l’exact opposé dans la manière plus habituelle de parler des éboueur.e.s, comme on va le voir.
Illustration 2

Actuellement, sont mis en lumière des personnages imaginaires dans une situation exceptionnelle qui dérange le « bon ordonnancement du monde » ; les éboueur.e.s deviennent alors les remparts à l’envahissement urbain de déchets porteurs de sinistres effets sanitaires. Des remparts vivants à la propagation d’un processus mortel. De la potentielle « chair à virus », si je puis me permettre de détourner la métaphore martiale du « premier d’entre nous ». De la sorte, on les drape d’une dignité qui leur est habituellement refusée. Pour l’observateur attentif, il y a de quoi être désarçonné : dans un jeu spéculaire qui n’a rien d’amusant, ni de divertissant, les éboueurs héroïques du jour font face à leur double sombre d’hier (sont-ils finalement Janus ?) qui, dans les périodes où la vie suit son cours paisible dans les méandres du métabolisme urbain capitalisé, surgit dans les médias le plus souvent à l’occasion d’une crise, sociale celle-ci. Loin du héros sanitaire, l’éboueur se voit dépeint comme un dangereux gréviste, un vrai petit salopard sanitaire en quelque sorte, réduit à une silhouette stéréotypée s’agitant pour de viles raisons de revendications salariales, n’hésitant pas une seconde à « pourrir la vie » des citoyen.ne.s grâce à la position de force acquise dans les négociations par sa corporation louche (Marseille et Paris étant les deux villes généralement passées au crible des commentaires journalistiques et politiques).
Mais ces deux images qui émergent des discours rapides et mal informés sont tout aussi fausses l’une que l’autre. Et pour cause : elles se focalisent sur des figures rhétoriques éculées (le profiteur versus le demi-dieu) plutôt que sur le travail effectif. Les éboueur.e.s ne sont ni des feignasses[11], ni des personnages mythiques, mais des travailleur.euse.s engagé.e.s dans un certain nombre d’activités plus ou moins[12] difficiles à réaliser selon les périodes et les lieux, selon l’état des moyens matériels disponibles et selon l’état des coopérations au sein des équipes et avec la population. A-t-on besoin d’être sociologue du travail pour rappeler cela ? Si c’est le cas, il va falloir que le gouvernement actuel arrête de couper dans les budgets pérennes de l’enseignement supérieur et de la recherche, parce qu’il va y avoir du boulot…
L’éboueur, cette victime des impérities (surtout gouvernementales)
L’éboueur n’est pas seulement un héros du temps qui est là ; il est également une victime du confinement qui se dérobe à lui. Surtout ne cherchons pas les contradictions là où elles ne sont pas. On peut très bien être un demi-dieu victime : il suffit d’être sacrifié par quelqu’un de plus fort à quelqu’un de plus puissant encore, ou alors d’être suffisamment costaud soi-même pour s’auto-sacrifier à une force supérieure (selon l’époque historique, Dieu, l’État, les quatre saisons, etc.). Le héros peut tout à fait être envoyé mener « la guerre » contre le virus ; sa condition particulière le prédispose même à en mourir, le cas échéant – sacrifice triste, mais nécessaire au bien commun. Il devient alors la victime d’un ennemi plus fort ou supérieur en nombre. À moins qu’il ne soit victime de quelque chose de moins glorieux ?
De nombreux articles ont ainsi dénoncé, avec une (rare) obstination qui fait plaisir à voir, le scandale politique que représentait le fait d’envoyer les éboueurs travailler et se confronter aux risques infectieux liés au virus sans avoir les moyens suffisants pour se protéger (en matériel, ou en droit du travail – attaque contre le droit de retrait). Les éboueurs seraient ici les victimes d’un État défaillant et d’entreprises non moins fautives (Illustration 3).
Illustration 3
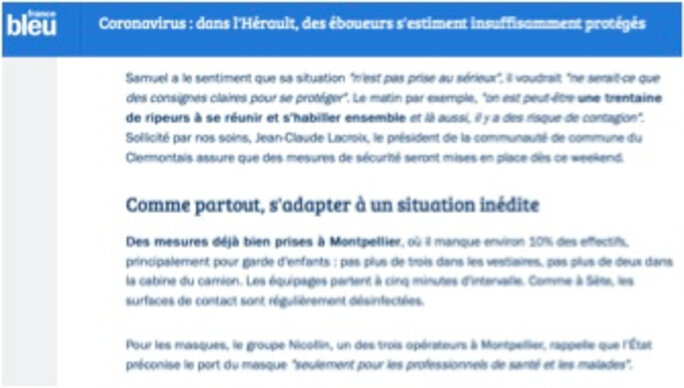
Hum… Réfléchissons (si, si, j’insiste), rien qu’un petit peu. Se pourrait-il que cette mise en danger soit finalement la manifestation exceptionnelle d’une mise en danger courante ? Loin de moi l’idée de vouloir nier la dangerosité du coronavirus. Ce petit machin agressif a tout l’air d’être sacrément actif – même si on va devoir attendre un peu pour connaître l’étendue exacte de son activité morbide et les motifs de son expansion aussi rapide qu’incontrôlée. Comme l’a déclaré la ministre des Transports, Élisabeth Borne, lors de son audition du 2 avril 2020 à la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable[13], des moyens de protection supplémentaires auraient été effectivement bienvenus pour les éboueur.e.s les réclamant en dépit de l’avis contraire du Haut Conseil de la santé publique[14], pour peu que les soignant.e.s eussent déjà eu accès à ces équipements (dont l’usage est plus crucial dans leur cas que dans celui des éboueur.e.s ou des caissières, pour des raisons qui n’auront échappé à personne, j’espère[15]). La ministre, suivant le HCSP, a en effet affirmé que les connaissances disponibles relatives notamment au maintien de l’infectiosité du SARS-CoV-2 et à ses modalités de transmission ne justifiaient pas le port d’équipements de protection individuelle autres que celles habituellement portées pour le cas des « ripeurs[16] ».
Les déclarations un peu ennuyées d’Élisabeth Borne rappellent certes cruellement le problème global de la gestion des masques en France depuis le début de la crise du coronavirus – et l’enchaînement dramatique des mauvaises décisions stratégiques de certain.e.s représentant.e.s de l’État, Marisol Touraine et ses proches socialistes en premier lieu[17]. Mais il ne faut pas oublier non plus qu’en temps normal (et ce constat pourrait être élargi à l’ensemble des travailleur.euse.s des déchets[18]), le matériel pour se protéger contre les risques de maladies infectieuses n’est généralement pas adapté (soit parce que ces moyens sont tout bonnement absents, soit parce que sont privilégiés des modes de protection individuels là où des formes collectives seraient plus efficaces). Par ailleurs, quand des masques (ou des lunettes) pourraient être portés, soit ils le sont sans tenir compte du mode d’emploi[19], soit ils ne le sont pas pour des raisons pratiques[20], mais surtout pathiques : les porter revient à admettre que le danger bactériologique existe, ce qui empêche le contrôle symbolique de la peur au niveau individuel et collectif. Or, comme la clinique du travail l’a bien montré, quand la peur s’installe, impossible de travailler durablement sans se blesser ou tomber malade.
Revenons à notre statut de victime du virus. Lorsque les rues ne ressemblent pas à un film d’Éric et Ramzy[21], les éboueur.e.s sont régulièrement confronté.e.s à de nombreux comportements méprisants et dangereux lorsqu’ils/elles travaillent, principalement à la collecte des ordures ménagères (oui, celles-là mêmes que l’on suspecte actuellement de devoir être ramassées pour ne pas ajouter de la crise à la crise) : on klaxonne, on injurie, on slalome avec son scooter entre les corps au travail et le camion-benne… Bref, on manifeste sa hargne de les voir « encombrer » la chaussée « pour le plaisir » (« Bouge-toi ! Je travaille moi ! »)[22]. À suivre beaucoup d’articles de journaux, on pourrait dire que les éboueur.e.s sont victimes de ces « incivilités », si leur engagement dans le travail n’empêchait d’adopter cette vision un brin passive et misérabiliste des choses : loin de simplement subir, les éboueur.e.s contre-attaquent bien souvent, soit en alimentant directement l’agressivité des usager.e.s (quand on agite une pelle de quelques kilos, on a un argument à opposer à n’importe quel.le conducteur.rice de grosse berline), soit en trouvant des parades pour « calmer le jobard[23] ».
En fait, le scandale politique, le vrai celui-là, c’est que les données épidémiologiques disponibles (bien que partielles) montrent que le taux d’accidentologie au travail des éboueur.e.s est l’un des plus élevés de France, tandis que l’âge moyen de décès au moment de la retraite est l’un des plus bas (tristes records partagés avec les ouvriers du BTP[24]). Autant dire que les attaques actuelles contre le droit du travail – qui sont une perfidie stupéfiante dans le timing et dans le contenu – ne constituent qu’une péripétie abjecte de plus (même si elle est préjudiciable) pour ces travailleur.euse.s.
L’éboueur, ce travailleur invisible et injustement méconnu (forcément, puisqu’il est invisible)
Le troisième type de commentaires est asséné avec la force de conviction du.de la nouveau.elle converti.e : enfourchant sa fière monture critique, le.la commentateur.rice qui entend pourfendre l’injustice sociale ne manque pas de relever avec un sens aigu de l’observation que les éboueurs sont, par la grâce de cette crise sanitaire, enfin remis à la juste place qui devrait être la leur dans l’échelle sociale des métiers – « utilité sociale » dirait Emmanuel Macron, autre grand visionnaire. Invisibles hier, lorsque tout allait bien dans le meilleur des mondes (je force un peu sur la naïveté…), les éboueur.e.s, comme les caissières, auraient retrouvé la consistance physique permettant aux rayons de lumière de ne plus les traverser. Invisibles et injustement méconnus dans leur lutte contre les dérèglements orduriers, les voilà qui explosent à la face du monde et que peut enfin se comprendre leur rôle central dans le « métabolisme urbain ».
Arrivé à ce point de mes développements, on aura compris que je suis un chouia agacé par 1/ dans le meilleur des cas, un manque de réflexion a minima, 2/ dans le pire des cas, l’expression d’un mépris social qui s’ignore peut-être lui-même (s’il est consciemment formulé, on est plus proche de la condescendance, non ?). En fait, les éboueur.e.s ne sont méconnu.e.s que de ceux et celles qui le veulent bien (les personnels politiques ayant tourné le dos aux catégories populaires ; les journalistes ayant déserté le champ de l’analyse du travail ; les usager.e.s de l’espace public ayant arrêté de penser et se comportant sur le mode du robot auto-accéléré – le même qu’ils/elles adoptent dans leur propre travail[25]). Depuis une vingtaine d’années, des chercheur.euse.s et quelques journalistes ont produit une série de travaux et documentaires suffisamment précis et diversifiés pour que toute personne curieuse puisse étancher sa soif de savoir en matière de travailler détritique[26].
La question de l’invisibilité mérite que l’on s’y arrête un peu plus. Au sens fort, les éboueur.e.s ne sont pas invisibles : comme je le mentionnais plus haut, cela se vérifie avec force tension lorsqu’ils/elles collectent les déchets dans l’espace public. Pourtant, les enquêtes sociologiques ont montré que les éboueur.e.s se disent invisibles, aussi bien quand ils/elles travaillent que dans les médias, sauf lorsque la négativité surgit (au détour d’une grève, au gré d’un ralentissement dans une rue). Plutôt que parler d’invisibilité (état), il est alors plus exact de parler d’invisibilisation, c’est-à-dire d’un processus d’effacement touchant leur qualité de travailleur.euse au service du commun territorial. Mais comment comprendre ce processus par lequel des travailleur.euse.s se retrouvent invisibilisé.e.s dans certaines circonstances ? Découle-t-il de l’impossibilité psychique, pour les membres d’une société aseptisée, de se confronter sereinement aux résultats peu glorieux de leurs comportements productifs et consommatoires ? Vient-il illustrer la perte de référence à la centralité du travail dans le quotidien des classes populaires ? Est-il le résultat logique de la longue lutte darwinienne vers la moyennisation socioéconomique soutenue par les libéraux de tous poils ? Est-il l’expression du mépris d’individus s’estimant en droit de bénéficier de services de la part d’autres individus, nécessairement inférieurs ?
Pour l’heure, la catastrophe du coronavirus a effectivement contribué à « contre-invisibiliser », sur un mode extrêmement maladroit, certain.e.s travailleur.euse.s des déchets[27]. L’attention s’est temporairement tournée vers celles et ceux que beaucoup d’entre nous ne souhaitent pas croiser en temps normal. Et une forme de gratitude s’est également exprimée, à travers des mots d’encouragement collés sur le couvercle de conteneurs, à travers des dessins d’enfants, à travers des « haies d’honneur » faites par balcons interposés au moment du passage d’une benne. Mais cette attention et cette gratitude renvoient-elles à de la reconnaissance au sens fort du terme ?
En psychodynamique du travail, la notion de reconnaissance est habituellement distinguée en deux jugements : le jugement de beauté (celui proféré par les pairs sur le travail et le résultat du travail d’un.e collègue) et le jugement d’utilité (proféré par les supérieurs hiérarchiques et par les usagers bénéficiant du travail). Dans le cas qui nous intéresse ici, le premier jugement n’entre pas en ligne de compte (il est totalement hors de la focale journalistique), à l’inverse du second. Par exemple, selon les entreprises ou les collectivités locales, les éboueur.e.s se sentiront considéré.e.s si tout est fait pour leur assurer les moyens de travailler dans des conditions de sécurité renforcée, ce qui semble malheureusement loin d’être le cas partout (Illustration 4).
Illustration 4

Mais le jugement d’utilité se donne à voir également à travers les nombreux messages de riverain.e.s qui ont fleuri ces derniers jours sur les couvercles de conteneurs : « Merci pour ce que vous faites pour nous. Surtout, n’hésitez pas à venir à telle adresse pour prendre un café à n’importe quelle heure ». Le sentiment de reconnaissance sociale existe donc pour un certain nombre d’éboueur.e.s : cela se perçoit aisément sur la page Facebook du collectif Ripeurs59DK, qui ne manque pas de relayer des photos où apparaissent des formes variées de remerciement et d’encouragement. Mais ne demeure-t-il pas fragile en l’état actuel des choses ?
La recherche que nous avons menée avec Loïse Bilat sur le traitement du métier dans la presse écrite nous a incité.e.s à adjoindre à ces deux jugements un troisième élément : le jugement de familiarité sémiotique. Par là, nous voulions souligner l’importance, pour de nombreux.euses professionnel.le.s (demandez aux sociologues, aux policiers, aux huissiers, etc.), qu’il y a à se reconnaître dans le regard médiatique progressivement élaboré au gré des articles, des interviews, des dépêches, etc. Ceci implique notamment le recours à un vocabulaire « récurrent » cohérent avec l’exercice du métier et les propriétés sociales et morales des professionnel.le.s (ce qui éviterait de tomber dans le stéréotype), conditions minimales qui n’existaient pas avant la crise sanitaire et qui contribuent à produire l’invisibilisation de ces travailleur.euse.s[28].
En dépit de l’attention plus importante – et plus positive – portée aux éboueur.e.s, en particulier sur les réseaux sociaux, j’ai des doutes sur la profondeur de l’évolution de ce jugement de familiarité sémiotique. Bien sûr, cette conclusion provisoire demandera à être systématiquement vérifiée à l’issue de cette crise, mais il me semble d’abord, que leur image médiatique demeure fortement distordue par rapport à leur vécu du travail ; ensuite, leur travail effectif actuel est réalisé dans des conditions exceptionnelles de « vide circulatoire » qui élimine de facto les possibilités de frictions relationnelles : cette période de « pacification des mœurs routières » constitue une parenthèse enchantée dans le métabolisme urbain, dont rien ne dit qu’elle survivra à la remise en route des routines (se rendre au travail, accompagner les enfants à l’école, etc.)[29]. Pour que la « gratitude collective spontanée » survive longtemps à la pandémie de coronavirus, il faudra que notre rapport au monde change radicalement, en particulier que la question des liens entre travail et écologie soit saisie par les citoyen.ne.s comme une priorité sociale, économique et politique. Au-delà de l’enjeu démocratique, c’est la vie de l’espèce humaine qui est dans la balance.
[1] Ce texte s’appuie sur les résultats de plusieurs enquêtes en sociologie et en psychodynamique du travail menées depuis une douzaine d’années sur le métier d’éboueur.e. L’une de ces recherches, menée avec ma collègue Loïse Bilat (analyste du discours en sociologie des médias), a consisté à analyser un corpus d’articles de presse écrite (Le Monde, Sud Ouest et Le Parisien) sur une période de dix ans. Il sera intéressant de procéder à la même analyse pour la période de crise sanitaire et de comparer les résultats.
[2] Je remercie Loïse Bilat, Antoine Duarte, Jean Frances et les éditeur.rice.s du blog « Ateliers travail et démocratie » pour leurs critiques sur une version antérieure de ce texte. Je reste seul responsable de son contenu.
[3] https://www.liberation.fr/france/2020/03/24/cette-crise-rend-visibles-ceux-qui-sont-d-ordinaire-invisibles_1782955. J’explique plus bas en quoi ce titre est « malvenu ».
[4] La situation des personnels soignants – notamment des brancardiers, agents de services hospitaliers, aides-soignantes et infirmières – demanderait une analyse à part entière impossible à mener ici.
[5] Claire Le Breton, « Confinement : les livreurs de repas à domicile toujours plus déshumanisés », The Conversation, 31 mars 2020 : https://theconversation.com/confinement-les-livreurs-de-re…R21CP51ALykjxQN49gSWZHYuCNVw5TPw9B24N3KQMwHdJX8776ZwnRvuFU.
[6] L’activisme (ou auto-accélération) est une stratégie individuelle de défense contre certaines formes de souffrance. Le fait d’aller à son balcon à heure fixe pour applaudir les soignant.e.s avec ses compatriotes comporte une dimension mimétique démonstrative étrangement théâtrale – forme de contagion virale d’un autre type. Cette manifestation de gratitude collective « spontanée » (les réseaux sociaux structurent les comportements collectifs, en permettant notamment la coordination et la synchronisation individuelles ; pour la spontanéité, on repassera…) a sans doute surpris les personnels soignants (et leur a sans doute fait plaisir). Mais est-ce la marque d’une réelle reconnaissance sociale ou le signe d’un besoin d’être dans le mouvement pour lutter contre son propre désarroi ? Il faudra du temps à l’issue de la crise pour répondre précisément à ces questions.
[7] Peut-être y en a-t-il d’autres, mais ces trois-là me semblent suffisants pour supporter mon argumentation.
[8] En cas de spécialisation dans la collecte des ordures, on parle davantage de ripeur.euse que d’éboueur.e. Camille Rannou, « “Je ne suis pas un héros, je fais mon métier de ripeur” », Le Républicain lorrain, 10 avril 2020 : https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomeration/2020/04/10/je-ne-suis-pas-un-heros-je-fais-mon-metier-de-ripeur?fbclid=IwAR3CMauS_WxK3o0hmWCvG4kQG9Xxf-jDNh8R-dF9BMKE41TxXNL-f-PNqds.
[9] Oui. Le héros éboueur est toujours un mâle. Mais soyons juste : statistiquement, c’est globalement vrai, les femmes ne représentant qu’une faible proportion de la profession.
[10] Car oui, les éboueur.e.s ne font pas que collecter les ordures ménagères. Il arrive aussi qu’ils/elles nettoient les rues que de charmantes personnes estiment pouvoir souiller devant celles et ceux chargé.e.s de les nettoyer. Stéphane Le Lay, « L’homo detritus fait-il de la politique ? Quelques réponses sous forme de mégots de cigarettes », Mouvements, 87, 2016.
[11] Quelques jours avant le déclenchement de la crise du coronavirus, une petite vidéo filmée héroïquement par un.e inconnu.e avait permis de dénoncer courageusement sur les réseaux sociaux le comportement d’un éboueur allongé sur un rebord de vitrine pour se reposer. Ce travailleur a été licencié suite à cette vidéo (puis convoqué par la police suite à une action syndicale engagée pour le soutenir : http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/l-ancien-eboueur-licencie-pour-une-photo-de-sieste-convoque-par-la-police-a-paris-23-01-2020-8243130.php), sans même que l’on puisse savoir s’il était en pause ou non (damned ! Ces gens-là ont des pauses ! qu’ils/elles travaillent de 6h à 12h ou de 6h à 17h…). L’accusation de fainéantise adressée aux éboueur.e.s est récurrente dans l’exercice de leurs fonctions – notamment parce que les accusateur.trice.s ne connaissent rien du travail et de son organisation.
[12] Bien souvent plus que moins…
[13] http://videos.senat.fr/video.1573636_5e872b2ba4c32.audition-de-mme-elisabeth-borne-ministre-de-la-transition-ecologique-et-solidaire.
[14] Haut Conseil de la santé publique, « Avis relatif à la protection des personnels de déchets au cours de l’épidémie de Covid-19 », 31 mars 2020. Certains éboueurs disent avoir peur actuellement, au motif de ce manque de moyens de protection. L’affirmation explicite de peur n’est guère habituelle et vient peut-être signifier une déstabilisation des stratégies de défense viriles généralement mobilisées dans le travail.
[15] Et je n’affirme pas cela parce que j’ai beaucoup d’infirmières et aides-soignantes dans mon entourage proche. Toutefois, dire ça ne revient pas à s’empêcher de poser une question subsidiaire : comment se fait-il que les soignant.e.s n’aient pas eu accès, dès le début de la crise, à des masques en nombre suffisant, de manière à pourvoir ensuite rapidement les professionnel.le.s travaillant en présence du public ou dans des conditions rendant difficile le respect des consignes de protection ?
[16] « Les voies de transmission principales du SRAS-CoV-2, c’est-à-dire interhumaine, par contact étroit, par l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires (particules de diamètre supérieur à 5-10 μm) et par contact indirect, manuporté, avec des surfaces et objets fraîchement contaminés par les gouttelettes ne justifient pas le port d’un masque en conditions professionnelles pour les agents de collecte et de tri des déchets. Le port d’un masque pourrait par ailleurs, être difficilement toléré dans la durée du fait des efforts physiques au cours du travail et pourrait conduire au relâchement des gestes barrières classiques. », Haut Conseil de la santé publique, « Avis relatif à la protection des personnels de déchets au cours de l’épidémie de Covid-19 », 31 mars 2020, p. 3.
[17] Nadia Sweeny, « Comment l’État a laissé tomber son usine de production de masques, l’une des plus importantes au monde », 14 avril 2020 : https://www.bastamag.net/production-masques-FFP2-strategie-industrielle-usine-Plaintel-plan-social.
[18] Voir le rapport récent de l’ANSES sur ce sujet : https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2016SA0137Ra.pdf.
[19] Par exemple avec une barbe de trois jours, ou en faisant un trou dedans pour pouvoir fumer sa cigarette sans le retirer. Anecdotes que m’a racontées un collègue de l’INRS après des visites de chantier de désamiantage – autre déchet toxique s’il en est. Mais mortel seulement à long terme…
[20] Un formateur à l’École de la propreté de la ville de Paris nous avait ainsi déclaré : « Le masque, ça sert à rien, on ne peut pas respirer avec, et les odeurs on s’y habitue. Les lunettes faut pas demander non plus, parce que dès que tu touches un masque et des lunettes, t’es obligé de toujours les porter. S’il t’arrive quelque chose et que tu ne les avais pas, c’est pour toi ! » Et effectivement, en atelier, personne ne portait ni l’un ni les autres.
[21] Éric Judor et Ramzy Bedia, Seuls two, 2008.
[22] J’ai eu l’occasion d’analyser ces éléments de la coopération transverse dans Stéphane Le Lay, « Être éboueur.e à Paris », Travail, genre et sociétés, 33, 2015. Christophe Ratt, le ripeur messin confirme ce constat : « “D’habitude, mon métier n’est pas bien perçu, indique l’agent. On se fait réprimander, on nous dit qu’on travaille moins que les autres. On gêne la circulation, les gens peuvent, parfois, être intolérants”. Il y a quatre semaines, ces comportements étaient encore vrais. Mais depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, la population a compris que ce métier est indispensable. » (Camille Rannou, art. cit.).
[23] Pour reprendre une expression du sociologue américain Erving Goffman, « On cooling the mark out. Some aspects of adaptation to failure », Psychiatry, 15/4, 1952.
[24] Élément utile à avoir à l’esprit à l’heure où des patrons du BTP sont qualifiés de « défaitistes » par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
[25] « Garder le nez dans le guidon », « se mettre sur un mode robot », autant d’expressions utilisées par les travailleur.euse.s pour décrire le phénomène consistant à aller « plus vite que la musique » dans les activités, tout en anesthésiant son sens critique et moral. Or, l’auto-accélération pratiquée au travail a tendance, pour conserver son efficacité, à se poursuivre par-delà les murs de l’entreprise. Christophe Dejours, Travail : usure mentale. De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Paris, Bayard éditions, 1993 (1980).
[26] Pour une bibliographie récente sur ce sujet, voir le rapport de l’ANSES (2019) : https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2016SA0137Ra.pdf.
[27] On parle en effet peu de celles et ceux travaillant dans les centres de tri ou dans les usines d’incinération, pour ne prendre que deux exemples. Pourtant, leur rôle est essentiel dans l’organisation et le fonctionnement du circuit de prise en charge des déchets ménagers.
[28] Loïse Bilat et Stéphane Le Lay, « Les éboueurs en discours. Enjeux sociaux et linguistiques d’une (in)visibilité socioprofessionnelle », Semen. Revue de sémio-linguistique des textes et discours, à paraître 2020.
[29] Christophe Ratt, le ripeur messin a d’ailleurs la même préoccupation : « “Les messages sur les poubelles nous font plaisir, ils sont touchants mais ça serait bien que cette bienveillance se poursuive toute l’année”, glisse le ripeur. À bon entendeur… » (Camille Rannou, art. cit.).



