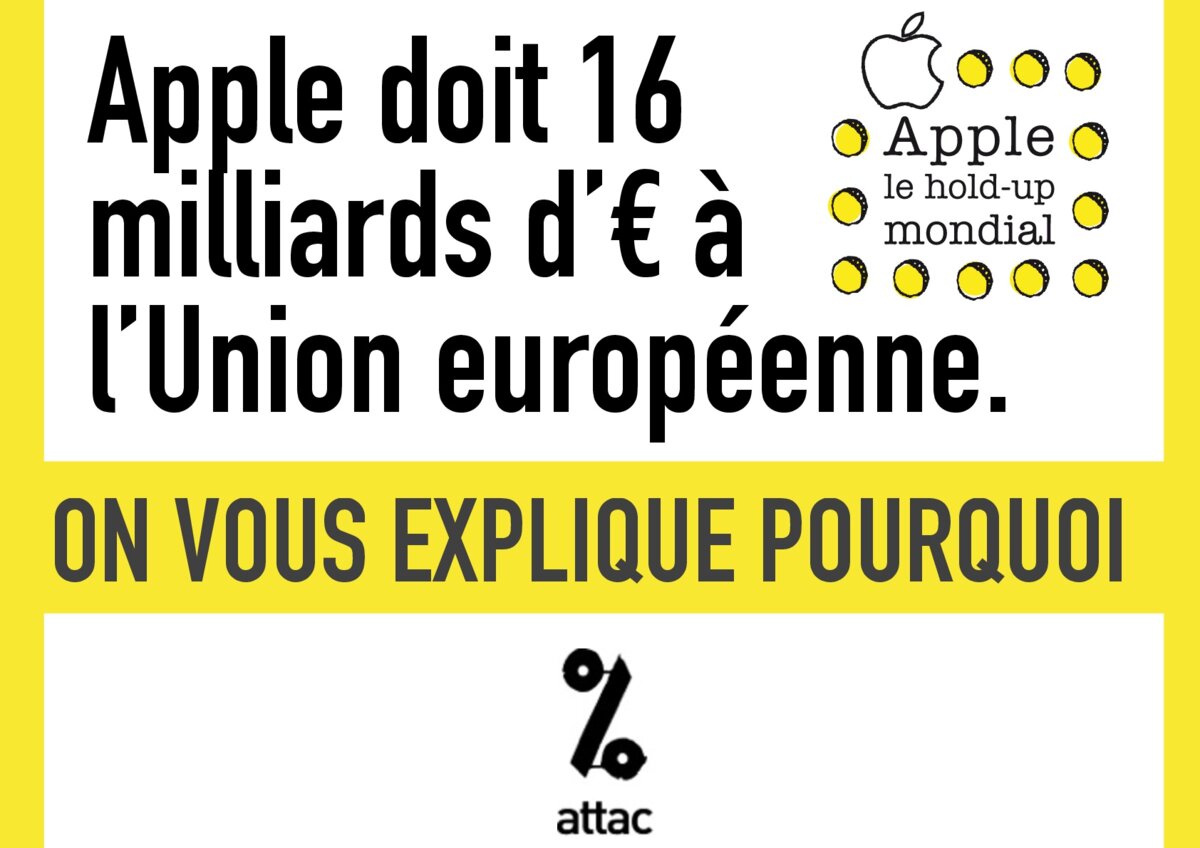
Agrandissement : Illustration 1
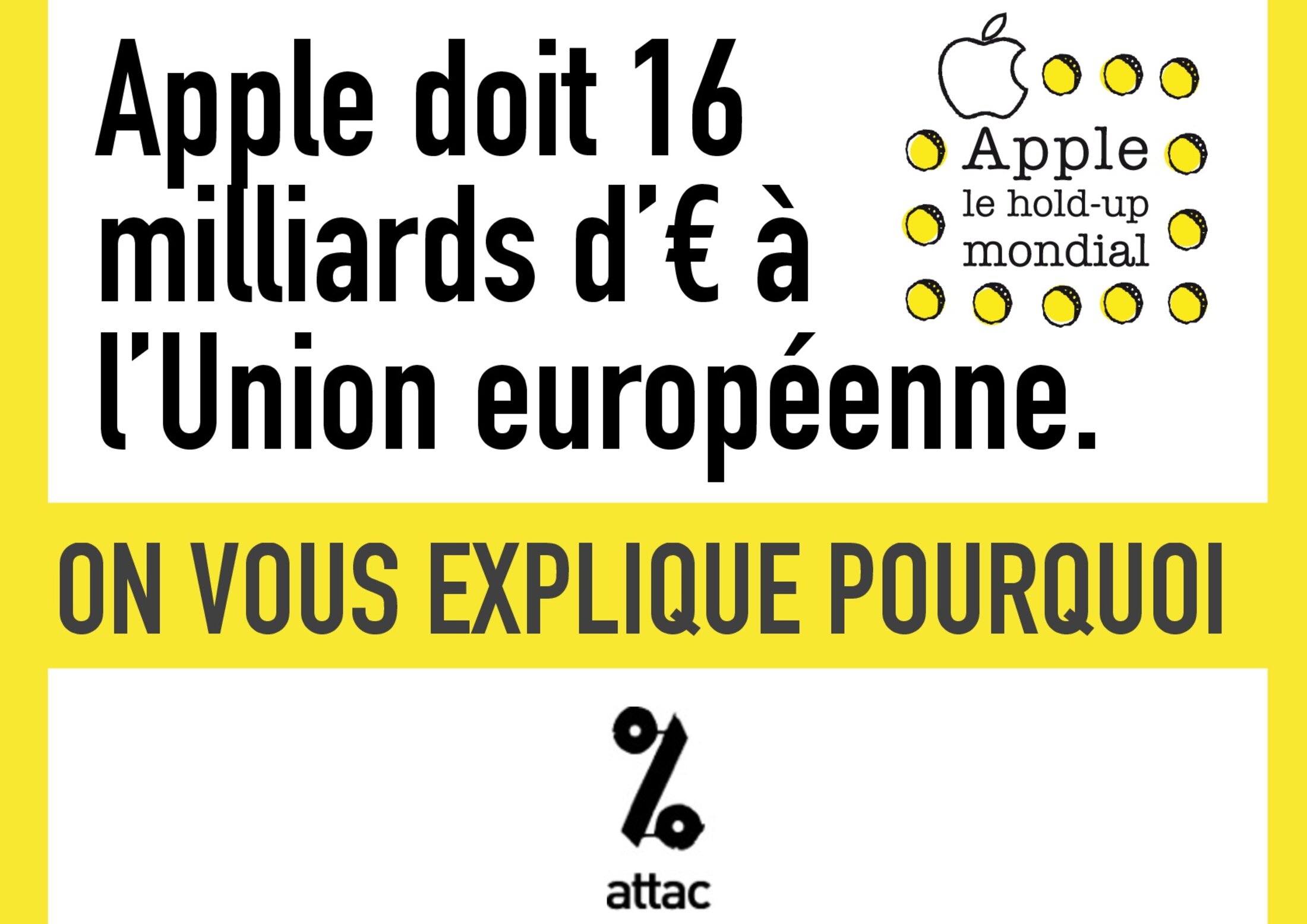
Découvrez le rapport "Apple le hold up mondial", sur le site d'Attac France
Diminution des aides au logement, suppression de contrats aidés, coupes budgétaires pour les collectivités locales et le système de santé, suppression annoncée de 120 000 postes dans la fonction publique… le nouveau gouvernement mène une attaque violente contre les services publics et les dispositifs de solidarité. En la matière, il ne fait pas preuve de l’ « innovation » à laquelle tient tant Emmanuel Macron, mais au contraire poursuit et approfondit les politiques libérales des trente dernières années. Au nom de la réduction des déficits publics, ce sont in fine toujours les plus fragiles qui sont les plus touché·e·s, tandis que les plus riches vont bénéficier de cadeaux fiscaux tels que la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur le patrimoine financier. Mais en arrière-plan un scandale tout aussi inacceptable se perpétue : l’évasion fiscale.
L’évasion fiscale recouvre deux types de pratiques. D’une part, la fraude fiscale est une infraction à la loi afin de diminuer son imposition. Elle est le fait de particuliers qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux pour échapper à l’impôt sur le revenu ou sur le patrimoine, ou bien d’entreprises qui ne reversent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les rapports sur la question estiment qu’elle coûte chaque année à la France entre 60 et 80 milliards d’euros de pertes fiscales,1 soit l’équivalent du déficit public. D’autre part, l’optimisation fiscale désigne l’utilisation de mesures a priori légales pour atteindre le même objectif de diminution de l’impôt. Mais les frontières de la légalité sont en la matière assez troubles et il est courant que ces pratiques donnent en fait lieu à des abus de droit et donc à des fraudes. Il peut s’agir d’une utilisation de niches fiscales pour les particuliers ou de montages financiers qui permettent aux multinationales de localiser leurs profits dans des territoires à faible fiscalité.
Dans notre nouveau rapport, "Apple le hold up fiscal" nous nous intéressons spécifiquement aux méthodes d’« optimisation agressive » des multinationales, et en particulier de la première d’entre elles : Apple. Alors que les « Paradise Papers » viennent de confirmer qu’elle continue de pratiquer une évasion fiscale à grande échelle, la première partie de ce rapport analyse les montages financiers et commerciaux auxquels elle a recours. Ce cas exemplaire, permet ainsi de mieux comprendre la cuisine fiscale des multinationales. Pour concocter leurs recettes anti-impôts, elles mêlent des ingrédients tels que le paiement de droits de propriété intellectuelle, la localisation fictive d’activités de marketing ou
de financement, la conclusion d’accords secrets (les « tax rulings ») avec les États complices, etc. Le tout dans le but de localiser le maximum de bénéfices dans les paradis fiscaux et de payer le moins d’impôts possible.
L’ampleur du phénomène est difficile à évaluer, mais des études prudentes estiment qu’il coûte chaque année entre 160 et 190 milliards d’euros à l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ramené à l’échelle de la France, cela représenterait entre 25 et 30 milliards d’euros de pertes fiscales par an, qui s’ajoutent aux 60 à 80 milliards de la fraude fiscale.
Ces pratiques ne sont rendues possibles que par la complaisance d’un certain nombre d’États qui offrent aux multinationales des conditions fiscales toujours plus avantageuses pour les attirer. Ces « paradis fiscaux » se trouvent dans des îles effectivement paradisiaques telles que les Bermudes et les Caïmans, mais d’autres sont bien plus proches de nous : en Irlande, au Luxembourg, à Jersey ou aux Pays-Bas, pour ne citer que ceux qui ont fait l’actualité dernièrement. Leurs choix politiques alimentent une course au moins-disant fiscal qui entraîne tous les États derrière eux. C’est ainsi qu’il convient de comprendre les récents cadeaux fiscaux en France, tels que le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ou le Pacte de responsabilité (PR), qui coûtent 40 milliards d’euros par an à l’État,3 sans effets notables, selon les pouvoirs publics eux-mêmes, sur l’investissement et l’emploi. Et c’est aussi ce qui guide le projet de diminution de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33 % à 25 % prévu par le gouvernement. Les seuls gagnant·e·s de ce cercle vicieux sont les multinationales et leurs actionnaires, pour tou·te·s les autres l’addition est salée : destruction des services publics, mise à mal des politiques de redistribution des richesses, hausse des inégalités, etc.
Mais il ne s’agit pas là d’une fatalité. Le rapport Rendez l’argent rappelle que des mesures crédibles permettraient de récupérer 200 milliards par an en cumulant la lutte contre l’évasion fiscale sous toutes ses formes, la taxation des transactions financières, et la suppression des niches fiscales, du CICE, du Pacte de responsabilité et des subventions aux énergies fossiles. Dans la continuité de ce rapport, la seconde partie de ce document présente des mesures qui permettraient d’en finir avec l’évasion fiscale des multinationales.
Celles-ci s’articulent autour de l’exigence de transparence fiscale, de la fin de l’impunité dont bénéficient les multinationales et d’une réforme en profondeur de leur taxation. Elles prennent réellement acte de la capacité des multinationales à localiser leurs bénéfices là où elles trouvent les conditions fiscales les plus avantageuses et de manière totalement déconnectée de leurs activités réelles. Face à cette situation, les demi-mesures ne sont plus suffisantes et il convient de transformer radicalement la fiscalité des entreprises, dans le sens de l’intérêt général et non de celui de leurs seul·e·s actionnaires.
Les sommes ainsi récupérées seront utiles pour préserver les acquis sociaux et relever les défis collectifs qui nous attendent. À l’inverse du discours tenu par les partisan·e·s d’un amaigrissement de l’État, les dépenses publiques sont restées stables depuis 25 ans, autour de 55 % du PIB. Cette dépense permet de donner accès à tou·te·s à des services tels que la santé et l’éducation, qui forment un socle d’égalité. Elle contient aussi pour une bonne part des transferts sociaux qui institutionnalisent la solidarité au sein de notre société. Ce modèle social n’est pas responsable de la flambée des déficits, qui résulte bien plus de l’érosion progressive des recettes publiques par l’évasion et les cadeaux fiscaux.
Surtout, la lutte contre le réchauffement climatique impose une transformation en profondeur de nos modes de vie et de production qui va nécessiter de mobiliser des moyens financiers importants. Le rapport Un million d’emplois pour le climat estime qu’il faudra 105 milliards d’euros par an pour relever ce défi en investissant dans la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, ou encore l’agriculture paysanne. Les impôts des multinationales seront bien plus utiles à cette transition que cachés dans les paradis fiscaux.



