
Agrandissement : Illustration 1
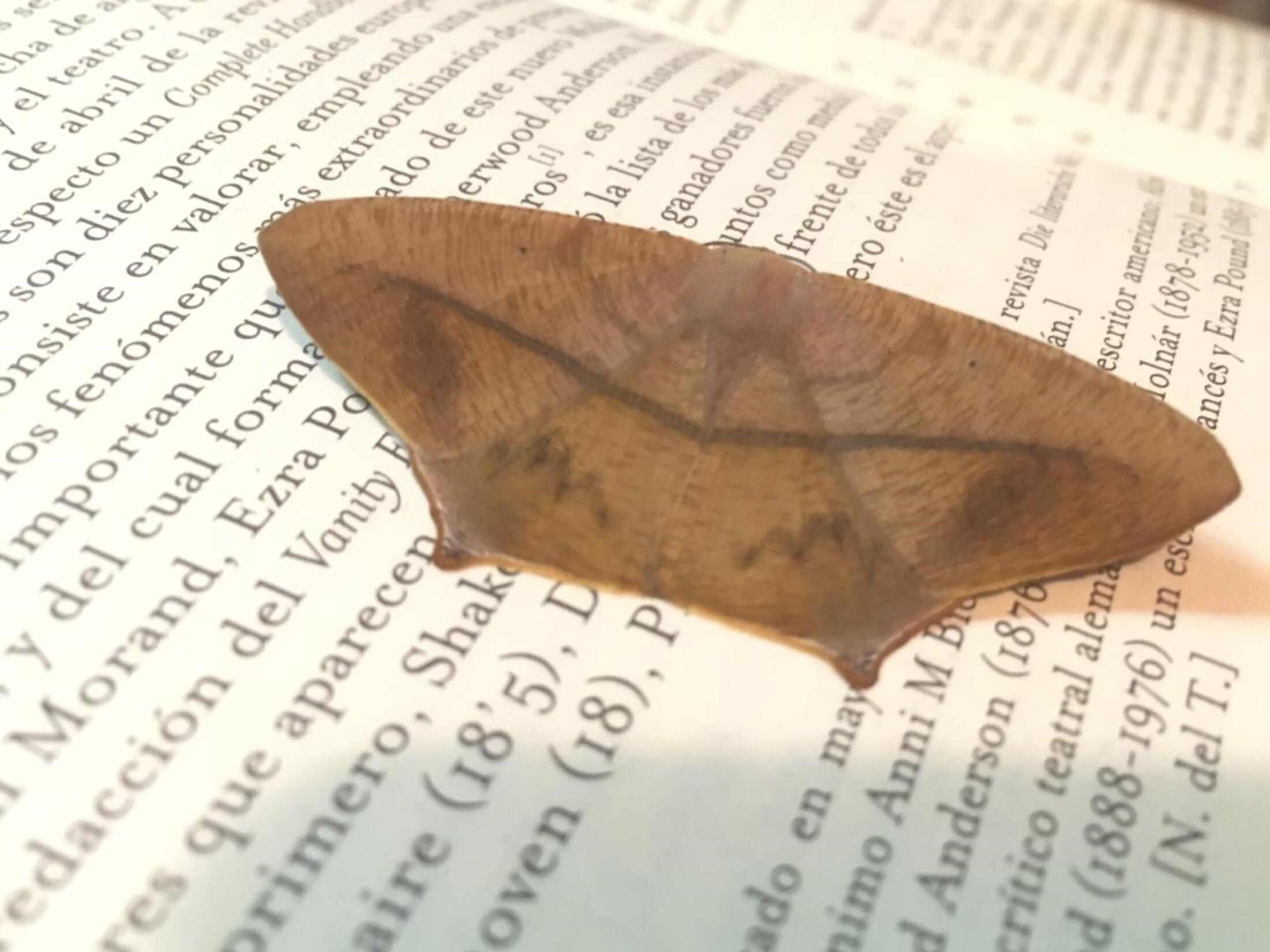
Le jour d’après. Le jour d’après, ce ne sera pas un seul jour, mais plusieurs. Il y aura plusieurs jours d’après, car nos histoires sont multiples, indéfiniment multiples. Ainsi pour ma tante, c’est aujourd’hui déjà un peu le jour d’après. Ses filles sont en train de l’enlever de la maison de repos où elle est enfermée depuis un mois, et où la bestiole s’est introduite auprès de certains pensionnaires, mais aussi du personnel soignant, dont une partie s’est enfui, comme les Indiens de la Sierra Nevada, qui par centaines sont repartis dans la forêt.
Chaque histoire est multiple, mon confinement n’échappe pas à cette loi. J’ai vécu un premier confinement à Bogota, parce qu’une amie est arrivée de Paris au moment où les autorités sanitaires colombiennes prenaient les premières mesures, obligeant les étrangers à un “auto-isolement” de 14 jours. Ensuite, sur les conseils de l’Ambassade de France, nous sommes venus ici, à Tinjaca, qui est ma résidence officielle, sur les hauts-plateaux andins.
Mais cette région très reculée, d’une beauté inouïe, comme suspendue dans le début du XXème siècle, s'est soudain en l’espace d’une nuit retournée au XVème siècle, avec stigmatisation des français, chasse aux sorcières et fausses rumeurs. Mon amie Claudine était donnée mourante et moi très malade, mon chauffeur ostracisé par sa propre communauté. Il nous fallu batailler durant deux semaines pour exfiltrer mon amie et la ramener avec un chauffeur privé (qui a lui accepté la course, quasiment au tarif normal) jusqu’à Bogota, où elle a trouvé par miracle un billet dans le dernier vol d’Air France.
Cette situation a fait resurgir de très anciennes forces mythiques, qui remontent à la conquista, directement associée à de terribles maladies amenées par les Espagnols, et dont les montagnes ont gardé toute la mémoire. Une situation qui ravive aussi la douloureuse époque de la stigmatisation des malades du sida. La radio nationale diffuse en hâte depuis ce matin un communiqué pour lutter contre la stigmatisation des étrangers, en particulier des Français, dont certains ont été chassés, jetés à la rue par des hôteliers pris de panique, en pleine nuit, avec enfants et valises. Maintenant que tout le monde est en quarantaine, ils se sont calmés et ils prient le ciel.
J’ai ensuite vécu un troisième confinement, une vie où rien ne change, en apparence J’ai pris la décision, début 2017 de venir vivre ici, au milieu d’une forêt de chênes. Pas une retraite, plutôt un retrait, ou un retirement, pour retrouver l’essentiel, quatre réalités dont l’absence m’avait cruellement fait souffrir, en France, sans que je ne m’en rende compte : l’amour, le temps, l’écriture et la terre. Je suis en train d’apprendre, lentement, à retrouver ce lien puissant à la terre, et à tout ce qui en sort. Je suis en train d’apprendre à reprendre mon temps, et je mesure maintenant tout ce temps où le temps nous a été volé. Depuis une dizaine d’années, j’ai vu cela grandir, ce temps que nous n’avons plus, le temps pour rien, le temps pour soi, occupés que nous sommes à ne pas avoir le temps – cette occupation de nos vies par des armées même pas étrangères, à qui nous avons laissé le droit de coloniser nos vies.
Toute personne de moins de quarante ans peut difficilement le comprendre, avoir du temps, beaucoup de temps, le temps pour l’essentiel, ou le pas essentiel, mais nous prenions le temps, il se donnait à nous, même si parfois il fallait sans doute insister. Le temps passant, j’ai vu, entendu, senti cette vague déferler sur nous, cette occupation interne, intériorisé, au fil des années passées dans le monde digital. Ici dans la vallée, nous avons le temps, et c’est un immense plaisir.
Puis vint le quatrième confinement. Après deux semaines de retraite, consacrée à l’écriture et aux arbres que je plante, dans la vie d’avant, mon amour venait me rejoindre, dans notre refuge. Là il ne viendra pas. Il est confiné à Bogota. Et nous sommes en train de renouer avec notre vie d’avant, quand notre amour était séparé par “la flaque” – c’est ainsi que les Colombiens appellent l’Atlantique – et que l’absence nourrissait la vie.
Mais le confinement est beaucoup plus que l’océan, un tout autre type de distance. Heureusement il y a les moyens de communication d’aujourd’hui, et ceux d’hier, dont on redécouvre la puissance d’invention. Avec un ami musicien, nous sommes en train de monter une radio libre pour les 15 vallées du village, Radio Tinjaca, le vieux modèle des Radios libres, que l’on appelle ici radio communautaires – le mot “communauté” est ici très mobilisé, mais dans un sens très différent de celui que nous connaissons en Europe. Une radio faite pour les gens de Tinjaca et avec eux. Une façon de reprendre le projet de Benjamin, qui déjà faisait de la radio un projet d’élite pour tous. Une radio qui appelle autant à mon voisin de droite, Don A., conseiller de l’ancien président Santos pour les droits de l’homme (donc un des artisans des accords de paix), et à ma voisine de gauche, Dona Zonia (je parle géographiquement, mais pas seulement, je m’en rends compte), qui vient de m’apporter les œufs et le lait qu’elle a elle-même trait, avec ses mains, comme tous les soirs que dieu fait.
Est-ce que Radio Tinjaca pourra survivre au jour d’après ? Est-ce qu’elle produira quelque chose ? Le jour d’après peut aujourd’hui nous apparaître un peu abstrait, mais ce qui ne l’est pas, c’est le jour, les jours d’après la paralysie du monde. Ce qui est le plus surprenant, c’est de voir que l’effondrement du système a mis en lumière et en évidence toute une série d’idées politiques, dramatiquement minoritaires, qui essuyaient l’humiliation de “l’utopie”, devenue le point de Goldwin de la discussion politique. Ce temps viral – qui pour le moment nous donne le temps de penser, pour agir le temps venu – a le pouvoir inouï de déciller les esprits, de rendre évidentes des idées qui hier étaient tant moquées, et dissoutes par les gaz et les matraques.
Comment expliquer cette espèce d’inversion carnavalesque de toutes les valeurs, ce renversement des pôles, qui donne aujourd’hui force et crédit à ce qui hier était faible et inaudible ? C’est que pour la première fois de son histoire la classe moyenne blanche travailleuse et reproductrice – à la fois corvéable à merci, et formatée aux ordres macroéconomiques, mais grande bénéficiaire de l’ultralibéralisme extractiviste – vit dans sa chair, et sur sa peau, les drames que produit la mondialisation. De Colomb à Gosh, le projet colonial et toutes ses mutations ingénieuses – car la colonisation du monde est d’abord une gigantesque ingénierie – a semé la guerre, les viols et violations, l’esclavage et la barbarie, mais c’était loin, délocalisé, finalement très abstrait. Un exemple pour rendre les choses plus concrètes. Circule ces jours-ci l’information selon laquelle le confinement en République démocratique du Congo pourrait générer une pénurie de Cobalt et de Coltan, dont 80% des ressources mondiales se trouvent dans ce pays. Mais qui hier se préoccupait de la guerre ethnico-civile qui ravage le Congo depuis 2001 ? La vérité est que s‘il n’y avait pas eu ces 6 millions de morts, nos téléphones cellulaires ne couteraient pas 500 euros, mais dix fois plus.
Le mien vient de bipper, intempestif, je regarde : “Une scientifique espagnole : vous donnez 1 million d’euros par mois à un joueur de football, et à un biologiste 1 800 euros. Maintenant que vous cherchez par tous les moyens un taritement contre ce virus, vous n’avez qu’à demander à Christiano Ronaldo ou à Messi de trouver le vaccin.” Pendant que je lis ce message, un second m’alerte pour me dire que c’est un fake. D’accord, cette scientifique n’a jamais dit ça, sauf que tout le monde aurait pu l’écrire. Les fake news nous ramènent aux faussaires, que Walter Benjamin, admirait beaucoup, voyant en eux, après avoir fait exploser la gangue morale de la propriété et son alliée fidèle la signature personnelle, les héritiers des conteurs, dont les récits sont sans signataire, les derniers à combattre pour la sauvegarde de l’aura des choses, dans un monde qui l’a condamnée à mort, l’obligeant à renaître ailleurs, de façon improbable, ici dans une “fake new”. En l’occurrence, l’image utilisée pour illustrer le post est celle d’une femme politique espagnole, qui nous glisse subrepticement ce message. L’inadéquation entre le texte (d’une scientifique) et l’image (d’une politique, ancienne ministre de l’agriculture, en visite au Maroc en 2018 pour défendre l’agro-industrialisation productiviste du monde paysan…) est tellement grossière que de fausse, elle en devient hautement signifiante.
Le choc se redouble encore par le fait que la classe moyenne mondialisée, et donc développée, est en train de vivre des scènes dignes de ce Sud pestilentiel, chaotique et refoulé (aux frontières), pudiquement baptisé en voie de développement. Elle comprend, parce qu’elle le vit maintenant dans son corps menacé, que cette civilisation, après avoir vécu le développement, s’est engagée sur la voie du dé-développement – une réalité habilement masquée par les prêches arrogants d’une classe politique aux mains des puissances de l’argent : austérité, croissance, productivité, et tout l’alphabet d’une langue qui allait produire les destructions massives que nous connaissons. Le dé-développement repose sur deux piliers, l’asphyxie financière et la bureaucratisation : vider de sa substance tout ce qui a été construit en matière de services publics, en donnant moins pour faire plus, et en bureaucratisant les démarches à outrance[1]. Ce sabordage a été voulu, accepté et voté, à la majorité, par tous ceux qui aujourd’hui sont victimes du carnage hospitalier. Le sentiment de toute puissance de la modernité digitale a fait le reste de la besogne. Notre civilisation, comme toute civilisation, a produit en elle-même la barbarie qui l’a fait vivre, et le virus mondial a su trouver le frein d’urgence pour arrêter le train fou de la mondialisation. Ces deux célèbres (para)phrases de Walter Benjamin ne doivent pas faire illusion. Une fois le train stoppé, les voyageurs choqués vont descendre, au bord de la voie. Et que vont-ils faire ?
Tous les repères dominants s’effondrent conne un château de cartes. C’est fascinant, et un peu inquiétant, en effet, car le confinement peut accoucher de tous les scénarii. Le jour d’après, le libéralisme, bien qu’il soit carbonisé dans sa forme actuelle, est parfaitement capable de se régénérer, il sait très bien y faire, les crises l’y ont toujours aidé, comme le démontre de manière implacable Noami Klein, dans la Théorie du choc. La catastrophe naturelle aura bon dos, pour faire passer la pilule du jour d’après.
Mais le jour d’après, cette prise de conscience peut aussi se traduire dans des actes élémentaires, comme le refus tout simple de reprendre comme avant, et la volonté, vraiment collective, de traduire cette nouvelle conscience dans une politique du réel, et non celle de l’argent – qui a nié le réel, notre réel, notre bien commun, la vie, jusqu’à l’interdiction sacrilège d’accompagner nos mourants, et d’enterrer nos morts. Dans ce cas, le jour d’après, ce ne sera déjà plus la même République, et il faudra en tirer toutes les conséquences. Dire par exemple : les femmes et les hommes politiques qui nous représenteront vont faire exactement ce pour quoi nous les choisissons. Ou encore : cette catastrophe n’est pas naturelle, mais elle a été produite par l’homme, par des hommes, de bout en bout. Il faudra donc leur demander des comptes, mais surtout les isoler, les confiner, le temps nécessaire, pour qu’ils ne puissent plus propager la mort et la barbarie, au nom de la Culture et de la Civilisation, en notre nom.
[1] De 2013 à 2016, j’ai travaillé trois ans dans un ministère non rentable par excellence, dont l’essentiel de l’énergie ne consistait pas à répartir de l’argent public, mais à en retirer le plus posible sans faire exploser le système. Une stratégie de la gestión du retrait de l’Etat et de son démontage, opérée par ses agents mêmes, qui permet par exemple que les hauts fonctionnaires présidant à ces sinistres destinées, n’aient absolument aucun rapport organique avec les milieux de la culture.
Bruno Tackels, Tinjaca (Colombie), 4 avril 2020
Bruno Tackels est philosophe et jardinier.



