Imprégnée de culture napoléonienne, la Troisième république en a conservé le penchant uniformisateur et autoritaire, fermé aux différences : « Ancrée dans une Révolution célébrée comme un « bloc », la culture républicaine croise un idéal des droits de l’homme avec un universel abstrait, négateur des singularités. La République confondue avec l’État, parce que les républicains en avaient pris le contrôle, s’est glissée dans une administration napoléonienne, centralisée, hiérarchisée et cloisonnée, sans prise sur les réalités complexes du terrain et qui ne défend pas suffisamment les faibles. »
Une remise en cause « sacrilège » – écrit Suzanne Citron – mais n’est-elle pas cautionnée « par le fait (…) qu’après Vichy, l’idéologie républicaine n’a pas été décortiquée et que le fonctionnement de l’État est demeuré intact ? Le colonialisme, l’une de ces idéologies – et, parmi elles, « l’Algérie française » - ne s’est effondré qu’au prix d’une guerre, de l’exode non préparé des pieds-noirs, du massacre des harkis abandonnés à leur sort. Mais pour quelles remises en cause ? Les actuelles agitations autour des relations franco-algériennes, les passions réactivées autour des mémoires concurrentes sont bien l’indication que le temps des histoires croisées inaugurées par les chercheurs n’est pas encore advenu pour tous. »
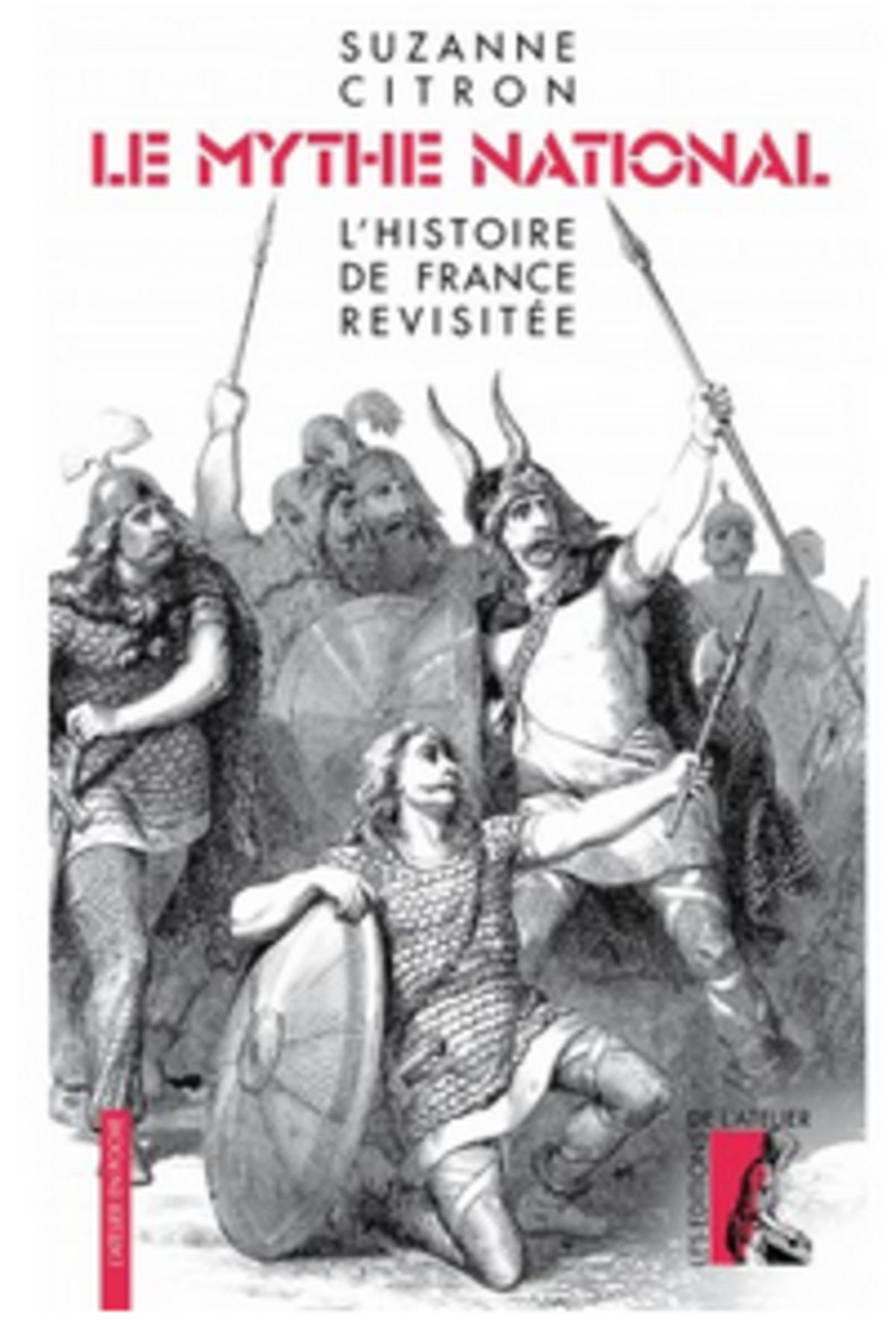
Les valeurs de la république dont l’école fait aujourd’hui la source de l’éducation dite morale et civique doivent être confrontées à leur réalité ; une confrontation accablante : « Le contraste entre les valeurs républicaines et les impasses, je dirai même les indignités couvertes par l’État, est accablant dans certains domaines. […] Aujourd’hui, les prisons sont remplies, elles débordent, elles sont plus déshumanisées que jamais […] D’où vient cette impuissance ? […] Et les bagnes d’enfants, ces institutions républicaines qui ont duré si longtemps, comment les expliquer ? La colonie pénitentiaire de Belle-Île […], créée en 1880 […], transformée en Institut public d’éducation surveillée (IPES) en 1940, fut retirée à l’administration pénitentiaire en 1945 mais son internat répressif n’a été fermé qu’en 1977 ! […] D’où viennent la pérennité ou la perpétuelle reproduction de ces instructions inhumaines, bureaucratiquement répressives, militaires ou civiles, où le pouvoir d’un « supérieur » déshabille l’autre de sa personnalité, où l’exécution de règles abstraites est un déni d’humanité ? Les « camps de concentration français » de la Première Guerre mondiales, les « camps de la honte » d’avant Vichy, les centres de rétention d’aujourd’hui, de quel mal spécifiquement français sont-ils les témoins ? N’y a-t-il pas là, dans la République, ces « séquelles de l’État monarchique » jamais vraiment balayées ? »
Inévitablement, Suzanne Citron en arrive alors à la question de l’échec scolaire auquel la république n’a jamais répondu que par des déclarations de principe, un mélange de cécité et de mauvaise foi : « Dans l’échec du système scolaire « républicain », le problème des contenus […] n’est pas seul en cause. Certes les conditions matérielles peuvent également jouer mais quelque chose de plus profond, dans le fonctionnement du système, émousse ou stérilise, chez certains enseignants, le regard qui donne confiance, le souci de ne pas rabaisser. Qui n’a pas rencontré, pour lui-même ou en tant que parent, la surdité ou l’inadvertance d’un professeur qui, ligoté dans le système, « enfonce » l’élève dans la mésestime de soi ? Lorsque, dans les banlieues en difficulté, les adolescents réclament du « respect » comme quelque chose qui ne leur serait pas accordé, il me semble que cette revendication masque, à côté d’autres causes, l’hypocrise secrète de notre société […] »
Au cœur de l’échec scolaire, pour Suzanne Citron, « un enseignement secondaire généralisé, mais non repensé dans sa vocation originelle, est devenu une machine perverse de sélection par élimination. L’idéologie dualiste qui infériorise les métiers physiques ou manuels inspire une dynamique sociale dont l’objet, depuis la IIIe République, est de « monter » dans la société. S’y ajoute le « gagner plus » pour « consommer » plus. Les « décrocheurs » du système scolaire, sans pouvoir vraiment l’analyser, sont à la fois infériorisés par celui qui les a (ou dont ils se sont) exclus, par le statut inférieur des métiers « sales » ou non qualifiés particulièrement mal payés en France, les seuls cependant auxquels ils peuvent prétendre si l’offre s’en présente. Et comme à cette quadruple exclusion de l’école, du travail noble, de l’argent, de tout travail, se superpose le plus souvent la différence de couleur de peau et l’abus des contrôles au faciès, la relégation aux marges de la société coïncide le plus souvent avec une relégation ethnique […] »
Trente-sept ans après la première version de ce texte, l’analyse de Suzanne Citron, non seulement, n’a pas pris une ride mais, par ses questionnements, même dérangeants, elle ouvre des perspectives et une alternative crédible au populisme éducatif à courte vue auquel s’accroche aujourd’hui l’Éducation nationale.
Suzanne Citron, Le mythe national, L’histoire de France revisitée, Les Éditions de l’Atelier, 2017.



