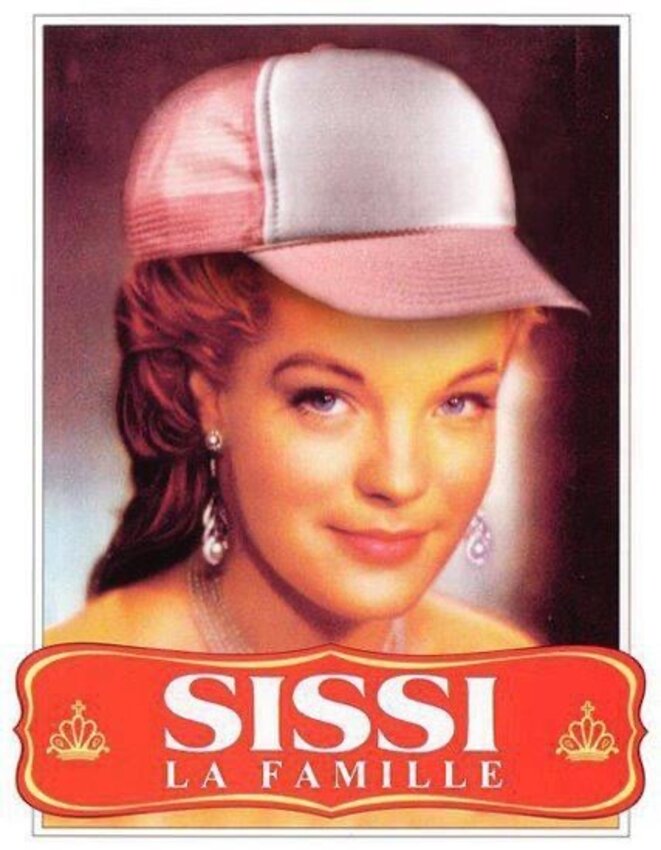Si je me décide aujourd’hui à répondre aux attaques répétées de certains « intellectuels » contre le rap, c’est après de nombreuses hésitations. N’est-ce pas leur prêter trop d’importance que de leur accorder le temps de formuler une réponse raisonnée ? N’est-ce pas aussi une manière de valider leurs coups de gueule haineux que d’y répondre ? Je me suis beaucoup interrogée, mais j’ai fini par me convaincre de la nécessité de le faire. Non pas pour nourrir la polémique en la matière (pour ou contre le rap), mais plutôt pour tenter de prendre le problème par une autre voie, lui donner une forme de complexité au sens où Morin l’entend.
Le rap s’inscrit dans un mouvement qui le dépasse qu’est le Hip-Hop. Ce mouvement est complexe au sens où il recèle en son sein, plusieurs types d’expression qui sont reliés les uns aux autres. Il s’inscrit lui aussi dans une autre complexité qu’est le champ de l’art en général, de la création, qui s’inscrit lui aussi dans un mouvement sociétal. Il s’agit donc bien d’un ensemble de mouvements imbriqués les uns dans les autres qui pris isolément et tous ensemble font système. Toute découverte, artistique ou scientifique, s’inscrit dans un contexte sociale, historique et technologique. Elle en est issue et autorisée par ce contexte.
Parler de la complexité, c’est parler de système et signifier les différents paramètres qui traversent la question posée, non pour les comparer les uns aux autres, ce qui supposerait de les séparer, de les catégoriser comme des éléments indépendants les uns des autres, mais pour les relier : envisager ce qui les réunit, leurs points de partages et de rencontres.
C’est précisément cette complexité que les personnalités médiatiquement conviées à donner leur avis sur toutes les questions de société, quelque soit leur niveau d’expertise en la matière, me semblent occulter dans leur raisonnement sur la question. Ils prennent le rap comme un élément isolé, un bloc, niant ainsi son caractère dynamique et donc sa complexité. Ils l’isolent de ses fondations et de ses développements pour le regarder comme un objet d’étude dont ils pourraient dévoiler la vérité absolue. Ils paraissent ne pas accorder à ce mouvement, la même valeur qu’aux autres mouvements artistiques et intellectuels qui, tous, s’édifient et s’instituent à partir des paramètres sociétaux qui les appellent et les autorisent.
J’en veux pour preuve, la dernière sortie d’Alain Finkelkraut sur la question dans l’émission de Ruquier « On est pas couché » en date du samedi 3 octobre 2015 , où il se réfère au rappeur Booba (ex membre du groupe Lunatic entre 1994 et 2003, ayant débuté sa carrière solo en 2002) pour faire le parallèle entre ses textes et les propos de Nadine Morano sur la « race blanche ». En substance, il renvoie face à face les deux discours pour interroger le fait que le premier serait systématiquement décrié par une forme de bien pensance qui y verrait une agressivité insupportable quand le second serait valorisé socialement puisqu’il passe sur les ondes sans que nul ne s’étonne de la virulence des propos. En somme, Finkelkraut dénonce ici la politique du « deux poids deux mesures » et réclame la même clémence pour Morano que pour Booba, ou bien la même virulence contre l’un et l’autre.
Choquée par les raccourcis de pensées que ce type de raisonnement suppose, il m’est alors devenu urgent d’y apporter quelques nuances, à partir de mes recherches philosophiques d’une part, mais aussi de ma connaissance du mouvement sur lequel je tente d’apporter une sorte de réflexion depuis que je suis tombée dedans quand j’étais petite…
Le mouvement Hip-Hop a pris de l’ampleur aujourd’hui. Alors que dans les années 90, on écoutait IAM, Assassin, Minister Amer ou NTM (voire les trois) dont les textes racontaient des histoires et relataient l’urgence sociale, le quotidien de la banlieue et ses difficultés (avec les flics, l’amour, l’amitié, l’ennui, la rage, etc.), désormais le mouvement est extrêmement large et tous n’ont pas le même partis pris. De fait, le mouvement a grandit. Il s’est développé et n’est plus fait d’un bloc comme on pouvait le penser au départ. Bien sûr, déjà à l’époque entre ces différents groupes, il y avait déjà des différences fondamentales. IAM était apprécié pour ses images et métaphores qui faisaient de chaque morceau une sorte de fable plus ou moins comique ou réaliste. On écoutait Assassin pour son caractère politique et engagé au sens militant du terme. Toujours, les textes étaient recherchés et invitaient à l’action politique, comme le prouve les liens qui ont été tissés entre Assassin (et les groupes qui gravitaient autour) et le MIB, le mouvement Inter Banlieue. Minister Amer avait la particularité d’être un groupe plus « hardcore » qui relatait la réalité telle qu’elle leur apparaissait sans fards et NTM s’est toujours présenté comme un groupe se faisant le porte parole de l’urgence sociale. Déjà, des différences existaient au sein des pionniers du mouvement. Pourtant, ce qui reliait chacun les uns aux autres, malgré les luttes apparentes entre eux, les différents clashs et battles (notamment entre Paris et Marseille, renforcés par le soutien inconditionnel des uns à l’OM et des autres au PSG !), c’était déjà la nécessité de faire la place belle à une parole tue jusqu’alors : celle des jeunes issus des quartiers dits « défavorisés », ce qu’on appelle aujourd’hui les « jeunes de banlieues ».
En tant que tel déjà, le rap avait bel et bien une fonction artistique et sociale : l’expression d’un point de vue sur le monde à partir du prisme de la création et donc de l’imaginaire. Si on accepte avec Hegel que "L'art créé un royaume d'ombres, de formes, de tonalités, d'intuitions »[1], alors l’art est toujours partiel. Il ne vise pas une sorte de totalité du monde, sa compréhension et sa révélation totale, dans son essence, mais représente, donne à voir un point de vue (celui de l'artiste). Il est donc toujours subjectif, sans pour autant qu’il puisse être réduit à la subjectivité pure puisqu’il parle, résonne, retentit aussi chez le spectateur ou l’auditeur. Il s’agit donc d’un point de vue (subjectif) qui vise néanmoins la sortie de soi (l’expression) pour toucher l’autre. Il relie par les sens les individus entre eux par leur amour commun ou le plaisir procuré. Phénoménologique, il relève d'un savoir sensible, d'un accès théorique à partir des sens, du vécu, du ressenti...
Ainsi, le rap répond à ce "besoin rationnel qui pousse l'homme à prendre conscience du monde intérieur et extérieur et à en faire un objet dans lequel il se reconnaisse lui-même"[2]. Il est un objet philosophique à ce titre et produit un discours qui doit s’entendre et se comprendre en tant que tel, comme indicateur social. En tant qu'art, il délivre un message subversif qui met au jour de ce qui est enfoui, caché, invisible. Cette subversion est le propre de tout art qui révèle par la médiatisation des sens (sensibles) un sens (intelligible) original, nouveau, inattendu. Nécessairement, cela peut choquer, comme tout ce qui n’est pas conforme aux habitudes de penser.
Le rap produit donc une forme de « contre discours », un « contre pouvoir », qui s'apparente de ce que Nietzsche appelle "la puissance dionysiaque"[3]. Celle-ci consiste à laisser libre court à son imagination, sa puissance de rêve pour produire des formes, des apparences qui loin de cacher la vérité à l’esprit, lui en indique la voie. Pire, selon Nietzsche, "un esprit philosophique a même le pressentiment que, sous la réalité où nous vivons, il en existe une autre, cachée, et donc que notre réalité aussi est une apparence"[4]. L'art et le rap en l’occurrence nous indiquent une voie à suivre quant à la réalité de ce qui nous apparaît. En tant que tel, ce courant musical a donc une valeur artistique au même titre que les autres courants et ne peut être réduit au rang de sous culture. Il est objet philosophique au sens fort puisqu’il appelle à la réflexion sur le sens du discours qu’il propose et comporte une forme de complexité à mettre au jour pour en déterminer les différentes formes et significations entremêlées.
Le mouvement s’est désormais transformé. Cela semble logique et cohérent, puisqu’en tant que mouvement il n’a pas vocation à rester statique, mais bien à se développer. Un mouvement ne peut être entendu comme un bloc, puisque le bloc relève de la matière fixe quand le mouvement est une force, une impulsion qui génère nécessairement une forme de transformation. Lorsque j’opère un mouvement, j’agis sur le réel, je lui donne une forme particulière qu’il n’avait pas auparavant. Parler de mouvement, c’est donc nécessairement parler d’un élan, d’un devenir et d’un développement. C’est pourquoi, le mouvement Hip-Hop dont le rap est une branche, une de ses ondes de forces, ne peut être entendu autrement que dans sa diversité.
Aujourd’hui, 30 ans après son apparition, sa forme s’est encore complexifiée, les ondes de choc se sont multipliées à mesure des impacts de chaque sortie de maxis et d’albums. Au sein même du rap, plusieurs branches se sont développées révélant ainsi le dynamisme même du mouvement qui reste productif et fécond comme le prouve justement sa diversité. Lorsque je jette un caillou dans l’eau, j’use de ma force pour générer le mouvement que je transmets au caillou lui-même. Celle-ci s’imprime dans les cercles dessinés autour du point d’impact du caillou dans l’eau. Ces cercles sont de plus en plus larges et éloignés du point d’impact à mesure que la force se transmute, se transforme par le biais de son passage dans l’eau. Tout en s’éloignant du point d’impact initial, le mouvement s’élargit, prend de l’ampleur…
En tant que mouvement, le rap est donc une onde de choc qui comporte une force initiale et a eu un impact sur la culture musicale que les branches qui en sont issues aussi larges et différentes soient elles démontrent justement. Bien qu’elles proviennent toutes de la même force centrifuge, à savoir le Hip-Hop, elles se donnent à voir et à écouter sous des aspects divers et variés dont le lien avec l’impact d’origine se brouille, même s’il reste réel.
Toujours, ce mouvement artistique tire son origine du détournement des instruments de la société pour leur donner un sens nouveau, pour exprimer une parole originale, jusqu’ici passée sous silence. Qui dit détournement, dit nécessairement une forme de violence, puisque détourner, n’est pas un mouvement « naturel » qui va de soi. Il suppose la contrainte du réel et la torsion des habitudes. Cette violence du détournement (de son, de matériels industriels, des codes linguistiques et corporels, de la culture elle-même) prend désormais le pas sur la violence émeutière, la violence brute non transformée, non sublimée, lui répond en écho. Ainsi, loin d’appeler à la violence, le rap contient et invite à la sublimation de cette violence pour la rendre intelligible et non plus pulsionnelle.
Dès l’origine, il y a donc quelque chose de cathartique, voire un effort de sublimation, dans cette forme musicale. De ce fait, elle renvoie nécessairement aux vécus de chacun, vécus fondamentalement subjectifs et ne peut être entendu comme un bloc unilatéral et pensable « objectivement », à savoir considéré comme un objet dont les propriétés vaudraient une fois pour toute. Parler du rap en soi, en tant que genre pris comme un ensemble cohérent et définissable une fois pour toute, est déjà une erreur conceptuelle. En tant que mouvement, en tant que force, le rap, comme le Hip-Hop est un objet philosophique qui ne peut se comprendre qu’à partir de ses origines et de ses développements, du sens qu’il révèle dans sa diversité et non dans sa forme apparente. La première erreur conceptuelle consiste donc à confondre mouvement (force, impulsion, élan) et objet (forme définie et fixe). Evoquer le rap comme argument intellectuel, cela suppose donc de le prendre pour ce qu’il est un mouvement, une force, qui induit nécessairement diversité et transformation. Il s’inscrit dans un contexte, une époque, des déterminants sociaux qui influent sur son développement.
De nos jours, le monde n’est déjà plus celui que nous connaissions dans les années 90. Il n’est plus le même monde d’un point de vue économique, politique et artistique. Notre société est elle aussi un mouvement car elle est culturelle et la culture est la manière dont l’humanité impulse sa force (son mouvement, son action) sur la nature et ainsi la transforme. De ce fait, la société et par voie de conséquence le rap qui en est l’émanation se sont transformés. Ils ne sont plus exactement ce qu’ils étaient dans les années 90 et cette transformation est aussi la preuve de ses capacités d’adaptation, puisqu’il reste un courant musical apprécié et revendiqué. Alors qu’il aurait pu disparaître avec les mouvements sociaux, il s’est renforcé en se diversifiant, de la même manière que l’humanité elle-même. Il a produit plusieurs branches selon les perceptions et points de vue des uns et des autres, sans pour autant qu’on puisse parler de « races » dans le rap, on parlera plutôt de genre. Certains revendiquent, par exemple, le fait de faire de l’argent comme l’objectif ultime de leur art. Ce faisant, ils incarnent les clichés du genre importés des USA. Parmi eux, quelques uns vont même développer leur musique là bas et ne revendiquent aucune valeur ou engagement spécifique pour le rap. Ils incarnent une branche qui fait parti du Hip-Hop, même s’il peut surprendre jusqu’en son sein, car il vient signifier ce contre quoi précisément se battaient les anciens (ceux qui sont rentrés dans le mouvement dans les années 90 comme moi d’ailleurs !). L’éloignement du point d’impact, de ce qui fonde l’origine n’en est pas pourtant une preuve de sa trahison, c’est la suite logique. Le fait que certains se soient emparés de ce qui rebutait précisément les pionniers du genre est bien la preuve de l’émancipation des nouvelles générations par rapport aux anciennes et que le mouvement reste dynamique.
Cette branche du mouvement, notamment revendiqué par Booba, même s’il ne le nomme pas comme ça, est une branche inspirée du rap dit West Coast, du gangsta rap où la réussite sociale grâce à l’argent de la musique et de la production est le message politique. Il s’inspire et s’inscrit (la culture est à la fois source d’inspiration et origine même de la possibilité de le penser) d’une culture de la réussite individuelle que l’argent incarne et dont il est le vecteur. Pour bien comprendre cette perception, il faut rappeler qu’aux USA, l’argent n’a pas la même fonction sociale qu’en France, car nos fondements culturels sont différents. Là-bas, le rapport à l’argent est beaucoup moins complexé que chez nous, car il vient démontrer la valeur personnelle. Cette démonstration tient aux racines protestantes des Etats-Unis, comme le démontrait déjà Weber dans Ethique protestante et l’origine du capitalisme dès le 19ème siècle. Là encore, toute société, toute culture donc, est un système complexe dont il s’agit de voir comment les paramètres qui le composent s’entremêlent pour comprendre les valeurs véhiculées culturellement. Ces dernières sont à la fois l’expression de cette complexité et sa simplification. Elles traduisent les connexions des différents paramètres tout en se donnant une apparence de simplicité. Elles devraient se comprendre et résonner en chacun de manière simple, quand en leur fond, elles ne sont que la réunion, le lieu de la complexité elle-même. Le rapport à l’argent (économique) est fait de cette complexité et comprend des facteurs théologiques, des facteurs politiques et des facteurs historiques, ce que Weber, bien avant Morin avait déjà mis au jour. Puisqu’on reproche régulièrement au rap de n’être désormais qu’intéressé par les signes extérieurs de richesse, et que cet argument est si souvent mis en avant pour décrier le mouvement, il m’a semblé nécessaire de faire un détour ici pour signifier comment le rapport à l’argent se construit lui aussi culturellement. Ce qui me paraît se nouer en creux des polémiques sur le genre sont des confusions sur la manière dont nos sociétés se sont construites et les principes idéologiques sur lesquelles elles reposent et que la mondialisation actuelle semble brouiller.
Dans la culture protestante, l’élection divine refait son apparition. Elle avait été mise de côté par la version première de la chrétienté (aujourd’hui nommé catholicisme puisque la chrétienté comporte elle aussi plusieurs branches désormais) pour permettre la conversion des juifs et donc la propagation rapide et simple du mouvement. Avec la chrétienté, arrive le prosélytisme qui n’existe pas dans la culture juive. Le monde commence alors à devenir un objet de conquête et le prosélytisme est un moyen d’accroître les territoires acquis. Pour permettre le prosélytisme, encore fallait il se défaire de l’appartenance à un peuple élu dès la naissance. Cette conception hébraïque de l’appartenance culturelle avait l’avantage de soutenir la solidarité interne du peuple et le sentiment d’appartenance qui fonde le lien social au sein d’une communauté donnée, mais avant aussi l’inconvénient de ne pas permettre sa propagation. Au moment, où le pouvoir se démontre par les conquêtes (comme l’ont prouvé celles d’ Alexandre Le Grand 356 av. J-C – 323 av. J-C ou d’Hannibal 247-183 av. J.-C.), la nécessité de favoriser la conquête des peuples se couplent à celle des territoires.
La chrétienté remplace donc l’élection par le baptême. Avec la réforme protestante qui vient donner plusieurs formes à la chrétienté et relaie sa forme initiale au catholicisme, la notion d’élection divine refait son apparition, mais ne rompt pas totalement avec la possibilité du prosélytisme puisque l’élection n’est plus de naissance, elle n’est plus transmise de la mère à l’enfant, mais s’acquiert par l’effort, le travail. Elle devient donc aussi individuelle, alors qu’elle est collective dans la religion juive. Ce n’est plus par la filiation que l’élection s’acquiert, filiation qui n’est pas du fait de l’individu, mais un état de fait, quelque chose sur lequel il n’a pas de prise, mais par la manière dont l’individu fait prospérer la terre et ainsi acquiert ressources et richesses. Ce faisant, l’individu démontre au reste du monde qu’il a été élu par Dieu et Dieu lui signifie par les richesses et productions acquises que cet individu a été choisi, élu. Dieu choisit les meilleurs et les récompenses de leurs efforts pour faire prospérer la terre qu’il a mise à leur disposition. Il les remercie de leurs efforts en leur donnant des richesses, c’est un retour sur investissement. Il ne s’adresse plus à un peuple, mais à des individus. C’est une relation directe qui s’installe entre la personne et Dieu qui n’est plus médiatisée par le collectif qu’incarne la notion de peuple chez les juifs et les ministères ecclésiastiques dans la culture catholique. Désormais, le prêcheur peut être n’importe quel individu qui souhaite transmettre un message aux autres, il n’y a plus une seule parole possible, mais plusieurs, voire autant que d’individu ou de paroisses. On dit d’ailleurs aux USA qu’il y a autant de religions que de fromages en France, c’est pour dire !
Toute la culture et les valeurs américaines relèvent de cette importance nouvelle accordée à l’individu lors de la réforme. Le monde divin est désormais relégué au niveau de la conscience individuelle, comme c’est aussi le cas dans la religion musulmane, mais dont la culture européenne est alors totalement ignorante à l’époque déjà. Avec cette notion de conscience individuelle, d’opinion propre, de relation au divin par le biais de la pensée, de l’introspection, l’élection individuelle devient possible, pensable et ce principe induit à la fois la nécessité de la réussite individuelle et la démonstration de ses richesses. On comprend donc bien que les rappeurs américains aient mis en avant le culte de la personne (égotrip), de la réussite par l’acquisition de richesse (gangsta rap) et que le mouvement là bas se soit constitué autour d’individualités, parfois même considérés comme des prêcheurs. Les discours n’ont pas vocation à être cohérents les uns avec les autres, mais expriment des courants de pensée, des lectures du monde.
En France, nous restons très catholiques dans notre rapport à l’argent. L’argent est suspicieux dans cette culture catholique, car il est proche de la vanité qui reste un péché capital. La réussite et l’effort ne sont pas les motifs de la réussite sociale en France, non par paresse fondamentale du peuple français (comme peuvent se le représenter parfois les américains), mais bien parce que nos racines culturelles font de l’argent quelque chose de sale (ce qu’on retrouve aussi dans la religion musulmane qui partage le concept de charité). Posséder ce n’est pas la preuve que Dieu nous aime, c’est potentiellement avoir pris quelque chose pour soi que Dieu aurait déposé à la portée de tous. Dieu a fait le monde à son image et nul ne peut s’approprier Dieu. C’est la possession, la propriété qui est douteuse, car elle induirait que celui qui possède, celui qui est propriétaire s’est pris pour Dieu en s’octroyant une part du monde qui ne lui appartient pas, ne lui revient pas de droit. Seuls les rois, qui sont de droit divin, donc incarnation de Dieu sur terre, sont en droit de posséder des richesses et non les individus qui doivent œuvrer pour la richesse du roi et non pour eux-mêmes. Celui qui possède individuellement est donc celui qui « vole » Dieu. C’est un péché à expier que d’avoir oser défier Dieu, se mettre à son niveau, chercher à lui faire concurrence, et c’est pourquoi l’argent est sale.
Pour se défaire de la culpabilité qu’il induit (il est sale d’avoir quelque chose de sale), il faut en donner aux autres (la charité) pour lui redonner une valeur positive. Si l’argent circule alors il reprend une valeur plus positive car il devient ce par quoi je suis en lien avec les autres, je me rappelle que Dieu a fait le monde à son image et pas uniquement moi, je redonne ainsi sa grandeur à Dieu qui ne peut jamais être entendu comme mon serviteur, mais c’est à moi d’être le sien. Avoir de l’argent, être riche, c’est quelque part avoir eu de la chance à la naissance (l’ancien régime est dominé par l’aristocratie, qui tient sa richesse de la naissance et non de l’effort). Cela n’a donc rien à voir avec la valeur personnelle. Je me dois donc de rendre à Dieu ce qui lui appartient, tant par l’aumône (paiement de mon du à la communauté religieuse), par la charité (paiement de mon du à l’humanité) ou à la dîme (paiement de mon du au Roi/Dieu). C’est pourquoi, en France, avoir de l’argent se montre, mais ne se dit pas car cela relèverait du péché et surtout induirait de devoir le rendre ! C’est par les signes extérieurs de richesse qu’on remarque les ressources, elles se devinent par le costume social, la manière dont on se donne à voir, mais elle ne se parle pas, elle n’est pas énoncée, explicitée.
Depuis la révolution française où c’est précisément ces privilèges de naissance dont ont été visés le dépassement, le rapport à l’argent a encore été transformé. Jusqu’alors, l’argent était la démonstration de sa bonne naissance dont on pouvait s’affranchir en faisant la charité et en avouant ses pêchés de luxure et d’avidité. Il était donc de l’ordre du mal, mais il restait des possibles pour en profiter. Désormais, le rapport à l’argent devient encore plus suspicieux, car ceux qui en ont auraient dû avoir la tête coupée ! La fortune individuelle renvoie à une subversion des principes républicains et notamment de la valeur égalité. Il incarne ce contre quoi le peuple s’est soulevé pour solliciter une redistribution non pas individuelle justement, mais collectivement (notamment par le système de redistribution des impôts qui repose sur le principe suivant : « chacun participe à hauteur de ses ressources et reçoit au regard de ses besoins ». De ce fait, le rapport à l’argent ne peut être entendu de la même manière. Il sert au collectif et non à l’individu et la suspicion tient au fait que la fortune individuelle induit la possibilité d’avoir été soustraite au collectif. Etre riche serait donc une sorte de refus de contribution à la richesse de tous pour privilégier la richesse individuelle.
De nos jours, tous ces éléments se mélangent du fait notamment de la mondialisation et des nouvelles technologies. Les messages émis peuvent venir de n’importe où dans le monde et nous avons accès à des discours idéologiques et culturels divers. De ce fait, le rapport qu’entretient l’individu à sa culture n’est plus aussi évident qu’il l’était auparavant. Désormais, les valeurs américaines que sont l’effort individuel, le fameux « quand tu veux tu peux », la réussite individuelle démontrée par l’argent affiché, sont présentes partout et sont monnaies courantes des discours individuels des citoyens français. Elles ont été incarnées par l’émergence de ce qu’on a appelé dans les années 80, les nouveaux riches, à savoir des fortunes qui se montrent et s’affichent telles quelles alors que jusqu’à présent, la bourgeoisie s’était bien gardée de faire l’étalage de ses richesses…
Ces valeurs qui ont servies de base au capitalisme comme le démontre Weber, ont été mondialisée à mesure que le capitalisme a lui aussi pris de l’ampleur avec l’industrialisation du 19ème siècle notamment. Toutefois, elles ont été renforcées par le néo-libéralisme qui prend de l’ampleur après le premier choc pétrolier en 1973. Quand jusqu’alors, les profits des entreprises (encore très industrielles) sont réinvestis dans l’entreprise elle-même (qui peut encore être considérée comme un collectif) avec le développement des parts en bourse et des stock options, les bénéfices reviennent à des individus que sont les actionnaires et ne sont plus vecteurs de redistribution collective.
Désormais, on ne comprend pas bien, voire on se moque parfois aussi, de la manière dont la France impose un système de redistribution obligatoire (le système des impôts critiqué de plus en plus fermement et par les politiques et intellectuels eux-mêmes !) car c’est la notion même de redistribution, le sens du collectif qui perd de sa force. Il est vrai que nos élites elles-mêmes en ont détourné le sens et donnent à voir leur réussite personnelle plus que leur conscience de l’intérêt général qui incarne précisément cette primauté du collectif sur l’individu. Par voie de conséquence, les citoyens français (dont font parti les rappeurs) s’y perdent à leur tour et oscillent entre une perception du « rap game » qui incarnent les valeurs importées des Etats-Unis et une autre plus consciente qui dénonce le culte de l’argent, de la réussite, de la consommation, de l’élitisme, bref du néo-libéralisme.
Booba incarne ce premier genre où la réussite individuelle se démontre par les possessions acquises et notamment par les femmes présentées comme des signes extérieurs de richesses, les belles voitures, les bijoux et les belles maisons. Il adhère aux valeurs américaines (jusqu’à décider de s’y installer pour vivre et travailler), s’est emparé de ses codes et modes de fonctionnement. Il propose quelque chose qui fonctionne, car cela parle à une certaine partie de la population et notamment les plus jeunes qui ont grandit dans un autre monde que les anciens, n’ont connu que le culte de l’individu et de la réussite personnelle initiée dans les années 80 et renforcé depuis les années 2000 avec l’invasion des nouvelles technologies. Ces dernières renforcent le brouillage des origines culturelles par la rapidité de l’accès à l’information, la négation de l’espace et le temps en tant que réalité pour leur préférer une virtualité parfois déroutante. Néanmoins, c’est le monde actuel, les paramètres qui traversent notre réalité du moment et il serait absurde de le nier ou de les occulter tant ils influent sur notre manière d’être au monde et donc de le penser et de l’exprimer.
Booba se moque bien de délivrer un message, ce qu’il vise, c’est la réussite. Il sait mieux que personne ce qui va fonctionner ou non et fait de la musique pour être populaire, connu, écouté, pas pour être compris, suivi. Il fait du rap commercial et c’est sa marque de fabrique, ce qu’il revendique. Il fait du rap néo-libéral finalement. Il est dans son temps, dans la culture qu’il a embrassé. Le rap est devenu un moyen d’ascension sociale et il l’a bien compris. La transformation majeure du mouvement tient d’ailleurs en cela.
Dans les années 90, le rap est essentiellement un vecteur d’expression sans autres formes d’objectifs. Le mouvement est alors trop récent pour en saisir les éventuels finalités, il est encore en balbutiement. Les jeunes d’aujourd’hui, en revanche, ont pu observer que certains avaient « réussis » grâce au rap, avait gagné une certaine notoriété, acquis une vie plus « bourgeoise », s’était quelque part extrait de leur classe. L’ascension sociale par cette voie est donc possible et paraît même plus aisée que celle proposée par la République, à savoir l’école. En même temps que le rap se développe, commence à passer sur les ondes, que le Hip-Hop s’immisce dans les musées, dans les discours sociaux, dans la culture en général, l’ascenseur social qu’est l’école se bloque. Il devient donc un vecteur d’ascension parmi d’autres dont les figures sont invitées sur les plateaux télé, écoutés, entendus, reconnus. Dans un système où c’est celui qui tire son épingle du jeu qui est le héros, celui qui sait tirer parti du système en place, le rap devient un moyen de s’en sortir, comme le sport ou la réussite scolaire (qui pour sa part perd de plus en plus de son aura compte tenu des discriminations qui ne cessent de grandir). Booba incarne ce type de personnage qui a réussit aux yeux des jeunes qui l’écoutent.
De ce fait, ses textes sont assez rudes vis-à-vis de la France et de la République qu’il a décidé de quitter (et non d’y faire de la politique justement). Il a fait le choix de quitter un système de redistribution pour lui préférer un système de la réussite individuel. C’est son choix et quoi qu’on en pense, on ne peut que saluer le fait qu’il ait été jusqu’au bout de sa démarche. Chacun reste libre de s’autodéterminer et nul n’est en droit de juger les choix d’autrui (base même de la liberté d’opinion). Il fait du rap commercial, c’est son droit. Le rap commercial est né aux Etats-Unis et ne peut être exclu du mouvement car il révèle quelque chose de nous-mêmes de ce qui fait culture, culture à laquelle nous appartenons. Exclure Booba du mouvement (de la même manière que ce qu’on appelle classiquement dans le milieu la TRAP, à savoir un rap plus commercial, moins axé sur le message que sur le fait de plaire au plus grand nombre), cela reviendrait à considérer le rap comme un bloc unique, ce qu’il n’est pas. Ce serait lui ôter son caractère dynamique et le réduire drastiquement dans son essence et son développement.
Néanmoins, Booba ne résume pas le Hip-Hop et encore moins le rap français, qui est métissé, divers, mélangé. Accepter que cette branche existe, la reconnaître comme faisant parti du mouvement, c’est, dans le même temps, reconnaître et admettre que le mouvement ne s’y résume pas, mais comporte aussi d’autres branches. Lorsqu’on attaque le rap par le biais de Booba, finalement, on tend le bâton pour se faire battre car Booba participe du mouvement, mais ne le résume pas. Cela serait du même ordre qu’imaginer pouvoir évoquer et analyser les discours de la classe politique dans son ensemble à partir du tropisme des propos de Morano par exemple. Aberration ! Je ne peux pourtant me résoudre à l’idée que cette inversion ait été fortuite. Nul n’ignore aujourd’hui que la musique est diverse et que le mouvement Hip-Hop n’est pas d’un bloc. Lors de l’émission de télévision en question, les commentateurs ont bien tenté de faire entendre à Alain Finkelkraut que d’autres rappeurs existaient, citant par exemple Oxmo Puccino dont certains titres sont utilisé pour des causes humanitaires (comme par exemple L’enfant seul), mais il semble être resté sourd. Etait-ce un coup médiatique ? Une manière de signifier combien il restait opaque à l’idée même que ce type de musique puisse être positive ?
Je crois surtout qu’admettre que le rap ne se résume pas à Booba, c’était aussi prendre le risque d’érailler son raisonnement. En donnant à celui-ci les atours d’une vérité absolue et universelle, il enrobe les erreurs conceptuelles qui s’y cachent pour ne plus donner à entendre qu’une apparence de cohérence. Evoquer Booba comme l’archétype du rap français, revient à considérer qu’on peut évaluer et juger un mouvement musical à l’aune de sa commercialisation. Ce n’est pas parce qu’il vend le plus de disque au grand public, qu’il incarne le mouvement à lui seul. De la même manière que ce n’est pas parce que Finkelkraut ne résume pas le paysage intellectuel à lui seul parce qu’il serait actuellement le plus médiatisé.
Pire, quand ce dernier tente de défendre les propos racistes de Morano en mettant en perspective ses propos avec ceux de Booba, il fait deux erreurs conceptuelles majeures.
La première consiste à penser que l’on pourrait mettre sur le même plan un discours délivré dans un morceau musical et donc artistique, à visée divertissante (et précisément, Booba ne cherche pas à passer des messages comme on a pu le voir), et un discours prononcé par un représentant politique. Booba n’a jamais été élu pour incarner les voix d’autres personnes que lui. La démocratie représentative suppose que chaque citoyen en votant donne sa « voix », autrement dit sa capacité propre d’expression, ce qui fait son individualité et sa pensée propre, à un représentant dont l’expression représentera désormais aussi la sienne. La parole du politique n’engage donc jamais que lui, mais toujours avec lui, celles des citoyens qui lui ont donné leur voix. On ne peut pas mettre sur le même plan un discours qui n’engage que celui qui le prononce (Booba) et un autre qui représente une frange de la population.
En faisant ce genre d’amalgame, c’est précisément la notion de représentativité qu’il viole impunément. Oui, il la viole, il la force et en fait un objet à l’usage de son raisonnement alors qu’elle est un concept en soi. Cette notion de représentativité est déjà bien mise à mal ces derniers temps par les politiques eux-mêmes dont les propos et sorties publiques ne paraissent plus prendre en compte cette dimension. A croire que ce qu’ils expriment n’engagerait plus qu’eux. Je pense ici aux propos de B. Horteffeux qui lui ont valu un procès sans pour autant qu’il ne semble prendre la mesure de leur portée haineuse. Mais je pense aussi aux nombreuses affaires qui mettent à mal l’intégrité des figures politiques et donc leur capacité à incarner une parole collective et non pas personnelle. Il me semble que le rôle des intellectuels (s’ils devaient en avoir un) serait plutôt de redonner du sens, un sens authentique, à cette notion (revenir à ses origines, ses racines et ses implications) plutôt que de la galvauder davantage. Or, en situant les deux discours sur le même plan, Finkelkraut cautionne ce détournement de la notion de représentativité en l’asseyant au lieu de le dénoncer. Il vide de sa substance, le concept démocratique fondateur et le détourne dans son intérêt propre (servir son raisonnement). Il s’agit là d’un sophisme dangereux puisqu’il met à mal jusque les fondements de la République elle-même, alors que le cœur de son propos repose sur une critique de ceux qui attaque cette République, qu’il met à terre en tentant de la défendre !
Par ailleurs, la politique n’a pas la même finalité que l’art. L’art ne cherche pas à transformer la société, à y agir, mais à la décrire, délivrer un message la concernant. A partir de ce message, chacun se positionne. L’art laisse chacun libre de ses opinions et jugements. Un morceau, un tableau, un spectacle parle ou pas, plaît ou pas. L’artiste qui réussit aujourd’hui, est celui qui plaît le plus (vente de disque, marché de l’art), mais sans pour autant que cette réussite commerciale soit un gage de qualité de l’artiste au regard de critère purement esthétique. Les critères commerciaux ont pris le pas sur les critères esthétiques, et c’est le rapport quantitatif du nombre de disques vendus qui prend le pas sur le rapport qualitatif de la production artistique. Toujours est il que l’art ne se résume pas à son marché, de la même manière que le marché (économique) ne résume pas le politique, même s’il y participe.
La politique en revanche, n’a pas la même fonction que l’art artistique. Elle ne vise pas à produire du beau, de l’agréable, de la mise en mouvement interne de l’imaginaire. Elle est un art de la conviction. En ceci, elle est art, au sens où elle n’est pas science (savoir absolu et qui vaudrait une fois pour toute une fois les compétences et expériences en la matière acquise). Elle ne relève pas d’une recherche rigoureuse qui viserait une forme d’objectivité, elle s’appuie sur des convictions personnelles (et non des certitudes) qui sont transmises par le discours et doit nécessairement déboucher sur une prise de position induite par le discours lui-même. Le discours politique cherche à influencer l’autre (ce que l’art ne cherche pas à faire, puisqu’il laisse le spectateur ou l’auditeur se positionner selon ses goûts et libre arbitre). Le politique n’use pas du langage de la même manière que l’artiste. Ce dernier est « pris dans les filets du langage »[5]. Le langage est à la fois trop étroit pour rendre compte de ses dessins, de ses perceptions, intuitions et impressions et de ce fait, l’enferme en ses filets, tout en donnant des indices de ce qui le dépasse par les interstices laissés entre les mots. Il y a donc pour l’artiste un paradoxe du langage qui indique son dépassement tout en signifiant sa limitation. C’est au sein de ce paradoxe que l’artiste se niche pour créer, innover, inventer.
Le discours politique, en revanche, s’approprie différemment ce paradoxe inhérent a langage. Ce faisant, il relève du sophisme, de ce qu’on appelle aussi l’art de la persuasion, qui n’a que faire de la vérité, mais donne aux propos des atours de vérité. Le discours politique use du langage et des raisonnements pour délivrer un propos aux atours de cohérence et donc de potentielle vérité, sans en avoir les fondements. Le but ou la finalité est essentiellement de convaincre l’autre de sa vérité et non de la démontrer par le raisonnement logique. Il cherche à plaire, à séduire et non à exprimer une sincérité. L’artiste cherche à plaire au public dans sa vérité nue, brute, il s’expose. Le politique cherche à plaire aux électeurs dans ses convictions qu’il fait passer pour des certitudes, il ne donne pas à entendre sa vérité, mais un discours préalablement constitué d’éléments de langage, qui enrobent le message implicite d’illusions de véracité. Quand l’art se fait sans dessein, ou tout du moins sans autre dessein que d’exprimer une forme de vérité pour l’artiste (j’évoque ici la dimension qualitative de l’art et non sa commercialisation), le politique se fait à dessein.
Leurs discours (politique et artistique) n’ont donc ni la même fonction, ni la même forme, ni la même visée. Le discours artistique permet à chacun de se définir à partir de ses goûts et intérêts, transforme les codes et la forme du langage lui-même, s’invente et vise le plaisir sensuel. Le discours politique vise à convaincre les futurs électeurs du bien fondé des raisonnements, il est fait d’éléments de langage qui cachent les messages implicitement délivrés et vise l’action politique et l’exercice du pouvoir au nom du peuple. Je ne peux pas croire que cette confusion entre ces deux types de discours si fondamentalement différents soit fortuite. Je fais plutôt l’hypothèse qu’il s’agit d’une manière de détourner la fonction artistique du mouvement Hip-Hop afin de le vider de sa substance et nier ainsi la possibilité même pour ce mouvement d’avoir une forme de légitimité. Ce faisant, le discours politique perd aussi de sa valeur et de sa force et tout devient énonçable, jusque les pires aberrations. En cherchant à saper les bases du mouvement (diversité, fonction sociale, mouvement dynamique), c’est donc toutes les possibilités d’expression citoyenne qui sont en même temps mise à mal et qui perdent de leur force démocratique, jusque l’expression politique. En effet, si finalement, tout se vaut ainsi et que les discours n’engagent que ceux qui les prononcent et qu’on les juge à l’aune de leur commercialisation, alors, pourquoi avoir attaqué les discours énoncés par J.M. Le Pen qui relevaient à peu de choses près des mêmes ressorts et des mêmes sous entendus ? C’est vrai que lui aussi a vendu moins de disques que Booba.
La deuxième confusion tient encore au fait que les deux discours mis en perspective ne peuvent pas l’être en ceci qu’ils ne parlent pas de la même chose. Néanmoins, cette fois, ce n’est plus tant sur la forme et fonction du discours que sur le fond des propos. Ces dernières années, le développement fulgurant des amalgames semble être porté par des personnages de ce type qui en parallèle des discours qui ne peuvent pas l’être car ils se situent sur des plans différents et sur des objets différents. C’est ainsi qu’on créé des amalgames. Ce procédé est régulier et fréquent en politique, mais jusqu’alors les intellectuels avaient pour fonction de le dénoncer et non de le cautionner. Désormais, ces « intellectuels » qui sont « en colère » d’après l’Express de la semaine, viennent les asseoir par leurs propos. Ils deviennent ainsi le bras armé du politique quand le seul intérêt qu’ils pourraient avoir en tant que catégorie socioprofessionnelle serait qu’ils puissent au moins exercer leur fonction de contre pouvoir, de transmission du savoir et non sa rétention. Il y aurait de quoi être en colère finalement, mais peut être contre eux aussi qui occupe une fonction sociale qu’ils n’assurent pas ou plus. S’ils passent sur les ondes, c’est pour être pédagogues non ? Pardon, naïvement, je le pensais encore…
Booba est, soit, virulent vis-à-vis de la République, mais en tant que citoyen, c’est son droit et n’importe quel « intellectuel » se disant « philosophe », autrement dit ayant une culture philosophique, sait qu’il s’agit là du principe fondateur du contrat social posé dès le départ par Rousseau. Chaque individu, chaque citoyen peut critiquer le système dans lequel il vit et a fortiori dans notre République. Il en va même de la morale citoyenne et républicaine puisque la critique de l’Etat est un devoir citoyen. Attention, la critique est ici à entendre dans son sens noble, à savoir la capacité à définir les limites des possibles et des impossibles. Cette critique est ce qui autorise la participation sociale et ainsi chacun devient en mesure de modifier l’Etat par cette participation qui repose sur un esprit critique pour qu’il corresponde davantage aux aspirations collectives. Sans cette critique, pas d’évolution possible et l’Etat se fige alors qu’il a une fonction dynamique de transformation, d’évolution, d’adaptation au monde qui nous entoure n’en déplaise encore à certains. Puisque l’homme est perfectible, alors il n’est pas donné une fois pour toute et l’Etat auquel il appartient et participe doit pouvoir rendre compte de cette évolution, de cette perfectibilité. Dès le contrat social, Rousseau invite donc à cette critique du fondement même de l’Etat en appelant dans un alinéa du livre I à ce que chaque génération puisse revoter les lois pour s’assurer qu’elles leur correspondent toujours. On voit donc bien combien l’investissement et la prise de position vis-à-vis de l’Etat est un acte citoyen au sens fort. La critique de l’Etat fait partie de notre culture démocratique et fonde même notre participation sociale (tout du moins dans l’esprit).
C’est pourquoi, il est important de rappeler que lorsqu’un individu se rebiffe contre l’Etat, c’est son droit (que sa colère s’exprime vis-à-vis des institutions d’Etat comme l’école ou la police ou vis-à-vis de la République elle-même et de son fonctionnement), il s’agit même d’un droit fondamental (droit de manifester, droit de grève, droit de retrait dans la fonction publique, droit d’exprimer son opinion). Même si ce droit semble de plus en plus éloigné de nos réalités de terrain et qu’on voit de moins en moins de biais par lequel l’individu citoyen peut faire valoir ses droits face aux institutions qui représentent l’Etat dans son ensemble (donc ont la force du nombre de leur coté), il n’en demeure pas moins encore présent.
J’en veux pour preuve : les médiateurs de la République qui ont pour fonction de soutenir les citoyens dans les litiges qui les opposent aux institutions (même si bizarrement, leur rôle et fonction sont peu médiatisés), le Défenseur des droits (même si ce poste est régulièrement remis en question), les juges d’instructions qui assurent la fonction de veille au respect des droits du prévenu et notamment de la présomption d’innocence (et ce malgré l’erreur d’Outreau, un système ne peut être jugé à l’aune des individus qui le composent et de ses exceptions qui existeront toujours car le système est composé d’êtres humains qui, en tant que tels, ne sont pas des machines qu’on peut programmer et donc comportent des marges d’erreurs possibles), mais aussi l’esprit même de la loi 2002-2 que seul le secteur social semble connaître et d’ailleurs souvent mal, mais qui repositionne la citoyenneté de chacun devant l’Etat et la nécessité pour chacun d’exprimer son opinion, de participer au fonctionnement et d’être pris en compte dans le fonctionnement même des institutions… Le rôle fondamental du citoyen est d’interroger, de critiquer le système dans lequel il est afin de le mettre en branle, de lui permettre d’évoluer, de bouger, de changer, de se transformer.
En revanche, les représentants de l’Etat (police, politique, fonctionnaire) n’ont pas le droit de se retourner contre des individus ou des catégories d’individus ce qui reviendrait à nier leurs droits fondamentaux. Il n’est conceptuellement pas tenable de mettre sur le même plan des représentants de l’Etat et des individus citoyens. Encore, il s’agit d’une confusion entre deux plans qui n’ont aucune commune mesure, d’une erreur arithmétique. Cette différence tient au fait que le citoyen est une unité, un chiffre, quand le fonctionnaire est un nombre. Je m’explique. Le citoyen relève du 1. C’est un 1 citoyen qui par cette citoyenneté complète son existence individuelle et lui donne un caractère social, sociétal. Le citoyen n’est pas vous et moi, c’est le maximum de chacun d’entre nous et permet à chacun d’entre nous de nous y retrouver à travers la notion de sujet de droit. Je ne suis pas que citoyen, je suis aussi une personne incarnée avec des dispositions et des caractéristiques individuelles, mais je suis aussi plus que ces dispositions individuelles qui sont le fruit de mon éducation, de mes composants physiologiques, de mes rencontres, etc. Je ne m’y réduis pas. Si la citoyenneté en France relève de cette distinction entre la personne réelle et le citoyen conceptuel, c’est bien car l’enjeu de la révolution française est justement d’extraire la citoyenneté et son potentiel accès des conditions de naissance qui génèrent les privilèges. Le citoyen est donc une entité conceptuelle au sein de laquelle, nous sommes tous sensés nous reconnaître, mais qui ne résume aucun d’entre nous. Il n’a ni sexe, ni couleur, ni origine, ni culture, ni religion. Il est sujet de droit aux yeux de l’Etat et en tant que tel, ne peut être réduit à ses caractéristiques individuelles.
De ce fait, il incarne le collectif au sens où son existence citoyenne le relie à tous les autres, mais l’exercice de son pouvoir politique de ce fait reste un exercice individuel. Chacun s’exprime différemment dans sa citoyenneté, mais ce qui nous réunit c’est que nous le sommes tous. Le statut de citoyen s’acquiert individuellement et c’est ainsi qu’on rejoint le collectif, il revêt un caractère ontologique, relève de l’être de chacun puisqu’il indique que nous ne pouvons être réduits à nos actes et dispositions particulières. Nous sommes à la fois des individus incarnés par le biais de nos différences fondamentales et des individus désincarnés grâce à la citoyenneté qui nous réunit. Nous sommes à la fois la diversité totale (ce qui interdit d’ailleurs le recours à la notion de race en France pour justifier une citoyenneté plutôt qu’une autre) et l’unité absolue. Cette double vocation de la citoyenneté qui signifie dans le même temps notre irréductibilité fondamentale les uns aux autres et notre communion par le biais de la notion de sujet de droit et de citoyenneté qui fonde le principe d’égalité et malheureusement trop peu enseignée et peu comprise. Les attaques répétées contre le concept d’égalité lui-même en sont les démonstrations. On ne sait plus sur quoi ce principe repose.
Le fonctionnaire quant à lui, n’a pas la même fonction que le citoyen. Les fonctionnaires sont des citoyens et des individus, mais dans l’exercice de leur fonction, ils assurent une mission collective, représente le collectif Etat et non l’individu qui assure la fonction. C’est d’ailleurs ce qu’incarne l’uniforme pour certains d’entre eux. Le fonctionnaire ou le politique par leurs actes et discours n’engagent donc pas uniquement eux-mêmes, mais l’intégralité du collectif Etat quand le citoyen par ses actes le fait en conscience, à savoir au regard de ses dispositions propres et individuelles. Il n’est pas seul à décider et ce sera la réunion des volontés particulières exprimées, leur point de rencontre qui sera énoncé dans la loi qui détermine le droit à partir de cette expression unique qu’est l’intérêt général. Bien sûr, ce principe aussi s’estompe à mesure que les lois sont érigées non plus pour le collectif dans son ensemble, mais pour des catégories de population, voir suite à des faits divers. Néanmoins, les principes de notre système restent encore ceux-là.
Par voie de conséquence, aucune bavure policière ne devrait être pardonnées et exemptées comme c’est malheureusement trop souvent le cas, car la police et les policiers sont d’abord des représentants de l’Etat et l’Etat ne peut user de sa force (la fameuse violence légitime de l’Etat décrite aussi par Weber) qu’à condition que ce dernier (dans son ensemble) soit menacé. Qu’un jeune menace un policier, ce n’est pas menacé l’Etat dans son ensemble. Le rapport de force n’est pas le même. C’est plutôt de l’ordre du combat de David contre Goliath, voire un appel au secours, un appel à l’Etat à lui reconnaître son statut de citoyen. L’individu citoyen est toujours perdant face au nombre qu’incarne l’Etat. On ne peut donc pas parler ici de violence légitime de l’Etat car le collectif n’est pas menacé par un individu et il me paraît logique que les jeunes et les moins jeunes qui ont vu et perçu les représentants de l’Etat (police, école, politique) s’asseoir sur les principes mêmes de la République, les droits fondamentaux des citoyens et la primauté du collectif sur l’individu, n’y croient plus. Booba en fait partie. Beaucoup de rappeurs évoquent d’ailleurs combien la République se nie elle-même. Ce faisant, loin de chercher à l’abattre, il l’appelle à elle-même. Il suffit pour cela d’écouter « La France d’en bas » de Paco, « Fautes de Français » de Lino, « Sincèrement » de Demi-Portion ou encore les textes sublimes de Keny Arkana ou de Casey sur la question. Dénoncer les bavures policières, l’école à deux vitesses, le système qui créé des élites de plus en plus éloignés des peuples qu’elles dirigent n’est pas anti-républicain, bien au contraire, c’est avoir pris la citoyenneté au pied de la lettre, c’est rappeler Rousseau et le Contrat Social à lui-même. Déjà en 1995, le groupe Kabal, y faisait explicitement référence dans le morceau « De part les yeux d’1 disciple ».
Lorsque Nadine Morano évoque l’idée que la France ait une identité de race blanche, elle commet une erreur historique d’une part, car les origines socio-historique de la France ne peuvent être énoncée en termes de race qui renvoie à des éléments biologiques, qui relèvent donc de la nature, et non culturels. Une identité culturelle ne peut être mise sur le même plan qu’une identité « naturelle » qui reste d’ailleurs philosophiquement douteuse. Autrement dit, elle opère une inversion intellectuellement grave qui consiste à substituer une cause par une autre sur des effets qui ne peuvent alors plus se comprendre. Une identité culturelle se constitue à partir des éléments qui fondent la civilisation, donc précisément, la prise de distance par rapport aux déterminants naturels. Evoquer une identité culturelle de race blanche est non seulement un non sens, mais induit des effets pervers puisqu’elle fait passer pour de l’inné ce qui est fondamentalement acquis. Cela supposerait que serait de bons citoyens ceux qui sont de races blanches alors que la citoyenneté ne peut absolument pas être réduites aux déterminants individuels. Elle démontre ainsi son incompréhension même du concept de citoyenneté ce qui reste problématique pour une politique…Elle génère de la confusion, ce qui est le lit de l’amalgame et se situe aussi hors la loi (ce qui doit nécessairement interroger lorsqu’il s’agit en plus d’un représentant de l’Etat puisque cela pourrait être considéré comme une circonstance aggravante). Ses propos relèvent de l’incitation à la haine et sont objectivement racistes ce que la constitution dénonce).
Comment quelqu’un qui se dit droit de l’hommiste et donc des Lumières a pu omettre un élément d’une telle importance ? Quand Booba critique la République, c’est en vertu de ses paradoxes qui sont réels. Il a fait le choix de quitter ce pays dans lequel il ne se reconnaît plus, prenant au mot Sarkozy qui disait en 2007, « la France tu l’aimes ou tu la quittes ! » Il l’a quittée. Par ailleurs, en tant que citoyen français, il garde le droit de le faire (de critiquer la République), car il s’agit d’un droit fondamental, du premier contre pouvoir citoyen imaginé par les encyclopédistes eux-mêmes: celui de la critique. On ne peut pas non plus qualifier ses propos d’incitation à la haine comme Finkelkraut le laisse entendre, puisqu’il s’agit d’une forme artistique qui n’appelle pas à brûler la République, mais la dénonce légitimement. Booba en critiquant ce qu’il quitte est assez cohérent finalement. Indépendamment de la qualité de ses morceaux et de ses textes qui renvoient aux goûts de chacun et dont l’évaluation ne m’appartient pas, car elle ne peut qu’être subjective, Booba est cohérent avec lui-même, même si je ne partage pas la plupart de ses points de vue. Il a fait sienne l’idée que la réussite individuelle était plus aisée dans un pays qui la revendique que dans un pays qui ne sait plus d’où il vient et d’où il part. Il démontre sa réussite et en fait profiter sa communauté. Ce faisant, il se fond et s’intègre totalement dans la culture américaine tout en vendant ses albums en France puisque ses textes résonnent en France et sont écrits en français. Il aurait d’ailleurs pu faire un autre choix car on voit bien que la France achète des artistes américains dont les textes ne sont que très peu compris. On peut lui reprocher ses choix, mais pas ses textes, ni son positionnement et ses choix. Il a fondamentalement le droit et en ceci, il est plus légitime que Morano qui elle, n’a pas le droit, de prononcer les propos qu’elle énonce.
On ne peut donc pas comparer un discours qui enfreint la loi et un discours légitime, même si on ne le partage pas car il n’engage que celui qui l’énonce. A cela s’ajoute que le discours de Morano promeut la différence raciale en la présentant comme un fait alors qu’elle n’a été qu’un recours (donc une construction intellectuelle, une invention comme tous les autres concepts dont nous usons chaque jour) pour classifier les êtres humains au sein de l’espèce. Classification qui a démontré son inefficacité et son inefficience puisque aucune caractéristique commune n’a pu être suffisamment dégagée pour évoquer ce qui relèverait de chaque race indépendamment des agencements génétiques. Encore aujourd’hui, la notion de race ne recouvre pas grand-chose et les humains semblent être davantage faits de mélanges entre des gênes que de branches bien définies. Pire, c’est par le mélange des gênes que l’espère humaine se perpétue, donc par le métissage de tous avec chacun. La notion de race biologique n’est donc pas une évidence, un fait à prendre dans l’absolu. Les êtres humains ont des caractéristiques, toujours différentes, se ressemblent parfois, par familles et non par races.
Ce qui me choque le plus dans ces discours, qu’ils soient politiques ou intellectuelles c’est qu’ils induisent un retournement qui me semble inacceptable en 2015 et a fortiori en France. Comment des politiques peuvent se dire « républicains », tout en prononçant ce genre d’inepties ? Comment des intellectuels peuvent ils venir cautionner ce type de discours par des amalgames qui ne servent que leur raisonnement (sophisme) et non ouvrent sur une réflexion plus large, plus féconde, plus généreuse ? On parle régulièrement de morale républicaine ou laïque, mais qu’en est il des fondements de notre citoyenneté ? Ils sont systématiquement passés sous silence, à croire qu’on en aurait honte…
Il s’agit pourtant d’un enjeu fort et important pour redonner du sens au lien social et à notre République qui sinon ne pourra que marcher sur la tête. J’avoue ma surprise d’entendre ce type de critiques, où des « intellectuels » dénoncent chez des rappeurs exactement le même mécanisme que celui qu’ils utilisent. Ils dénoncent la perversion de la République, en citant Booba en exemple, alors qu’ils l’ont initiée par eux-mêmes en la coupant de ses bases, de ses fondements, de ses potentiels. Si plus personne ne fait de la pédagogie sur nos fondements politiques et juridiques, pas étonnant qu’il soit complexe de les comprendre, d’autant qu’ils ne sont pas simples. Or, à grands renforts de discours élitistes et de catégorisation des populations entre ceux qui seraient les bons et les mauvais citoyens, à coup de catégories socioprofessionnelles qui induiraient que certains pensent mieux que les autres (qu’est-ce d’autres que la catégorie « intellectuels »), on remplace la pédagogie par la confusion et l’amalgame à tous les niveaux et a fortiori dans les discours politiques et intellectuels.
Ce principe d’égalité comprend précisément la distinction entre le sujet incarné (vous, moi, avec nos déterminants physiques et culturels) et le sujet de droit. Nous ne sommes pas que l’un ou l’autre. Nous sommes les deux et aussi plus, car nous en faisons un agencement unique qui fait l’originalité de chacun. Les déterminants physiques ne peuvent donc en aucun cas être reliés à la citoyenneté, n’en déplaisent à certains courants idéologiques qui voudraient qu’on puisse deviner en chacun de nous les caractères et destins à partir des éléments physiologiques (voir psychologiques parfois aussi…). Cela reviendrait à induire un rapport de causalité, voir de nécessité entre les origines et le destin, entre les racines et les comportements, entre la constitution et l’existence. Bien sûr que ces éléments participent de notre manière d’être au monde, de le construire pour nous et de nous y mouvoir, mais il n’en demeure pas moins que nous sommes plus que cela aussi, nous pouvons nous en émanciper et notamment par notre participation au collectif Etat qui n’appartient pas au politique qui exerce le pouvoir sur délégation du peuple et non en leur nom. A partir du moment, où le citoyen paye ses impôts (en tant qu’il travaille sur le sol français et consomme sur ce même territoire), inscrit ses enfants à l’école (les amenant ainsi normalement à partager quelque chose d’une histoire commune et l’appréhension des règles de vie sociales), alors il est français (même si les dernières lois sur l’immigration vise à le réduire drastiquement le principe du droit du sol reste le fondement de la citoyenneté française démontrant qu’elle n’a rien à voir avec le sang, l’origine, la race…).
Pourtant, Alain, tu le sais tout ça ! Pourquoi fais tu semblant de l’oublier ? Qu’est-ce que la rap a bien pu te faire pour que tu le brandisses toujours un peu plus pour venir défendre tes nouvelles amitiés politiques ou intellectuelles ? La perche était trop belle, comment ne pas y répondre et la saisir, pour dénouer les nœuds de ton discours et ses ravages…La haine vous va si mal monsieur qu’elle vous fait perdre jusqu’à votre crédibilité intellectuelle, c’est dommage…
[1] Hegel, Esthétique, PUF 1953 - réédition juin 1998, textes choisis par Claude Khodoss, p.19
[2] ibid. p. 22
[3] Nietzsche, La naissance de la tragédie, Denoël, trad. Cornelius Heim, 1964, p. 18
[4] ibid.
[5] Nietzsche, Le livre du Philosophe.