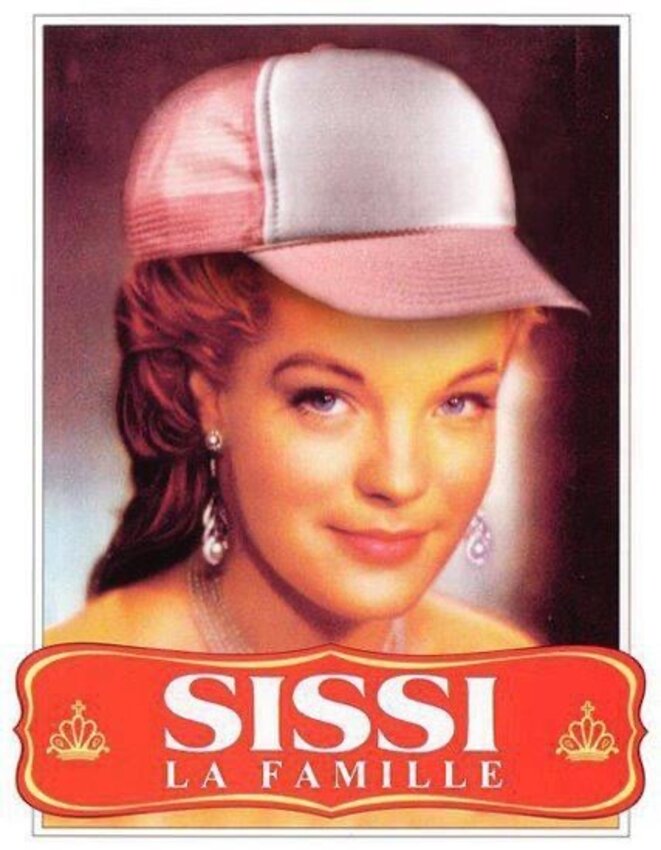Agrandissement : Illustration 1

http://www.20minutes.fr/culture/2170467-20171116-balancetonporc-milieu-rap-francais-concerne
Derrière cet attrait pour la dimension misogyne du rap, n’est-ce pas plutôt une tentative désespérée de sauver un système de domination phallique qui s’essouffle ? Déjà en 2005, Michel Tort décrivait la fin d’un monde fondé sur une représentation traditionnelle du « Père » dans Fin du dogme Paternel (édition Aubier). Historiquement construite afin d’asseoir les formes traditionnelles de domination masculine en assurant aux hommes le monopole de la fonction symbolique, elle est l’archétype du pouvoir entre les sexes. Sauf que le paternalisme a la peau dure. Quand il ne se joue plus dans la sphère familiale et intime, il revient par la fenêtre des représentations sociales et culturelles. Si les « nouveaux pères » sont encensés, que les gentlemen font la vaisselle et laissent leur femme travailler tout en étant conscient de leur « charge mentale », qui sont donc ces hommes qui traitent les femmes de manière archaïque ? Forcément, les rappeurs – ces enfants d’immigrés, d’ouvriers, de chômeurs même parfois, bref des incultes aux yeux des « éclairés ». Finalement, n’est-ce pas cette condescendance de classe (pour reprendre une expression formulée par Karim Hammou[1]) qui s’exprime en sous-main ? La Une de Charlie à l’occasion du changement d’heure était assez significative : l’harceleur de rue ne peut qu’être un jeune de cité, un peu voyou, un peu désoeuvré, mais surtout cultivé au rap exclusivement. Rapport de cause à effet, écouter du rap rendrait misogyne. Bien sûr…
http://surunsonrap.hypotheses.org/
Il suffit pourtant de faire un petit tour sur le site Madame Rap pour voir combien de femmes participent au mouvement. Eloïse Bouton, fondatrice du site, ne cesse de le répéter à longueur de conférences et d’interventions : le rap n’est pas plus misogyne que le reste de la société, voire moins. Cette culture inclusive dès ses premiers instants reste très méconnue du grand public faute d’intérêt réel des médias qui n’en traitent que la surface. Ne se résumant pas aux ventes et succès médias, ce courant a aussi réussi le coup de force de se passer des maisons de disques et des distributeurs classiques pour surfer sur la vague des réseaux sociaux justement. L’exemple PNL vient contredire des années de stratégies commerciales et de communication classiques. Nous y voilà, le rap se joue du système, c’est même dans ses fondements, alors forcément il dérange. Loin d’être dans la reproduction sociale d’héritiers en héritiers, il permet à des jeunes issus des classes les plus pauvres (donc perçues comme les plus dangereuses) de se retrouver à la tête d’entreprise dont les modèles économiques sont à la fois originaux et efficaces. https://www.lexpress.fr/culture/musique/booba-soprano-damso-pnl-jul-niska-nouveaux-rappeurs-de-force-dans-la-musique_1972830.html
Ce n’est pas nouveau, le rap dérange. Pire, cela fait partie de ses fondements de déranger, il gratte. Pas de penser sans choc, le confort et le contentement éteignent notre capacité réflexive. Depuis ses origines, le HipHop vise le dépassement des clivages et des oppositions, entre les arts, entre les classes sociales, entre les communautés. Il est le lieu de la réunion, du partage, de l’échange. Il est fondamentalement éducation populaire et non éducation populiste comme certains voudraient nous le faire croire. Loin de chercher à plaire au plus grand nombre en prônant l’abrutissement des masses (populisme), il prône et vise le développement des compétences de chacun au-delà des représentations classiques en la matière, considérant chacun comme capable a priori (éducation populaire). Toujours pointé du doigt par les médias comme une « sous culture »[2], c’est bien une nouvelle forme de paternalisme occidental qui s’exprime et une méconnaissance profonde des fondements culturels du mouvement sur un air post-colonial. Reconnaître que le HipHop est un mouvement culturel favorisant autant l’émancipation sociale que l’ouverture des possibles dans un élan de création collective, serait reconnaître, dans le même temps, que la culture classique, celle des « intellectuels », n’est pas la seule et unique. D’autres discours deviendraient alors possibles, d’autres façons de voir le monde où le pouvoir n’est pas forcément dans les mains des « gentlemen », des « puissants », des « installés socialement ». Ce pouvoir de dire, de faire, d’agir, de développer, de créer appartient à tous. « Nous sommes capables » indépendamment de nos sexuations, de nos origines, de nos difficultés scolaires, sociales… Tel est le slogan HipHop, qui aurait pu/dû être celui de la République si elle se voulait vraiment inclusive justement. Sauf que loin de voir ses propres dérives que précisément beaucoup de textes de rap dénoncent, mieux vaut faire du rap une dérive à part entière… Retournement s’il en est, torsion logique, qui opère très efficacement. Même procédé qu’avec les réseaux sociaux, même torsion qu’avec la question des violences sexuelles. A croire que lorsque des mouvements qui échappent au pouvoir des faiseurs de tendance et de pensée se développent et s’imposent jusqu’à devenir incontournables, ils doivent nécessairement être décriés… De la liberté d’expression d’accord, mais à condition qu’elle ne remette pas en cause les acquis du système ?
http://lebonson.org/2016/03/09/une-critique-sociale-par-le-rap-francais-onvautmieuxqueca/
Le cas féminin en est un bon exemple d’ailleurs. Ici et là fleurissent des journées dédiées au rap féminin, recréant ainsi des oppositions qui n’ont pas lieu d’être. Déjà, la notion de rap féminin est un non-sens. Le rap est une discipline à part entière qui peut être portée par des hommes ou des femmes. Parler de rap féminin est déjà une manière de constituer un sous genre de la catégorie qui quelque part dessert la cause. Des hommes et des femmes font du rap, participent au mouvement HipHop sans pour autant que l’opposition entre hommes et femmes nécessitent d’être restaurer, même positivement. Bonne intention au départ, les femmes deviennent une minorité visible, suscitant intérêt et curiosité. Or, elles sont présentes dans le rap français depuis ses origines. J’en veux pour preuve, la compilation Lab’elles (1996)[3] qui réunissait déjà 15 artistes féminines, bien avant le succès commercial de Diam’s. Toutes n’ont pas persévéré dans le genre, mais n’en demeurent pas moins la preuve que le rap a toujours pu être conjugué au féminin. De Bam’s à Ste Strauz en passant par Lady Laistee ou K-Reen, les femmes ne sont pas en reste. Bien sûr, leur visibilité peut être questionnée et interrogée, mais est-ce du fait du milieu ou de la société capitaliste dans son ensemble ? La domination masculine va de pair avec la domination du capital, pas étonnant alors que la question se pose au niveau des majors. Sauf que les majors ne résument pas le rap, loin de là. Même d’ailleurs dans les majors, les femmes sont pléthores, beaucoup d’hommes/artistes sont « gérés » par des femmes, combien de textes écrits encore aujourd’hui par K-Reen, bref, les femmes ne sont pas absentes du milieu loin de là. Booba a choisi une femme pour manager sa carrière et ses artistes, Lino et Kery James sont aussi managés par des femmes pour ne citer qu’eux. Aussi, le HipHop ne se résume pas au rap, loin de là. Il est fait de la danse, du graffiti, du Djing, du beatbox. Les femmes y sont aussi présentes, parfois envers et contre tout, comme le rappelait la danseuse Kanti Schmidt. Autrement dit, le HipHop a toujours été émancipateur tant pour les hommes que les femmes. Par la danse HipHop, garçons et filles se retrouvent alors que jusqu’alors la danse était une activité exclusivement féminine. Quel autre mouvement peut proposer un tel exemple de retournement des représentations de genre ? Dans le Djing, une femme a remporté dans le silence le plus absolu, le championnat National Red Bull 3Style (DJ Emii) se sélectionnant ainsi pour le championnat mondial à Cracovie et ce, devant un parterre masculin.
https://www.redbull.com/fr-fr/red-bull-3style-finale-france-dj-emii.
Enfin, les hommes qui composent le mouvement ne sont pas tous à brûler sur l’autel de la prédation sexuelle et de la misogynie. Qu’ils soient virulents ou non dans leur propos vis-à-vis des femmes, cela n’induit pas forcément des comportements associés. C’est d’ailleurs ce que rappelle timidement Booba dans certains textes ou ce que s’évertue de rappeler Damso aux journalistes. Bien au contraire, certains rappeurs dénoncent même explicitement les violences faites aux femmes comme l’a fait récemment le jeune Vin’s (25 ans) dans le titre #meetoo, Swift Guad dans Hématome, Nakk Mendosa dans Elodie, Melan dans Princesse, Furax et Scylla dans Les poissons morts, Georgio dans Svetlana et Maïakovski et bien d’autres. Sauf que loin de mettre ces initiatives en avant, c’est souvent les « petites affaires » et autres clichés qui prennent le dessus. La liturgie raciste est bien trop souvent présente en sous-texte, avec son relent de paternalisme, de refus d’émancipation pour les classes les moins aisées et surtout la suspicion permanente du coup de pub, afin de discréditer a priori toutes initiatives positives.
https://maze.fr/musique/03/2017/rap-saffranchit-genre/
Le mouvement est donc bien loin des clichés sur le genre. Lieu de diversité, de réflexion, d’évolution, de dialogue, le HipHop dans son ensemble et le rap en particulier n’est pas l’archétype du sexisme. Bien au contraire, beaucoup le dénonce en le caricaturant. Le rap rappelle combien la puissance d’agir de chacun est à prendre en compte et s’adresse à tout ceux qui se vivent comme bloqués par l’ascenseur social ou le plafond de verre… Forcement, les modes de communication initiée par ses acteurs viennent contredire les codes classiques du système médiatique. Le message n’est plus descendant mais ascendant. La base reprend le pouvoir et renvoie ainsi le paternalisme à son caractère obsolète. Les messages ne sont plus dictés d’en haut, l’autorité des puissants s’étiole légitimement à mesure que leurs exactions se dévoilent et notamment sur les femmes. Ce paternalisme incarné par l’art de vivre du « gentlemen », modèle de virilité et d’ascension sociale perd de son charisme. En France, les résistances au changement n’ont pas tardé à s’exprimer mettant en avant l’aveuglement social des défenseurs d’un système patriarcal à la fois rétrograde et dangereux. Sous couvert de libération sexuelle, le droit à disposer d’autrui serait revendiqué. Expression de violence s’il en est puisque le corps est le lieu de l’intégrité (tant physique que psychique, l’un et l’autre n’étant pas dissocié). Retournement de la violence, syndrôme de Stockholm ? Toujours est il que le système de domination masculine s’appuie sur le fait de disposer du corps d’autrui comme sa chose sous couvert d’une présupposé infériorité de genre, de race ou d’orientation sexuelle. Elle maintient la domination d’un système occido-centré qui érige le « gentlemen » en modèle du respect de la femme. Résultat, tous cherchent à situer le sexisme ailleurs afin de préserver le système en place : chez ces jeunes de banlieues incultes et si peu enclin au respect compte tenu de leurs « origines et croyances ». A croire que les religions considérées comme acceptables étaient ouvertes aux questions de sexualité et notamment féminine… Bref, sous couvert d’émancipation, c’est bien du racisme pur et dur qui s’exprime. La figure du harceleur ne peut qu’être la même que le voyou, le jeune de banlieue, le rappeur, bref l’autre, l’étranger. Finalement, le HipHop n’est il pas la voie royale de l’émancipation sociale, sexuelle, générationnelle ? N’est- il pas le lieu de la contestation du système qui permet justement d’évoquer ces injustices sociales, ces discriminations, ces violences ?
[1] Sociologue chargé de recherche au CNRS, rédacteur en chef de Sur un son Rap.
[2]
[2] Lire à ce sujet l’article d’Eloïse Bouton dans DaronMagazine « Le rap, art méprisé » - décembre 2017
[3] Production Barklay