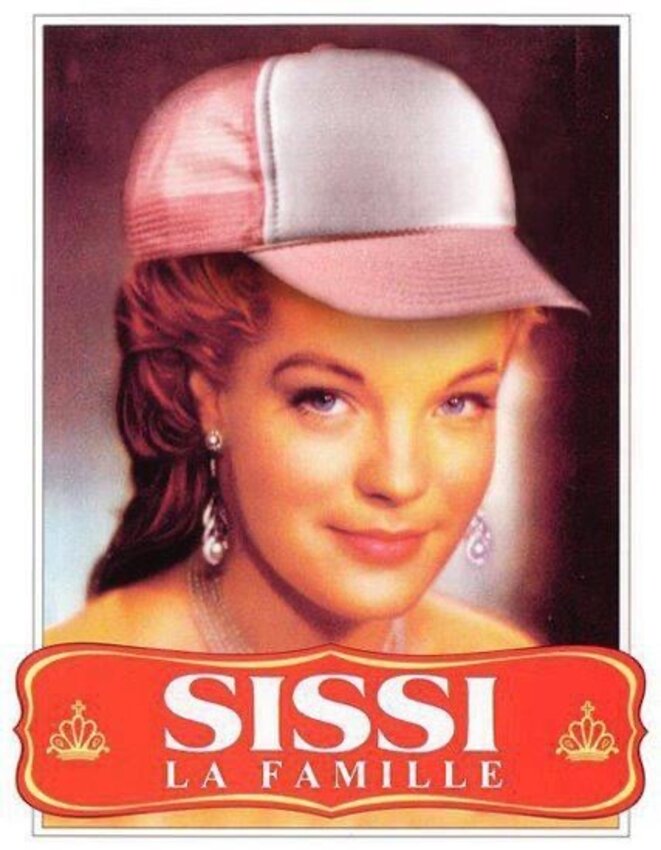Agrandissement : Illustration 1

Le brassage des cultures et des origines est le terreau indispensable de la République. Sans lui, le système devient sclérosé et s’enkyste. Il suppose de prendre en compte les effets du déracinement et les conséquences des ambivalences actuelles quant à l’intégration, mais est-ce suffisant ? Si le déracinement renvoie au parcours individuel et aux désillusions de chacun face aux conditions d’accueil qui font de l’intégration un vœu pieux tant que la société n’est pas réellement inclusive, alors la question est aussi de savoir comment favoriser ce mélange nécessaire à la République, celui sans lequel elle devient une coque vide ? De quoi se compose-t-il ? Parler de mélange, de brassage ou de métissage suppose de le mettre en perspective avec des relations entre des unités différentes. Il n’y a mélange, brassage ou métissage qu’à condition que les termes de la relation soient fondamentalement différents au départ et construisent ensemble du nouveau. C’est par la rencontre, le dialogue et même parfois l’opposition des points de vue que la République advient et non dans le repli sur soi. En soi, le principe républicain contrevient au communautarisme en considérant chaque citoyen en tant que sujet de droit et non dans ses caractéristiques de naissances, ses distinctions propres. Par conséquent, des droits spécifiques - selon les caractéristiques de naissance - n’ont pas lieu d’être et l’intérêt général est censé primé sur les intérêts individuels (et non les libertés). Or, s’observe régulièrement des détournements de ces principes que le rap français exprime régulièrement depuis ses débuts. Beaucoup se souviennent des morceaux collectifs comme 11.30 contre les lois racistes (1997) et 16.30 contre la censure (1999) ou des nombreuses compilations à thème ouvertement sociopolitique de cette époque comme par exemple : L432 (1997), Sachons dire Non (1998), la Révolution HipHop (1998), Plaidoiries (1998) ou encore Les militants (2002). La plupart de ces initiatives visent à se rassembler pour dénoncer une injustice sociale qui touche les quartiers populaires.
Critiquer et dénoncer les dérives sociétales est une chose, mais que propose le rap français pour y faire face ? Au-delà de l’indignation réelle sur des faits, les questions internes au mouvement étaient aussi passées au crible comme dans Sans faire couler le sang en 1998. Alors qu’une opposition frontale se marque entre la région parisienne et la province, Don Choa, Le Rat Luciano, Sat et Menzo du groupe marseillais la Fonky Family se joignent à Kadaz et Moz du groupe strasbourgeois La mixture et à Kertra d’Expression Direkt issu des Yvelines pour scander : « Unissons-nous sans faire couler le sang ». Sous l’impulsion de la FF qui connaît alors un succès national, l’objectif est d’attirer l’attention sur la manière dont le monde du rap (public compris) aurait une forme de responsabilité sur les enjeux sociaux en tant qu’il véhicule une certaine image de la banlieue, des jeunes, du milieu en lui-même. Dès l’introduction Don Choa pose le cadre : « Samedi soir/Pleine lune, les pompiers flippent/Des bagarres/Du sang sur le trottoir/Devant une soirée rap/Tous les bavards/Et les flics rappliquent/Viennent voir vite/Ça s'agite pour une banale histoire/Rien à foutre/Mais j'avais quand même l'espoir/Que le Hip Hop reste un univers de paix/Malheureusement comme partout/Beaucoup de langues de putes/Pas assez de respect ». Le HipHop n’est pas exempt de dérives potentielles et chacun en porte une part de responsabilité, tant les MC que le public, comme l’explique Kertra qui s’adresse lui directement à « ceux qui veulent la jouer/Foutre leur bordel dans mes concerts » pour les tourner finalement en ridicule : « Qui veut la sèremi, finira par faire la siesta ». Nécessaire de faire amende honorable, de regarder authentiquement nos parts de responsabilité dans la crispation sociale actuelle. Le constat est glaçant tant que la violence prône dans les concerts : « c’est trop con/Les médias font de l’intox/Le HipHop passe pour un con/Assez de filles qui crient/De salles qui ferment/On va finir par s’griller/Les flics et les fachos sont contents de nous voir éparpillés ». L’enjeu est bel et bien là. L'image que le milieu lui-même véhicule n'est pas seulement le fruit d'une manipulation médiatique mais aussi le résultat de ses difficultés à dépasser les oppositions et les frontières imaginaires qu'il s'est lui-même construites. Tel est le mobile premier du HipHop : le dépassement pour aller à la rencontre d’autrui. Dépassement de soi, de ses représentations mais aussi de ses vieux démons.
En 2001, Salif réitérait l’appel avec Tous ensemble. Ce rappeur de Boulogne alors âgé de 20 ans et son acolyte Exs lancent un appel à l’unité dans le combat non plus pour nettoyer dans les rangs mais pour renverser la tendance sociétale : « Vas-y sans hésiter, défends tes idées/Rendez-vous sur les Champs-Élysées ». Souvenons-nous qu’à l’époque, les manifestations contre la Loi Allègre font apparaître le phénomène des « casseurs » issus de banlieues parisiennes. Salif reprend alors à son compte cette nouvelle construction du jeune de banlieue inconscient et violent gratuitement pour lui donner un caractère plus politique que les médias voudraient alors le faire croire. La violence n’est pas gratuite, elle vise l’égalité sociale, mais aussi et surtout la reconnaissance de son identité qui ne mérite pas d’être dissimulée, mais revendiquée : « Sans t’déguiser, c’est vrai, oublies les cagoules et les capuches ». Pire, si cette violence trouve des points de convergence, alors elle peut mettre sur la voie d’une révolution réelle, car le contre-pouvoir que représente la jeunesse, l’impact et l’essor que connaît le mouvement laissent entrevoir une réelle possibilité d’action collective et « si on veut contrôler Paris/Tu sais que ce sera tous ensemble ». Les jeunes font peur non pas en tant que tels, mais parce qu’ils ont le pouvoir. Ils sont le pouvoir et Salif l’a bien saisi comme il le rappelle dans le refrain qui sonne comme un slogan de manif détourné : « On est tous ensemble, du Nord au Sud de l’Est à l’Ouest/On est tous ensemble, pour tous ces gens que l’Etat laisse/On est tous ensemble, tous ensemble/Tous ensemble ouais ! ». Le pouvoir institutionnel n’a qu’à bien se tenir, la Révolution HipHop est en marche et elle renverse les cartes.
En 2007, c’est la compilation Ecoute la rue Marianne qui vient interroger directement la République sur sa responsabilité quant aux violences urbaines. Suite aux émeutes de novembre 2005, la multiplication des violences policières (et notamment l’affaire de Zied et Bouna) et la stigmatisation grandissante des jeunes de banlieue, plusieurs artistes répondent à l’appel pour construire cette action collective. Là encore, le dépassement des clivages internes aura été nécessaire pour favoriser le dialogue et la mise en perspective des points de vue. Chaque titre personnifie la figure de Marianne pour lui faire jouer son propre rôle dans l’Histoire à partir de ces petites histoires. Le fil rouge est d’appeler la République à elle-même, à sa responsabilité dans les divisions opérées en son sein, les difficultés d’intégration et problématique de déracinement. Passi dans Marianne et Mamadou, lui rappelle que l’immigration n’est pas sans lien avec la colonisation et que « Marianne doit composer avec Mamadou » car elle n’a pas vraiment la possibilité de faire autrement compte tenu des liens qui les unissent (sur le modèle d’un mariage dont on peut interroger le consentement des deux parties). « À un moment ça semblait beau leur histoire d'amour/Mamadou a même servi le drapeau, les tambours sous Pompidou/Ils ont reconnu Dom et Tom leur enfant des derniers jours/Pom délaissé, repartit sur la mère patrie/Porté par un rêve de liberté et d'Afrique unie/Mais un roi en République bananière est esclave aussi/La réalité l'emporte, c'est le poids historique des colonies. » Il y a nécessité à ce que la République se souvienne de la réalité de ce qui l’unit à l’Afrique, à ses propres enfants dont ceux issus de l’immigration. Si elle perpétue la stigmatisation, c’est elle-même qu’elle dénie, qu’elle renie, ainsi que ses principes et ses valeurs qu’elle dévalue. La marginalisation des jeunes issus de l’immigration est une double peine qui va à l’encontre de l’idée républicaine comme s’efforce de le rappeler toute la compilation, dont Passi qui s’inquiète puisque « tant sont tombés dans les fosses, tombés sous les clichés/C’est comme si nos futures générations allaient encore vivre le fouet ». Si le dialogue se rompt entre Marianne et les enfants de Mamadou, alors c’est la violence qui reviendra nécessairement car le silence opposé à l’interpellation est une véritable violence. Sans possibilité de dialogue, chacun se repli sur soi, campe sur ses positions faute de pouvoir envisager l’altérité de manière positive. La rencontre devient difficile car elle suppose une ouverture à ce qui n’est pas moi, à l’Autre. Sans cette ouverture, autrui devient menaçant et c’est la concurrence qui vient remplacer la rencontre. Seul le dialogue prenant en compte l’ensemble des points de vue exprimés de manière équivalente, évite les phénomènes de repli sur soi et de mise en concurrence des individus et des cultures.
Pourtant en 2015, Lino et Dokou s’interrogeaient toujours dans Fautes de français sur la possibilité même du dialogue entre les classes, les générations, les franges de la population. Les années passent et il semble de plus en plus loin ce dialogue nécessaire au sentiment démocratique, ce dialogue qui permet le respect de la dignité de chacun en lui laissant la parole, la voix. Rappelant que ce dialogue est au cœur de l’idéal républicain, ils constatent qu’il est vicié dès le départ car la rencontre est déjà faussée : « comment tu veux qu’on s’comprenne quand c’est TF1 qui fait les présentations ? ». Chacun arrive avec une représentation prédéfinie de l’autre qui empêche nécessairement la rencontre authentique qui suppose a minima d’être surpris par l’autre. Cette surprise est empêchée par les clichés et les différentes stigmatisations que renforcent les médias. Si la République délègue aux publicitaires le soin de favoriser le dialogue en son sein, force est de se rendre à l’évidence qu’elle perd la main. Or, « partout la crise a besoin de bouc émissaire », car l’économie actuelle s’inscrit dans un système de concurrence globalisée qui favorise l’escalade des oppositions : « Conflit de civilisations, à qui profite le crime ? ». Si les principes idéologiques deviennent subsidiaires face aux principes économiques, alors c’est la rentabilité qui prend le pas sur l’idéal du vivre ensemble et comme le rappelle Lino, difficile de penser au creux de cette inversion : « La raison manque à l’appel, on sait même plus qui a raison, qui a tort (…) Nos vies s’conjugent, les cultures s’entrechoquent ». Loin de voir comment soutenir le vivre ensemble à partir du brassage et de la rencontre entre des termes différents, c’est le conflit qui est prôné et la mise en concurrence des individus eux-mêmes dans tous les pans de la société.
Cette compétition entre les individus et les genres est toujours un enjeu social comme au sein du rap français. Bien que la compétition ait toujours été une des valeurs du HipHop dans son ensemble dans une perspective d’émulation collective et non d’exclusion, elle devient aujourd’hui le lieu de la catégorisation, du jugement de valeur et de la remise en question permanente de l’autre. Chacun questionne le succès de l’autre car le rap est désormais devenu un enjeu économique réel. Loin de voir la confusion entre le qualitatif et le quantitatif à l’oeuvre, les débats se corsent, chacun campe sur des positions aussi erronées les unes que les autres puisqu’elles ne traitent pas du même plan. La valeur économique d’un artiste tient au nombre de ventes qu’il fait et au nombre de vues sur les réseaux. Forcément, c’est à partir de ces éléments que les producteurs (qui inscrivent leur travail dans une perspective économique) choisissent des « produits » qu’ils vont financer ou non. En revanche, la valeur artistique d’un « produit » tient à la manière dont il touche ou non son public (qui peut se traduire par des vues ou non car certains font peu de clips, mais beaucoup de scènes par exemple), à son travail, son talent d’écriture, ses choix artistiques. Or, il semble que le nombre de vues, de clics, de ventes prennent le pas sur la valeur artistique. Cette confusion entre valeur économique et valeur artistique (qui n’est pas propre au rap, mais à l’ensemble du marché de l’art) vient empêcher le dialogue et donc le vivre ensemble et recrée des niches qui font le lit du communautarisme.
Quand la logique économique suppose de voir la rentabilité à court terme, la logique artistique prend du temps. La création suppose de s’inscrire hors temps, hors rentabilité, hors contingence matérielle. Il y a donc opposition fondamentale entre l’une et l’autre et pourtant, certains parviennent à les faire aller ensemble. Pour ce faire, encore faut-il garder à l’esprit la distinction pour ne pas se perdre dans les affres de l’une et de l’autre et donc de rester vigilant quant aux sirènes du succès, ne pas se réduire au produit que la logique économique façonne. C’est notamment ce que Josman, jeune rappeur de Vierzon âgé de 23 ans, évoque dans Vanille en 2017 : « Dis-moi comment on pouvait construire une relation de qualité/Quand personne veut d'la solidité, tout l'monde veut d'la quantité/Pas d'identité, pas non plus de personnalité/Ils veulent tous en dev'nir une à tout prix même sans qualité/Même sans qualification, à cause de l'éducation/Génération rien pour l'honneur, tout pour la réputation/Donc j'me remets en question, j'fais face à mes accusations. » Conscient des dérives de son époque, il cherche à trouver sa voie en dehors des clichés qui lui collent à la peau (tant en tant que rappeur, que jeune, que noir) : « Tout l'monde a l'air content, on est là/on accepte et on consent/Non, j'suis pas parfait, j'suis pas tout blanc, au moins j'suis conscient ». Est-ce à dire avec Josman que le repli serait le salut ? « Le silence parle beaucoup, ferme ta gueule pour le bien d'autrui (yeah, yeah, yeah)/J'arrive plus à pioncer, le silence fait trop d'bruit (yeah, yeah, yeah) ». Mais si le refus du dialogue est l’issue, alors c’est aussi l’esprit HipHop qui se perd.
Peace, Love and Unity était à la base de la Zulu Nation : paix entre les communautés justement, amour d’autrui et l’unité au sein du mouvement. Rien à voir avec la logique économique, ni avec une guerre entre des styles, des quartiers, des générations, des régions… encore moins entre les sexes. La culture HipHop depuis son origine appelle le mélange, l’unité, la rencontre et le dialogue et le dépassement de soi. Elle invite à la réflexion sur les injustices sociales et les différentes formes d’exclusion. Or, il semble qu’aujourd’hui, c’est en son sein que le dialogue devient difficile à en croire la nature des débats actuels sur les sites spécialisés. Néanmoins, des initiatives résistent et demeurent afin de ne pas faire perdre de vue la dimension collective et unitaire du genre, comme le fait chaque année la Scred Connexion pour son festival qui se tiendra les 19, 20 et 21 janvier 2018 au New Morning pour la troisième édition. Ce festival réunit des artistes francophones (français, belges, suisses), hommes et femmes pour proposer un plateau indépendant dans un esprit HipHop alliant autant le Djing, le graffiti, le rap et des éléments de transmission de l’histoire de la culture à partir d’un nombre important d’événements sur ces trois jours.