
Agrandissement : Illustration 1

« Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon ? Eh bien ! Nous allons vous expliquer ce que c’est. Ce sont des individus qui n’ont aucune dignité, qui n’ont aucune morale, qui n’ont aucune personnalité, mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l’indépendance et d’autres continuent aujourd’hui à nous trahir au profit de leurs maîtres. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l’Afrique, à aider le maître à piller l’Afrique », Capitaine Ibrahim Traoré, extrait du discours au premier sommet des Chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel ce samedi 6 juillet 2024[1]
« L’impérialisme postcolonial n’est pas l’impérialisme qui viendrait après la colonisation. Il est l’impérialisme noir, l’impérialisme invisible, de la Race ou de la Bête, c’est‑à‑dire de la valeur et de la libido, de l’Argent et du Sexe. Il est le point aveugle que partagent la théorie postcoloniale et ses contempteurs. »
Joseph Tonda, in : L'impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Karthala, 2015.
Depuis septembre 2022, à la faveur d’un coup d’État, le capitaine Ibrahim Traoré s’est imposé comme la figure d’un processus politique inédit.
Dans un pays miné par l’instabilité, la violence djihadiste et les héritages néocoloniaux, il a recentré le discours sur la souveraineté populaire, l’action collective et la transformation des mentalités. Plus qu’un simple changement de régime, c’est une révolution silencieuse – précaire mais puissante – qui s’esquisse. Les médias occidentaux peinent à en saisir la portée, prisonniers d’une double grille de lecture : d’un côté, l’analyse sécuritaire et géopolitique qui réduit le Burkina à une zone de bascule de l’influence française vers celle de la Russie ; de l’autre, l’imaginaire postcolonial qui juge toute expérience politique africaine à l’aune des normes libérales occidentales.
Cette approche occulte les dynamiques populaires, la réinvention citoyenne et les expérimentations locales en cours. Pour comprendre la singularité du processus burkinabè, il faut élargir le cadre théorique. Dans Peau noire, masques blancs, Frantz Fanon décrivait l’aliénation coloniale comme une mutilation intérieure : le colonisé en venait à désirer l’Autre et à mesurer sa valeur selon ses normes. Joseph Tonda, dans L’impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, a prolongé cette réflexion en voyant l’Occident comme une puissance ensorceleuse : un régime d’images et d’objets – luxe, publicité, technologies, modes – qui capte le désir et formate l’imaginaire.
La domination devient alors d’autant plus efficace qu’elle est intériorisée et reproduite par ceux qui en sont victimes. Dans ce cadre, la révolution burkinabè apparaît comme un double mouvement : lutte pour la souveraineté matérielle et reconquête de l’imaginaire. Ibrahim Traoré ne s’attaque pas seulement aux puissances étrangères ; il dénonce aussi les élites locales fascinées par l’Occident, qu’il qualifie d’« esclaves de salon ». En relayant les signes extérieurs de la modernité importée – villas, voitures de luxe, costumes, smartphones – ces élites prolongent l’emprise coloniale et enferment l’Afrique dans le rêve d’Autrui.
La révolution vise donc à délégitimer ces relais intérieurs, à désactiver la magie des objets-fétiches et à réhabiliter les langues, savoirs et pratiques populaires comme sources d’un imaginaire autonome. Dans la continuité de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré propose une pédagogie politique fondée sur la dignité, la souveraineté et la mobilisation collective. Mais cette révolution demeure fragile, exposée à des contradictions : entre l’idéalisation de la figure du leader et l’ancrage populaire, entre le rejet des cadres occidentaux et l’invention encore incertaine de nouvelles formes institutionnelles.
C’est pourtant dans cette tension que réside l’intérêt majeur de l’expérience burkinabè : l’esquisse d’un horizon postcolonial où l’émancipation passe autant par la reconquête matérielle que par la libération des imaginaires.
La situation appelle prudence et vigilance. La récente criminalisation de l’homosexualité, présentée comme une défense des « valeurs familiales traditionnelles », témoigne d’une orientation restrictive[1]. Elle s’accompagne d’une limitation des libertés d’expression et d’information, pressions sur les journalistes et opposants, expulsions d’organisations internationales et violences dans le cadre de la guerre contre-insurrectionnelle.
En parallèle, on observe une réaffirmation populaire de souveraineté, portée par une partie de la jeunesse et des mouvements sociaux. C’est dans ce jeu de tensions et de contradictions que le Burkina Faso apparaît aujourd’hui comme un espace d’expérimentation politique, où s’esquisse – encore de façon incertaine – la possibilité d’une révolution africaine contemporaine.
Traoré et l’ombre portée de Sankara
« IBRAHIM TRAORÉ est vraiment la réincarnation de Thomas Sankara. Parfois, je me surprends à me demander : Où était-il jusqu’à maintenant ? » - Témoignage de Koffi Anani
Ibrahim Traoré revendique explicitement l’héritage de Thomas Sankara. Dans ses discours, il cite régulièrement son prédécesseur, reprend des slogans emblématiques – « consommons ce que nous produisons », « la patrie ou la mort, nous vaincrons » – et relance des politiques de souveraineté économique, de lutte contre la corruption et d’autonomie alimentaire. Il y ajoute une rhétorique plus contemporaine, visant les « esclaves de salon », ces élites accusées de complicité avec la domination occidentale.
Cette posture critique, qui conjugue engagement panafricain, dénonciation de l’ordre mondial et proximité affichée avec les plus démunis, réactive l’esprit sankariste sous une forme adaptée aux défis du présent. La réappropriation de cette mémoire révolutionnaire s’incarne également dans des gestes symboliques forts : construction d’un mausolée, élévation de Sankara au rang de héros national, réactivation des références panafricanistes.
Ces dispositifs visent à ranimer une mémoire militante capable de mobiliser la jeunesse et de souder la nation autour d’un récit commun.
Ce lien symbolique est historiquement cohérent : Sankara comme Traoré inscrivent leur action dans une volonté de transformation radicale de l’État et de la société. Mais il relève aussi d’une stratégie politique. En se plaçant dans l’ombre de Sankara, Traoré s’adosse à une légitimité morale et émotionnelle qui compense la fragilité de son propre pouvoir. Le sankarisme de Traoré, davantage qu’une fidélité doctrinale, fonctionne ainsi comme un outil narratif destiné à unir la nation autour d’un imaginaire révolutionnaire tout en neutralisant ses opposants.
Cette filiation se trouve néanmoins enrichie par d’autres références, implicites ou explicites : Paulo Freire, Che Guevara, les expériences cubaines d’éducation populaire et d’économie collectivisée. Autant de sources qui dessinent les contours d’un projet révolutionnaire entendu aussi comme projet d’apprentissage collectif.
Apprendre en produisant : Faso Mêbo et les chantiers coopératifs
« Le chef de l’Etat (le Capitaine Ibrahim Traoré) l’a toujours dit. C’est par nous-mêmes, par nos efforts, par notre génie, que nous allons relever les défis du Burkina Faso », Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre, à la tête d'une délégation gouvernementale qui a fabriqué et posé des pavés ce 31 mai 2025 à Ouagadougou.
Dès ses premiers gestes, Ibrahim Traoré a frappé l’opinion publique : mobilisation des transporteurs pour ravitailler les zones affamées, dénonciation de la flambée des prix des camions, appels directs à la population. Il est apparu comme un président à l’écoute, au contact, soucieux des réalités quotidiennes. Il connaît la misère des zones rurales, l’absence d’infrastructures, la vulnérabilité des jeunes.
Ce pragmatisme engagé devient un geste éducatif. En incarnant un autre style de pouvoir – direct, humble, solidaire – Ibrahim Traoré produit une éthique de la présence : il réhabilite la politique comme service public, non comme privilège. Ce modèle a une portée pédagogique majeure : il enseigne la proximité, la responsabilité et l'action collective comme fondement de la souveraineté populaire.
« Ce qui m’a marqué, c’est que, quelques jours après avoir lancé un appel aux transporteurs, il dénonçait déjà la flambée des prix de location des camions. Je me suis demandé : comment un président peut-il s'intéresser au prix des camions ? » - Témoignage de Koffi Anani
Cette attention portée aux détails du quotidien manifeste un style de gouvernance enraciné.
Les premières politiques impulsées par Ibrahim Traoré s’inscrivent dans une logique de mobilisation populaire : effort de guerre, autogestion, agriculture nationale, embellissement urbain (Faso Mêbo), participation citoyenne aux chantiers publics. L’idée d’un peuple acteur de son destin se concrétise dans des gestes collectifs qui deviennent autant d’espaces d’apprentissage : apprendre à produire, à organiser, à coopérer.
On retrouve ici l’inspiration des brigades de travail cubaines ou des chantiers de jeunesse révolutionnaires. Le travail volontaire, réhabilité, est vécu comme un acte de reconstruction nationale. Che Guevara voyait dans ce travail une école de conscience socialiste. De manière comparable, Ibrahim Traoré transforme les actions de terrain en processus d’éducation civique.
« Il connaît la réalité des zones rurales, où manquent routes, eau potable, infrastructures de base. Là où les populations sont abandonnées, et où certains jeunes, faute d’alternatives, se radicalisent. » - Témoignage de Koffi Anani
Cette connaissance du terrain inspire une pédagogie connectée aux réalités sociales et territoriales.
L’enseignement burkinabè, encore marqué par l’héritage colonial, connaît aujourd’hui une demande de refondation. Le souvenir de la réforme éducative de 1984 portée par Sankara revient en force. Cette réforme visait à construire une école du peuple, décolonisée, intégrée à l’environnement local, avec des écoles-champs, des enseignants formés dans les villages, une réduction des frais, une gestion communautaire et une production scolaire endogène.
Aujourd’hui, cette ambition refait surface. Dans plusieurs régions, des projets d’écoles liés à l’agriculture ou à l’artisanat se multiplient. Les savoirs endogènes, les langues nationales, la mémoire panafricaine, la critique de la dépendance sont remis au centre. Cette réorientation pédagogique que Paulo Freire n’aurait pas reniée : l’éducation comme dialogue critique entre savoirs populaires et réflexion politique, dans une perspective d’émancipation.
L'Initiative présidentielle "Faso Mêbo" (« Construisons le Faso » en mooré), officiellement lancée le 31 mai 2025 par le président Ibrahim Traoré, vise à promouvoir la mobilisation citoyenne. Inscrite dans une logique d’autonomie, de coopération et de transformation durable du territoire, elle incarne une dynamique originale de souveraineté productive. Conçu comme un réseau d’entreprises collectives, le programme associe jeunes, anciens combattants, commerçants et travailleurs du secteur public et privé autour de chantiers de construction et de production locale.
Loin de se réduire à une opération de travaux publics, Faso Mêbo fonctionne comme un espace de formation intégrée, où l’on apprend en fabriquant des pavés, en organisant des chantiers et en gérant collectivement les ressources. Cette pédagogie de l’action transforme rues, quartiers et unités de production en autant d’« écoles vivantes », où se conjuguent apprentissage, entraide et appropriation du développement.
Les impacts sont déjà visibles : urbanisme participatif, grâce à la modernisation des infrastructures portée par un engagement collectif renforçant le sentiment d’appartenance ; transformation des mentalités, puisque les citoyens deviennent artisans de leur cadre de vie, dépassant la simple logique de prestation ; enfin, embellissement et salubrité, l’initiative s’orientant aussi vers la propreté, l’esthétique et l’organisation collective de l’espace urbain.

Agrandissement : Illustration 2

La contribution sonnante et trébuchante des auteurs de cet article à l’opération « Faso Mêbo »
Rompre l’idéalisation de l’Occident : de l’éblouissement à la révolution
Dans L’impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Joseph Tonda décrit l’Occident comme une puissance non seulement politique et économique, mais aussi ensorceleuse : un régime d’images, d’objets et de symboles qui capte le désir et formate l’imaginaire. Les « éblouissements » désignent ces forces de séduction - publicité, luxe, technologies, modes - qui incitent à imiter le maître et à intégrer ses codes comme des évidences universelles.
La domination devient d’autant plus efficace qu’elle est intériorisée : le colonisé en vient à reproduire lui-même, souvent à son insu, les logiques qui le maintiennent dans la subordination. Cette analyse entre en résonance directe avec celle de Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs.
Fanon montrait déjà que l’aliénation coloniale n’est pas seulement une contrainte extérieure mais un habitus intériorisé : le colonisé désire l’Autre, revêt ses « masques », mesure sa valeur à l’aune des normes coloniales. Ce que Fanon décrit comme une mutilation de l’être correspond à ce que Tonda appelle la « société des éblouissements » : un monde où la domination s’exerce moins par la violence brute que par la capture du regard et du désir. Mais cette situation ne relève pas seulement de la psychologie coloniale : elle définit ce que Tonda nomme l’Afrodystopie.
Les sociétés africaines et afrodescendantes vivent en effet « dans le rêve d’Autrui » : celui du capital, de l’État, de la technique et de l’Occident, qui transforment les sujets en images vivantes de leur propre fantasme. L’Afrodystopie est ce monde fantôme du « continent noir » où l’on ne rêve pas ses propres rêves mais ceux de l’Argent et de la domination. Or, cette capture ne produit pas que des victimes passives : elle engendre aussi des relais actifs de la domination.
C’est ce que dénonce Ibrahim Traoré lorsqu’il fustige les « esclaves de salon », ces élites qui, fascinées par le maître, pillent leurs propres pays, trahissent leurs frères et servent l’Occident pour préserver leurs privilèges. C’est ici que l’Afrodystopie rencontre le projet révolutionnaire de figures comme Thomas Sankara et Ibrahim Traoré. L’un et l’autre affirment que rompre avec l’idéalisation de l’Occident ne suffit pas : il faut inventer un autre horizon, une autre temporalité, une autre économie. Sankara appelait à l’autonomie productive, à l’auto-suffisance alimentaire, à la libération des femmes, à la désaliénation culturelle. Traoré, dans la continuité, proclame la nécessité de « refuser le rêve du maître », de combattre les élites complices, et de redonner au peuple la capacité d’imaginer son avenir en dehors de l’ordre impérial.
Rompre avec l’idéalisation de l’Occident n’est donc pas seulement un geste psychique (déséblouissement, désaliénement) : c’est un acte révolutionnaire, qui vise à défaire les structures de la dépendance et à arracher l’Afrique à l’Afrodystopie.
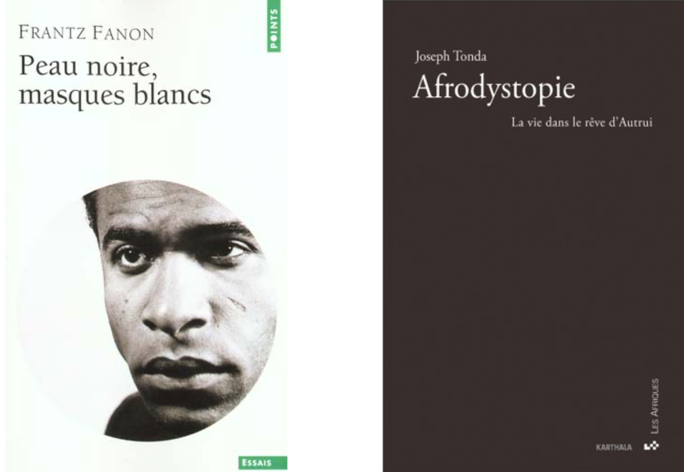
Agrandissement : Illustration 3
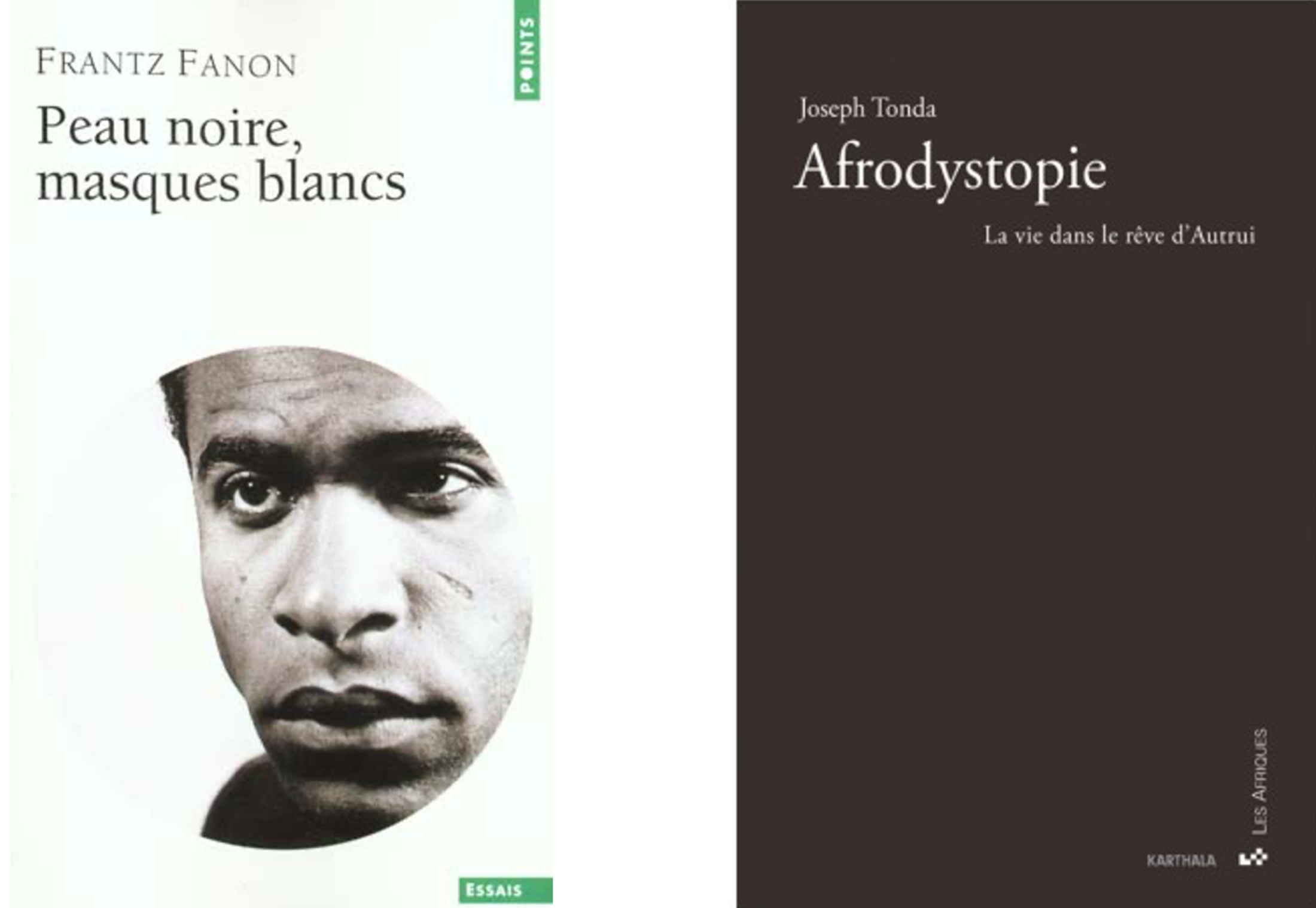
En ce sens, le « déséblouissement » tondien, le « désaliénement » fanonien et la dénonciation des « esclaves de salon » par Traoré convergent dans une même direction : refuser de vivre dans le rêve d’Autrui pour commencer à rêver par soi-même, comme le proposaient déjà Sankara et, aujourd’hui, Traoré.
Or, les élites locales visées par Ibrahim Traoré - ces « esclaves de salon » - ne sont pas de simples collaborateurs de circonstance : elles constituent le maillage interne qui permet à l’imaginaire dystopique de perdurer. En relayant les valeurs, les normes et les institutions héritées de la colonisation, elles assurent la reproduction d’un ordre où l’Afrique demeure prisonnière du rêve d’Autrui.
Ces élites sont les agents d'entretiens de l'Afrodystopie : elles gèrent la continuité des dispositifs économiques, politiques et culturels qui prolongent l’exploitation coloniale sous la forme capitaliste et néocoloniale. C’est pourquoi, dans la perspective révolutionnaire de Sankara et de Traoré, la lutte n’est pas seulement dirigée contre l’Occident en tant que puissance extérieure, mais aussi - et surtout - contre ces cadres intérieurs de la domination, qui donnent consistance et légitimité à la dépendance. Rompre avec l’idéalisation de l’Occident implique donc de délégitimer ces relais internes, de briser leur pouvoir symbolique et matériel, et de réactiver la possibilité d’un imaginaire autonome.
Les objets-fétiches de l’Afrodystopie : Mercedes, villas, costumes et smartphones
L’Afrodystopie, telle que la pense Joseph Tonda, ne se limite pas à un système abstrait de domination : elle s’incarne dans une multitude d’objets concrets, devenus les fétiches de la modernité importée. Ces objets structurent l’imaginaire social, captent le désir et donnent à l’élite africaine le sentiment de participer au rêve d’Autrui.
La Mercedes, par exemple, est bien plus qu’un simple véhicule. Elle condense à elle seule la promesse de distinction, l’affiliation aux élites mondialisées et la rupture avec le peuple. Ses phares lumineux, dans l’imaginaire urbain, sont parfois associés à des récits cauchemardesques : voitures qui transforment les passants en porcs, ou qui aspirent la vitalité des corps pour nourrir les guerres occidentales. La voiture de luxe est ainsi le décor privilégié de la dystopie : instrument de prestige et instrument d’effroi.
La villa moderne fonctionne de la même manière. Protégée par des grilles, surmontée de barbelés, dotée de vitres teintées, elle isole ses occupants de la rue et du voisinage. Elle n’est pas seulement un lieu d’habitation mais un signe : elle matérialise la distance sociale, la frontière entre ceux qui « vivent dans le rêve » et ceux qui restent à l’extérieur. Dans ces espaces, le salon climatisé devient l’antichambre de l’Occident. Le costume-cravate et la langue française ou anglaise sont d’autres fétiches. Ils donnent à celui qui les porte une posture d’autorité, un habitus de respectabilité.
Mais ce vêtement, importé et imposé, a remplacé les habits traditionnels comme symboles de pouvoir. Il opère une conversion des corps : pour être reconnu, l’homme politique africain doit revêtir l’uniforme occidental, preuve que son autorité dérive encore d’ailleurs. Le whisky, le champagne et les mets importés complètent ce tableau. Ils signent l’accès à une jouissance codifiée par l’Occident, une consommation de prestige qui substitue au partage communautaire l’exhibition individuelle. La fête élitaire est ainsi toujours une fête d’imitation, un rituel d’appartenance au club des possédants globalisés.
Le smartphone de dernière génération est enfin devenu le fétiche contemporain par excellence. Objet de désir, signe de réussite, outil de connexion, il fascine d’autant plus qu’il semble contenir le monde entier dans sa surface lisse. Mais il est aussi une machine de dépendance, reliant son utilisateur aux flux d’images et de désirs produits ailleurs. Sa possession ne garantit pas l’autonomie, mais reproduit l’aliénation : il incarne à merveille ce « rêve d’Autrui » dont parle Tonda.
Ces objets, comme l’aurait noté Roland Barthes dans ses Mythologies, ne sont pas seulement des biens de consommation : ils sont des mythes. Ils transforment des rapports de domination en signes naturels de prestige et de réussite, effaçant l’histoire coloniale et capitaliste qui les a rendus possibles. La Mercedes, la villa ou le smartphone ne disent pas seulement « confort » ou « modernité » : ils racontent une fable idéologique, qui présente comme évidence universelle ce qui est en réalité la perpétuation d’une dépendance.
Là où Tonda parle d’« éblouissements », Barthes aurait vu des « mythologies » : des récits invisibles qui habillent la domination sous les traits du désir et de l’évidence. C’est précisément ce système que Thomas Sankara avait cherché à briser. En remplaçant les Mercedes des ministres par des Renault 4, il avait porté un coup direct à l’imaginaire de l’élite. Son geste symbolique visait à engourdir le rêve : désactiver le prestige des objets-fétiches, montrer qu’un dirigeant n’a pas besoin de s’asseoir dans la voiture du maître pour être digne.
Mais ce geste, précisément, lui fut fatal. En bloquant le rêve, Sankara a touché au cœur de l’Afrodystopie, ce qui revenait à miner les fondements mêmes de l’ordre postcolonial. Aujourd’hui, Ibrahim Traoré reprend ce flambeau lorsqu’il dénonce les « esclaves de salon ». En s’attaquant à l’élite qui vit entourée de ces fétiches - villas, voitures, costumes, smartphones - il pointe les cadres intérieurs de la domination : ceux qui permettent à la dystopie de perdurer en l’habillant des signes de la modernité.
Comme Sankara, il affirme que l’émancipation passe par le refus de ces fétiches et la reconquête d’un imaginaire autonome, nourri non plus des vitrines occidentales mais des aspirations populaires. Rompre avec l’idéalisation de l’Occident signifie donc rompre avec ses objets-fétiches. C’est défaire la magie des Mercedes et des villas, retrouver la dignité au-delà des costumes et des champagnes, et oser penser un futur qui ne soit plus alimenté par les flux d’images de l’Autre, mais par le rêve des peuples eux-mêmes.
Une révolution inachevée, un apprentissage en cours ?
« Tout est urgent, car la population a faim. » - Capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa première rencontre officielle avec les secrétaires des ministères, peu après son arrivée au pouvoir.
On refuse souvent au Burkina Faso la possibilité d’une révolution, car cela impliquerait de briser plusieurs certitudes solidement ancrées dans les imaginaires politiques occidentaux. Reconnaître un tel processus supposerait d’abord d’admettre qu’un pays africain, longtemps relégué au rang de périphérie instable, puisse devenir le centre d’une initiative historique autonome, portée par ses propres références et non dictée par une puissance extérieure.
Une telle reconnaissance heurterait l’héritage colonial et postcolonial qui a toujours assigné l’Afrique à un rôle d’objet, jamais de sujet, de l’histoire. Elle obligerait aussi à remettre en cause le dogme qui identifie la révolution au seul cadre démocratique libéral. Or, le régime de Traoré, issu d’un coup d’État militaire, échappe à cette grille : les médias et intellectuels occidentaux, attachés à ce modèle, peinent à concevoir qu’un processus émancipateur puisse émerger hors de leurs normes - alors même que l’histoire regorge d’exemples contraires, en Europe comme en Amérique latine.
De plus, réduire l’expérience burkinabè à un simple basculement géopolitique vers la Russie revient à nier la part d’initiative propre des acteurs locaux. Cette lecture perpétue l’idée que l’Afrique ne serait jamais qu’un pion sur l’échiquier mondial, incapable d’inventer ses propres règles. Enfin, accepter l’idée de révolution obligerait à prendre au sérieux la complexité du moment : reconnaître les avancées et innovations (mobilisation populaire, souveraineté culturelle, projets économiques endogènes) tout en analysant lucidement les contradictions internes qui - dans le discours occidental dominant - suffisent à disqualifier le processus dans son ensemble, au lieu d’être comprises comme les tensions inhérentes à toute transformation radicale.
C’est ici qu’un programme éducatif devient décisif. Non pas pour transmettre des savoirs techniques ou reproduire des modèles exogènes, mais pour cultiver une conscience critique capable de déchiffrer les mécanismes d’aliénation et de fascination. En travaillant sur les objets-fétiches - voitures de luxe, villas, costumes, smartphones - comme supports d’un imaginaire aliéné, l’éducation peut révéler comment ces signes participent à la perpétuation de l’Afrodystopie et de la dépendance capitaliste. Mais elle doit aussi ouvrir la voie à un autre imaginaire : valoriser les modèles endogènes de réussite, les langues et savoirs locaux, les pratiques de solidarité, et stimuler la créativité à travers l’écriture, les arts visuels, le théâtre, les projets collectifs.
Inspirée de Sankara et de Traoré, cette pédagogie du déséblouissement armerait symboliquement les nouvelles générations pour désactiver la magie des fétiches et inventer des formes de dignité et de liberté qui ne soient plus dictées par les vitrines occidentales, mais par les aspirations populaires elles-mêmes. Le Burkina Faso expérimente aujourd’hui une voie originale, centrée sur l’action populaire, la reconquête de la souveraineté et la réinvention d’une pédagogie sociale.
L’héritage de Sankara s’y conjugue avec les intuitions de Paulo Freire, les pratiques de Che Guevara et les aspirations d’une jeunesse en quête de dignité. Même si rien n’atteste que Sankara ait lu Freire, la parenté est frappante : tous deux placent l’éducation au cœur de la libération, non comme simple transmission de savoirs mais comme éveil critique des consciences. Chez l’un comme chez l’autre, apprendre est déjà agir : nommer le monde, c’est se donner la capacité de le transformer. Et comme le rappelait Thomas Sankara dans son Discours de la Révolution (Ouagadougou, 1983) : « L’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Il ne mérite que sa honte. »
Bernard Müller
[1] https://www.minute.bf/capitaine-ibrahim-traore-les-esclaves-de-salon-sont-toujours-prets-a-trahir-leurs-freres-pour-satisfaire-le-maitre/
[2] https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/burkina-faso/report-burkina-faso/?utm_source=chatgpt.com



