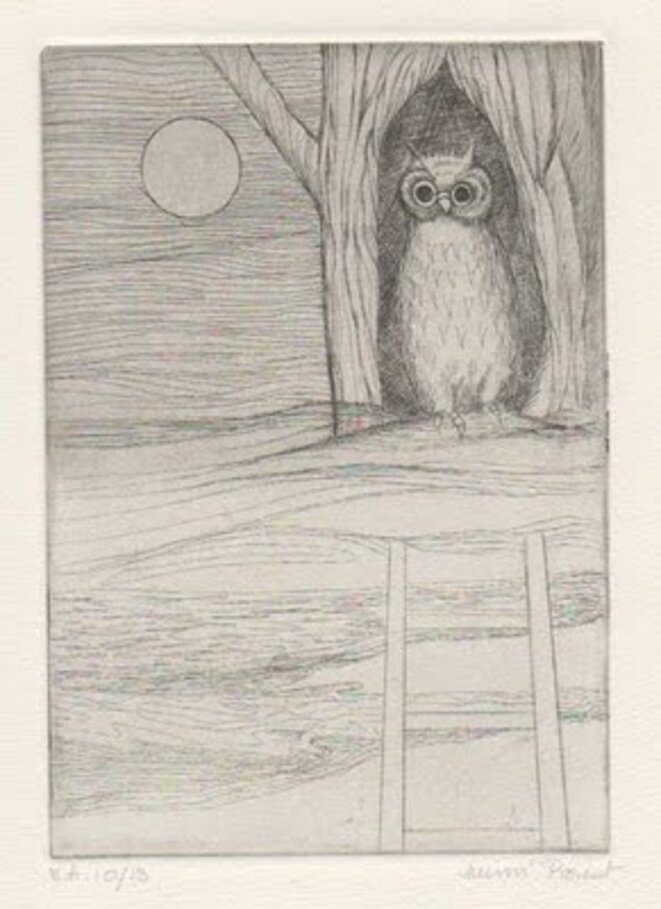Ce nouveau bulletin fait suite au précédent ; il a été suscité par certains commentaires et certains messages de lectrices et de lecteurs.
J’ai en effet appris qu’en aidant Soraya et son fils, j’avais commis ce qu’on appelle en France de manière apparemment informelle le « délit de solidarité », et qu’à celui-ci s’oppose, depuis juillet 2018, le « principe de fraternité » ; j’ai vu par ailleurs que ce principe de fraternité était l’objet et le sujet d’un certain nombre de discussions philosophiques et juridiques. Cela m’a conduit à m’interroger rétrospectivement sur la nature et le mobile de mon acte ainsi que sur le sens qu’il est possible de donner, de manière générale, à cette notion de fraternité.
Certes, la mention « traite d’êtres humains », qui est inscrite sur le bulletin n°2 de mon casier judiciaire, est scandaleusement erronée et la justice bulgare le sait très bien : en me condamnant à la peine minimum dont est passible ce délit de « traite d’êtres humains », elle a, de fait, explicitement signifié qu’elle ne m’assimilait en aucun cas à un passeur et implicitement reconnu la nature purement humanitaire ou en tout cas désintéressée, non lucrative, de mon acte. Seulement, il faut croire qu’elle n’avait aucun autre chef d’accusation sous la main…
Étant donné que je connaissais Soraya, la migrante afghane à qui j’ai porté secours, et surtout son frère, Bassir, et que c’est lui qui m’a demandé de les aider, c’est essentiellement par amitié que j’ai fait ce que j’ai fait. Cela dit, bien que n’étant pas du tout militant, j’aurais agi exactement de même avec une ou des personnes inconnues se trouvant dans une situation identique à celle de Soraya, et c’est dans cette perspective hypothétique que les notions de solidarité, d’humanité et de fraternité peuvent prendre tout leur sens.
La fraternité, pour s’en tenir à elle, est donc le troisième terme de la devise de la République française ; mais imagine-t-on un(e) Français(e) adresser la parole à un(e) de ses compatriotes en l’appelant « frère » ou « sœur » ? Dans certains pays, la fraternité n’est pas une devise républicaine ou nationale ; c’est en quelque sorte une conception, une doctrine, ou plus précisément l’application d’une conception ou d’une doctrine au niveau culturel et linguistique. Dans ces pays ainsi que dans certaines cultures, il est en effet remarquable et riche d’enseignement que le mot « frère » (ou « sœur ») soit employé pour s’adresser à une personne inconnue. Les Afghans utilisent en dari le mot « biyadâr » (ou plus rarement et à l’écrit « béradâr »), les Indiens le mot hindi « bhaiya », et, de manière plus générale, les arabo-musulmans le mot « khoya » ou « akhi » (« okhti » pour les femmes). Tous ces mots ont exactement la même signification, celle de « frère » (« mon frère » et « ma sœur » pour les deux derniers), et ils sont employés de manière quasi systématique quand on s’adresse à une personne plus jeune que soi ou du même âge.
À une personne plus âgée, les Afghans s’adressent en disant « oncle » (« kâkâ » ou « mâmâ », accompagné de la particule « djan », qui signifie « cher »), et les Indiens utilisent carrément et communément l’anglais « uncle » (« aunty » quand il s’agit d’une femme), accompagné de la particule de respect « dji ». On peut par ailleurs, en Afghanistan, s’adresser à une personne plus jeune ou du même âge en l’appelant aussi « cousin » ou « cousine » (« batché kâkâ/mâmâ »), et à une personne beaucoup plus âgée en lui disant « bâbâ » (ce qui signifie « père » ou « grand-père »).
Il s’agit là bien entendu, dans tous ces cas, d’un usage spontané de la langue, qui renvoie à une pratique collective et culturelle, et non d’une démarche personnelle, consciente et volontaire du locuteur. Celui-ci, en appelant son allocutaire « frère/sœur », « oncle/tante », etc., n’exprime aucun sentiment particulier et peut même, à la limite, être parfaitement indifférent et insensible à la situation éventuellement précaire ou misérable de cet allocutaire.
Quelle est donc la raison d’être de ces pratiques langagières, qui sont essentiellement présentes dans des pays de culture orientale et qu’on aurait tort de réduire, de manière hâtive, à une simple forme de politesse ? Certes, il s’agit de marquer, à chaque fois, si on veut, un certain respect ; mais, justement, sur quoi repose en dernière instance ce respect ? Il repose sur la reconnaissance tacite d’une même appartenance fondamentale du locuteur et de l’allocutaire à quelque chose qui leur est supérieur et qui les unit.
Quand je m’adresse à quelqu’un que je ne connais pas et que je n’ai jamais vu en l’appelant « frère », indépendamment de sa condition sociale, je reconnais que lui et moi avons une origine commune, en vertu de laquelle nous partageons exactement la même qualité, la même nature, la même essence. La fraternité n’est rien d’autre que la reconnaissance de cette communauté d’origine, qui est une façon d’inclure par avance et par principe autrui dans ce dont moi-même je pense faire partie, dans ce dont moi-même je pense n’être qu’une partie. Il ne s’agit donc pas d’un sentiment spécial pour tel ou tel individu ou telle ou telle catégorie d’individus, mais d’une sorte d’affection désintéressée et générale pour toute l’espèce humaine.
Le vieil adage selon lequel « je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » peut être considéré comme une expression assez juste de cette affection générale et désintéressée ; mais c’est dans le bouddhisme, me semble-t-il, qu’on en trouve la forme la plus poussée. La « karunâ » bouddhiste, qu’on traduit par « compassion universelle », est en effet, lorsqu’elle est bien comprise, cette bienveillance abstraite, globale, indifférenciée, qui s’étend à l’universalité des êtres, sans restriction (et non aux seuls êtres humains). Une telle bienveillance n’a rien à voir avec la sensibilité ; basée sur une théorie immuable de la nature des choses, elle est au contraire liée à une conception métaphysique.
On peut se demander quel est, dans ces conditions, le contraire de la fraternité. Ça ne peut pas être un sentiment (la peur ou la haine de l’autre, par exemple), puisque la fraternité, telle qu’elle a été définie à la lumière de certaines données de la culture ou plutôt de la civilisation orientale, se situe en dehors de la sphère sentimentale et de la sensibilité. Au niveau de la langue, on peut considérer que l’emploi de mots tels que « barbare » et « sauvage » révèle une attitude certes très peu fraternelle puisqu’on sait que, d’après leur étymologie, ces mots, adressés à autrui, consistent, en rejetant celui-ci dans l’animalité et dans la nature, à l’exclure de la civilisation et à lui refuser tout caractère humain. Mais, en toute logique, le contraire de la fraternité, ou bien son absence, ne peut se définir que par la négation de cette origine commune dont il a été question, par la négation de cette même appartenance, et, plus largement, par celle d’un principe supérieur et unificateur, quel qu’il soit. Cette négation porte un nom : c’est l’individualisme, au sujet duquel il suffit de rappeler qu’il est la caractéristique et le fléau de nos sociétés occidentales modernes.