Je m’apprête à chroniquer un ouvrage dont j’espérais depuis longtemps l’apparition. En effet, le livre de Vincent Tiberj, La droitisation française. Mythe et réalités. Comment citoyens et électeurs divergent (Paris : PUF, septembre 2024) propose une réponse à une question que je me pose depuis longtemps : comment se fait-il que si l’on regarde les grandes enquêtes portant sur les valeurs des Français et des Européens l’on ait l’impression que les sociétés européennes évoluent depuis des décennies vers plus d’ouverture, de tolérance, alors que, du point de vue de l’actualité de la vie politique envisagé sous l’angle des électeurs et encore plus des partis politiques, les forces et partis d’extrême-droite ne cessent de s’affirmer partout ?
Pour simplifier mon interrogation, comment se fait-il qu’alors que les Français sont (en moyenne) moins racistes, xénophobes, sexistes, homophobes, etc. qu’en 1974 ils votent massivement pour des partis d’extrême-droite (RN et dans une bien moindre mesure Reconquête en 2022 et en 2024) ? Pour tourner la chose de manière caustique, « On ne peut plus rien dire » (à propos des femmes, des homosexuels, des étrangers, etc.), rengaine bien connue de l’extrême-droite et d’une partie de la droite, mais, par contre, on ne se prive pas de voter fort à droite pour dire bien clairement qu’on devrait pouvoir avoir le droit de tout dire de nouveau, et éventuellement de tout faire.
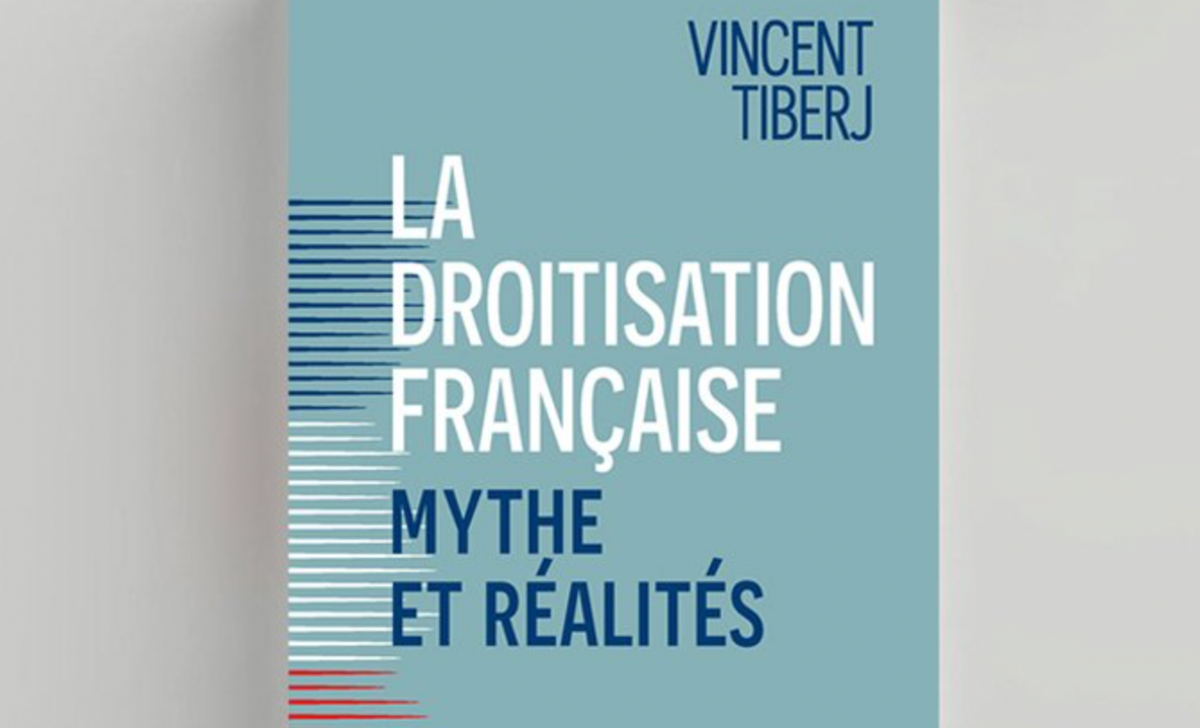
Agrandissement : Illustration 1
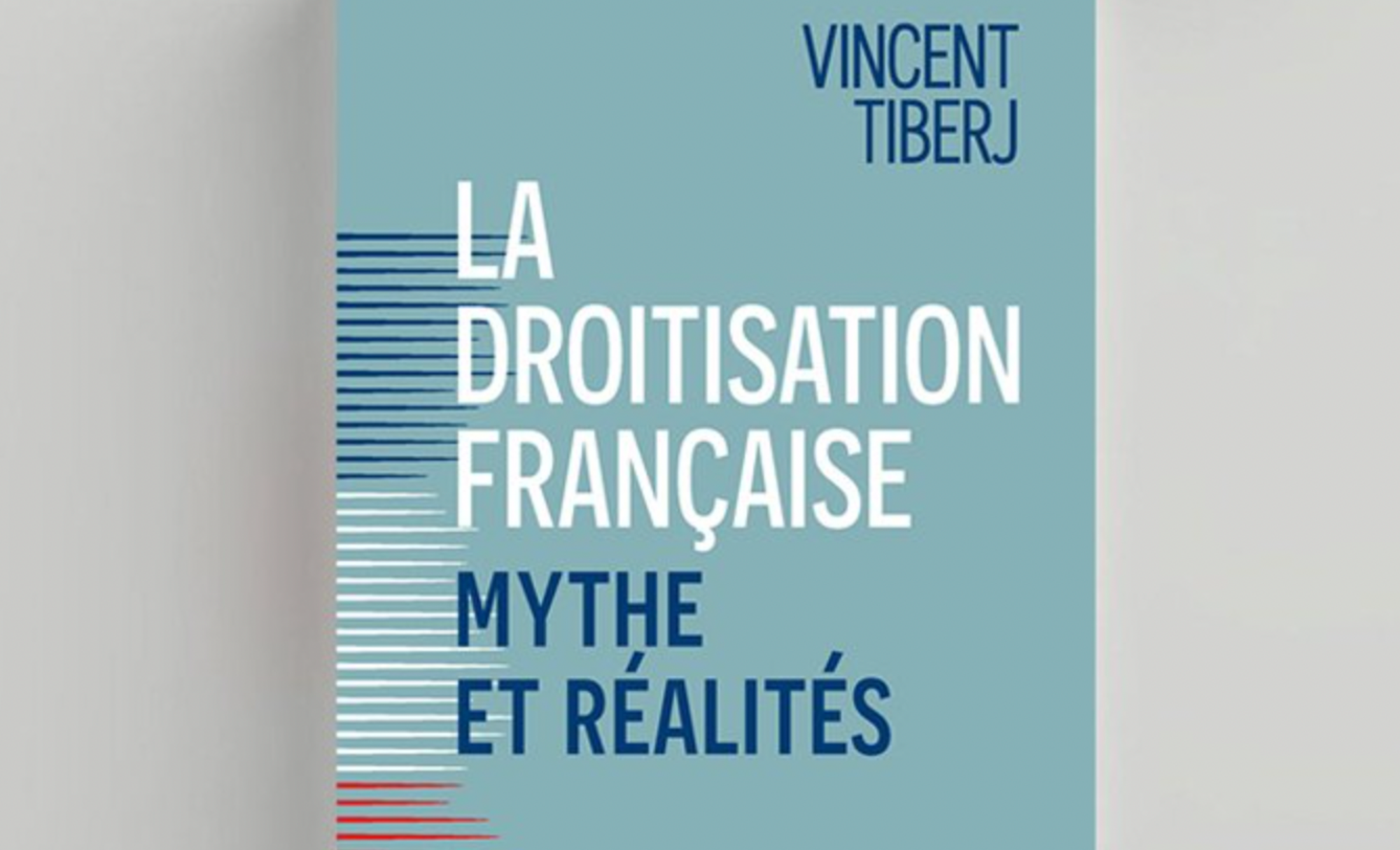
Mon interrogation vient du fait que je suis spécialiste de l’objet « partis » et que, dans l’Europe contemporaine (depuis les années 1990), les nouveaux partis d’extrême-droite ou éventuellement du centre libéral cartonnent de manière bien plus durable que les quelques exemples de percées électorales par la gauche (par exemple, Podemos, Syriza, etc.). Les partis d’extrême droite sont présents dans les parlements de presque tous les pays de l’Union européenne (l’Espagne et le Portugal ayant rejoint le club récemment avec Vox et Chega respectivement), avec parfois plusieurs partis très à droite (comme en Pologne ou même désormais en Espagne). On ne peut pas en dire autant des partis d’extrême-gauche. Les élections européennes de juin 2024 ont bien illustré ce fait majeur, avec un très net glissement à droite de l’équilibre général du Parlement européen (avec pas moins de deux groupes parlementaires très à droite, Les Patriotes pour l’Europe [PfE], et Europe des Nations Souveraines[ESN], sans compter quelques purs allumés parmi les non-inscrits).
Celle de V. Tiberj vient probablement de la simple incohérence qu’il constate entre ce que les meilleurs sondages d’opinion disponibles peuvent mesurer des évolutions des valeurs des Français et les évolutions électorales constatées. Il le dit d’ailleurs clairement par le sous-titre de son livre : « Comment citoyens et électeurs divergent », ce qui pourrait être explicité en « Comment les valeurs majoritaires parmi les citoyens lorsqu’ils sont sondés et les choix effectifs des électeurs divergent ». Pour expliquer cette divergence, V. Tiberj est amené à étudier tous les filtres, mécanismes, qui transforment en quelque sorte l’or (des valeurs d’ouverture de la majorité sociologique du pays tel qu’elle répond aux sondages) en plomb (des votes bien à droite toute des électeurs) – dans la tête et, un jour peut-être, dans les corps.
Le premier chapitre montre que, si l’on prend tous les sondages sérieusement faits et permettant de construire des indices (‘moods’) qui synthétisent l’humeur générale de l’opinion sur des différentes grandes questions, la tendance depuis 1980 correspond bien à un mouvement de longue durée à la Inglehart. Les jeunes générations, bien plus éduquées en moyenne que les précédentes, sont plus ouvertes que les anciennes. Les trois indices sont, selon V. Tiberj, des constructions solides parce qu’ils agrègent des questions aux résultats très corrélés entre eux: l’indice longitudinal de préférences sociales correspond à toutes les questions de l’axe droite-gauche classique, qui oppose le travail et le capital, l’État et le marché; l’indice longitudinal de préférences culturelles correspond à toutes les questions portant sur l’évolution des mœurs (homosexualité par ex.); enfin, l’indice longitudinal de tolérance élargi correspond à des questions portant sur les minorités présentes en France (par ex. juifs ou musulmans).
De ce premier chapitre, il ressort selon V. Tiberj que les sondés entre 1980 et aujourd’hui ont tendance à être en moyenne plus ouverts sur les mœurs et les minorités, et qu’il n’y a pas de mouvement clair de l’opinion publique en ce qui concerne le libéralisme économique. Sur ce dernier point, cela rejoint, si mes souvenirs sont exacts, les conclusions de Kevin Brookes dans sa thèse sur les difficultés de déploiement du néo-libéralisme en France. Il n’y a donc pas de « droitisation par le bas ». Toute la démonstration qui suit ne prend bien sûr sens qu’à partir de ce premier chapitre. Pour ne prendre que cet exemple, il est certain à la fois à la vue des données de sondages rappelées par V. Tiberj, de l’évolution de la législation en la matière, que l’homosexualité se trouve en moyenne beaucoup plus acceptée aujourd’hui par les Français qu’en 1980 (cf. encadré 1, p.50-52). Cette acceptation se traduit d’ailleurs par la présence au sein même du personnel politique de l’extrême-droite de personnalités clairement identifiées comme homosexuelles, détail qui devrait attirer notre attention sur l’absence de pertinence éventuelle de tels indices trop généraux pour saisir la réalité des oppositions politiques effectives à un moment donné.
Le second chapitre commence l’explication du paradoxe par une description de la droitisation très nette des intellectuels médiatisés et de certains médias. Le cas de CNews constitue bien sûr le point focal de ce chapitre. Le troisième chapitre, nourri de sondages comme le premier, démontre qu’il existe un « cadrage musulman de la diversité » (p. 131): « (….) l’opposition aux musulmans est devenu structurante dans la France ethnocentriste. » (p. 146). Surtout, grâce aux intellectuels médiatiques qui ont fait de l’Islam un épouvantail et qui ont politisé des préjugés à son propos, il est devenu facile aux Français les plus ethnocentristes d’exprimer publiquement leur détestation de l’Islam, sans encourir le blâme moral que leur feraient encourir des propos racistes à l’ancienne (biologisants): « En revanche, du côté ethnocentriste, les choses changent [vers plus de tolérance (sic)], mais moins vite, parce que le ‘cadrage musulman’ permet d’exprimer ‘à moindre coût’, de manière acceptable, des positions qui autrement seraient condamnées. » (p. 155)
En somme, le malheur des temps fait, ma bien chère dame, qu' « On ne peut plus rien dire », mais, tout de même, parler en long et large mal de l’Islam, des musulmans, pour ne pas parler bien sûr de l’islamisme qui est consubstantiellement un terrorisme (cf. ce qu’il faut dire dans l’espace public sur le Hamas sous peine d’être soi-même vu comme un soutien du terrorisme et dénoncé comme tel à la justice), est devenu la norme chez nos concitoyens un peu hostiles aux autres en général. On mesure le rôle que peut jouer en ce sens CNews depuis peu, ou, depuis bien plus longtemps, qu’ont joué tous ces intellectuels à la laïcité un peu trop emphatique pour être honnête, dans la sortie de la « spirale du silence » dans lequel les intolérants de tout poil risquaient de se retrouver enfermés par une société globalement plus tolérante. Eh, ma brave dame, misère de misère, ô tempora, ô mores, on ne peut plus se moquer des femmes, des homosexuels, des handicapés, des Maghrébins, des Africains, des Chinois, des Juifs, etc., mais, heureusement, il nous reste les musulmans un brin trop islamisés, la Gaule/oiserie est sauvée. CQFD.
Le chapitre 4 s’intéresse à l’affaiblissement du lien entre le fait d’être en bas de la hiérarchie sociale et d’être politisé à gauche en faveur de la redistribution. Sans surprise, V. Tiberj rappelle à quel point les membres des classes (objectivement) populaires ne s’identifient plus à la classe ouvrière, qu’ils se voient (à tort) comme des (petites) classes moyennes, et que cela est lié au recul du syndicalisme ouvrier. Ce dernier ne peut plus proposer en effet de défendre un collectif populaire, qui agrégerait autour de lui, y compris des personnes n’appartenant pas au sens restreint au monde ouvrier (travailleurs manuels d’exécution de l’artisanat ou de l’industrie). Là encore, les effets de cadrage par le haut de la situation jouent à plein : parmi les pages les plus intéressantes de l’ouvrage (p. 181-186), V. Tiberj montre à quel point le fait de déclarer ou non croire que ‘les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment’ influence fortement en 2022 le placement d’un électeur sur l’échiquier politique (gauche, droite, centre, ni de gauche ni de droite) ou bien la probabilité de voter pour l’un ou l’autre grand candidat en 2022 (Macron, Mélenchon, Le Pen), en dépit même des orientations socio-économiques sous-jacentes de chacun. Un électeur aux valeurs socio-économiques très redistributives qui croit cependant que ‘les chômeurs ne font pas d’effort’ risquent fort de voter Le Pen. Et cette croyance en la culpabilité des chômeurs se trouve nettement majoritaire parmi les « gens d’en bas » comme dirait notre nouveau Premier Ministre (p. 183).
Le cinquième chapitre, sans aucun doute le plus brillant de l’ouvrage, introduit la notion de « grande démission des citoyens français ». Il s’agit en fait d’une relecture de tout ce qu’on peu savoir sur l’abstention et sur le rapport des Français à la politique telle qu’incarnée dans les partis, en utilisant en particulier les enquêtes INSEE sur la participation électorale (c’est-à-dire le fait effectif d’avoir voté, et non pas seulement celui de déclarer à un sondeur qu’on a voté ou non). Le bilan apparaît ici aussi net que calamiteux.
Concernant l’abstention, l’auteur montre le cumul de trois mécanismes sociologiques : d’une part, à partir des générations nées au milieu des années 1960 (ce que l’auteur appelle les « post-boomers ») le rapport au vote devient intermittent; d’autre part, au sein de ces générations récentes, l’intermittence du vote est d’autant plus marquée que la position sociale (objective) est faible; enfin, pour ne rien arranger (tout au moins du point de vue d’une gauche redistributrice et/ou libertaire), les plus éduqués de nos jeunes concitoyens (donc les plus tolérants) oublient plus de voter à l’occasion que les autres. Au final, le « boomer » ancien cadre supérieur multi-propriétaire n’oublie pas d’aller voter (ou de faire une procuration pour exprimer son choix), le jeune prolétaire laissé à lui-même sans plus d’encadrement syndical oublie presque toujours d’aller voter (surtout en comparaison avec le « boomer » ancien ouvrier), et le jeune diplômé « hipster » ou le jeune cadre vote de temps à autre, mais bien moins qu’il ne le devrait. Ce triple effet finit par aboutir à ce que V. Tiberj décrit comme un décalage croissant entre citoyens et électeurs, avec un avantage croissant pour les droites. En effet, en raison des effets de mortalité différentielle lié à la profession exercée pendant la vie active, les « boomers » électeurs de gauche, permanents du vote, vont dans les années à venir, mourir plus tôt que leurs équivalents de droite, et, du côté, des jeunes électeurs l’intermittence semble durablement de mise, sauf pour … la petite part dans ces générations montantes qui vote RN.
Grâce à V. Tiberj, on comprend bien pourquoi à la fois le RN est le premier parti parmi les (rares) votants ouvriers, et pourquoi les ouvriers ( jeunes ou d’âge médian) sont quasiment en voie de disparition dans les urnes (ce qui ne les empêche pas d’avoir encore des positions socio-économiques redistributives lorsque les sondeurs les interrogent). Comme V. Tiberj travaille à partir des enquêtes INSEE sur la participation, il ne prend pas logiquement en compte en plus la part des classes populaires qui n’ont la nationalité française, en situation régulière ou irrégulière sur le territoire, mais participant à sa vie économique et sociale, ce qui bien sûr aggraverait encore le tableau. Pour ce qui est du placement sur l’axe gauche-droite (ou du non-placement), l’on retrouve peu ou prou la même logique. Le non-placement progresse de génération en génération.
Les données utilisée par V. Tiberj lui permettent toutefois de bien repérer le désastre Hollande pour le classement à gauche des classes populaires (cf. Figure 5.5, p. 225). « Rappelons que ce sont parmi les catégories populaires qu’on compte le plus d’électeurs intermittents, mais aussi désormais le plus de non-alignés. Ne pas prendre position n’avait rien d’inéluctable: il fut un temps où les catégories populaires savaient où se placer, et cela permet de laisser de côté l’explication par la compétence politique. Que le non-placement touche d’abord les employés et les ouvriers, c’est très vraisemblablement la conséquence des déceptions de la gauche revenue au pouvoir en 2012, mais aussi pendant les décennies précédentes. (…) Leur désalignement est produit par en haut, par les décisions prises au pouvoir. » (p. 229)
J’avais moi-même, en étudiant les sondages d’opinion pendant l’année 2012, été étonné de la rapidité du décrochage de la confiance dans le Président F. Hollande au sein du monde ouvrier. Ce décrochage n’a pas été surmonté à ce jour. 2012 restera donc bien l’année où se déclarer de gauche est devenu un privilège de « Brahmane » ( des classes moyennes et supérieures éduquées, pour paraphraser T. Piketty), ce que retrouvent les données de V. Tiberj (cf. Figure 5.5, p. 225). Pour l’avenir électoral de la gauche, le « mariage pour tous », ce fut bien sympa, mais la hausse radicale du SMIC et la finance mise au pas, cela aurait été bien mieux. De profundis.
Le chapitre 6 fait fonctionner sur les dernières élections (celles de 2017, de 2022, et de 2024 que l’auteur a pu prendre en compte in extremis) tous les mécanismes qu’il a décrit précédemment. En gros, la gauche se fait régulièrement piler, parce que le cadrage médiatique de ce à quoi l’électeur doit penser avant d’aller voter ne lui est absolument pas favorable. Le cadrage médiatique par l’immigration, l’insécurité, l’Islam etc. portent au contraire Marine Le Pen. Et, pour ainsi dire, cela s’accentue d’élection en élection. Par ailleurs, au niveau des électeurs, surtout les plus jeunes, les aspects « culturels » prennent de plus en plus le dessus sur les aspects « socio-économiques » du vote. La « politique des deux axes », comme l’appelle V. Tiberj, bascule donc de plus en plus vers une domination de l’axe « culturel » dans les choix exprimés, tout particulièrement lors du second tour des élections présidentielles de 2017 et de 2022. C’est le fameux « barrage », qui correspond par définition à un choix négatif.
Plus inquiétant, selon l’auteur, le vote des « boomers » (de droite) a bougé lors des législatives de 2024 vers l’extrême-droite. C’est inquiétant parce que ce sont des électeurs réguliers, qu’ils ne sont pas prêts de mourir (le Bon Dieu, la retraite par répartition, la Sécurité sociale, et leur compte d’épargne les protègent, Amen!), et parce que, du coup, eux aussi votent plus en fonction de leur position sur l’axe des oppositions « culturelles » que des oppositions « socio-économiques ». Faut-il faire le lien avec le fait que ces braves « boomers » de droite regardent un peu trop CNews? Que Marine Le Pen jure désormais ne surtout pas vouloir augmenter les impôts. Possible.
Au total, l’explication donnée par V. Tiberj du décalage entre évolution des valeurs et évolution électorale me parait crédible. Elle rassemble en effet de nombreux savoirs déjà acquis en un tableau cohérent, documenté. J’ajouterai que les éléments d’explication que V. Tiberj développe sur le cas français me paraissent tout aussi pertinents vu depuis une comparaison européenne: cadrage dominant des médias à droite (coucou S. Berlusconi!), désyndicalisation (merci Maggie!), conversion des dirigeants socialistes au néo-libéralisme (coucou T. Blair, G. Schröder, F. Hollande, et tutti quanti), abstention différentielle très marquée selon la génération et le niveau social, etc. L’auteur insiste plutôt sur les parallélismes avec la situation électorale aux États-Unis, parce que souvent ce sont des auteurs nord-américains qui ont décrit les premiers pour la science politique ces phénomènes (par ex. le caractère de plus en plus négatif des campagnes électorales), mais son propos pourrait être facilement être européanisé.
Par contre, au delà de toute l’admiration que je peux avoir pour ce travail, je dois avouer ne pas être d’accord du tout sur l’encadrement normatif que V. Tiberj donne à son propos. En effet, la tonalité générale de l’ouvrage part du principe normatif que les valeurs des citoyens devraient être reflétées dans les choix électoraux, et ensuite dans les politiques publiques suivies. Ce lien suppose en quelque sorte que la politique au sens de la lutte d’élites pour le pouvoir n’existe pas. Or tout l’ouvrage montre justement par a+b que la droite et l’extrême-droite (ou plutôt leurs alliés intellectuels et médiatiques) sont bien meilleures pour donner à la discussion médiatique le tour qui les arrange, pour cadrer le débat public, pour instrumentaliser la part des valeurs des citoyens qui les arrange, qu’elles savent ne pas trop démobiliser leurs électeurs traditionnels lors de leurs passages au pouvoir, que les électeurs les plus conservateurs sur le plan des valeurs n’oublient pas eux d’aller voter contrairement aux millions de hipsters et assimilés, que les classes populaires sont atomisées façon puzzle, etc..
V. Tiberj a donné comme sous-titre à son ouvrage « Comment citoyens et électeurs divergent ». J’aurais tendance à dire que ce sous-titre constitue un non-sens. En particulier, ne pas aller voter, c’est simplement ne plus être citoyen. Que les gens, même très éduqués, ne se rendent pas bien compte que ne pas aller voter est se mettre d’office du côté des perdants du jeu politique en place, fait lui-même partie du jeu politique, et ne doit surtout pas être rationalisé comme le fait l’auteur, suivant en cela une tendance chez de nombreux politistes contemporains, comme une autre manière de faire de la politique. Ne pas jouer au football avec les pieds, ce n’est jouer autrement au football, c’est perdre d’office.
De fait, je n’arrive pas à adhérer à cette vision « à la Habermas » de la démocratie (ou, pour prendre une autre référence, façon économiste du bien-être: la politique comme manière d’effectuer des choix collectifs). Il est vrai que je n’ai pas passé ma vie à étudier des sondages – instrument qui peut effectivement être utilisé en ce sens d’identification des choix collectifs souhaitables. Je m’en tiens à une vision « à la Schumpeter » de la politique. Il y a des élites opposées qui veulent conquérir le pouvoir d’État, organisées en partis, en se disputant les faveurs des électeurs- et là, si j’ose dire, tous les coups sont permis, et que le meilleur (ou le pire) gagne. C’est tout. Si l’une de ces élites trouve son avantage dans l’abstention ou la désorientation des électeurs possibles de l’autre camp, c’est le jeu. Et malheur aux vaincus.
Tout ce qui fait appel à cette théorie normative d’une politique comme représentation des valeurs de citoyens me parait caduc, une illusion toute juste bonne pour les enfants des écoles, pour les constitutionnalistes ou pour les économistes du bien-être. Les valeurs des citoyens sont simplement un matériau à partir duquel les politiques travaillent pour accéder au pouvoir et s’y maintenir. V. Tiberj ne dit d’ailleurs pas autre chose dans la part descriptive de son travail (par ex. quand il parle de « jouer sur les ‘cordes’ de valeurs », p. 256 et suivantes), mais il semble rêver et faire rêver ses lecteurs (de gauche évidemment!), en tant qu’intellectuel engagé dans la vie publique, que cela puisse être autrement. Or on pourrait d’ailleurs lui faire remarquer qu’il existe une large endogénéité des valeurs des citoyens dans une société donnée, au sens où les valeurs des gens ordinaires ne se sont le plus souvent que ce que les forces dominantes sur l’éducation (famille, école, religion, médias, etc.) à un moment donné voulaient apprendre aux enfants d’un certain groupe social lors de leur socialisation.
V. Tiberj constate ainsi la disparition dans l’opinion publique des croyances liés au racisme biologique au fil du temps et des générations. Ce racisme biologique ne venait pas de nulle part dans les esprits des plus anciens des Français. Il correspond à l’état des savoirs dominants au moment de leur éducation (avant 1945). Je l’avais bien constaté sur mon propre père (Paix à son âme), qui fut marqué jusqu’à la fin de sa vie son éducation dans un milieu catholique et colonialiste. De même, l’ouverture, la tolérance, etc. des générations montantes correspond à un programme éducatif particulier. Moi-même, n’ai-je pas vu Nuit et Brouillard au collège, n’ai-je pas été éduqué dans la glorification de la Résistance. Ou éventuellement de l’ambiance du moment tel que la lutte des élites la fait (comme le rappelle V. Tiberj en commentant l’évolution de ses indices lors que même les anciens finissent par être influencés par ce que pensent les jeunes). En fait, nous sommes tous dans ce que nous croyons être nos valeurs, dans notre for intérieur, les résultats d’une bataille des idées menée par des élites en conflit. D’ailleurs, V. Tiberj ne travaille-t-il pas lui-même depuis longtemps pour une institution publique chargée de faire la vigie des Droits de l’Homme dans notre pays (CNCDH), et ne se félicite-t-il pas des moments où les élites ont été en défense de la tolérance.
Au delà de cette critique d’ordre presque philosophique, ou de ce que doit être l’épistémologie de la science politique (réalisme strict ou défense d’un modèle démocratique), je m’interroge sur cette divergence entre les valeurs professées et les votes exprimés : que veulent dire des valeurs qui ne débouchent pas sur des votes? Quelle est la valeur de ces valeurs? Est-ce que ces jeunes éduqués aux valeurs libertaires et/ou sociales qui ne vont pas faire l’effort d’aller voter donnent un poids réel à ces valeurs pour ce qui concerne le collectif? C’est bien là le point essentiel à retenir : les personnes inquiètes de l’immigration ou de la place de l’Islam en France vont elles aller voter. Cela leur tient vraiment à cœur. L’explication par le cadrage (ce à quoi il faut penser) me parait à moitié satisfaisante. Il me semble que les victoires électorales des extrêmes droites tiennent aussi au fait que leurs électeurs sont plus motivés, énervés, enragés.
Étrangement, la semaine dernière alors que je réfléchissais à l’ouvrage de V. Tiberj, je me suis trouvé à discuter de cela avec un médecin de ma génération qui regrettait l’éducation trop orientée vers la culture qu’elle avait donnée à ses enfants. Devenus adultes, ils ne pensent qu’à leurs loisirs culturels, et oublient parfois d’aller voter. En pratique, c’est un ordre de priorité. Du coup, c’est toute la faiblesse d’une réflexion appuyé sur des sondages à propos des valeurs qui apparait. La seule véritable monnaie qui compte en politique, ce sont les actes, et le premier d’entre eux, le vote. Un homosexuel, fort bien toléré par une société fort tolérante, fort tolérant à tous égards dans ses réponses, qui vote RN, c’est tout de même un vote de plus pour l’extrême droite. Et n’allons pas raconter que cette dernière est devenue elle-même plus tolérante : son fond xénophobe reste le même.
Du coup, largement en contradiction avec le message plutôt optimiste sur le fond tolérant de la société française, l’heure est vraiment grave, comme le montre la conclusion de V. Tiberj au titre éloquent : « Are you ready for the storm? ». V. Tiberj y oscille entre deux avertissements : celui évident d’une possible victoire par défaut du RN lors de la prochaine grande élection – les « castors » du second tour qui ont fait 2017, 2022 et 2024 pour des raisons « culturelles » pourraient se lasser de faire « barrage », d’être une nouvelle fois contraint de voter négativement pour un candidat qui leur déplait, alors que les seniors de droite sont en train de basculer à l’extrême-droite toute; celui d’une politique totalement hors-sol avec une majorité de citoyens éduqués, distants, au mieux intermittents du vote, ne s’en laissant pas compter par des politiciens élus seulement par deux ou trois électeurs restés fidèle à leur devoir électoral (façon élections municipales de 2020).
Sur le second point, V. Tiberj suggère le recours à plus de référendums à tous les niveaux, et l’abandon par les élites politiques françaises de leur certitude d’être des génies menant tant que bien mal des veaux, comme dirait le Général De Gaulle (ce qu’il appelle fort poliment la « ratiocratie », p.309). A raison, V. Tiberj souligne que les électeurs français pourraient, vu leur niveau d’éducation actuel, participer à de multiples débats référendaires. A vrai dire, les Suisses le font depuis deux siècles. Mais quel politicien est prêt à se désarmer ainsi? Et toutes ces masses de braves « castors », croit-il vraiment qu’ils auront plus de capacité dans le futur à se réveiller en dehors du dernier moment de la grande élection décisive? Quelle serait la force de rappel (réveil)?
De fait, si l’on prend un point de vue de gauche (en fait des élites de gauche de mon point de vue, soyons cohérent!), le livre possède l’immense mérite de bien décrire l’impasse actuelle. Il dessine en creux les stratégies possibles (par exemple, reprendre le contrôle de l’agenda médiatique). Cependant, la remontée électorale me parait extrêmement difficile pour les prochaines années, ne serait-ce que parce que le dernier passage au pouvoir de la gauche a été un désastre et qu’un certain F. Hollande encombre toujours et, de plus en plus d’ailleurs, le paysage politique. Rappelons-lui que ce n’est pas Guy Mollet qui a gagné en 1981.



