Me revoilà m’apprêtant à rendre compte d’un ouvrage de Pierre Charbonnier, celui paru l’été dernier, Vers l’écologie de guerre. Une histoire environnementale de la paix (Paris : La Découverte, août 2024). L’auteur se propose à la fois de faire une histoire des idées autour des conditions de la paix mondiale, vu par le prisme des contraintes écologiques, perçues, ignorées ou déniées, par les différents penseurs du moment, et une proposition politique qui se veut réaliste en 2024 pour sortir de la crise écologique.
Ainsi, pour le résumer brièvement, disons que l’auteur souligne que la (relative) paix qu’a connu le monde entre 1945 et 2022 tient à une considération largement ignorée de la plupart des contemporains, à savoir l’abondance des ressources fossiles alors disponibles et à leur impact alors dénié, ignoré, minimisé, repoussé dans l’avenir, sur la biosphère. D’une certaine façon, Pierre Charbonnier rejoue l’histoire des années post-1945 à la manière des théoriciens de l’Etat-Providence. Ceux-ci ont montré de longue date que l’extraordinaire croissance économique des années 1945-1975 avait permis la pacification des relations sociales et des vies politiques au sein des pays développés. Ici, la même opération est menée pour la géopolitique d’après 1945.
C’est grâce à l’abondance des énergies fossiles disponibles dans les deux camps de la Guerre froide et dans les pays non-alignés que l’on sort d’une logique malthusienne d’un monde apparaissant fini dans ces ressources et appelant chaque puissance à l’expansion territoriale. Contrairement à la vision classique d’une géopolitique de l’espace vital, reposant sur l’ampleur des terres agricoles disponibles pour un peuple et pour sa démographie exponentielle, la géopolitique de l’après-guerre aurait été apaisée de manière souterraine par l’extraordinaire abondance énergétique de ces années-là. Les morts de toutes les guerres liées aux décolonisations, souvent liées à des enjeux pétroliers ou de ressources minières, apprécieront à sa juste valeur une telle affirmation de l’auteur (qui ne les ignore certes pas), mais il reste qu’effectivement, ni l’Ouest, ni l’Est, ni les non-alignés, ne souffrent guère de disette énergétique dans les années 1945-1975. Les crises énergétiques (1974, 1979) sont d’ailleurs assez vite résolues par une expansion ultérieure de l’abondance énergétique (que ce soit par la mise en exploitation de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz, ou par le développement d’une puissante énergie nucléaire civile comme en France). On ne s’éclaire à la bougie que suite à des choix politiques nationaux désastreux très spécifiques (comme la Roumanie de Ceausescu dans les années 1980).
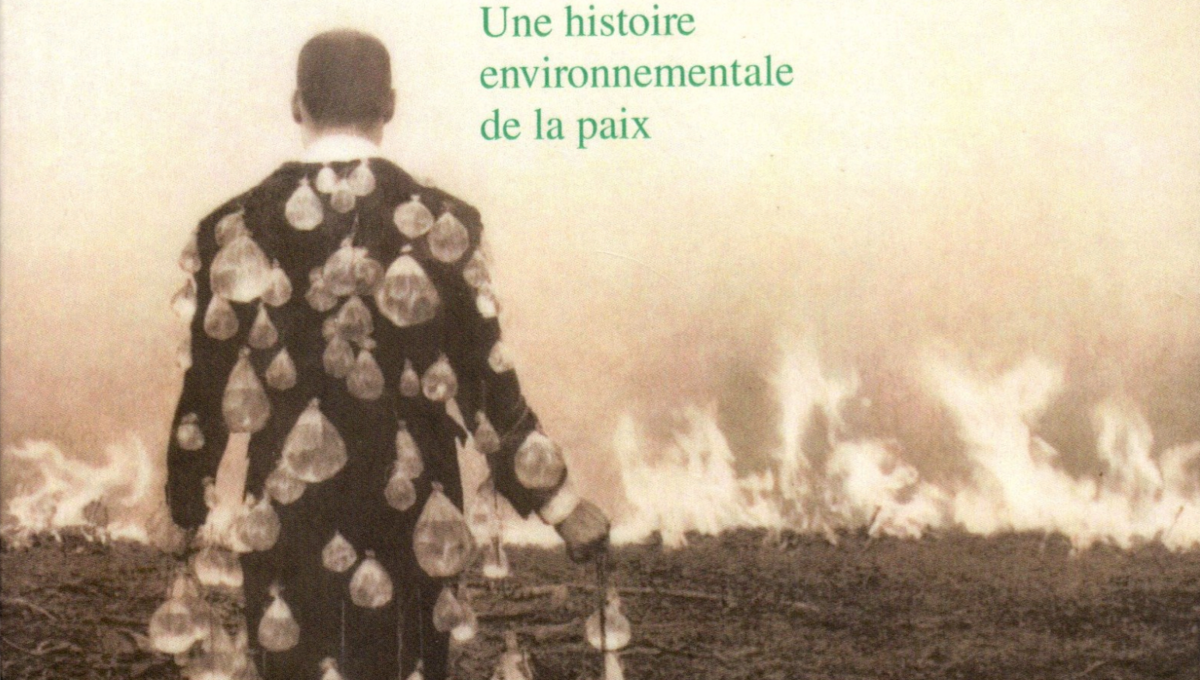
Agrandissement : Illustration 1
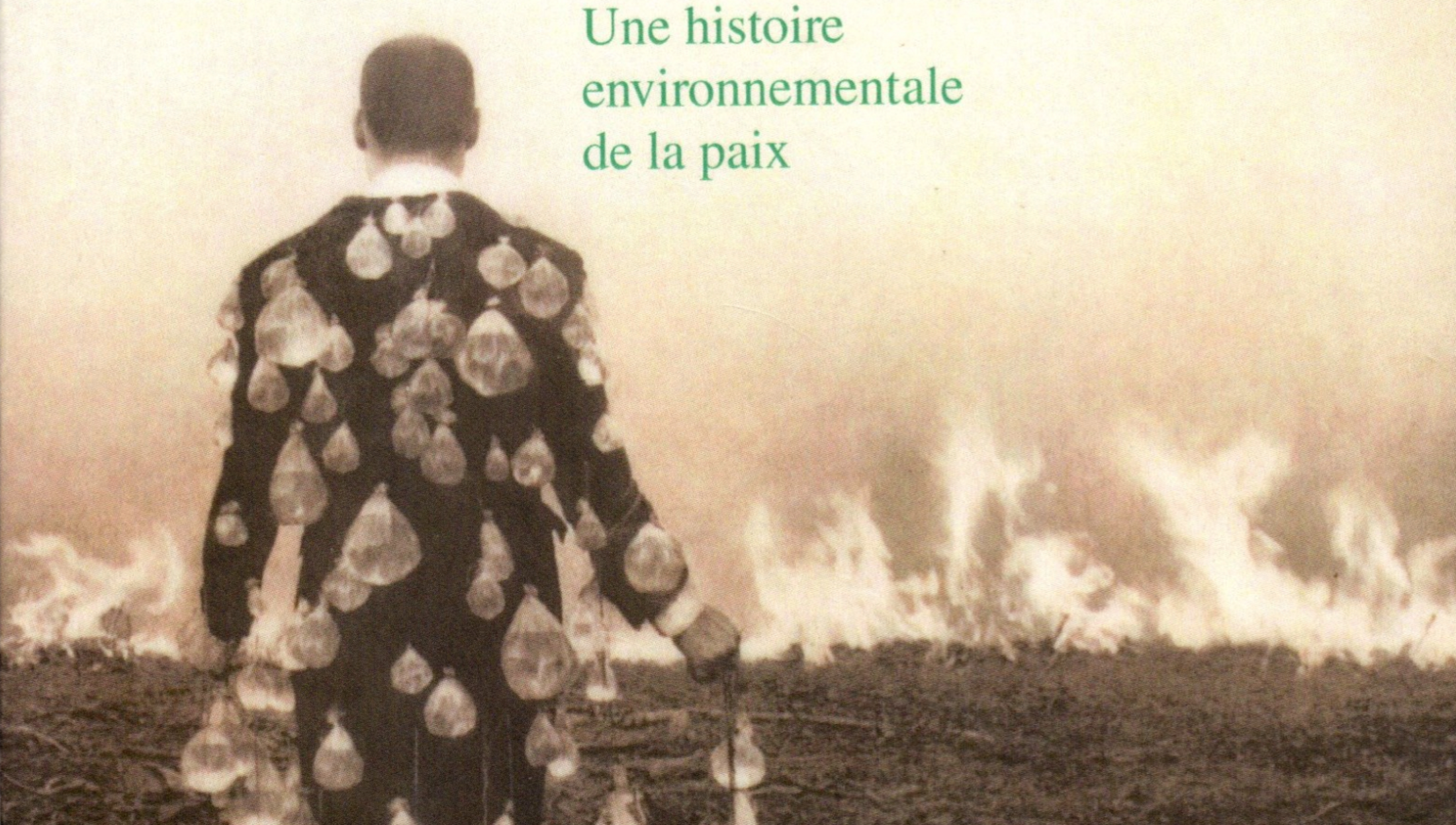
Pour l’auteur, cette époque est révolue, car les conséquences écologiques de l’abondance énergétique liée aux énergies fossiles ne peuvent plus être factuellement ignorées. Ces conséquences sur le climat mondial et les sociétés humaines sont déjà tellement graves et évidentes que s’est engagée un double conflit : d’une part, entre les pays/secteurs économiques dépendant pour leur prospérité des énergies fossiles et les pays/secteurs économiques proposant des alternatives économiquement viables à l’usage de ces énergies fossiles; d’autre part, un conflit entre grandes puissances (États-Unis, Chine, Union européenne) pour s’imposer comme le leader de cette décarbonation de l’économie mondiale (avec tous les profits économiques qui y sont liées pour chaque capitalisme). Pierre Charbonnier a développé à ce sujet le concept d' «écologie de guerre » en particulier pour décrire la possible stratégie de l’Union européenne après 2022, consistant à se dégager de sa dépendance énergétique au pétrole et surtout au gaz russes, en en profitant pour développer sur son propre territoire une abondance énergétique décarbonée. Il s’agit d’aligner l’impératif d’écologie et celui de sécurité nationale. Force est de constater que, vu de ce début de 2025, le succès de cette approche est plutôt mitigé à tous points de vue, tant la sécurité énergétique de l’Europe dépend encore à ce stade d’importations de gaz et de pétrole, en particulier de gaz liquéfié américain, tant le coût de l’énergie est devenue un sujet de préoccupation pour les industriels européens, tant les consommateurs européens souffrent de l’inflation des coûts de l’énergie.
L’approche de Pierre Charbonnier fait par ailleurs son deuil de l’Accord de Paris (2015). Il montre bien que de tels engagements nationaux volontaires, surveillés par nul gendarme international, à la décarbonation des économies ne peuvent pas fonctionner, car ils ne s’inscrivent pas assez dans des logiques de puissance et de sécurité. De même, l’écologisme classique, qui trop souvent propose de réduire le niveau de vie matériel des populations au nom de la protection de la Nature, n’a aucune chance d’emporter l’adhésion des citoyens, alors que l’écologie (réaliste) de guerre propose de reconstruire la base énergétique de la société et de garantir la sécurité nationale et le niveau de vie des populations.
Bien sûr, on se dira d’emblée que le livre a déjà bien mal vieilli. Donald Trump a été réélu en novembre 2024 Président des États-Unis, et le slogan « Drill, baby, drill ! » a été l’un des ses mantra de campagne. Il signe depuis son entrée en fonction des Executive orders qu’on pourrait tout aussi bien Oukases tant on dirait que désormais c’est lui qui fait le droit. Tout ce que raconte P. Charbonnier sur les efforts américains sous la Présidence Biden de s’imposer comme le leader des technologies de décarbonation semble devoir être aussi rapidement obsolète qu’une version de Windows sur mon ordinateur. L’Union européenne est, de son côté, en train d’enterrer sans fleurs ni couronnes le Green Deal. Et, lors des élections allemandes de ce mois de février, nous risquons bien d’avoir un bloc des partisans du retour du gaz russe pas cher autour de 30% des suffrages (autour de 25% pour l’AfD et autour de 5% pour le BSW, sans compter les ambiguïtés sur ce point de certains dirigeants du SPD, voire de la CDU-CSU ou du FDP).
La victoire de Donald Trump et sa volonté de refaire des États-Unis une puissance dominante, fondée sur l’abondance des énergies fossiles, rendant très compétitif le Made in America, me semblent saper à la base la vision de P. Charbonnier. En effet, ce dernier raisonne en philosophe soucieux du bien de l’Humanité comme si la réalité du changement climatique devait tout de même inciter les acteurs étatiques à la rationalité en matière d’usage des énergies fossiles pour des simples et banales raisons de sécurité. P. Charbonnier remarque d’ailleurs que la manière d’envisager le changement climatique parmi les élites intellectuelles américaines réfléchissant à ce sujet ressemble fort à la manière d’appréhender la guerre nucléaire.
Il faut aller jusqu’à la limite, n’est-ce pas Monsieur Nordhaus ? Prendre ses risques. Il me semble que ce que représente Trump et Cie n’est autre que la forme nouvelle de cette prise de risque. Il me parait évident que Trump et Cie savent que le réchauffement climatique d’origine anthropique existe bel et bien, mais ils considèrent que les États-Unis, vu leur domination militaire et leur situation géographique, peuvent se désintéresser de ce qui va arriver au reste du monde. Tous les modèles montrent que ce sont les zones tropicales qui vont devenir inhabitables si le changement climatique se poursuit ainsi. Quelle importance alors, et cela d’autant plus que deux océans et un mur empêcheront les miséreux de parvenir jusqu’au Nouveau Paradis terrestre énergétique fossile. Et puis après tout, comme le prétend E. Musk, ne faut-il pas se préparer à quitter la Terre, à décoller et non à atterrir, et à conquérir l’Univers !
La tentative trumpiste d’assurer la sécurité et la prospérité des États-Unis en dehors du monde risque bien de remettre C. Schmidt fort à la mode. P. Charbonnier a gardé de sa formation philosophique une tendance à ne pas vouloir sombrer dans une vision noire, trop pessimiste, de l’histoire de l’humanité. Il ne sera guère d’accord avec mes remarques. Pour ma part, les premiers pas de D. Trump dans sa seconde Présidence me convainquent que l’humanité n’échappera pas en ce XXIe siècle à des tribulations qui dépasseront de loin les épreuves du XXe siècle.
Quant au contenu du livre de P. Charbonnier, en dépit du beau travail d’histoire des idées qu’il représente, j’ai peur pour lui qu’il aille rejoindre rapidement le cimetière des belles et généreuses idées des philosophes. Que l’Apocalypse advienne enfin par la grâce de l’Antéchrist à la blonde chevelure !



