Arnaud Orain, Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVI-XXIe siècle), Flammarion.
Voilà un essai qui ne manque pas d’audace. L’historien Arnaud Orain n’y affirme-t-il pas dans sa première phrase : « Le néo-libéralisme est terminé » (A. Orain, Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude [XVIe-XXIe siècle], Paris, Flammarion, 2025, p. 7). Cette phrase-choc pourra faire sursauter plus d’un lecteur, car elle entend résumer le diagnostic de l’auteur sur l’état du monde en 2025, diagnostic qui ne va pas entièrement de soi a priori tant la domination de l’idéologie néo-libérale – et même désormais de l’idéologie libertarienne – semble encore peser sur les esprits.
Pour l’auteur, nous sommes cependant rentrés depuis le début des années 2010 dans une nouvelle phase du capitalisme, ce qu’il appelle le « capitalisme de la finitude ». En effet, en suivant l’histoire économique du capitalisme depuis sa naissance à l’orée de la Renaissance, Arnaud Orain observe à la fois dans les pratiques et les discours qui les accompagnent l’alternance entre deux formes de capitalisme. Un « capitalisme de la finitude », chronologiquement premier, qui apparait à la suite des « Grandes découvertes » européennes, appuyé sur une monopolisation de ressources économiques (épices par exemple) par des acteurs liés à l’une ou l’autre puissance étatique du moment, capitalisme largement anti-concurrentiel dans sa manière d’opérer, pratiquant le commerce maritime militarisé à longue distance. Un « capitalisme libéral », chronologiquement second, dépendant de l’hégémonie d’une seule puissance, à la fois dominante économiquement et capable de garantir la liberté du commerce maritime pour tous les pays, capitalisme justifié et défendu par les théoriciens du libéralisme, puis du néo-libéralisme.
La chronologie proposée est alors la suivante : XVIe-XVIIIe siècle, premier « capitalisme de la finitude » fondé sur la compétition sur toutes les mers du globe entre Portugais, Espagnols, Hollandais, Britanniques et Français, symbolisé par leurs grandes compagnies marchandes à monopole respectives; 1815-années 1880/90: premier « capitalisme libéral » sous l’égide de la domination sans partage des mers et de l’économie industrielle par les seuls Britanniques; 1880/90- 1945: second « capitalisme de la finitude », qui commence avec le partage de l’Afrique à la Conférence de Berlin par les puissances européennes, avec le décollage industriel et agricole de l’Amérique protectionniste – que regrette tant l’actuel Président Trump -, et le décollage industriel de l’Allemagne impériale, et qui culmine dans les différentes tentatives, lors de la crise des années 1930, de créer des ensembles impériaux autonomes économiquement les uns des autres avant d’être en guerre les uns contre les autres ; deuxième « capitalisme libéral », sous l’hégémonie américaine, qui œuvre pour la réouverture du commerce international d’abord (avec le GATT dès 1947), puis à la « mondialisation heureuse » (avec l’OMC en 1994); troisième « capitalisme de la finitude », qui débuterait au début des années 2010. Il serait marqué par deux réalités majeures de notre temps : d’une part, la Chine serait désormais assez forte économiquement pour inquiéter les dirigeants américains sur le maintien de leur propre suprématie; d’autre part, les États-Unis, en dépit des sommes dépensées dans leur défense, ne seraient plus en mesure de jouer leur rôle d’hégémon naval incontesté, à la fois en raison de la montée en puissance de la marine chinoise (civile et militaire) et en raison de montée en puissance de nouvelles menaces maritimes (par exemple, les Houthis en Mer rouge).
L’aspect le plus intéressant et novateur de l’ouvrage – dont certaines thèses rappelleront évidemment bien des choses à des connaisseurs de l’histoire longue du capitalisme – est de nouer en permanence le grand récit ainsi proposé autour des affaires de commerce maritime.
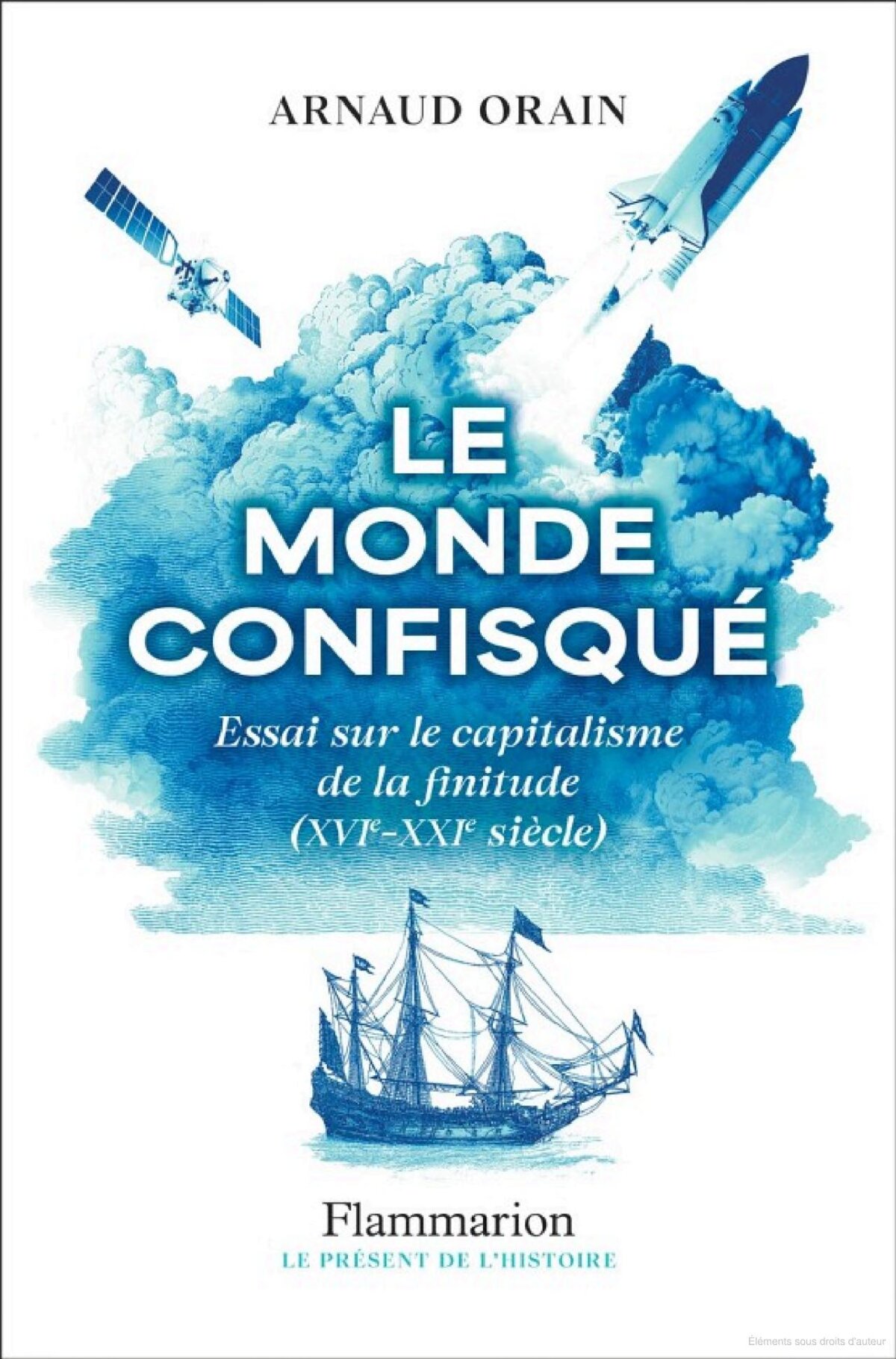
Agrandissement : Illustration 1
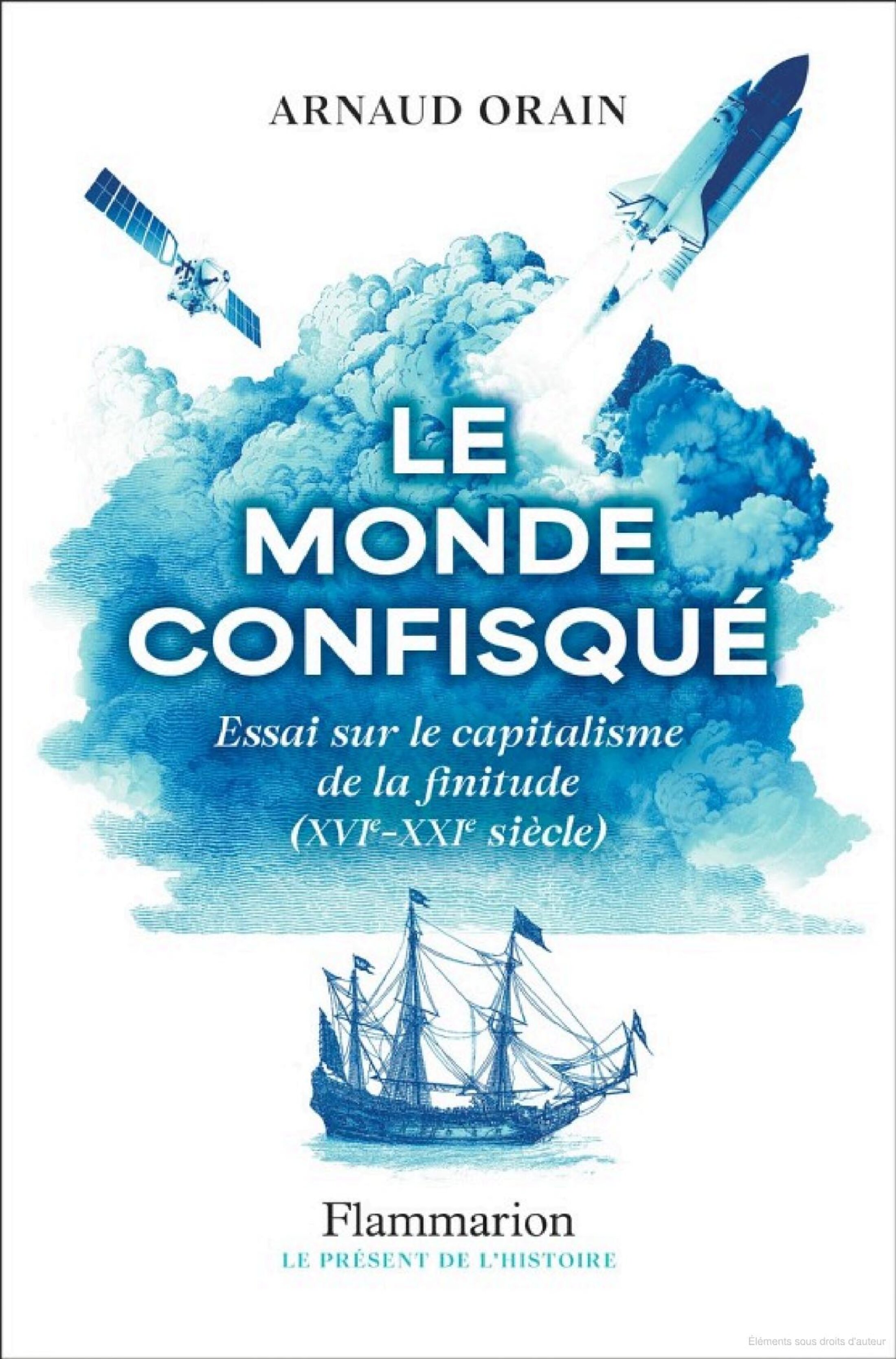
Le commerce maritime est-il libre et concurrentiel, ou est-il monopolisé par quelques acteurs ? Comment s’articulent puissance navale (militaire) et puissance maritime (civile)? Sur quels points d’appui terrestres le commerce maritime s’appuie-t-il ? Des ports ouverts à tous, ou des ports monopolisés par quelques puissances ? L’ouvrage mêle ainsi en permanence des rappels historiques sur les cinq derniers siècles et des considérations sur l’actualité des dernières années. En particulier, la montée en puissance des marines chinoises (de transport de marchandises, de pêche hauturière, et de guerre), de tout l’ensemble de ports et d’entrepôts liés aux grandes entreprises chinoises (dont en particulier l’armateur COSCO), et des initiatives en faveur du développement et du commerce (la « Belt and Road Initiative »), sont fortement mobilisées par l’auteur en faveur de sa thèse, tout comme les discours de dénégation de cette montée en puissance par les porte-parole autorisés des autorités chinoises elles-mêmes, au nom du libéralisme (!), alors même que tout montre que cette poussée chinoise vise à s’assurer la sécurité d’accès aux ressources (minérales, fossiles, agricoles, etc.) dans un monde conçu désormais comme fini et soumis au changement climatique.
On comprend mieux en lisant Arnaud Orain la raison des menaces de Donald Trump sur le Panama et son canal, ou sur le Canada, le Groenland et leurs ressources énergétiques/minières. Le moment des « grands espaces » à la Carl Schmitt semble advenir sous nos yeux, mais de manière bien plus océanique que prévu par ce dernier. Arnaud Orain montre en effet une tendance à établir des souverainetés nationales sur des espaces maritimes de plus en plus étendus. On serait presque tenté de dire que, bientôt, les mers seront des terres comme les autres.
Comme il s’agit d’un essai, l’auteur ne s’aventure pas à proposer une théorie générale de ces oscillations dans l’esprit du capitalisme. On comprend toutefois qu’il suppose que le passage au « capitalisme de la finitude » correspond à la prise de conscience d’un monde aux ressources limitées, à la recherche de rentes par certains acteurs nationaux, à l’intensification préalable de la concurrence de la part de nouveaux acteurs étrangers, à la volonté de prioriser la puissance de l’État sur le seul bonheur privé des consommateurs nationaux. Il trouve la trace de tous ces éléments dans les discours tenus par les auteurs qui accompagnent à chaque fois le mouvement vers un « capitalisme de la finitude » de leurs discours apologétiques. Le passage inverse (du « capitalisme de la finitude » vers le « capitalisme libéral ») attire moins son attention sans doute, car les auteurs concernés (A. Smith, R. Cobden, etc.) sont bien plus connus, et parce que ce n’est plus notre actualité des années 2020.
Quoi qu’il en soit, l’ouvrage offre un angle de réflexion tout à fait intéressant sur la situation contemporaine, et il a le mérite d’attirer l’attention sur des auteurs qui ont largement plaidé en leur temps pour l’un ou l’autre des aspects du « capitalisme de la finitude ». Par exemple, les pages consacrées à l’amiral nord-américain Mahan à la fin du XIXème siècle (p. 78-84), théoricien de la nécessaire double puissance à la fois navale (militaire) et maritime (civile), sont vraiment éclairantes. En revanche, cet ouvrage d’une lecture vraiment très agréable m’est apparu quelque peu décevant par deux aspects.
Premièrement, comme l’auteur le dit lui-même, il s’agit d’un essai. Il n’empêche que manque tout de même ici d’une théorie générale du développement du capitalisme. Peut-on aller au delà des discours des contemporains comme explication ? Arnaud Orain connait sans aucun doute ces grandes théories (comme celle de F. Braudel, I. Wallerstein par exemple), mais il semble ne pas vouloir trop les utiliser. Probablement s’agit-il de ne pas trop se rapprocher du marxisme et de rester le plus empirique possible. Il a d’ailleurs écrit un autre livre sur les savoirs oubliés de l’économie, et il semble fasciné par la possibilité de savoirs qui ne soient pas en quelque sorte monopolisés par des grands savants dans leur tour d’ivoire.
Deuxièmement, les conclusions politiques de l’ouvrage sont quelque peu étranges. De sa description de l’état du monde actuel, il tire d’abord une sorte d’attaque à front renversé de l’extrême droite européenne, à savoir d’être bêtement (nationale-)souverainiste, alors qu’elle pourrait être intelligemment européenne-souverainiste, au nom de la préservation de la puissance européenne (p. 312-314). De même, il s’en prend à la version proposée à gauche par Pierre Charbonnier de cette même puissance européenne maintenue, à savoir la voie de « l’écologie de guerre ». Il plaide du coup, pour ce qu’il appelle, la « version forte de l’écologie de guerre et de transition : une économie des quatre éléments démocratique, décentralisée et décroissante » (p. 318). Il craint fort en effet que l' »écologie de guerre » – ce qu’il appelle le « patriotisme écologique sécuritaire » ne finisse par ressembler en pratique au « nationalisme fossile » (p. 319). Il faut bien dire que les évolutions du parti écologiste allemand auraient tendance à lui donner raison. Mais n’est-ce pas là de leur part du simple réalisme géopolitique? Il faut des armes de haute technologie pour rester un peuple libre. La leçon ukrainienne est sans appel.
Autrement dit, Arnaud Orain semble pris dans un écart difficile à accepter pour lui entre, d’une part, une tendance du monde à l’autodestruction écologique par les différents blocs capitalistes pensés pour affronter un monde fini qu’il voit se mettre en place depuis les années 2010 et, d’autre part, ses convictions politiques, éthiques, privilégiant un monde décroissant, vraiment décolonisé et démocratique, égalitaire, rompant avec cinq siècles de capitalisme. Là encore, on voit bien la différence avec les théoriciens marxistes (ou post-hégéliens). En général, face à une description aussi sombre du monde que celle-là, le théoricien marxiste aurait conclu que la dialectique interne du capitalisme lui-même et de ses contradictions finira par accoucher du socialisme ou du communisme. Là, il n’y a rien de tel, et l’auteur parie même sur l’impossibilité de revenir à un « capitalisme libéral », tout au moins oserait-on dire, en suivant la logique qu’il expose, tant qu’un nouvel hégémon ne sera pas imposé – ce qui, évidemment, au vu des épisodes précédents, n’annoncerait rien moins que la Troisième guerre mondiale. Une fois que la Chine aura terrassé l’Amérique…
Au final, je ne doute pas que ce livre devienne un must-read pour nos étudiants, mais je doute qu’il les aide à garder le moral. En effet, les tendances qu’Orain décrit ne sont rien moins que l’annonce d’un monde surchauffé à tous points de vue.



