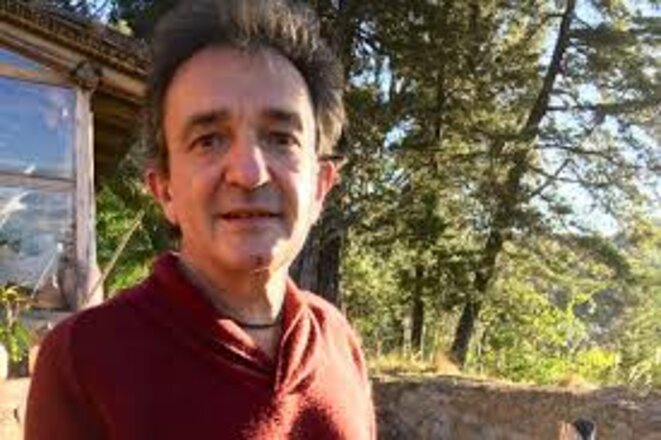Agrandissement : Illustration 1

Le Conte de l'olivier créole, septième et dernier épisode
Au dix-septième siècle, les Dominicains ont traversé l’océan en emportant avec eux une grande variété de graines et de plantes. L’olivier est de ces rares variétés qui supportent l’absence de saison. Il prospérera – et rendra riches ses propriétaires – au Pérou, en Bolivie et sur la cordillère orientale de Colombie, permettant ainsi aux communautés religieuses de s’implanter, par l’Évangile mais aussi par des terres productives. Un Dominicain de Villa de Leyva écrit en 1602 : « Ici nous cultivons des oliviers qui n’ont pas besoin d’être cultivés. » Ce qui n’est évidemment pas vrai, mais ce qu’il veut dire, c’est que l’olivier sous les Tropiques démultiplie sa générosité.
L’olivier a toujours eu cette pente voyageuse, qui l’a amené à s’implanter dans de nombreux pays. Aujourd’hui, les rameaux voyagent en avion, bien qu’il soit interdit de transporter des végétaux sur les vols internationaux. Il existe une pratique très efficace, que l’on appelle en Colombie « le courrier des sorcières », et qui consiste à insérer un rameau d’olivier à l’intérieur d’une cravate ou d’une chemise, et d’emballer le tout dans un journal humidifié. Il serait sans doute préférable de pouvoir s’épargner cette situation infantilisante, et commencer à imaginer partout sur la planète des musées vivants de l’olivier, qui réuniraient les plus belles pièces du monde.
Ce type de délocalisation positive pourrait malheureusement devenir une manière de sauvetage pour les oliviers d’Europe, qui risque de souffrir drastiquement dans les siècles qui viennent, en fonction des évolutions climatiques. Les hivers trop chauds, laissant prospérer les maladies et les parasites, et des printemps sans suffisamment d’eau et provoquant un stress hydrique, pourrait mettre en péril la productivité de l’oléiculture dans la région méditerranéenne. Espérons que l’oliveraie de Boyaca comme nouvelle version, végétale, de l’arche de Noé, reste un conte de Noël.
Dans la mesure où l’arbre « sacré », et considéré comme « béni » dans les trois monothéismes – « celui qui se nie à mourir » a traversé « la flaque », comme on nomme l’océan Atlantique en Amérique du Sud, et a supporté ce changement de vie radical, on peut le considérer comme un arbre créole, une plante qui vient de loin, mais qui donne maintenant génération sur la terre des Andes. Il faut imaginer que sur quelques neuf cent « cultivars » (ou variétés), seulement une cinquante a supporté la vie andine tropicale, et l’on compte sur les doigts de la main les variétés productives – essentiellement le cultivar Picual d’Espagne ; Cordivil, Cobrancosa et Passareira du Portugal ; et Ascolana d’Italie.
En lisant ces noms, c’est bien toute l’histoire de l’Europe qui affleure, en son sens méditerranéen – une histoire où l’on retrouve tous ces lieux qui l’ont construite : l’Asie mineure, Carthage, La Crète, le Gard, l’Andalousie, la Vallée du Douro – et qui révèle la double face de l’arbre de la sagesse, ancré dans le sol et migrateur, enraciné et voyageur. L’arbre qui ne meurt pas résiste à tous les désastres, construisant, dès la Genèse, le mythe de la colombe messagère de la paix. Lorsque Noé la lâche au bout de 40 jours, elle revient avec un rameau d’olivier dans le bec. Les eaux sont en train de descendre.
L’évolution de l’olivier colombien montre que la culture européenne peut continuer à dialoguer avec sa propre histoire en Amérique latine, certes définissable comme cet « événement révoltant qui transforme le monde nouvellement conquis en salle de torture », selon la formule de Walter Benjamin, qui aura encore une fois le dernier mot de ce récit. Mais la « Conquista » a parfois permis l’épanouissement d’une culture nouvelle, qui se démultiplie et s’enrichit par la rencontre de l’autre.
C’est en réalité Bertolt Brecht qui aura ici le dernier mot, en poème, dans L’ABC de la guerre.
« Toi, l’olivier, qui de ton feuillage clément
Couvres si bien les meurtriers de tes frères
Tu es souvent comme ces femme coiffées de blanc
Qui soudent les bombes pour un petit salaire. »
Bruno Tackels
Le Fournil, Tinjacá, décembre 2023