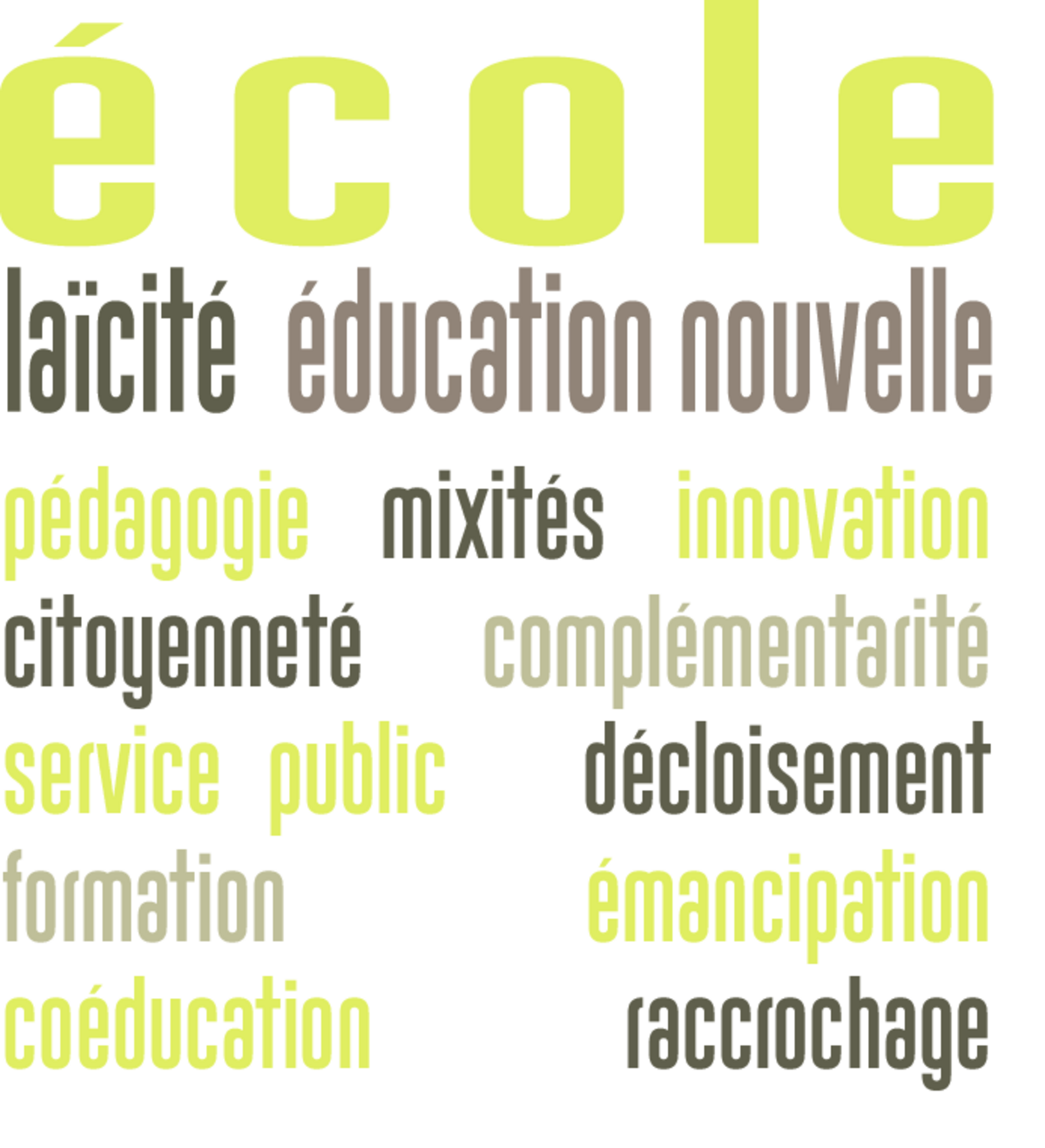
Agrandissement : Illustration 1
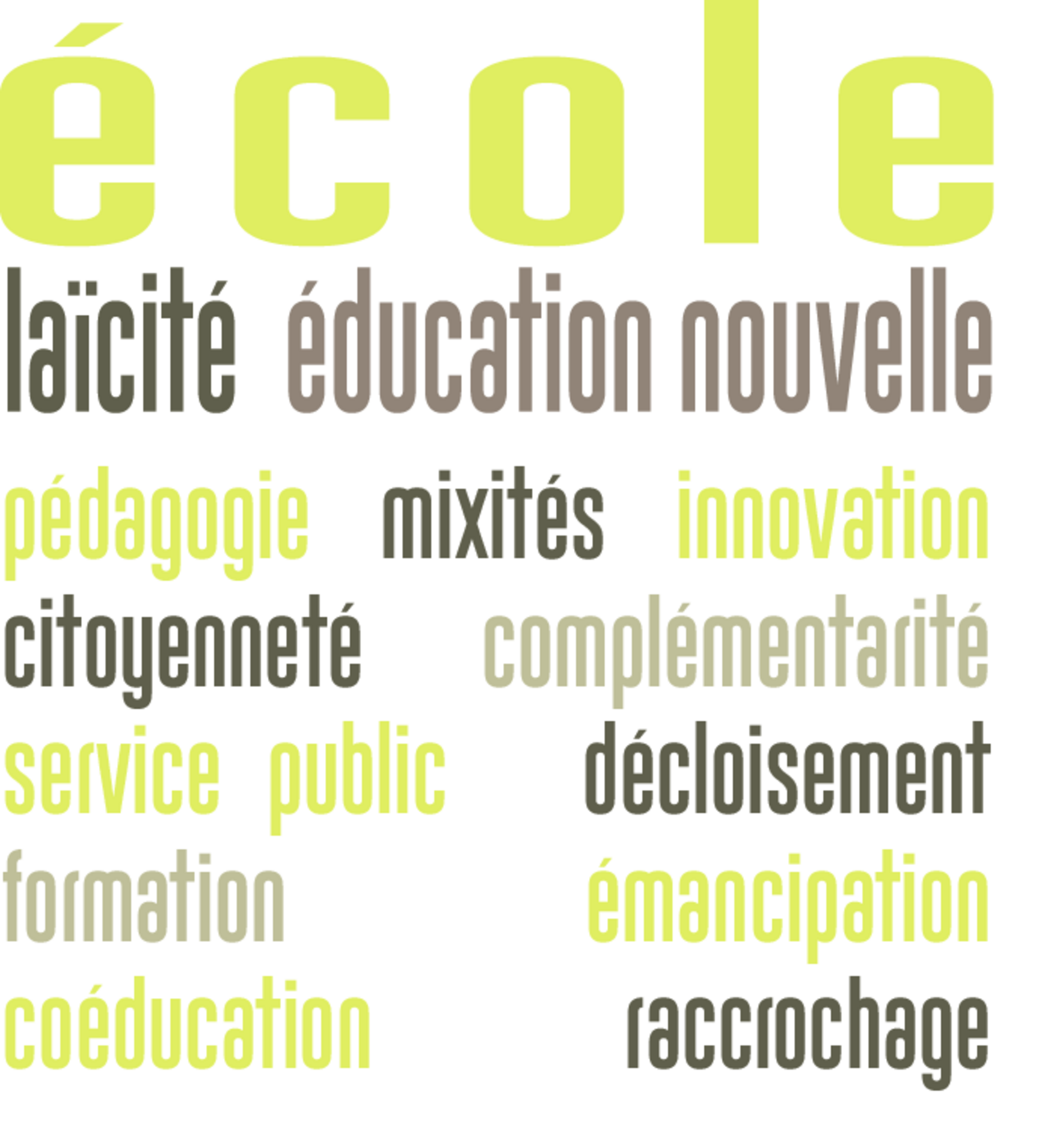
Étymologiquement, le préfixe « peri » vient du grec et signifie « autour de ». Mais dans les contes persans, ce mot de « péri » désigne un génie, qui pourrait être assimilé aux fées de nos contes populaires. Amusant et heureux hasard de la linguistique, car le périscolaire ne se définit pas seulement par sa proximité temporelle avec l’école. Il représente bien plus que cela. Le périscolaire est un vrai moment éducatif, avec un rôle social important. Il ne se contente pas d’accompagner l’école, il en est complémentaire et participe à une éducation plus globale.
La réforme des rythmes scolaires de 2012 a mis un coup de projecteur sur ce temps périscolaire, que l’on a semblé redécouvrir pour l’occasion. Pourtant ces moments entourant l’école ont une longue histoire. Un temps qui a souvent été géré par les enfants eux-mêmes. « Quand quatre heures sonnèrent, qu’ils eurent filé à la maison prendre le chanteau de pain habituel et qu’ils se trouvèrent de nouveau rassemblés à la carrière à Pepiot… » Dans La Guerre des boutons, Louis Pergaud raconte la vie d’enfants au début du XXe siècle : les batailles picrocholines entre villages, l’organisation du groupe, la construction de cabanes. Aujourd’hui, si en tant qu’adultes, nous repensons aux moments où nous n’étions pas à l’école, ce ne sont pas des parenthèses, mais souvent des temps forts de rencontre avec d’autres. Des temps informels, comme lorsque l’on se retrouvait simplement pour jouer, ou des temps structurés autour d’activités diverses. Mais aussi des temps qui permettaient parfois de ne rien faire, une forme d’activité qui n’est pas sans importance dans la construction personnelle.
La prise en compte institutionnelle de ce temps périscolaire s’est longtemps cantonnée à un temps d’étude, qui permettait aux enfants de rester une heure de plus à l’école, pour faire leurs devoirs, encadrés par des enseignants rémunérés par les communes avec un accord de l’Éducation nationale. Cela a marqué l’inconscient collectif en assimilant dans l’esprit des gens le temps après l’école avec le travail encadré pour les devoirs. Ce qui n’est pas toujours simple à faire évoluer.
Dans de nombreuses communes, ces temps d’avant et après l’école, ainsi que ceux de la pause méridienne avaient été organisés bien avant la réforme des rythmes, avec la collaboration de services municipaux, de MJC et d’associations. Nous avons publié plusieurs articles sur les rythmes scolaires, notamment en 1996 (Ven 482) et plus récemment en 2013 dans Ven 551 (La laïcité aujourd'hui : principes et enjeux fondateurs) .
La réforme de 2012 en rendant obligatoire et en généralisant une prise en compte, même partielle, de ces temps éducatifs a, de fait, amené à réinterroger la globalité de l’éducation. Les enjeux de ces temps périscolaires sont multiples. Ils amènent à repenser le temps de l’enfant comme un tout. Jusqu’alors, les espaces avaient tendance à être cloisonnés. Les activités périscolaires nous poussent à une réflexion plus globale. Pour autant, il ne s’agit pas de faire l’école en dehors de l’école ou de faire de l’animation à l’école. Les fonctions et les missions de chacun et chacune sont bien distinctes, mais elles participent à leur échelle et dans leur environnement à une globalité éducative.
La reconnaissance des temps périscolaires rappelle qu’utiliser l’informatique, lire, écrire des histoires, faire des activités physiques, des arts visuels… ne se font pas seulement dans le cadre scolaire. Pratiquer des activités dans différents temps et avec différents objectifs ne s'oppose pas ; c'est une démarche complémentaire et constructive. Ce que les enfants vivent et apprennent à l’école influence ce qu’ils vivent et apprennent durant les temps périscolaires ou avec leurs familles et vice-versa. Cette interaction permet aux enfants de créer du sens et du lien dans et entre ce qu’ils apprennent. Cela amène aussi à mettre en synergie les différents partenaires éducatifs, qu’ils soient animateurs, enseignants, parents, élus…
Des activités périscolaires pour quoi faire ?
Cependant dans la mise en place de cette réforme des rythmes, la forme a parfois eu tendance à prendre le pas sur le fond. Dans beaucoup de situations, l’accent est davantage mis sur le comment et ses contraintes organisationnelles que sur le pourquoi.
La vitrine que représente l’activité peut aussi être un écueil. La tendance a parfois été de mettre en avant des activités « nobles » et valorisantes nécessitant le recours à des professionnel.le.s formé.e.s spécifiquement à celles-ci, plutôt que réfléchir à la valorisation de l'existant, de l'environnement associatif proche des écoles, nécessitant moins de déplacements et - ce qui n'est pas sans importance - moins coûteux...
Les Projets éducatifs de territoires (PEdT) ont été pensés pour permettre la mise en musique des différents temps et espaces et la mise en mouvement des différent.e.s professionnel.le.s concerné.e.s. Ces dernie(è)r.e.s doivent s'en emparer pour adapter le fonctionnement des structures à la réalité et aux besoins des enfants de la commune et par là même interroger le pourquoi de ce qui est organisé. Cela peut être l’occasion de dépasser un certain formalisme et de mener une réflexion en profondeur sur la place de l’enfant dans le système éducatif en s’appuyant sur le réel.
Le temps périscolaire doit être avant tout envisagé en termes de réponse aux besoins des enfants. C'est ce qui lui donne son sens profond.
Ainsi, laisser du temps aux enfants pour s’organiser entre eux, en garantissant leur sécurité et en laissant du matériel et des jeux à leur disposition, peut selon les situations et les moments, correspondre à un besoin aussi important que faire du cheval ou des marionnettes. Permettre aux enfants de ne rien faire, de rêver, rêvasser peut correspondre à un besoin aussi important que n'importe quelle autre activité.
Formation, espaces et travail en équipe
La généralisation des temps périscolaires pose également des questions par rapport au statut et à la formation de ces animateurs et de ces personnels qui interviennent quelques heures par jour. On le sait aujourd'hui, une formation certifiée n'a pas toujours été exigée ; beaucoup d'employeur.se.s se sont contentés de recruter des titulaires du Bafa ; dans les écoles maternelles, les Atsem ont vu leurs missions se modifier en endossant le rôle d'animatrices sans forcément avoir été préparées à cela.
Si on peut affirmer que jamais les métiers de l'animation n'avaient éveillé autant d'intérêt pour les médias, les formations et conditions de travail des animateurs et animatrices n'avaient été autant commentées, on ne peut pour autant se réjouir de la réalité du quotidien de ces professionnel.le.s qui dépend beaucoup, il faut bien le dire, des décisions de leurs collègues enseignant.e.s. Mais déjà, parler de « collègues » n'est pas le mot juste !
Si animateur.rice.s et enseignant.e.s sont amené.e.s à partager un même espace, il y existe une hiérarchisation des droits des un.e.s sur les autres. L'espace classe est devenu aussi par défaut - on ne peut pousser les murs - l'espace des temps d'activité sans pour autant que cela soit pensé, réfléchi et anticipé. C'est un des chantiers à ouvrir dès demain : repenser l'architecture des écoles pour en faire des lieux où l'ensemble des professionnel.le.s y intervenant y ait sa place, ses espaces. Et en finir, comme c'est encore massivement le cas aujourd'hui, avec la domination du temps scolaire sur les autres temps qui implique la relégation des activités périscolaires dans des interstices consentis du bout des lèvres.
Pour cela, l'évolution des cultures professionnelles est fondamentale aussi bien du côté des enseignant.e.s que du côté des animateur.rice.s mais aussi des élu.e.s, des parents... Les Espé (écoles supérieures du professorat et de l’éducation) semblent être l'espace idéal pour avancer sur ce point. À condition que le E final d'éducation, ne se limite pas à celui du CPE (conseille(è)r.e principal.e d’éducation) mais soit bien le E de l'éducation globale, celle qui ne concerne pas que les temps dits formels. Les Espé pourraient jouer ce rôle en donnant la possibilité aux different.e.s profesionnel.le.s concerné.e.s d'avoir des temps de formation communs autour d'objets communs. Sans vouloir que la formation des animateur.rice.s y soit dispensée, il serait tout à fait envisageable de créer les conditions, dès la formation initiale, de rencontres pédagogiques. Ces conditions indispensables à la connaissance et reconnaissance mutuelles. Cela amènerait les différent.e.s acteur.rice.s éducatif.ve.s à travailler ensemble plus naturellement et non plus à travailler les un.e.s avant/après les autres, à la chaîne...
L'éducation globale ne peut vivre sans un même projet éducatif, sans un cadre et des temps communs pour le penser, l'élaborer, échanger. Les Projets éducatifs de territoire (PEdT) devraient contribuer à cette dynamique.
Le conseil d'école peut devenir a minima le lieu institutionnel de la rencontre et du partage intelligent des ressources et pourquoi pas, a maxima, le lieu de pilotage d'un projet collectif pour un lieu et un temps où la continuité est trop souvent seulement portée par les seuls usagers... les enfants ! Pour cela, il doit donc évoluer dans sa composition et son fonctionnement et s'élargir aux acteur.rice.s et aux temps du périscolaire.
Se reconnaître, se former ensemble, construire des projets et agir ensemble sont autant de conditions à la réussite de tous les enfants. La prise en compte du temps périscolaire est un pas essentiel vers une éducation plus globale et porteuse de sens. Un projet ambitieux qui ne fait que commencer. Un projet à poursuivre...
Cet article est issu de la revue Vers l'éducation nouvelle, n°565, Le péri-scolaire en quête de sens



