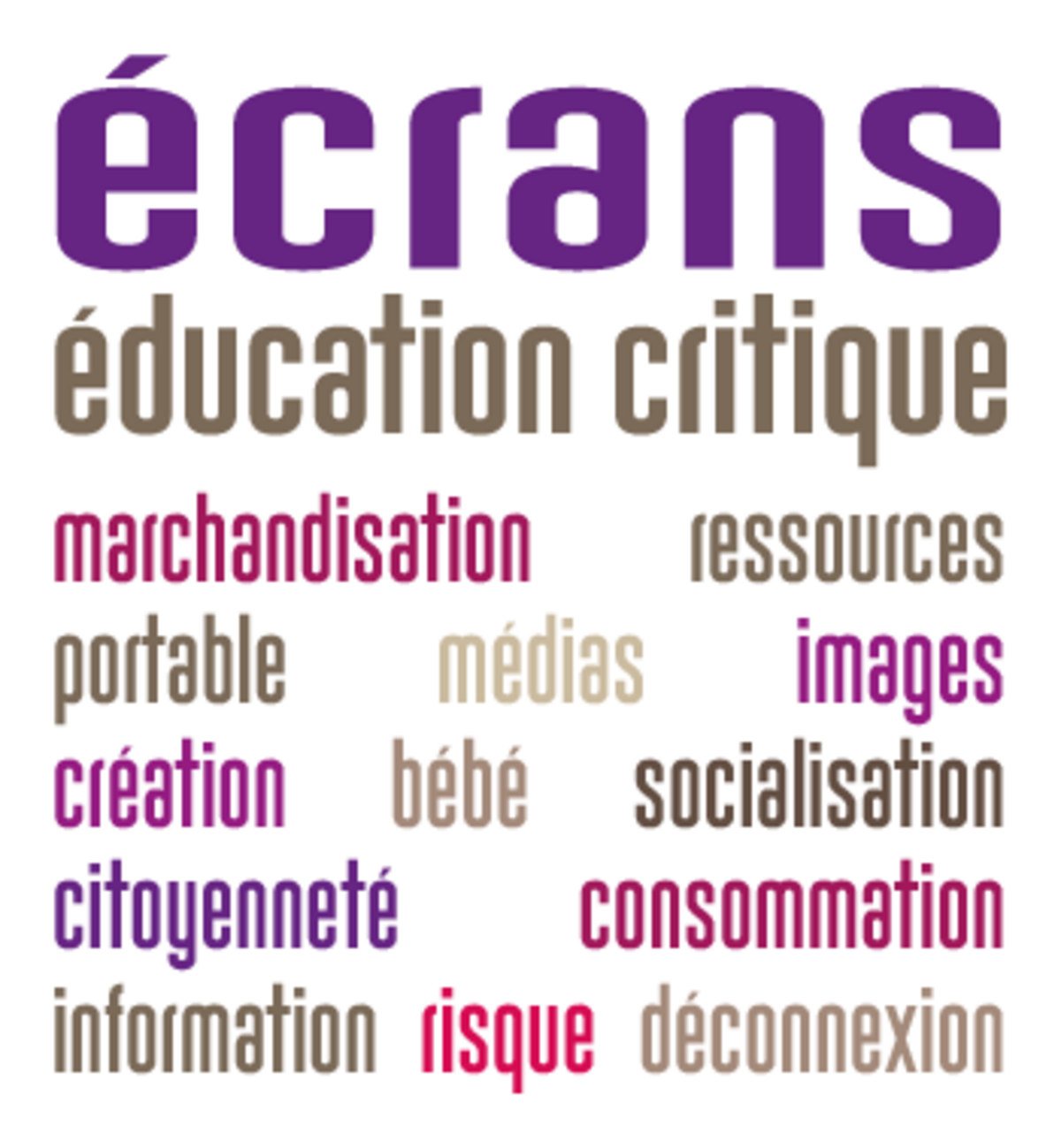
Suite à la publication des résultats de la première enquête quantitative en 2014, des entretiens qualitatifs ont été conduits en mars 2015 auprès de 50 jeunes de 16-17 ans, fréquentant des filières professionnalisantes et ayant bénéficié du dispositif « Éducation aux écrans ». Ils permettent de mieux comprendre la configuration des pratiques et la réalité des risques encourus par ces adolescents et de mieux dessiner les accompagnements à consolider.
Ce sont les résultats de cette deuxième enquête qui seront présentés dans ce rapport.
L’enquête qualitative réalisée en 2015 auprès de jeunes engagés dans des filières professionnalisantes a approfondi les modalités d’usage des réseaux sociaux et a permis de dresser 6 constats :
1. Le recours à l’image (photo et vidéo) dans les communications interpersonnelles est de plus en plus fréquent.
2. Il occasionne une plus grande exposition de soi et une vulnérabilité au regard des autres, que les jeunes tempèrent en adoptant une attitude de retrait et en limitant le nombre de leurs amis sur certaines applications (Snapchat en particulier).
3. Il permet aussi des pratiques « d’espionnage » devenues courantes, sur le fil d’actualité de Facebook ou sur les « stories » de Snapchat.
4. Les RSN sont consultés le plus souvent sur le téléphone portable, les notifications rythment le temps de beaucoup de jeunes et suscitent une sensation d’envahissement et d’ennui. La déconnexion qui s’impose pour des raisons externes (établissement mal connecté, téléphone qui se casse) est souvent vécue comme une libération.
5. L’accès à l’information sur le fil d’actualité des RSN propose pêle-mêle des « actualités » totalement disparates, informations privées sur la vie des copains, alertes diffusées par les médias d’information auxquels sont abonnés les adolescents (Le Monde, le Figaro, Ouest France…), les vidéos de gags ou de bastonnades recommandées par les contacts Facebook.
6. Le harcèlement sur les RSN est fréquent, les adolescents se sentent démunis pour y faire face, écrasés par le sentiment de faire partie d’une foule et de ne pas pouvoir faire grand-chose ; le conformisme au groupe les incite souvent à rendre les filles qui en sont victimes responsables des malheurs qui leur arrivent.
Retrouver l'enquête complète : http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1382



