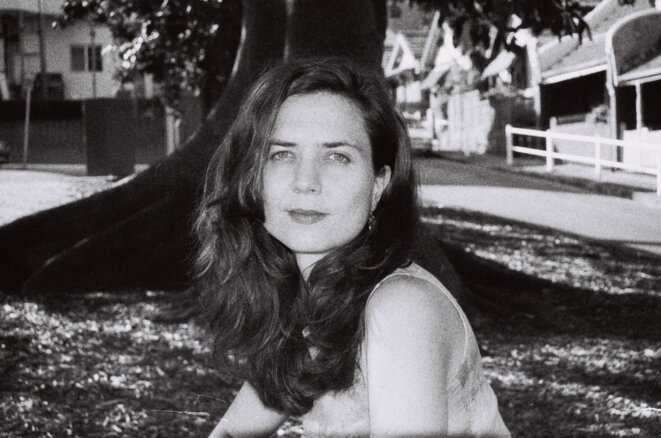La loi interdisant le port à l’école publique de vêtements ou de signes manifestant une appartenance religieuse vient se rappeler vivement à nous à nouveau avec la dernière polémique sur les abayas (et les qamis, j’y reviendrai). Cette loi aura vingt ans l’année prochaine. C’est l’occasion de revenir sur la loi elle-même, et de se poser la question de ses effets sur le corps social et politique.
Une des fonctions principales d’une loi est d’apaiser ce corps social en résolvant les questions qui y font tension et qui génèrent des conflits.
Commençons par un bref rappel des maillons de l’élaboration de la loi. Elle fût adoptée en 2004 ‘en application du principe de laïcité’, qui est lui-même un pilier de la construction de l’État-nation français, et dans le sillage de l’affaire de Creil de 1989 où trois jeunes filles furent renvoyées de leur établissement scolaire après avoir refusé de retirer leur voile en classe.
La question que la loi 2004 était censée mettre au repos est la suivante : le fait d’exprimer à l’école, donc dans l’espace commun de la République, par le port d’un vêtement (ou d’un signe) son appartenance à une religion, donc à un corps particulier, met-il à mal le vivre-ensemble, qui présuppose, lui, de se reconnaitre comme membre à part entière d’un corps plus général – la France.
La loi a-t-elle mis la question au repos ?
Avec vingt ans de sa mise en application, force est de constater qu’elle est au contraire génératrice de conflits. Son effet principal semblerait être d’avoir fait se répéter la situation première qui déclencha son développement initial, à un vêtement près, et rallongeant ainsi sans cesse la liste des vêtements qui tombent sous l’interdit républicain : voile, bandana, jupe longue, burkini, burqa, et, le dernier en date, l’abaya…
Une loi qui nous enferme dans un scénario à répétition, sans perspective d’une issue apaisée est une loi mortifère.
Il est donc temps d’admettre que la réponse apportée par la loi 2004 n’était pas la bonne. Cette réponse a consisté à inverser la charge de la responsabilité qui est inscrite au cœur du principe de laïcité, en la faisant reposer sur les épaules des écoliers plutôt que sur celui des agents de l’État : à eux de faire preuve de discrétion dans leur tenue vestimentaire, et de démontrer par là leur aptitude au vivre-ensemble.
La loi 2004 a entériné une laïcité intransigeante et étriquée, tellement peu sûre d’elle qu’elle ne peut s’accommoder de l’expression des différences. Cette version de la laïcité repose, de plus, sur un présupposé – ou plutôt un fantasme – bien compris, mais qui ne s’admet qu’à demi-mots : à force d’être empêchées dans leur expression, ces différences vont bien finir par disparaître, produisant ainsi un corps social bien lisse bien homogène.
Or, comme le constatait récemment la sociologue Agnès De Féo dans une tribue du Monde, loin d’effacer l’expression de l’islam dans notre société, la loi 2004 n’a fait qu’en décupler l’expression visible.
Il est bon de rappeler que la loi 2004 prenait le contrepied du Conseil d’État, le conseil des sages de la République, qui, lorsque, il avait été saisi sur la question par le Ministre de l’Éducation (en 1989), avait au contraire établi que ‘le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité’ ; ajoutant que l’enseignement public devait être ‘dispensé dans le respect’ et de ‘la neutralité de l’ensemble des services publiques’ et ‘de la liberté de conscience des élèves’ (Avis du Conseil d’État No 346963, 27 Novembre 1989).
Au début des années 2000, la loi était déjà un instrument clef dans la croisade de ceux que l’anthropologue des religions et spécialiste des questions d’islam Bruno Étienne appelait ‘les intégristes du laïcisme.’ Le laïcisme, c’est cette inversion de la laïcité bien comprise, qui impose une neutralité aux agents (adultes, donc) de l’État et non aux enfants de la République. Cette neutralité est ce qui permet le vivre-ensemble, ce qui rend possible le fait de faire corps social et politique malgré les différences. Elle n’a jamais eu comme visée d’étouffer les différences, à commencer par celles qui s’expriment dans les tenues vestimentaires.
Que vaut une loi qui, loin d’apporter l’apaisement, ne fait qu’attiser la volonté de la transgresser ? C’est le propre des lois coercitives. Ce qui est certain, c’est que celle-ci n’a fait qu’aiguiser le désir de trouver des façons de la contourner. Il est donc temps de se demander si une loi qu’on a de cesse depuis deux décennies d’essayer de contourner – avec le bandana, la jupe longue, et maintenant (nous dit-on) l’abaya – est vraiment la loi qu’il nous faut.
Avec sa dernière polémique en date, crée de toutes pièces par une circulaire ciblant spécifiquement l’abaya (et le qamis), c’est exactement sur le pouvoir attractif du potentiel transgressif qui inhérent aux lois coercitives que le gouvernement appuie.
Ceux qui ont mis l’accent sur l’abaya plutôt que le qamis ne s’y sont pas trompés : malgré l’ajout à la dernière minute par Gabriel Attal de ce vêtement masculin pour donner les apparences que le gouvernement (contrairement aux intégristes !) fait le jeu de l’égalité femme-homme, c’est d’abord et toujours, ne l’oublions pas, le corps de la femme et ce qu’elle porte qui est policé avec cette loi et ses petits ajustements. Pire, c’est la possibilité que par ce corps elle puisse - diable ! - exprimer son désir. Y compris celui de porter le voile.
Ironie suprême: La loi 2004 est une mauvaise mise en application d’un cadre que nous nous accordons tous à défendre.