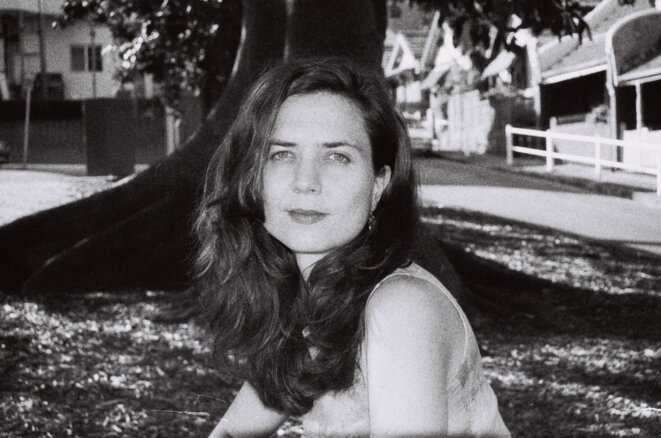Lundi 13 novembre 2023, le djihadologue Hugo Micheron était l’invité de l’emission Les Matins de France Culture à l’occasion du huitième anniversaire des attentats du Bataclan. Une demi-heure d’interview pour rappeler, sur fond d’une guerre atroce sur Gaza et de manifestations contre cette guerre de part le monde, que le djihadisme reste une « menace » sur l’Europe. Un « cycle de marées » alimenté par des « machines de prédication » qu’il ne faut oublier sous aucun prétexte, comme le montre l’assassinat d’un enseignant à Arras en octobre dernier. Nous ne sommes, d’après Micheron, qu’en « marée basse ».
Jetterait-il de l’huile sur le feu d’un débat publique déjà explosif ? Absolument pas, suggère l’expert en djihadisme. Micheron se présente comme la voix de la raison ; il assied son autorité avec de maintes références au « savoir » et à ses « recherches », mâtiné d’un accent arabe bien rodé pour décocher les noms de ses objets d’étude.
C’est justement ce mélange d’apparente modération et d’agitation de la menace qui suscite notre méfiance. Au-delà de multiples affirmations pour le moins questionables, le discours de Micheron est un excellent exemple d’un phénomène bien connu des chercheuses et chercheurs en relations internationales (RI) et en politique de sécurité : la sécuritisation.
Le terme a été conçu pour souligner que les menaces sécuritaires ne naissent pas comme telles ; elles le deviennent. Ce ne sont que des problèmes sociopolitiques parmi d’autres avant qu’on les sécuritise: qu’on les désigne comme des menaces existentielles contre lesquelles il faut prendre toutes les mesures possibles, sans quoi nous ne serons plus là pour en parler.
La théorie de la sécuritisation
Petite révolution dans l’histoire des RI et surtout des « security studies », la securitization theory fût inventée en 1995 par le théoricien des RI danois Ole Wæver, figure clef de « l’École de Copenhague des études de sécurité ».[1] C’est lui le premier qui proposa un paradigme, inspiré des travaux de Jacques Derrida, qui réussit à briser le carcan « américain » qui régulait jusqu'à la fin des années 1990 l’étude de l’objet sécuritaire, et qui restait focalisé sur une violence physique et militaire -- et qui fit que la France ne s’intéressa jamais vraiment aux RI, mais ça, c'est une autre histoire.
Les rouages de la sécuritisation sont en fait déjà bien connus du grand public. Ils forment le moteur bien rodé (d’aucuns diraient: cliché) de la plupart des films d’action. Face à la menace planétaire d’une organisation sournoise et tentaculaire, qui s’en remettrait à la démocratie et à l’état de droit plutôt qu’à l’héroïsme de Tom Cruise dans Mission Impossible ? La procédure politique normale est impuissante face à certains ennemis, dans ce genre cinématographique ; seules des mesures exceptionnelles peuvent nous sauver.
Lorsque la sécuritisation s’installe dans le débat public, elle est corrosive pour la démocratie et pour notre capacité à débattre librement. Son but n’est pas de présenter les faits de manière objective, mais de justifier le sacrifice de valeurs – la liberté, l’égalité, la démocratie, le respect de chacun – au nom de la lutte contre une menace, ici le terrorisme. Car sans ces quelques concessions sur nos valeurs, la menace aurait définitivement raison d’elles, et de nous. La sécuritisation est une sorte de point Godwin : c’est un geste de la parole face auquel l’argumentation posée devient impossible.
Micheron insiste sur le fait que la lutte contre le djihadisme doit désormais moins passer par le sécuritaire traditionnel (le fait de déjouer des attentats), que par la question de l’idéologie. Et c’est bien le propre de la sécuritisation que de dresser des menaces flottantes, insaisissables, loin des menaces militaires bien définies qui caractérisaient encore le 20è siècle. Le geste sécuritisant de Micheron instrumentalise l’Europe et ses libertés (d’expression et de circulation, entre autres) en insistant sur des « machines de prédication » virulentes, inexorables, agissant dans l’ombre, et contre lesquelles l’État ne peut pas faire grand-chose. D’où le rôle des « citoyens », selon le djihadologue, même s’il reste vague sur ce que tout un chacun pourrait faire pour endiguer le terrorisme.
Ces non-républiques d’Europe du Nord où le djihad ferait (secrètement) rage
Le premier point qui nous intrigue, écrivant depuis le Danemark, est l’insistance de Micheron à mettre en exergue ce petit pays nordique qui « n’est pas une république » mais bien pourtant une démocratie, qui n’a pas « d’histoire coloniale vis-à-vis du monde musulman » et « une immigration plutôt récente ». La raison de cette fixation sur le Danemark nous est apparue le lendemain quand y fût annoncée l'ouverture de débats parlementaires sur un projet d'une loi « ciblée » (l’expression a déjà fait couler beaucoup d’encre) qui s'apparente à une loi sur le blasphème, en réaction aux actes de provocations d'un activiste de l’ultra-droite à la double nationalité danoise et suèdoise qui a récemment brûlé des exemplaires du Coran devant les parlements du Danemark et de Suède (cette autre non-République !). [2]
Le Danemark serait, dans le discours sécuritisant de Micheron, le deuxième exportateur européen de djihadistes rapporté à la population. Pour contexte, le Centre International pour le Contre-Terrorisme de la Haye, publiait en 2016 un rapport sur les combattants djihadistes issus d’Europe. Un an avant la libération de Mossoul qui mit un terme aux départs vers le Moyen-Orient, les deux pays européens d’où provenaient le plus de combattants étrangers étaient la Belgique (41 par million d’habitants) suivie de l’Autriche (31 par million). La Suède (28 par million) et le Danemark (22 par million) occupent la troisième et quatrième place, suivis par la France (14 par million).
Montrer l’arbre pour cacher la Forêt
Un geste sécuritisant consiste à porter une loupe grossissante sur certains faits et pas d'autres. Avec entre 300 000 et 800 000 marcheurs (selon les sources), la manifestation pro-palestinienne du samedi 11 novembre à Londres fût une des plus grandes de l’histoire de la capitale Britannique; elle se déroula, qui plus est, dans un grand calme, ponctué seulement d'une poignée d'arrestations de contre-manifestants d’extrême-droite. D'un coup de ‘Londonistan’ bien placé, Micheron balaye la signification politique de cette manifestation, qui menera tout de même à un remaniement ministeriel et au limogage de la ministre de l'Interieur, Suella Braverman. Pour Micheron, le fait marquant fût la présence de quelques sympathisants d’un certain groupe islamiste, le Hizb-ut-Tahrir (entendre: /ħizbutːaħriːr/). Cette organisation quiétiste pour laquelle le califat doit s’établir dans la paix et sans les armes, aurait agité quelques bannières !
Cette gestuelle est usuelle – et usée. Un de nos collègues spécialistes du djihadisme ici au Danemark a lui aussi eu droit au coup de fil: après près d’un mois de manifestations pro-palestiniennes quotidiennes quasiment passées sous silence dans la presse, voilà la curiosité journalistique piquée par la présence, samedi dernier, au cours de la plus grosse, de quelques membres – vous l’aurez deviné – du Hizb-ut-Tahrir.
Convaincre : l’importance de la réception de l’acte sécuritisant
La sécuritisation se nourrit de mots et de sujets déjà sécuritisés par le passé. Et quelle menace existentielle plus emblématique dans un esprit français que le nazisme durant l’Holocauste ? Mais un acte sécuritisant est toujours un pari, un quitte ou double. Échouer à convaincre son auditoire revient à crier au loup : c’est une perte de crédibilité qui peut être fatale. D’où le jeu prudent de Micheron qui, évoquant les tribunaux de Nuremberg pour traiter la question des jihadistes européens encore présents en Syrie, s’empresse de rajouter « toutes proportions gardées ». Quand le journaliste Guillaume Erner lui demande si le Hamas est « antisémite », le djihadologue, sentant le piège, esquive. Peut-être pour éviter le sort de Caroline Fourest, qui, dans l’entrain de sa défense d’Israël, a basculé en direct dans la relativisation de la mort d’enfants palestiniens ?[3]
Dr Micheron s’inscrit dans la lignée de ceux, Bruno Etienne les appelait « les intégristes du laïcisme », qui défendent une lecture bien particulière de la laïcité, et dont la figure phare est son directeur de thèse Gilles Kepel (auteur egalement de l’expression « djihadisme d’atmosphère »). Dans la sphère médiatique, on retrouve des personnages comme Caroline Fourest ou encore Raphaël Enthoven, et plus généralement les contributeurs au magazine Franc-Tireurs. Après avoir dominé la sphère publique des années durant, ce movement semble aujourd'hui battre en retraite. Comme son object d'étude. La voie est donc libre pour que Micheron reprenne le flambeau. Pratique, quand on vient de publier un livre sur la question.
Vic Castro est chercheur en RI à l'Université de Copenhague.
Charlotte Epstein est professeure de RI et de théorie politique à l'Université de Sydney, et actuellement en détachement au Danish Institute for International Studies (DIIS).
[1] Ole Wæver (1995) “Securitization and Desecuritization”, in On Security, edited by Ronnie Lipschutz, pp.46-86, New Yok: Columbia University Press.
[2] Le Parlement danois étudie une proposition de loi contre le « traitement inapproprié de textes ayant une signification religieuse majeure pour une communauté de croyance reconnue » (utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund).
[3] https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2023/11/01/l-arcom-saisie-pour-des-propos-tenus-dans-les-medias-autour-de-la-guerre-entre-israel-et-le-hamas_6197662_3236.html