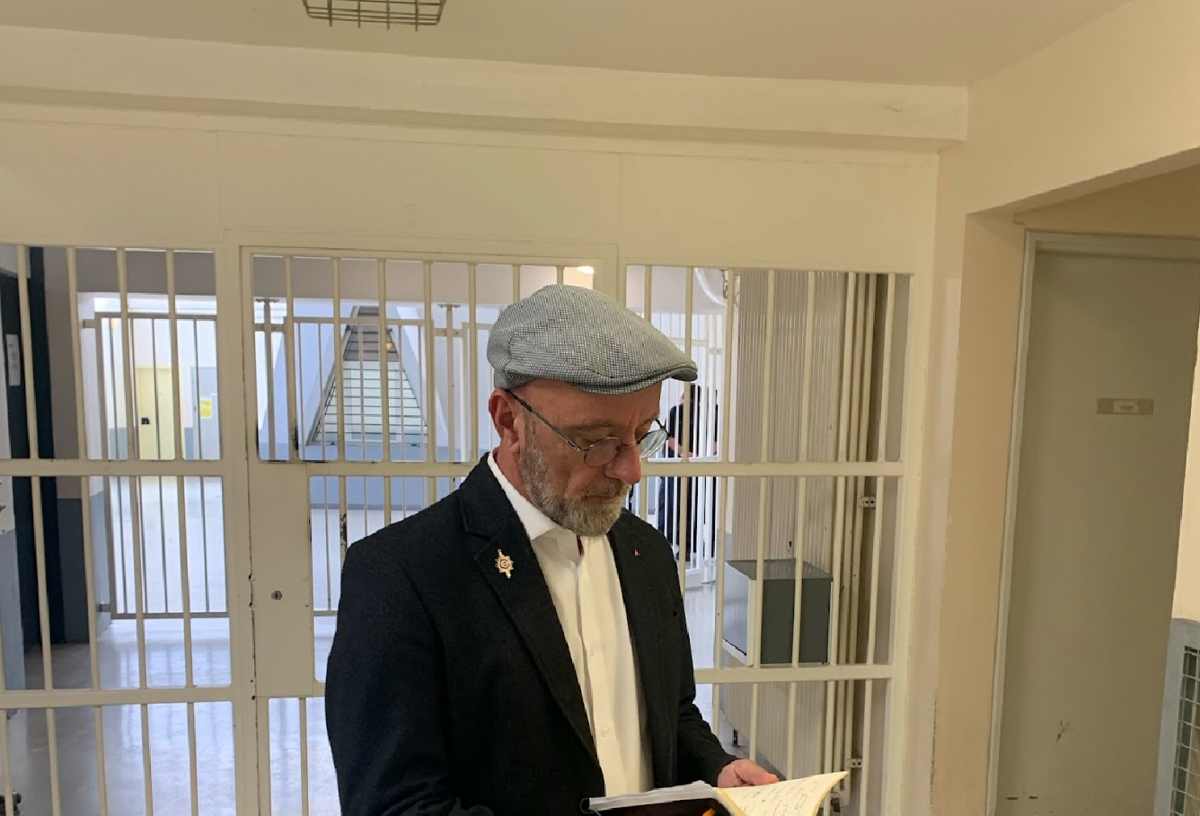
Agrandissement : Illustration 1
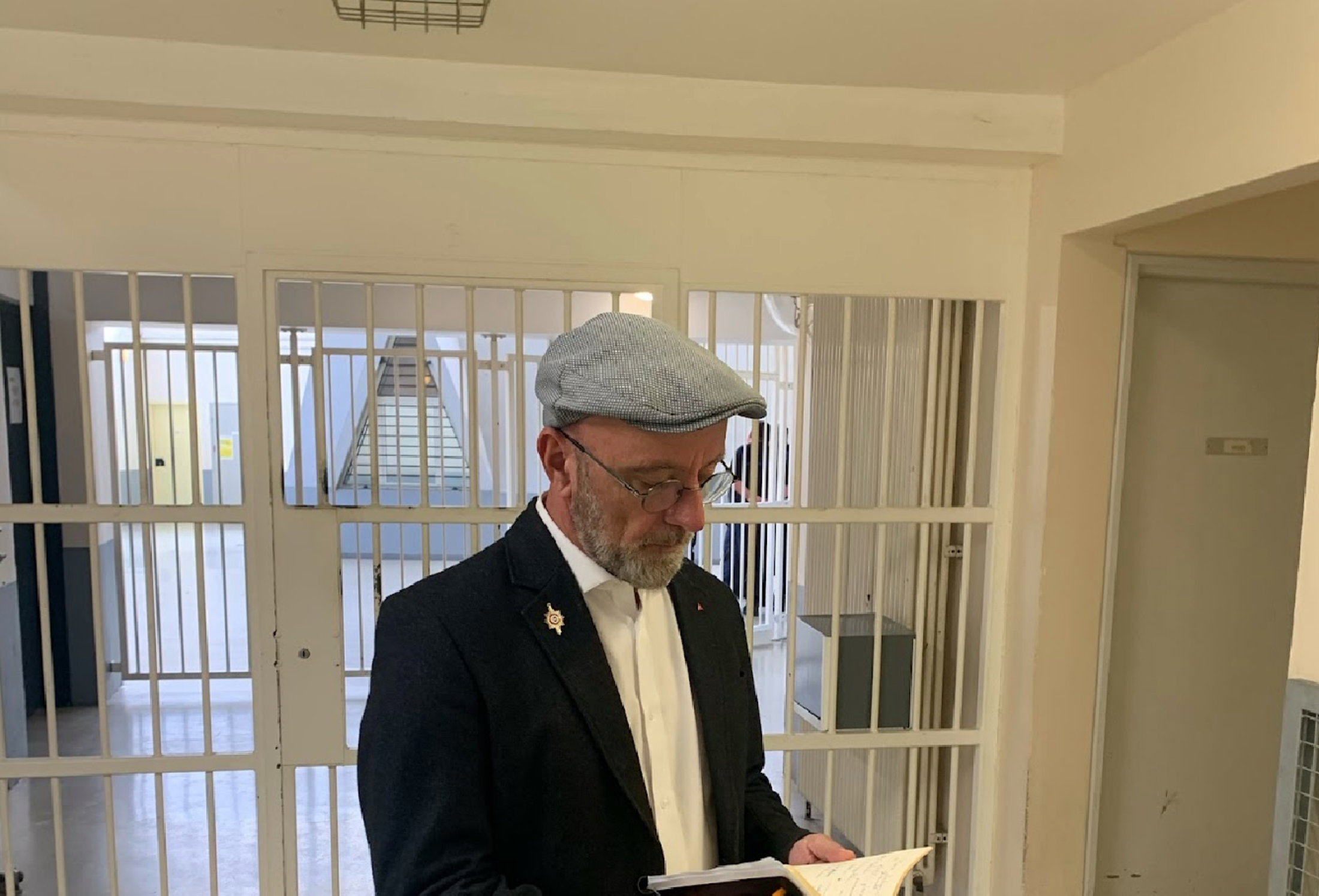
Les propos du Ministre entretiennent la méconnaissance de l’opinion publique des enjeux carcéraux, et des véritables problèmes que connaissent la justice et la prison dans notre pays. Assurer la sécurité de nos concitoyen·nes en leur garantissant une justice efficace et équitable, et protéger la société des criminels sont nécessaires. Mais cette sécurité dépend également des enjeux propres au système carcéral : à savoir les moyens mis en œuvre pour préparer à la réinsertion, à l’heure où le taux de récidive est en nette progression.
Une justice à bout de souffle
Il n’est pas possible de décorréler les problématiques carcérales de la question judiciaire. En effet, la justice française manque cruellement de moyens et d’effectifs. Les syndicats estiment que pour que la Justice française fonctionne correctement, il faudrait purement et simplement doubler le nombre des effectifs par fonction (voire par trois pour certaines fonctions). Ce manque criant d’effectifs a pour résultat un engorgement complet de la justice, et se répercute sur la question carcérale. En effet, aujourd’hui 26% des personnes incarcérées sont des prévenu-es en attente d’un procès. Le manque d’effectif dans le milieu de la Justice rallonge les temps de traitement des dossiers, et donc les temps de procès, un préjudice à la fois pour les victimes qui attendent une décision de justice pendant des années, et des prévenus qui remplissent les prisons.
Ainsi, les fonds alloués à la Justice ne sont pas suffisants. Le montant inédit de 10,1 milliards d’euros qui a été annoncé en 2024, est largement orienté vers l’extension des programmes immobiliers pénitentiaires, et ne met pas l’accent sur le rôle de la justice et des moyens alloués à la magistrature.
Des conditions de détention qui posent question
La France est régulièrement pointée du doigt pour les conditions de détention de ces prisons. La problématique principale étant la surpopulation carcérale. Le ministère de la justice a publié les indicateurs au 1er janvier 2025. Les prisons françaises comptent à cette date 80 669 personnes détenues pour une capacité opérationnelle de 62 385 places, soit une densité carcérale de 129,3 %. Dans les maisons d’arrêt où sont incarcérés les prévenus en attente de jugement, ce taux atteint 156%, voire 200% dans quatorze établissements.
Cette surpopulation, dans des infrastructures vétustes et insuffisantes conduit à une situation, que la Défenseure des Droits a qualifié d’”alarmante”. En effet, cela signifie que les détenus sont entassés dans des cellules non prévues à cet effet, qu’ils dorment sur des matelas posés sur le sol (4 310 au 1er janvier 2025), sans bénéficier de la moindre intimité. En outre, cela entraîne des problèmes comme les infestations de nuisibles, et un climat global de violence qui nuit à la sécurité, à la santé mentale des détenus et du personnel pénitentiaire.
Elles nuisent également au bon fonctionnement de l’incarcération : d’une part parce qu’elles nuisent au travail du personnel mais aussi parce que ces conditions augmentent le caractère criminogène de la prison, à rebours de ce qu’elle devrait être. Une maison d’arrêt où les courtes peines s'exécutent ne doit pas être une “école du crime”. Or pour éviter ce terrain propice, lutter contre ce climat de violence généralisé en luttant contre la surpopulation carcérale est nécessaire.
De plus, les conditions de détention indignes ont conduit à des condamnations répétées de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a appelé à des réformes structurelles pour remédier à cette situation.
Une fonction publique à bout de souffle
Pour compléter les difficultés de la prison, il est important d’insister sur le fait que les personnels pénitentiaires font face à des conditions de travail particulièrement difficiles, exacerbées par un manque chronique d'effectifs. L'administration pénitentiaire compte plus de 36 000 agents, dont environ 27 000 surveillants et surveillantes. Cependant, les conditions de travail anxiogènes et une trop faible rémunération rendent ces postes de la fonction publique peu attractifs. Le ministère de la Justice peine à combler ses besoins en personnel, avec près de 30 % des inscrits aux concours de surveillant qui ne se présentent pas aux épreuves, et 7 % des postes qui restent vacants. En plus de la problématique de la faible attractivité du métier, s'ajoutent des politiques d’austérité qui touchent la fonction publique, et des besoins en personnel sous estimés : en 2020 la Cour des Comptes estime qu’il faudrait 15% de surveillants en plus.
Cette pénurie entraîne une surcharge de travail pour les agents en poste, augmentant le stress et les risques psychosociaux. Surcharge d’autant plus importante que pour compléter des rémunérations peu avantageuses au vue de la pénibilité du métier, de nombreux agents cumulent les heures supplémentaires.
Ces conditions de travail dégradées affectent non seulement le bien-être des agents, mais également la qualité de la prise en charge des personnes détenues, compromettant lourdement la mission essentielle de réinsertion sociale dévolue au service public pénitentiaire.
Quelle vision avons-nous de la prison ?
La prison pour quoi faire ?
Avant tout, il est essentiel de s’interroger sur l’utilité réelle de la prison. Son rôle premier est d’écarter de la société les individus dangereux. Pourtant, il ne faut pas oublier qu’un jour, la majorité d’entre eux sortiront. Dans quel état souhaitons-nous qu’ils réintègrent notre société ? Si l’objectif est de réduire la dangerosité des détenus, alors la prison doit avant tout lutter contre la récidive en favorisant leur réinsertion.
Le personnel pénitentiaire travaille sur ce que l’on appelle les facteurs de risque, c'est-à-dire les éléments qui augmentent la probabilité de commettre des infractions : déficits cognitifs, impulsivité, comportements antisociaux, instabilité familiale, précarité ou encore faible niveau socio-économique. À l’inverse, il existe des facteurs de protection, tels que des liens familiaux solides, un environnement scolaire ou social structurant, et, à l’âge adulte, des repères comme l’emploi ou le mariage. Les activités proposées en détention ne sont donc pas de simples “loisirs” : elles constituent un véritable levier pour renforcer ces facteurs de protection. Les supprimer reviendrait à priver le personnel de réinsertion d’un outil essentiel à son travail.
Par ailleurs, le ministère de la Justice semble omettre des enjeux cruciaux, comme le suivi de la santé mentale des détenus en milieu fermé ou la lutte contre les addictions, alors même que la consommation de stupéfiants est particulièrement élevée en prison. Face aux déclarations parfois polémiques du ministre, qui traduisent un manque de connaissance du système pénitentiaire, une question demeure : quelle image de la prison voulons-nous véhiculer ? Doit-elle être un simple instrument de punition, relevant davantage d’un esprit de vengeance, ou un véritable outil de réinsertion et de prévention de la récidive ?
Comment lutter contre la surpopulation carcérale ?
La peine est souvent limitée à la prison dans l’esprit du grand public, négligeant ainsi les opportunités de travailler efficacement avec des personnes délinquantes en milieu ouvert. La loi prévoit que l’emprisonnement doit être considéré comme une sanction ou mesure de dernier recours en matière délictuelle. La probation est une démarche qui vise à mettre en œuvre des alternatives à l’incarcération. Elles constituent une réponse essentielle à la surpopulation carcérale. Plutôt que d’accumuler des détenus dans des établissements pénitentiaires déjà saturés, des solutions comme la libération conditionnelle, la semi-liberté, les travaux d’intérêt général (TIG) et la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) permettent d’assurer un suivi adapté tout en maintenant un cadre de sanction.
Pour les détenus en attente de jugement, des alternatives comme le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique réduisent le recours à la détention provisoire, qui représente une part importante de la population carcérale. L’exemple des mesures exceptionnelles mises en place durant la crise du Covid-19 a prouvé l’efficacité de ces dispositifs : en quelques semaines, la population carcérale est passée de 72 400 à 61 100 détenus grâce aux libérations anticipées et à la suspension de certaines incarcérations.
Mais ces politiques demandent des moyens conséquents, notamment en personnel chargé du suivi des condamnés, comme les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP), déjà en sous-effectif. Par exemple, si les recours à des peines alternatives comme le bracelet électronique augmentent, ce n’est pas le cas du nombre d’agents chargés du suivi de ces dossiers. Donc encore une fois nous avons des pistes sérieuses pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale, mais qui nécessitent des moyens humains conséquents, et qui ne correspondent donc pas aux régimes d’austérité appliqués à la fonction publique par nos gouvernements. Pourtant développer les alternatives à l’emprisonnement, c’est non seulement désengorger les prisons, mais aussi offrir un accompagnement plus adapté aux condamnés, réduisant ainsi les risques de récidive et renforçant l’efficacité du système pénal. Les peines de probation, qui permettent une meilleure sortie de la délinquance, sont à prioriser en matière de sanction pénale.
La nécessité de prévenir la récidive
Ainsi, malgré la surpopulation carcérale chronique en France, le recours aux peines alternatives reste sous-exploité, alors même que les courtes peines et la détention provisoire en sont les principales causes. Comme l’indique la chercheuse Corinne Rostaing dans “Une institution dégradante, la prison”, 80 % des détenus sortent après une courte peine, tandis que seulement 2 % restent plus de cinq ans derrière les barreaux. Ce constat soulève une question essentielle : l’enfermement est-il réellement la solution pour ces profils ? Et au vu des conditions de détention, est-il raisonnable de traiter de la même manière un primo-délinquant, d’un récidiviste ?
Loin de favoriser la réinsertion, la prison constitue un terreau favorable à l’embrigadement et à la radicalisation. À leur sortie, de nombreux détenus se retrouvent confrontés à des difficultés majeures : précarité, discriminations à l’embauche et manque d’accompagnement. Tous ne bénéficient pas du même accès aux aides à la réinsertion, ce qui perpétue les inégalités sociales au lieu de les atténuer.
C’est pour ces raisons que le travail des conseillers de réinsertion, de toutes les activités, qu’elles soient de loisirs, professionnelles, d’éducation, sportive, sont indispensables et font partie d’un dispositif d’ensemble visant à réinsérer un détenu dans la société. La vision d’une prison comme uniquement un outil répressif et punitif ne fait qu’entretenir un système violent et propice à la récidive.
Face à ces défis, il est essentiel de repenser l’échelle des peines et d’investir dans des dispositifs de suivi post-carcéral. Pourtant, le ministère de la Justice semble ignorer ces enjeux, tout comme la nécessité de renforcer le suivi de la santé mentale et la lutte contre les addictions en détention, alors que la consommation de stupéfiants y est particulièrement élevée. Dès lors, la prison doit-elle rester un simple outil de punition, ou bien doit-elle enfin remplir son rôle de réinsertion et de prévention de la récidive ?
En conclusion, cet édito à pour but de faire réfléchir et de lancer le débat sur ce que l’on veut de la prison. Loin des polémiques stériles lancées par un Ministre de la Justice qui joue des coudes avec l’extrême droite, il est nécessaire de réfléchir posément à la problématique carcérale. D’autant plus que l’on constate aujourd’hui l’échec alarmant du double discours qui crie à la sécurité et la répression à tout prix d’un côté, et casse la fonction publique policière, judiciaire et pénitentiaire de l’autre.



